Livret De L'exposition Sur L'évacuation De L
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Paris Apartment Is a Work of Fiction
READI NG GROUP GU I DE PhotosOfYou_TPTextFP Epilogue 2019-11-26 15:34:54 335 AUTHOR’S NOTE The Paris Apartment is a work of fiction. While a product of my imagination, the premises and characters I’ve chosen to create are inspired by real people and real events. The characters of Sophie Seymour and Estelle Allard were shaped by the experiences and courage of Virginia Hall, Pearl Witherington Cornioley, Christine Granville, Josephine Baker, Nancy Wake, and Andrée de Jongh. Their memoirs, interviews, and stories only give us an idea of how truly extraordinary each of these women was. Sophie’s work at Bletchley Park was based on the real men and women who worked tirelessly against time and almost im- possible odds to decode Nazi encryption devices. Most of us have heard of the Enigma cipher and the remarkable work by Alan Turing and his team to break that cipher. Told less often seems to be the story of Tommy Flowers and Bill Tutte, who, together with their teams, developed Colossus—the machine that was able to break the Lorenz cipher, known as Tunny at Bletchley. The Lorenz cipher was favoured by Hitler and used by High Command—and for good reason. It was a far more powerful than the Enigma and capable of exceedingly complex en- cryptions. Additionally, unlike the Enigma, it did not depend ParisApartment_TPtext1P Author’s Note 2020-10-01 21:13:57 395 396 AUTHOR’S NOTE on Morse code. Attached to a teleprinter, it automatically encrypted outgoing messages and decrypted incoming mes- sages, allowing longer messages to be transmitted with greater ease. -

Vom Österreichischen Gendarmerie-Offizier Zum Höheren SS- Und Polizeiführer Serbien, 1942-1944 August Meyszner: Stationen Einer Karriere
MARTIN MOLL Vom österreichischen Gendarmerie-Offizier zum Höheren SS- und Polizeiführer Serbien, 1942-1944 August Meyszner: Stationen einer Karriere Einleitung Seit den 1990er Jahren beschäftigt sich die sogenannte neuere Täterfor- schung mit jenen Männern (und wenigen Frauen), die als direkte oder indi- rekte Täter, mithin als Planer und/oder Ausführende in die nationalsozialis- tischen Mordaktionen gegen Juden, Slawen, Sinti und Roma sowie sonstige als rassische oder politische Gegner apostrophierte Gruppen involviert wa- ren.1 Gefragt wird hierbei nach den sozialen, generationellen, konfessio- nellen, bildungs- und herkunftsmäßigen sowie nicht zuletzt ideologischen Prägungen der Tätergruppen. Dabei fällt zugleich eine Konzentration des Forschungsinteresses auf die die eigentlichen Taten ausführenden Appara- te und deren Personal, insbesondere aus dem weit gespannten SS-Komplex, auf. Als Resultat dieser intensiven Forschungen sind zahlreiche Einzel- und Gruppenbiographien der wie auch immer definierten Täter erschienen, da- neben auch diverse Studien, die sich mit den situativen Rahmenbedingun- gen des Handelns der Täter vor Ort beschäftigen, meist im deutsch besetzten Ost- und Südosteuropa.2 Diese zuletzt intensiv betriebene Forschung hat bisher einen Mann aus dem engsten Kreis der Täter nicht einbezogen, der dies zweifellos verdient hätte, und sei es nur wegen seiner Funktion als Höherer SS- und Polizeifüh- rer (HSSPF) für das deutsch besetzte (Rumpf-) Serbien von Januar 1942 bis 1 Vgl. etwa, mit einleitenden methodischen Überlegungen, GERHARD PAUL (Hrsg.), Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche?, Göttingen 2002; HELGARD KRAMER (Hrsg.), NS-Täter aus interdisziplinärer Perspek- tive, München 2006; GEORGE C. BROWDER, Perpetrator Character and Motivation: An emerging Consensus?, in: Holocaust and Genocide Studies 17, 2003, S. -

Dossier Pédagogique De L'exposition
Exposition « Les Juifs de Corrèze dans la Shoah » Dossier pédagogique Sommaire Présentation de l’exposition et informations pratiques…..……………………………………………..3 Contenu de l’exposition………………………………………………………………………………………….………4 Les Juifs en Corrèze pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire méconnue……….5 Présentation du questionnaire pédagogique……………………………………………..…………………..7 Questionnaire pédagogique……………………………………………………………………………………………8 Lexique.………………………………………………………………………………………………………………………..13 Réponses.…………………………………………………………………………………………………………………….14 2 Présentation de l’exposition Reprenant et complétant l’exposition « Les Juifs de France dans la Shoah », réalisée en 2012 par l’ONAC et le Mémorial de la Shoah, cette nouvelle exposition apporte un éclairage inédit sur les persécutions qui ont frappé les Juifs en Corrèze entre 1940 et 1944. Plus de 2 000 Juifs se sont réfugiés en Corrèze pendant la Seconde Guerre mondiale. Victimes de la politique d'exclusion mise en œuvre par le régime de Vichy, et de sa collaboration avec l’Allemagne nazie, les Juifs ont subi, en Corrèze aussi, des rafles et des déportations massives. Celles-ci ont conduit plus de 500 d’entre eux, femmes, hommes et enfants, vers les camps d'extermination nazis. S’appuyant sur des travaux de recherche récents, l’exposition présente le sort des Juifs de Corrèze en le resituant dans le contexte des persécutions qui ont été commises, en France et en Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale. Présentée dans le cadre des commémorations du 70 e anniversaire de la Résistance, des débarquements, de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme, cette exposition a reçu le soutien de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives. Elle a vocation à être présentée à Paris, courant 2014, au sein d’une grande exposition sur l’histoire régionale de la Shoah. -

Allendale Allendale
1 AllendaleAllendale AllendaleAllendale Lifelong Learners Lifelong Learners Lifelong Learners Lifelong Learners Allendale Lifelong Learners 6676 Lake Michigan Drive PO Box 539 Allendale, MI 49401 www.allendale -twp.org/senior This newsletter is a service of the Allendale Charter Township Senior Citizens organization. If you know somebody who would benefit from the information included in this newsletter, please contact Kathy Hanes at 616 -843 -0572 or email khanes@allendale -twp.org 20 February 2020 They did —all 30 of them. Marceau’s exploits were just a few of the daring, and creative, feats What’s inside…? Page # pulled off by the French Resistance. The OCE was particularly in- genious: For example, while smuggling children over the border, A little bit of this and that... 444 one Resistance fighter realized that Nazis never searched sand- Rambling Thoughts... 666 wiches that had mayonnaise on them since the oily condiment might dirty their uniforms. As a result, they hid children’s ID cards - All Things Michigan... 888 in mayonnaise smeared sandwiches. And Loinger was able to get Jewish children over the Swiss border by throwing a ball and tell- Calendar of events... 101010 ing them to retrieve it. Born Marcel Mangel before the war, Marceau saved at least 70 What’s Happening... 121212 children. In addition to his border crossing feats, he also forged identity documents to make Jews look younger so Looking Ahead... 131313 they’d be allowed to flee Nazi deportation. After the war, he changed his name and soon skyrocketed to fame Diary of a Snow Shoveler... 141414 as the world’s most prominent pantomime artist. -

January 2021
ESTMINSTER Volume XII No.1 UARTERLY January 2021 A Jewish society wedding c.1892 Anglo-Jewish High Society The Philippines and the Holocaust The Children Smuggler ‘The Little Doctor’ From the Rabbi ‘Woe is me, perhaps because I have have identified; they suggest that, as the sinned, the world around me is being Festival itself marks increased darkness, darkened and returning to its state of let the candles reflect this reality too. chaos and confusion; this then is the Remove one each day, starting with the kind of death to which I have been eighth. The view of the School of Hillel sentenced from Heaven!’ So he began may also acknowledge that the world is keeping an eight-day fast. getting darker, but the ritual response is the opposite. When the world gets darker But as he observed the winter solstice we bring more light. and noted the day getting increasingly longer, he said, ‘This is the world’s So let us pay respect to both views. course’, and he set forth to keep an eight- Together we have the strength in our day festival. community to acknowledge the darkness in the world, and also to bring more light. (Adapted from the Babylonian Talmud, Many of us in the last year have stepped tractate Avodah Zara, page 8a.) up to contact and care for other members of our community, and we have benefited Together we have the from the resulting conversations and How do we respond to increased relations. We have found new creativity darkness? In Franz Kafka’s short story, strength in our to ensure our togetherness, building Before the Law, a man spends his whole community to special High Holy Days. -

ABSTRACT Title of Document: the FURTHEST
ABSTRACT Title of Document: THE FURTHEST WATCH OF THE REICH: NATIONAL SOCIALISM, ETHNIC GERMANS, AND THE OCCUPATION OF THE SERBIAN BANAT, 1941-1944 Mirna Zakic, Ph.D., 2011 Directed by: Professor Jeffrey Herf, Department of History This dissertation examines the Volksdeutsche (ethnic Germans) of the Serbian Banat (northeastern Serbia) during World War II, with a focus on their collaboration with the invading Germans from the Third Reich, and their participation in the occupation of their home region. It focuses on the occupation period (April 1941-October 1944) so as to illuminate three major themes: the mutual perceptions held by ethnic and Reich Germans and how these shaped policy; the motivation behind ethnic German collaboration; and the events which drew ethnic Germans ever deeper into complicity with the Third Reich. The Banat ethnic Germans profited from a fortuitous meeting of diplomatic, military, ideological and economic reasons, which prompted the Third Reich to occupy their home region in April 1941. They played a leading role in the administration and policing of the Serbian Banat until October 1944, when the Red Army invaded the Banat. The ethnic Germans collaborated with the Nazi regime in many ways: they accepted its worldview as their own, supplied it with food, administrative services and eventually soldiers. They acted as enforcers and executors of its policies, which benefited them as perceived racial and ideological kin to Reich Germans. These policies did so at the expense of the multiethnic Banat‟s other residents, especially Jews and Serbs. In this, the Third Reich replicated general policy guidelines already implemented inside Germany and elsewhere in German-occupied Europe. -

Canaux Et Véloroute D'alsace
CANAUX ET VÉLOROUTES D’ALSACE Wasserwege und Fernradwege im Elsass Waterways and Cycle routes in Alsace Waterwegen en Fietspaden in de Elzas www.rijnfi etsroute.eu www.velorouterhin.eu www.rhinecycleroute.eu | 184 km PFALZwww.rheinradweg.eu (D) 1.320 KM Le Rhin PALATINAT n PALATINATE ANDERMATT (CH) - ROTTERDAMh (NL) Der Rhein EUROVÉLO 15 : DaDah VELOROUTE RHIN Bad Bergzabern Der Rheinradweg 2 The Rhine The Rhine cycle route ttring WISSEMBOURG 27,8 km EUROVELO 15 1 De Rijn (Andermatt (CH) - Rotterdam (NL) Rotterdam (NL) 666 km Mainz (D) 232 km KARLSRUH Moselle LE RHIN en Lembach Der Rhein 1 The Rhine LAUTERBOURG DE Rijn PK Neuburgweier (D) 349 9,4 km Mothern 18,1 km ssel Woerth Munchhausen Lorentzen 46 Seltz LÉGENDE / Zeichenerklärung / Legend / Legenda PARC NATUREL 17 km RÉGIONAL 13 km DES VOSGES DU NORD Beinheim Roppenheim PK SACE BOSSUE 338 Roeschwoog 21,8 km Iffezheim (D) HAGUENAU Sessenheim Auenheim Neuhaeusel VOIES FLUVIALES ET CANAUX Stattmatten Flüsse und wasserwege / Rivers and waterways / Waterwegen en kanalen ALSACE Dalhunden Schwindratzheim 10,7 km Mutzenhouse Drusenheim Voies fl uviales et canaux Ports Bischwiller 11,5 km Wasserwegen und Kanäle Häfen / Ports / Havens Niederschaeffolsheim 9,1 km Bühl (D) Steinbourg Waterways and canals Waltenheim Herrlisheim Haltes 5 H Hochfelden Waterwegen en kanalen 87 2H sur Zorn Haltestellen / Stops / Aanlegplaatsen Offendorf Henridorff en cana SAVERNE 4,3 km Brumath Écluses nci l 4,8 km A liger Ka Capacité d’accueil ma na 5 km e er can l 8,2 km Schleusen / Locks / Sluizen h rm al 3 H 11 -

SAINTE-MARIE LYON SAINT-PAUL MADE in LA SOLITUDE LA VERPILLIÈRE 125 2 Som Mreai
SAINTE-MARIE LYON SAINT-PAUL MADE iN LA SOLITUDE LA VERPILLIÈRE 125 2 som mreai REFE RE REN FLEXI CE ONS 10 16 LA SEULE EDMOND MICHELET PATRIE RÉELLE OLIVIER HERBINET MICHEL FOUCAULT Juste parmi les Nations 13 24 UNE PAROLE QUI ÉLÈVE RELIRE LA PESTE MARC BOUCHACOURT BRUNO ROCHE Hommage à Philippe Jaccottet Une éthique du soin COL LEGE 44 54 CINÉ-CLUB TRAVAUX D’ÉLÈVES OUR DAILY BREAD TEXTES 48 DESSINS ÉCO-LOGIS ENTRAIDE VENDÉE GLOBE SCHUBERTIADE LES RE YEUX NOU FLEXI FERTI VEL ONS LES LES 30 78 82 SOLEIL DE SOROLLA LYON LA VERPILLIÈRE MICHEL LAVIALLE Quelques toiles en lumière 86 CARNET RÉEFÉDI RETNO RIALCE Récemment des parents s’étonnaient que nous utilisions définition, peut être au centre d’une communion universelle des peu les moyens modernes pour gagner du temps dans les saints sans ces prothèses communicantes. Un peintre imaginer apprentissages ou leur communiquer, « en temps réel », les ses toiles sans photothèque. Comment apprendre à se retrouver notes. L’efficacité technique est-elle une voie de progrès soi-même plutôt que de se laisser submerger par les flux de scolaire ou humain ? messages qui rendent esclaves, dispersés, futiles ? Sans avoir peur pour autant de ces machines à communiquer, l'école ne peut La peur de la panne, de la pénurie d’énergie paralyse nos augmenter « le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués, contemporains : nous sommes prêts à tout pour garder le dès leur enfance, à ne désirer que ce que les machines peuvent contact, « être au jus ». Les oreilles ficelées à un portable, les donner3». -
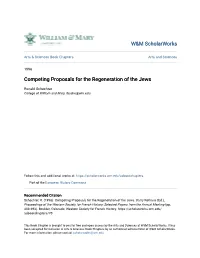
Competing Proposals for the Regeneration of the Jews
W&M ScholarWorks Arts & Sciences Book Chapters Arts and Sciences 1996 Competing Proposals for the Regeneration of the Jews Ronald Schechter College of William and Mary, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/asbookchapters Part of the European History Commons Recommended Citation Schechter, R. (1996). Competing Proposals for the Regeneration of the Jews. Barry Rothaus (Ed.), Proceedings of the Western Society for French History: Selected Papers from the Annual Meeting (pp. 483-493). Boulder, Colorado: Western Society for French History. https://scholarworks.wm.edu/ asbookchapters/70 This Book Chapter is brought to you for free and open access by the Arts and Sciences at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Arts & Sciences Book Chapters by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. Competing Proposals for the Regeneration of the Jews, 1787-1789 Ronald Schechter University of Heidelberg On 27 September 1791 the Constituent Assembly decreed that Jewish men who fulfilled the property requirements stipulated by the Constitution would be considered active citizens with political rights equal to those of non-Jews who had satisfied the same prerequisites.1 This piece of legislation, subse quently known as the "emancipation decree," was the product of many heated debates between deputies who believed that Jewishness was an obstacle to citi zenship and those who believed the contrary. Yet the story was more compli cated than this. The debates in the Assembly were the continuation of a decades old discussion about the feasibility of the "regeneration" of the Jews, to use the terminology of the time. -

Download PDF Catalogue
F i n e Ju d a i C a . pr i n t e d bo o K s , ma n u s C r i p t s , au t o g r a p h Le t t e r s , gr a p h i C & Ce r e m o n i a L ar t in cl u d i n g : th e Ca s s u t o Co ll e C t i o n o F ib e r i a n bo o K s , pa r t iii K e s t e n b a u m & Co m p a n y th u r s d a y , Ju n e 21s t , 2012 K e s t e n b a u m & Co m p a n y . Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art A Lot 261 Catalogue of F i n e Ju d a i C a . PRINTED BOOKS , MANUSCRI P TS , AUTOGRA P H LETTERS , GRA P HIC & CERE M ONIA L ART ——— To be Offered for Sale by Auction, Thursday, 21st June, 2012 at 3:00 pm precisely ——— Viewing Beforehand: Sunday, 17th June - 12:00 pm - 6:00 pm Monday, 18th June - 10:00 am - 6:00 pm Tuesday, 19th June - 10:00 am - 6:00 pm Wednesday, 20th June - 10:00 am - 6:00 pm No Viewing on the Day of Sale This Sale may be referred to as: “Galle” Sale Number Fifty Five Illustrated Catalogues: $38 (US) * $45 (Overseas) KestenbauM & CoMpAny Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art . -
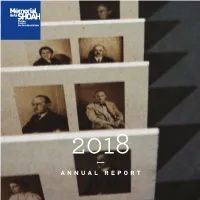
2018 Annual Report
2018_ Editorial The year 2018 was a rich, dense and hopeful one for the Memorial. Here are • Our educational activities have grown, some of the key highlights: now accounting for nearly 50% of our budget. For several years, the • Attendance rose by over 20%. More Memorial has been a key player in than 282,000 people visited the Paris raising awareness of anti-Semitism Memorial. If the Cercil (Study and and hatred of the other with the Research Centre on the Internment weapons we have at our disposal: Camps of the Loiret Region and the education and history. We do so Jewish Deportation) and our outside- across France, especially in sensitive the-walls activities are taken into areas. account, over 470,000 people visited or were in educational contact with Seventy-six years after its creation, the the Memorial. Memorial is still moving forward to keep pace with the needs of the society EDITORIAL • Three temporary exhibitions were in which it works, while remaining true Éric de Rothschild. highly successful: August Sander, to the mission set out by our founders. © DR. Beate and Serge Klarsfeld and Contemporary Artists and the None of that amazing work would Holocaust. have been possible without our staff, volunteers and donors, whom I thank • Closer ties were forged with the here with all my heart. Let us be Cercil-Vél’d’Hiv Children’s Museum- especially grateful to our great and Memorial, the creation of which dear friends who have the desire and in 1992 was initiated by Hélène courage to testify about the hell they Mouchard Zay, daughter of minister went through. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles the Tyranny of Tolerance
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles The Tyranny of Tolerance: France, Religion, and the Conquest of Algeria, 1830-1870 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Rachel Eva Schley 2015 © Copyright by Rachel Eva Schley 2015 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Tyranny of Tolerance: France, Religion, and the Conquest of Algeria, 1830-1870 by Rachel Eva Schley Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2015 Professor Caroline Cole Ford, Co-chair Professor Sarah Abrevaya Stein, Co-chair “The Tyranny of Tolerance” examines France’s brutal entry into North Africa and a foundational yet unexplored tenet of French colonial rule: religious tolerance. By selectively tolerating and thereby emphasizing confessional differences, this colonial strategy was fundamentally about reaffirming French authority. It did so by providing colonial leaders with a pliant, ethical and practical framework to both justify and veil the costs of a violent conquest and by eliding ethnic and regional divisions with simplistic categories of religious belonging. By claiming to protect mosques and synagogues and by lauding their purported respect for venerated figures, military leaders believed they would win the strategic support of local communities—and therefore secure the fate of France on African soil. Scholars have long focused on the latter period of French Empire, offering metropole-centric narratives of imperial development. Those who have ii studied the early conquest have done so only through a singular or, to a lesser extent, comparative lens. French colonial governance did not advance according to the dictates of Paris or by military directive in Algiers.