LISTE DES FONDS Archives Privées
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Effectiveness of Canada's Navy on Escort Duty
Munich Personal RePEc Archive The Effectiveness of Canada’s Navy on Escort Duty Skogstad, Karl Lakehead University 16 January 2015 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61467/ MPRA Paper No. 61467, posted 20 Jan 2015 09:32 UTC The Effectiveness of Canada’s Navy on Escort Duty Karl Skogstad1 January 2015 Abstract This paper examines the potential costs a country faces when it fails to develop domestic arms manufacturing. I examine these costs using the historical example of Canada’s decision to not develop domestic naval shipbuilding capacity prior to World War II. Canada’s primary naval responsibility during the war was to escort convoys be- tween the United Kingdom and North America. However its lack of advanced domestic shipbuilding capacity and congestion at Allied shipyards, meant that Canada could not obtain the relatively advanced destroyer class vessels necessary for convoy duty. Instead it had to rely on less advanced corvette class vessels, which were simple enough to be manufactured domestically. Using a unique data set, created for this project, I match convoy movements to German U-boat locations in order to examine the escort compo- sition and the number of merchant ships lost when an engagement occurred. Using this data I find that destroyers were 2.14 more effective than corvettes at preventing the loss of a merchant ship. Then, by constructing a counterfactual scenario, I find that developing a domestic ship building industry in Canada would have netted the Allies a benefit of 28.7 million 1940 Canadian dollars. JEL classification: N42, F51, F52, H56, H57 Keywords: Canadian Navy, World War II, Convoys, Domestic Arms industries. -

Report of the National Assembly of Québec 2011 2012
activity report of the National Assembly of Québec 2011 2012 national assembly oF Québec Parliament building Québec (Québec) G1a 1a3 assnat.qc.ca [email protected] 1 866 DéPUTÉS assnat.qc.ca Front cover: The bell tower rises above the coats of arms sculpted in high relief on the facade of the Parliament Building. Photo: Christian Chevalier, National Assembly Collection activity report of the National Assembly of Québec 2011 2012 assnat.qc.ca This publication was prepared in collaboration with the senior management and the personnel of all the administrative units of the National Assembly. Unless otherwise specified, the information in this activity report covers the National Assembly’s activities from 1 April 2011 to 31 March 2012. Supervision Jean Dumas Coordination and Editing Laurie Comtois Drafting Committee Louisette Cameron Catherine Durepos Mario Gagnon Lucie Laliberté Suzanne Langevin Revision Éliane de Nicolini Translation Sylvia Ford Indexing Rénald Buteau Graphic Design Manon Paré Page Layout Catherine Houle Photography National Assembly Collection Clément Allard, photographer Christian Chevalier, photographer Marc-André Grenier, photographer Renaud Philippe, photographer Roch Théroux, photographer With the participation of: French National Assembly (p. 65) Parliamentary Assembly of the Francophonie (p. 54) Debates Broadcasting and Publishing Directorate (p. 43, 44, 47) Education in Parliamentary Democracy Directorate (p. 84, 89) Guy Rainville, photographer (p. 52) Maynor Solís Calderón, photographer (p. 59) Organisation -

River-Class Frigates Background
River-class frigates background The River-class frigate was designed by William Reed of Smith's Dock Company of South Bank-on-Tees. Originally called a "twin-screw corvette", its purpose was to improve on the convoy escort classes in service with the Royal Navy at the time, including the Flower-class corvette. The first orders were placed by the Royal Navy in 1940 and the vessels were named for rivers in the United Kingdom, giving name to the class. In Canada they were named for towns and cities though they kept the same designation. The name "frigate" was suggested by Vice-Admiral Percy Nelles of the Royal Canadian Navy and was adopted later that year. Improvements over the corvette design included improved accommodation which was markedly better. The twin engines gave only three more knots of speed but extended the range of the ship to nearly double that of a corvette at 7,200 nautical miles (13,300 km) at 12 knots. Among other lessons applied to the design was an armament package better designed to combat U-boats including a twin 4-inch mount forward and 12-pounder aft. 15 Canadian frigates were initially fitted with a single 4-inch gun forward but with the exception of the HMCS Valleyfield , they were all eventually upgraded to the double mount. For underwater targets, the River-class frigate was equipped with a Hedgehog anti-submarine mortar and depth charge rails aft and four side-mounted throwers. River-class frigates were the first Royal Canadian Navy warships to carry the 147B Sword horizontal fan echo sonar transmitter in addition to the irregular ASDIC. -

National Shipbuilding Procurement Strategy Puts Canadians at Risk
Canadian Centre for Policy Alternatives December 2013 Blank Cheque National Shipbuilding Procurement Strategy Puts Canadians at Risk Michael Byers and Stewart Webb www.policyalternatives.ca RESEARCH ANALYSIS SOLUTIONS About the Authors Michael Byers holds the Canada Research Chair in Global Politics and International Law at the Uni- versity of British Columbia. Stewart Webb is a Research Associate of the Cana- dian Centre for Policy Alternatives and a Visiting Research Fellow with the Rideau Institute. AbbreviAtions A/OPS Arctic/Offshore Patrol Ship ISBN 978-1-77125-097-9 BIW Bath Iron Works This report is available free of charge at www. CCG Canadian Coast Guard policyalternatives.ca. Printed copies may be or- CPF Canadian Patrol Frigate dered through the CCPA National Office for $10. CRS Chief Review Services PleAse mAke A donAtion... CSC Canadian Surface Combatant Help us to continue to offer our publications free online. DND Department of National Defence With your support we can continue to produce high FELEX Frigate Life Extension quality research — and make sure it gets into the hands GCS Global Combat Ship of citizens, journalists, policy makers and progres- IMC International Marine Consultants Ltd. sive organizations. Visit www.policyalternatives.ca or call 613-563-1341 for more information. IRB Industrial Regional Benefits The opinions and recommendations in this report, JSS Joint Support Ship and any errors, are those of the authors, and do not MWC Marine Warfare Centre necessarily reflect the views of the publishers or funders -

The Battle of the Gulf of St. Lawrence
Remembrance Series The Battle of the Gulf of St. Lawrence Photographs courtesy of Library and Archives Canada (LAC) and the Department of National Defence (DND). © Her Majesty the Queen in Right of Canada represented by the Minister of Veterans Affairs, 2005. Cat. No. V32-84/2005 ISBN 0-662-69036-2 Printed in Canada The Battle of the Gulf of St. Lawrence Generations of Canadians have served our country and the world during times of war, military conflict and peace. Through their courage and sacrifice, these men and women have helped to ensure that we live in freedom and peace, while also fostering freedom and peace around the world. The Canada Remembers Program promotes a greater understanding of these Canadians’ efforts and honours the sacrifices and achievements of those who have served and those who supported our country on the home front. The program engages Canadians through the following elements: national and international ceremonies and events including Veterans’ Week activities, youth learning opportunities, educational and public information materials (including on-line learning), the maintenance of international and national Government of Canada memorials and cemeteries (including 13 First World War battlefield memorials in France and Belgium), and the provision of funeral and burial services. Canada’s involvement in the First and Second World Wars, the Korean War, and Canada’s efforts during military operations and peace efforts has always been fuelled by a commitment to protect the rights of others and to foster peace and freedom. Many Canadians have died for these beliefs, and many others have dedicated their lives to these pursuits. -

Reduced Crewing: Design Considerations THEME 1: BUILDING HUMAN CAPITAL Bernd Kulmus
H u m a n C a p i t a l a n d t h e N S P S M S Centre for Foreign Policy Studies P Dalhousie University O 6299 South Street PO Box 15000 N o Halifax, NS B3H 4R2 . 1 8 Centre for Foreign Policy Studies 902.494.3769 [email protected] Dalhousie University Maritime Security Occasional Paper No. 18 National Shipbuilding Procurement Strategy: Human Capital and the NSPS Proceedings of the Maritime Security Program Workshop Dalhousie University 14 November 2014 Edited by Ian Wood Prepared by Tim Dunne © Copyright 2015, Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University. A Workforce Plan Brian McCarthy . 63 Table of Contents THEME 2: NEW TRENDS IN MARITIME CREWING Decision Support for RCN Crewing Renée Chow . 68 LIST OF ACRONYMS . iii A Practitioner’s View INTRODUCTION . 1 Lieutenant-Commander Ramona Burke . 72 EXECUTIVE SUMMARY . 3 Reduced Crewing: Design Considerations THEME 1: BUILDING HUMAN CAPITAL Bernd Kulmus . 78 Education and Training Programs An Overview of Select Technical Capabilities Exploring New Trends in the Crewing of and Activities Modern Warships Ronald Pelot . 22 Nelly Chouvy . 81 Transforming the Labour Force to Meet the Demands THEME 3: SUSTAINING HUMAN CAPITAL: THE LONG VIEW of an Emerging Shipbuilding Industry Rosaline Penfound . 29 A Strong Workforce Vice-Admiral (Ret’d) Peter Cairns . 89 Nova Scotia Provincial Programs and Perspectives Building Human Capital: Skills Development Shipbuilding Research: A Systems Approach John Somers . 37 Ken Hansen . 91 Human Capital WORKSHOP PROGRAM . 99 Duff Montgomerie . 46 ABOUT THE PRESENTERS AND CHAIRS . 101 TABLE OF CONTENTS FOR RECENT ISSUES Industry Perspectives OF CANADIAN NAVAL REVIEW . -

Bulletin De L'amicale Des Anciens Parlementaires Du Québec
VOLUME 15, NUMÉRO 2, DÉCEMBRE 2014 BULLETIN D E L’A M I C A L E Marcel Masse, 1936-2014 L’assemblée générale du 14 mai 2014 Les 20 ans de l’Amicale TABLE DES MATIÈRES EN COUVERTURE 3 Mot du rédacteur 4 Conseil d’administration Marcel Masse est né à Saint-Jean-de-Matha, le 27 mai 1936. Compléta à Joliette ses études 5 Rapport de la présidente Carole Théberge primaires et secondaires, puis à Montréal à l’École normale Jacques-Cartier où il obtint un diplôme 9 Rapport du Comité sur le parlementarisme en pédagogie. Étudia en histoire à l’Université et la démocratie de Montréal, en science politique à l’Institut des sciences politiques de Paris, en civilisation 10 Rapport du Comité des archives et objets française à la Sorbonne, en histoire politique et de mémoire économique au Commonwealth au City of London 11 Rapport du Comité des communications College et, en 1978, en marketing international à l’Institut européen d’administration des affaires, à 12 Prix de l’Amicale Fontainebleau. 20 Prix du 20e anniversaire Professeur d’histoire à la Commission scolaire régionale Lanaudière à Joliette de 1962 à 1966. Président de la Fédération des 21 Mot du premier ministre instituteurs et institutrices du diocèse de Joliette de 1963 à 1965. Président de l’Association des enseignants de Lanaudière de 1964 à 1966. 22 Le parlementarisme à l’heure des défis du 21e siècle Coordonnateur du programme de l’Union nationale et élu député de ce parti dans Montcalm en 1966. Réélu en 1970. Ministre d’État à l’Éducation dans le cabinet 28 Signature d’une entente Johnson 1966 et 1967. -

Hon. J.W. Pickersgill MG 32, B 34
Manuscript Division des Division manuscrits Hon. J.W. Pickersgill MG 32, B 34 Finding Aid No. 1627 / Instrument de recherche no 1627 Prepared in 1991 by Geoff Ott and revised in Archives Section 2001 by Muguette Brady of the Political -ii- Préparé en 1991 par Geoff Ott et révisé en 2001 par Muguette Brady de la Section des Archives politiques TABLE OF CONTENTS PAGE PRE-PARLIAMENTARY SERIES ............................................... 1 SECRETARY OF STATE SERIES, 1953-1954 ..................................... 3 CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERIES ..................................... 4 Outgoing Correspondence - Sub-Series ........................................ 4 Citizenship - Sub-Series .................................................... 5 Estimates - Sub-Series .................................................... 28 National Gallery - Sub-Series .............................................. 32 National Film Board - Sub-Series ........................................... 37 Indian Affairs Branch - Sub-Series - Indian Act ................................. 44 Indian Affairs Branch - Sub-Series - General ................................... 46 Immigration - Sub-Series .................................................. 76 Immigration Newfoundland - Sub-Series ..................................... 256 Immigration - Miscellaneous - Sub-Series .................................... 260 Public Archives of Canada - Sub-Series ...................................... 260 National Library of Canada - Sub-Series .................................... -

The Readiness of Canada's Naval Forces Report of the Standing
The Readiness of Canada's Naval Forces Report of the Standing Committee on National Defence Stephen Fuhr Chair June 2017 42nd PARLIAMENT, 1st SESSION Published under the authority of the Speaker of the House of Commons SPEAKER’S PERMISSION Reproduction of the proceedings of the House of Commons and its Committees, in whole or in part and in any medium, is hereby permitted provided that the reproduction is accurate and is not presented as official. This permission does not extend to reproduction, distribution or use for commercial purpose of financial gain. Reproduction or use outside this permission or without authorization may be treated as copyright infringement in accordance with the Copyright Act. Authorization may be obtained on written application to the Office of the Speaker of the House of Commons. Reproduction in accordance with this permission does not constitute publication under the authority of the House of Commons. The absolute privilege that applies to the proceedings of the House of Commons does not extend to these permitted reproductions. Where a reproduction includes briefs to a Standing Committee of the House of Commons, authorization for reproduction may be required from the authors in accordance with the Copyright Act. Nothing in this permission abrogates or derogates from the privileges, powers, immunities and rights of the House of Commons and its Committees. For greater certainty, this permission does not affect the prohibition against impeaching or questioning the proceedings of the House of Commons in courts or otherwise. The House of Commons retains the right and privilege to find users in contempt of Parliament if a reproduction or use is not in accordance with this permission. -

National Shipbuilding Procurement Strategy: Charting the Course
Cover photo: A Canadian submarine manoeuvring in the vicinity of the Halifax Naval Dockyard. Photo courtesy of Department of National Defence National Shipbuilding Procurement Strategy: Charting the Course Maritime Security Occasional Paper No. 17 Edited by Ian Wood Prepared by Tim Dunne © Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, 2014. PART THREE: THE CANADIAN SURFACE COMBATANT Table of Contents What the NSPS has Delivered Ian Parker . 37 The CSC Statement of Requirements: Pushing the Envelope LIST OF ACRONYMS . i Eric Lerhe . 47 INTRODUCTION . 1 Value Propositions and NSPS: A Canadian EXECUTIVE SUMMARY . 3 Success Story? SUMMARIES OF PANEL PRESENTATIONS . 13 Kevin Arthurs, Lockheed Martin Canada . 53 PART ONE: SPECIAL PRESENTATIONS Canada’s NSPS Successes and Transitioning Joint Support Ship to CSC Challenges Brian Lavigne . 15 Jerry McLean, Thales . 58 Arctic Offshore Patrol Ship Improving Economic Outcomes: Value Lieutenant-Commander Jamie Sangster . 17 Proposition Considerations Scientific/Research Implications of Rich Billard, MDA Corporation . 61 the AOPS Jim Hanlon . 18 CONCLUDING REMARKS . 63 WORKSHOP PROGRAMME OF EVENTS . 65 PART TWO: NSPS: CURRENT PROGRESS AND ABOUT THE PRESENTERS AND CHAIRS . 67 POTENTIAL FUTURE CHALLENGES CANADIAN NAVAL REVIEW LATEST ISSUES . 75 Budget 2014, the CFDS Reset and the Impact on the NSPS David Perry . 20 Key Industrial Capabilities and the NSPS: Sailing toward Global Leadership Yan Cimon . 22 Independent Cost Estimating at the Parliamentary Budget Office Erin -
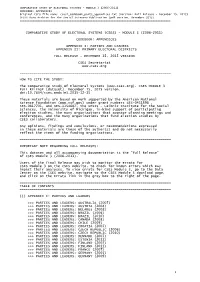
Comparative Study of Electoral Systems Module 3
COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS - MODULE 3 (2006-2011) CODEBOOK: APPENDICES Original CSES file name: cses2_codebook_part3_appendices.txt (Version: Full Release - December 15, 2015) GESIS Data Archive for the Social Sciences Publication (pdf-version, December 2015) ============================================================================================= COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS (CSES) - MODULE 3 (2006-2011) CODEBOOK: APPENDICES APPENDIX I: PARTIES AND LEADERS APPENDIX II: PRIMARY ELECTORAL DISTRICTS FULL RELEASE - DECEMBER 15, 2015 VERSION CSES Secretariat www.cses.org =========================================================================== HOW TO CITE THE STUDY: The Comparative Study of Electoral Systems (www.cses.org). CSES MODULE 3 FULL RELEASE [dataset]. December 15, 2015 version. doi:10.7804/cses.module3.2015-12-15 These materials are based on work supported by the American National Science Foundation (www.nsf.gov) under grant numbers SES-0451598 , SES-0817701, and SES-1154687, the GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, the University of Michigan, in-kind support of participating election studies, the many organizations that sponsor planning meetings and conferences, and the many organizations that fund election studies by CSES collaborators. Any opinions, findings and conclusions, or recommendations expressed in these materials are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the funding organizations. =========================================================================== IMPORTANT NOTE REGARDING FULL RELEASES: This dataset and all accompanying documentation is the "Full Release" of CSES Module 3 (2006-2011). Users of the Final Release may wish to monitor the errata for CSES Module 3 on the CSES website, to check for known errors which may impact their analyses. To view errata for CSES Module 3, go to the Data Center on the CSES website, navigate to the CSES Module 3 download page, and click on the Errata link in the gray box to the right of the page. -

Feuilleton Et Préavis
FIRST SESSION FORTY-FIRST LEGISLATURE Order Paper and Notices of the Assembly Wednesday, 28 March 2018 — No. 322 Nine forty a.m. President of the National Assembly: Mr. Jacques Chagnon QUÉBEC Part 1 ROUTINE PROCEEDINGS STATEMENTS BY MEMBERS − The Member for Trois-Rivières on the following subject: Underline the opening of the Salon de l'emploi de Trois-Rivières. − The Member for Rimouski on the following subject: Tribute to Jean Brisson. − The Member for Laval-des-Rapides on the following subject: Textil'Art, dual mission, twice the impact. − The Member for Johnson on the following subject: Tribute to Ms. Danielle Bédard. − The Member for Argenteuil on the following subject: Honourable mention to an Argenteuil athlete and participant in the PyeongChang 2018 Olympic Games. − The Member for Beauharnois on the following subject: Tribute to Mélodie Daoust. − The Member for Hull on the following subject: The Soupe populaire's young fairies, Mathilde and Frédérique. − The Member for Huntingdon on the following subject: Huntingdon's Promutuel intermunicipal skating rink, a Kraft Hockeyville contest finalist. − The Member for Pontiac on the following subject: Underline the 40th anniversary of the SAAQ insurance plan. − The Member for Saint-Jérôme on the following subject: The 100th anniversary of the Saint-Jérôme Knights of Columbus. STATEMENTS BY MINISTERS INTRODUCTION OF BILLS 1 PRESENTING (a) Papers (b) Reports from committees (c) Petitions ORAL ANSWERS TO PETITIONS COMPLAINTS OF BREACH OF PRIVILEGE OR CONTEMPT AND PERSONAL EXPLANATIONS ORAL QUESTIONS AND ANSWERS DEFERRED DIVISIONS Amendments proposed by the Minister of Transport, Sustainable Mobility and Transport Electrification and the Member for Berthier to the report from the Committee on Transportation and the Environment on Bill 165, An Act to amend the Highway Safety Code and other provisions (handed in under Standing Order 252).