Le Monde Et La Révolution Libyenne En 2011 Mohamed Ahmed
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journal Du Qatar Dossier N° 1 Du 25.12.11
PALESTINE – SOLIDARITÉ http://www.palestine-solidarite.org Journal du Qatar Dossier N° 1 du 25.12.11 Par C.De Broeder & M.Lemaire a) Le "Journal d'Iran " est visible sur les blogs : http://journaldeguerre.blogs.dhnet.be/ http://journauxdeguerre.blogs.lalibre.be/ b) sur le site de Eva Resis : no-war.over-blog.com c) sur le site de Robert Bibeau : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html d) Et sur le site Palestine Solidarité : NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : [email protected] Sommaire. Tiré à part Badis Guettaf : Libye : la «victoire occidentale» du Qatar. Sami Kleib : La vérité sur les visées inquiétantes du Qatar et des puissances occidentales. 1 Médias & Manipulation de l’opinion / Vidéos 1-1 H. Z : Al-Jazeera n’est pas une voix indépendante de l’Amérique ! 2 Les dosser & point de vue 2-1 Mounir Abi : Les manœuvres du Qatar en Algérie. 3 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage. 3-1 France: un fonds qatari de 50 millions d’euros pour les entrepreneurs de banlieue… 3-2 Parti Anti Sioniste : Le Qatar lorgne sur les banlieues françaises... Pourquoi ? 4 Analyse - Géopolitique et stratégie – Réflexion 4-1 Fatma Benmosbah : Les pérégrinations Qataries en Afrique du Nord. 5 Annexe 5-1 Rappel : Arnaud Castaignet : Libye: après l'OTAN le Qatar. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tiré à part Badis Guettaf : Libye : la «victoire occidentale» du Qatar. Si l’on en croit les médias, (car quand il ne s’agit pas de faire la guerre il leur arrive de donner de l’information), le Qatar ferait cavalier seul en Libye. -
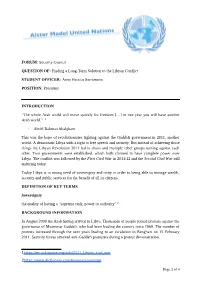
FORUM: Security Council QUESTION OF: Finding a Long-Term Solution
FORUM: Security Council QUESTION OF: Finding a Long-Term Solution to the Libyan Conflict STUDENT OFFICER: Anna Hatzius Sarramona POSITION: President INTRODUCTION “The whole Arab world will move quickly for freedom […] in one year you will have another Arab world.” 1 - Abdel Rahman Shalgham This was the hope of revolutionaries fighting against the Gaddafi government in 2011, another world. A democratic Libya with a right to free speech and security. But instead of achieving those things the Libyan Revolution 2011 led to chaos and multiple rebel groups turning against each other. Two governments were established, which both claimed to have complete power over Libya. The conflict was followed by the First Civil War in 2011/12 and the Second Civil War still enduring today. Today Libya is in strong need of sovereignty and unity in order to being able to manage wealth, security and public services for the benefit of all its citizens. DEFINITION OF KEY TERMS Sovereignty the quality of having a “supreme rank, power or authority” 2 BACKGROUND INFORMATION In August 2009 the Arab Spring arrived in Libya. Thousands of people joined protests against the governance of Muammar Gaddafi, who had been leading the country since 1969. The number of protests increased through the next years leading to an escalation in Benghazi on 15 February 2011. Security forces attacked anti-Gaddafi protesters during a protest demonstration. 1 https://en.wikiquote.org/wiki/2011_Libyan_civil_war 2 https://www.dictionary.com/browse/sovereign Page 1 of 4 AMUN 2019 – Research Report for the Security Council This event led to a UN resolution on “freezing the assets of Gaddafi and his inner circle” 3 and shortly afterwards to an intervention of NATO into the conflict. -

Amateur Computerist Newsletter
The Amateur Computerist Webpage: http://www.ais.org/~jrh/acn/ Winter 2012 Libya, The UN, and Netizen Journalism Volume 21 No. 1 Table of Contents by the UN in making possible the aggression against Libya. The actions taken by the Security Council and Introduction.. Page 1 other United Nations bodies like the Human Rights Int’l Media: 16th Member of the Security Council. Page 2 Council were contrary to the obligations of the UN Security Council Libya Mtg: Smoke and Mirrors. Page 5 charter and other principles of international law. The UN SC on Libya: Killing the International Law. Page 11 articles in this issue document the process by which Abuse of UN Processes by Security Council. Page 12 the UN became an accomplice in a NATO war against U.S. Uses UN to Bypass Congress to Go to War.Page 21 a sovereign nation that is a member of the United Journalism as a Weapon of War in Libya . Page 22 Nations. Open Letter From Concerned Africans on Libya.Page 23 These articles serve to argue that starting in What Does Gaddafi’s Fall Mean For Africa?. Page 26 February 2011 there was a media blitz supporting the ALBA Declaration on Libya and Syria. Page 27 NATO actions, largely based on unverifiable claims UNGA Debates NATO Attack on Libya. Page 29 by the opposition against the government of Libya. Lies of the Mainstream Media: TeleSUR. Page 30 The story that emerged is based on broadly circulated Munich to Tripoli: Aiding Aggression.. Page 32 falsifications of what was happening on the ground. -

LIBYA CONFLICT: SITUATION UPDATE March 2011
Opposition Movements and Statements LIBYA CONFLICT: SITUATION UPDATE March 2011 MARCH 31: Two Obama administration officials have reported that the U.S. is unlikely to provide arms to opposition forces. Secretary of Defense Robert Gates and Secretary of State Hillary Clinton have both stated their caution on issuing weapons, due to a lack of information on the dynamics and make-up of the rebel forces. Secretary Gates has suggested that, “the United States should stick to offering communications, surveillance and other support, but suggested that the administration had no problem with other countries sending weapons to help the rebels.” Secretary Gates additionally told members of the House Armed Services Committee that, “What the opposition needs as much as anything right now is some training, some command and control, and some organization.” (New York Times) MARCH 31: Rebels have begun deploying fishing boats to carry medicine and supplies from Benghazi to Misrata in the west. (LA Times) MARCH 31: The LA Times reports that the rebel effort has begun to fray due to ineffective leadership, a lack of weaponry, decreased morale, and the continued ambush by pro-Qaddafi forces. Some rebels have retreated over 200 miles to Benghazi to regroup, while others have remained at points outside of Ajdabiya. (LA Times) MARCH 30: A statement on counter-terrorism has been published to the Transitional National Council website, affirming the rebels,’ “commitment to the moderate Islamic values, its full rejection to the extremist ideas and its commitment -

Alternatif Politika Is Devoted to the Arab Revolts of 2011 –The Series of Dynamic Social and Political Developments Not Seen in the Arab World for Over Fifty Years
alternatif politika Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011 Misafir Editör: Prof. Bogdan SZAJKOWSKİ Timeline of the Arab Revolt: December 2010-June 2011 Bogdan SZAJKOWSKİ Social Media Tools and the Arab Revolts Bogdan SZAJKOWSKİ The Social Opposition Movement in Syria: The Assad Regime in the Context of Reform and Revolution Veysel AYHAN European Union’s Ineffective Middle East Policy Revealed after Revolution in Tunisia Bahar Turhan HURMİ Libyan Uprising And International Intervention: NATO’s Mission and Libya’s Gridlock Veysel AYHAN Arab Spring and Israeli Security: The New Threats Dünya BAŞOL Background of the Tunisian Revolution Nebahat TANRIVERDİ alternatif politika Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011 Introduction- Bogdan SZAJKOWSKİ, i-ii. Timeline of the Arab Revolt: December 2010 – June 2011- Bogdan SZAJKOWSKİ, 256-419. Social Media Tools and the Arab Revolts-Bogdan SZAJKOWSKİ, 420-432. The Social Opposition Movement in Syria: The Assad Regime in the Context of Reform and Revolution-Veysel AYHAN, 433- 454. European Union’s Ineffective Middle East Policy Revealed after Revolution in Tunisia-Bahar Turhan HURMİ, 455-489. Libyan Uprising And International Intervention: NATO’s Mission and Libya’s Gridlock-Veysel AYHAN, 490-508. Arab Spring and Israeli Security: The New Threats-Dünya BAŞOL, 509-546. Background of the Tunisian Revolution-Nebahat TANRIVERDİ, 547-570. INTRODUCTION Guest Editor: Prof. Bogdan Szajkowski This special issue of Alternatif Politika is devoted to the Arab revolts of 2011 –the series of dynamic social and political developments not seen in the Arab world for over fifty years. Throughout 2011 the Middle East, the Gulf region, Arab Peninsula and North Africa have witnessed social and political turmoil that has fundamentally impacted not only on these regions but also on the rest of the world. -

Popular Protests in North Africa and the Middle East (V): Making Sense
POPULAR PROTEST IN NORTH AFRICA AND THE MIDDLE EAST (V): MAKING SENSE OF LIBYA Middle East/North Africa Report N°107 – 6 June 2011 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................................... i I. INTRODUCTION: THE UPRISING .............................................................................. 1 II. THE NATURE OF QADDAFI’S REGIME ................................................................... 6 A. THE EARLY YEARS ...................................................................................................................... 6 B. THE JAMAHIRIYA AND THE ROLE OF IDEOLOGY ........................................................................... 7 C. THE FORMAL POLITICAL SYSTEM ................................................................................................ 8 D. INFORMAL POWER NETWORKS................................................................................................... 10 1. The Men of the Tent .................................................................................................................. 10 2. The Revolutionary Committees Movement ............................................................................... 10 3. Tribes and “Social People’s Leaderships” ................................................................................. 11 E. QADDAFI’S FAMILY ................................................................................................................... 12 F. THE ROLE OF PATRONAGE -
Making Sense of Libya
POPULAR PROTEST IN NORTH AFRICA AND THE MIDDLE EAST (V): MAKING SENSE OF LIBYA Middle East/North Africa Report N°107 – 6 June 2011 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................................... i I. INTRODUCTION: THE UPRISING .............................................................................. 1 II. THE NATURE OF QADDAFI’S REGIME ................................................................... 6 A. THE EARLY YEARS ...................................................................................................................... 6 B. THE JAMAHIRIYA AND THE ROLE OF IDEOLOGY ........................................................................... 7 C. THE FORMAL POLITICAL SYSTEM ................................................................................................ 8 D. INFORMAL POWER NETWORKS................................................................................................... 10 1. The Men of the Tent .................................................................................................................. 10 2. The Revolutionary Committees Movement ............................................................................... 10 3. Tribes and “Social People’s Leaderships” ................................................................................. 11 E. QADDAFI’S FAMILY ................................................................................................................... 12 F. THE ROLE OF PATRONAGE -

Continuity and Change in the Soviet and Russian Foreign Policies in the Middle East: the Cases of Egypt and Libya (1943-2017)
T.C. SAKARYA UNIVERSITY MIDDLE EAST INSTITUTE CONTINUITY AND CHANGE IN THE SOVIET AND RUSSIAN FOREIGN POLICIES IN THE MIDDLE EAST: THE CASES OF EGYPT AND LIBYA (1943-2017) MASTER’S THESIS Kulpunai BARAKANOVA Department: Middle Eastern Studies Thesis Advisor: Assist. Prof. Dr. Ismail Numan TELCI OCTOBER-2018 ACKNOWLEDGEMENTS First of all, I am deeply grateful to Allah for the opportunity to start and successfully complete my Master’s Degree in Sakarya University. Secondly, I would like to give a heartfelt thanks to my scholarship program TUBITAK which greatly facilitated my thesis writing and my whole study process in Turkey. Also, I want to express my highest gratitude to my supervisor, Assistant Professor Dr. Ismail Numan Telci, for his substantial help in choosing the thesis theme and his assistance throughout the thesis writing process. Finally, I give my eternal thanks to my parents, my husband, Gulnara Nazarbekova and to all the sincere people who helped, supported, and motivated me in difficult moments. Kulpunai BARAKANOVA 11.10.2018 ii TABLE OF CONTENTS DECLARATION……………………………………………………………………......i ACKNOWLEDGEMENTS……………………………………………………………ii LIST OF ABBREVIATIONS…………………………………………………………v LIST OF TABLES…………………………………………………………………......vi INTRODUCTION……………………………………………………………………...1 CHAPTER 1: A HISTORICAL BACKGROUND OF RUSSIAN FOREIGN POLICY TOWARDS EGYPT AND LIBYA (1943-1990)………………………….11 1.1. The Soviet Union’s Foreign Policy Doctrines and the Middle East (1943- 1991)……………………………………………………………………………………11 1.2. The Soviet Union’s Foreign Policy towards Egypt………………………………..14 1.3. The Soviet Union’s Foreign Policy towards Libya………………………………..26 CHAPTER 2: THE RUSSIAN FEDERATION’S FOREIGN POLICY TOWARDS EGYPT AND LIBYA (1991-2010)…………………………………………………...37 2.1. The Russian Federation’s Foreign Policy Doctrines and the Middle East (1993, 2000 and 2008)…………………………………………………………………………37 2.2. -
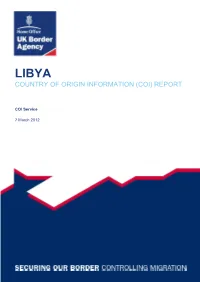
Libya Country of Origin Information (Coi) Report
LIBYA COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION (COI) REPORT COI Service 7 March 2012 LIBYA 7 MARCH 2012 Contents Preface Latest News EVENTS IN LIBYA FROM 15 FEBRUARY 2012 TO 5 MARCH 2012 REPORTS ON LIBYA PUBLISHED BETWEEN 15 FEBRUARY 2012 AND 5 MARCH 2012 Useful news sources for further information Paragraphs Background Information 1. GEOGRAPHY ............................................................................................................ 1.01 Map ........................................................................................................................ 1.07 Geographic and tribal issues .............................................................................. 1.10 The east ................................................................................................................. 1.12 Islamism ............................................................................................................. 1.12 State policy (under Gaddafi) towards the east ................................................... 1.13 Transport ............................................................................................................... 1.14 Roads ................................................................................................................. 1.14 Railways ............................................................................................................. 1.15 International and internal airports and flight routes ............................................ 1.16 Sea ports ........................................................................................................... -

CONTENTIOUS POLITICS in LIBYA: a STUDY of the INITIAL PERIOD of the 2011 LIBYAN UPRISING By
CONTENTIOUS POLITICS IN LIBYA: A STUDY OF THE INITIAL PERIOD OF THE 2011 LIBYAN UPRISING by Francis Talbot A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of George Mason University in Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of Master of Science Conflict Analysis and Resolution Master of Arts Conflict Resolution and Mediterranean Security Committee: ___________________________________________ Chair of Committee ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Graduate Program Director ___________________________________________ Dean, School for Conflict Analysis and Resolution Date: _____________________________________ Fall Semester 2016 George Mason University Fairfax, VA University of Malta Valletta, Malta Contentious Politics in Libya: A Study of the Initial Period of the 2011 Libyan Uprising A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science at George Mason University, and the degree of Master of Arts at the University of Malta by Francis Talbot Bachelor of Arts University of South Carolina, 2001 Director: Derek Lutterbeck, Swiss Chair and Lecturer in International History Mediterranean Academy of Diplomatic Studies Fall Semester 2016 George Mason University Fairfax, Virginia University of Malta Valletta, Malta Copyright 2016 Francis Talbot All Rights Reserved ii DEDICATION In memory of my father, Francis F. Talbot, and all that he taught me. iii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank the many friends, relatives, and supporters who have made this happen. I appreciate the guidance provided to me by my thesis advisor and other members of the faculty and program. I would also like to thank MEDAC and George Mason University Library staff for their support and assistance as I conducted my research. iv TABLE OF CONTENTS Page List of Tables ................................................................................................................... -

The Security Council and NATO's Campaign in Libya
As a Last Resort The International Responsibility to Protect in a Post-Western World Master Thesis Myrthe Toppen Faculty of Humanities Leiden University July 2014 Supervisor: Dr. A. O’Malley Second Reader: Prof. dr. A.W.M. Gerrits Contents 1. Introduction 3 Literature Review 4 Methodology 7 2. From Unity to Discord: the Security Council and NATO’s Campaign in Libya 9 Unity on an Urgent Situation: Resolution 1970 and 1973 9 Discord on NATO’s Actions: Militarization and Regime Change 13 Legitimate Objections? 15 3. Painful Silence: Division and Security Council Inaction on Syria 17 Bloc Formation in 2011 17 Continued Resistance 20 Legitimate Objections? 21 4. Conclusion 22 Bibliography 23 2 1. Introduction The extent to which human rights protection is and ought to be a legitimate concern of international society has for long been a topic of hot debate both among International Relations (IR) scholars and international actors. A recurrent theme in this regard concerns the question if the international architecture built around human rights norms is a mere product of Western power, a form of Western neo-imperialism even, or enjoys wider legitimacy. Lately, this question has come to the fore again in the light of discussions relating to ‘a global power shift’, denoting the decline of the West in favor of new emerging powers. In this respect, scholars question the longevity of an international human rights regime in a multipolar world, where it’s no longer the West who pulls the strings. This research engages with this question, focusing on the new doctrine of the Responsibility to Protect and examining the way in which both Western and non-Western powers conceived of its implementation during United Nations Security Council debates on Libya and Syria. -

Libyan Civil War Libyan Civil War Articles
Libyan Civil War and International military Intervention Since February 17th up to March 30th, 2011 Wikipedia Articles as at March 31, 2011 Part One Articles: Libyan Civil War. UN Security Council Resolution. Military Intervention. Casualties. Timeline. Domestic Reactions. International Reactions Map of the Wikipedia Articles 2011 Libyan civil war Protests International reactions • Domestic responses • Casualties • Timeline Battles First Battle of Benghazi • Tripoli clashes • Battle of Az Zawiyah • Battle of Misurata • Battle of Gharyan • First Battle of Brega • Battle of Ra's Lanuf • Battle of Bin Jawad • Second Battle of Brega • Battle of Ajdabiya • Second Battle of Benghazi • Battle of Az Zintan • Late March rebel offensive • International military intervention (Operation Ellamy – Operation Odyssey Dawn – Opération Harmattan – Operation MOBILE ) • Operation Unified Protector • Places Bab al-Azizia • Green Square • Maydan al-Shajara People Muammar Gaddafi • Saif al-Islam Muammar Al-Gaddafi • Mustafa Mohamed Abud Al Jeleil • Abdul Fatah Younis • Hafiz Ghoga • Hussein Sadiq al Musrati • Mohammed El Senussi • Idris al-Senussi • Fathi Terbil • Mohammed Nabbous • Mahmoud Jibril • Khalifa Belqasim Haftar • Ali Tarhouni • Ali Abd-al-Aziz al-Isawi • Iman al-Obeidi Forces Anti-Gaddafi forces (Libyan People's Army – Free Libyan Air Force – NCLO ) • Military of Libya (Libyan Army – Libyan Air Force – Libyan Navy ) • Revolutionary Guard Corps Related National Transitional Council • Abu Salim Prison • Fist Crushing a U.S. Fighter Plane • People's Hall, Tripoli • Topple the Tyrants • United Nations Security Council Resolution 1970 • United Nations Security Council Resolution 1973 ( International reactions to the intervention – Protests against the intervention – US domestic reactions to the intervention ) 2011 Libyan civil war From Wikipedia, the free encyclopedia The neutrality of this article is disputed .