Diagnostic – SAGE SIAGNE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
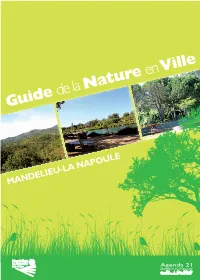
Guide De La Nature Enville
Guide de la Nature en Ville Mandelieu-la napoule Parcs naturels p. 4 Sentiers pédestres p. 18 Un patrimoine naturel préservé et entretenu p. 19 Débroussaillement p. 22 Respect du cadre naturel p. 23 Jardins publics (aires de jeux) p. 24 Parcours Forme p. 26 Mandelieu-la napoule, un pouMon vert exceptionnel • 3 137 hectares, surface totale de la commune • 310 hectares d’espaces verts (parcs, jardins, ...) • 5 parcs naturels : La Vernède, Robinson, La Rague, Le Bon Pin, Le Mont Turney • 1300 hectares de forêts (dont la forêt communale du Grand Duc et la forêt départementale du San Peyre) • 60 000 fleurs de saison plantées annuellement (30 000 l’hiver, 25 000 le printemps) • 20 000 bulbes plantés annuellement • 90 massifs de plantes fleuries • 80 variétés de plantes • 500 jardinières sur la commune les parcs naturels Notre commune est riche d’un patrimoine naturel très dense. Avec 1 300 hectares de forêt et 310 hectares d’espaces verts, Mandelieu-La Napoule est l’une des villes la plus verte du littoral. 1 2 Mont turney san peyre 50 000 m2 180 000 m2 3 4 estérel Grand duc 7 000 000 m2 900 000 m2 5 6 robinson ilot Wybrecht 50 000 m2 180 000 m2 7 8 Berges de camille siagne 14 000 m2 9 10 vernède Bon pin 30 000 m2 13 000 m2 11 tanneron 2 Ce document a été réalisé par le Service Communication, 2 000 000 m la Direction de l’Urbanisme, du Foncier et de l’Environnement de la ville de Mandelieu-La Napoule. -

Pégomas La Roquette Auribeau
SAM. 28 ET DIM. 29 Sorties CCAS SEPTEMBRE 2019 SEPTEMBRE Exposition fruits Auribeau-sur-Siagne sauvages et champignons Dimanche 1er : Fête de la figue à Solliès Pont De 10 h à 18 heures Départ 8 h 30 - Tarif : 45 € (déjeuner libre) Espace St-Jean - Salle des Marronniers Mardi 3 : Cueillette de pommes au Domaine d’Astros La Roquette La (Vidauban)- Départ 9 h 30 - Tarif : 40 € (déjeuner libre) ENTRÉE LIBRE Organisée par l’ABMS (Association Samedi 7 : Les flâneries aux miroirs (Martigues) Botanique et Mycologique de la Siagne) Départ 8 h 30 - Tarif : 52 € (déjeuner libre) Renseignement : www.abms06jb.info Mercredi 18 : Théâtre Anthéa Antibes - «Et Pof» avec Muriel Pégomas Robin - Départ 19 h 15 - Tarif : 88 € (1ère série place orchestre avec une boisson incluse) DIMANCHE 29 SEPTEMBRE La Roquette Fête au château Mercredi 25 : Théâtre Anthéa Antibes - «Père et fils» avec de 12 h à 17 heures Patrick Braoudé - Départ 19 h 15 - Tarif : 65 € (1ère série place Quartier du Château orchestre avec une boisson incluse) Auribeau Dimanche 29 : 41è édition des régates royales «Cannes»- Pégomas Concert gratuit, structures gonflables Départ 9 h 45 - Tarif : 97 € (Croisière + déjeuner + coupe de et jeux pour les enfants offerts par Champagne inclus) SEPTEMBRE 2019 la ville. Les restos installeront leurs Programme détaillé et inscription : 04 92 60 20 20 tablées dans la rue, devenue piétonne le temps d’une journée. Organisée par la municipalité Formations Communauté d’agglomération du Pays de Grasse DIMANCHE 29 SEPTEMBRE Thé Dansant Jardinage écologique de 14 h 30 à 18 heures Samedi 28 septembre et 5 octobre - concevoir son jardin Salle Mistral selon le principe de la permaculture de 9 h 30 à 16 h 30 - Les Jardins collectifs St-Claude. -

Commune D'escragnolles
D.I.C.R.I.M DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS Commune d’Escragnolles Livret de consignes à conserver. Édition 2019 Les CONSIGNES Les CONSIGNES Les CONSIGNES Les CONSIGNES LesDE BONNE CONSIGNES CONDUITE DE BONNE CONDUITE Pochettes-VERSO:Mise en page 1 19/08/10 10:31 Page 1 DE BONNE CONDUITEDE BONNE CONDUITE informez-vous f ace auxinform re isquesz-vous majf ace eur aux s r isques maj eur s informez-vous DEf ace BONNE auxinform r eCONDUITE isquesz-vous majf ace eur aux s r isques maj eur s informez-vous f ace auxinform re isquesz-vous majf ace eur aux s r isques maj eur s Les CONSIGNESinforme z-vous f ace aux r isques maj Les eur CONSIGNES s ALERTE EN CAS DE RISQUEALERTE MAJEUR EN CAS DE RISQUE MAJEUR DEALERTE BONNE EN CONDUITE CAS DE RISQUEALERTE Les CONSIGNES MAJEUR EN CAS DE RISQUELes CONSIGNES MAJEUR LES CONSIGNES DE BONNE CONDUITE FACE AUX RISQUES MAJALERTEEURS Vo uENs e nCAStend DEez l aRISQUE AsiLERTErène.V..R DoMAJEUR TuÉENEsB Ue nTCASt Den’Ad vousLDEeEz l aRISQUEentendez sLesirèn e CONSIGNESDEl.a.. RDFMAJEUR ITÉNBONNEE BDU’ATLERTE D’A. .vousCONDUITEL. E entendez la FIN D’ALERTE... ALERTEVo uENs e nCAStend DEez laRISQUE sDELesirèn BONNE eCONSIGNES.V.. RDoMAJEURTuÉEsB Ue nTCONDUITEt Den’AdvousLe E z laentendez sDEir èn BONNEe l.a.. RDFITÉNE BDU’A TCONDUITELERTE D’A..vousL. E entendez la FIN D’ALERTE... Un son montant et descLesendan tCONSIGNES VoUun so en nmtoenntadnUten e zst o dlnea sc coseninrtdiènanun dte e...RDT3É0EB seUcoTn dDe’sAUvousLnE so nentendez continu d ela F I3N0 Dse’cAoLERTEndes.. -

La Roquette Sur Siagne 06 UNE RÉFÉRENCE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS Optez Pour La Douceur De Vivre Et La Tranquilité De La Roquette-Sur-Siagne
LA ROQUETTE SUR SIAGNE 06 UNE RÉFÉRENCE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS Optez pour la douceur de vivre et la tranquilité de la Roquette-sur-Siagne. Festival d’art de vivre à l’affiche Sur la Côte d’Azur, il est des villes balnéaires dont le nom seul est évocateur de félicité, de prestige et de qualité de vie d’exception. Cannes, son élégante Croisette bordée de plages de sable fin, le tapis rouge de son festival international du film, sa splendide baie avec l’Estérel ou les Îles de Lérins en toile de fond, etc. Mandelieu-la-Napoule, la capitale du mimosa, sa corniche d’Or aux criques intimes et aux calanques sauvages, le spectacle des roches volcaniques rouges et des fonds marins bleu émeraude… À 2 pas de ces illustres voisines, et à 15 km de la tout aussi réputée technopole de Sophia-Antipolis, La Roquette-sur-Siagne est une agréable petite commune coulant des jours heureux. Entre mer et montagne, un village enchanté par les cigales et parfumé par les fleurs Paisiblement installée sur les hauteurs à 5 km de la mer, La Roquette-sur-Siagne est attachée à ses traditions et à sa douceur de vivre. Avec sa place ombragée de platanes, son église du 18e siècle, son cadran solaire et son marché de terroir, le centre ancien semble avoir arrêté le temps à l’époque où La Roquette était encore un petit village agricole. En plus de l’air pur, ses 5 537 habitants se félicitent à longueur d’année de leur environnement exceptionnel : vues panoramiques sur le massif du Tanneron ou encore sur la baie en toile de fond, 130 ha de collines boisées classées, plaine de la Siagne parsemée de champs de jasmin et de roses Centiflora. -

Vocabulaires Et Toponymie Des Pays De Montagne
VOCABULAIRES et TOPONYMIE des pays de MONTAGNE Robert LUFT Club Alpin Français de Nice – Mercantour 2 Vocabulaires et toponymie des pays de montagne Avant-Propos Tels qu'ils se présentent à nos yeux, les paysages sont le résultat de l'action millénaire des forces de la nature sur le socle des terres émergées, conjuguée avec celle des interventions humaines. Les plaines et leurs abords collinaires sont caractérisés aujourd'hui par une agriculture mécanisée, par l'importance des réseaux de voies de communication, ainsi que par une urbanisation envahissante. Au cours de la seconde moitié du 20ème siècle, les paysages agricoles ouverts, traditionnellement formés de champs et de bocages microparcellaires, ont cédé la place à de vastes étendues dénudées, indispensables à la pratique des nouveaux modes de culture. Par ailleurs, beaucoup de villages et de bourgs dépérissent ou se transforment en cités-dortoirs de grandes agglomérations de plus en plus envahissantes. Pour décrire son paysage de plaine le citadin, désormais majoritaire, n'a plus recours aux termes nuancés de quelqu'un qui tire son existence des produits de la terre ; son mode d'expression est plus technique, mais aussi plus pauvre que celui du cultivateur d'antan. Dans les zones de la montagne, au contraire, l'aspect du paysage a peu évolué, malgré l'apparition de nouvelles techniques agricoles. Les formes variées du terrain imposent leur marque aux paysages dont les structures naturelles sont celles d'espaces clos, limités par des barrières rocheuses et des cours d'eau, infranchissables par endroits. Ces milieux âpres dont, il y a peu encore, il était difficile de s'échapper sans d'importants efforts physiques, limitent les échanges. -

Provence - Côte D’Azur
PROVENCE - CÔTE D’AZUR 2020 Introduction SUNNY AND RADIANT, AUTHENTIC AND HERITAGE-PACKED, LIVELY, WARM AND CREATIVE... It’s all here! Provence and the Côte d’Azur are among the world’s most-coveted travel destinations. Our stunning south-eastern corner of France, where Europe and Mediterranean meet, is home to 700 km of shores and breathtaking scenery. Provence and the Côte d’Azur literally overflow with authentic little villages, where ancient heritage rubs shoulders with landscapes carved by olive trees, vineyards and lavender fields. Set at the gateway to 3 international airports – Marseille-Provence, Toulon-Hyères and Nice-Côte d’Azur - and numerous TGV (high-speed train) railway stations, these two exceptional destinations offer visitors a multitude of exciting travel experiences, whether gastronomy & wine tourism, history & heritage, art & culture, water sports & leisure, golfing, walking, cycling, arts & crafts, shopping, events, festivals and a great night life in every season. Or you can simply opt to relax and enjoy the warm weather and clear blue skies... Did you know? Our region’s two mythical seaside cities - Nice on the Côte d’Azur and Marseille in Provence - are located just 190 km from each other, or around 2 hours by car. Marseille and Nice were France’s sunniest cities in 2017: • 3 111 hours of sunshine in Marseille • 3 047 hours of sunshine in Nice How does it get any better? The Côte d’Azur and Provence boast a myriad of preserved and easily-accessible natural sites promising you many unforgettable walks, excursions and forays into our exceptional biodiversity. Media Library CONTENTS Provence-Alpes-Côte d’Azur Tourism Board [email protected] • www.provence-alpes-cotedazur.com 2 • Key Figures ABOUT THE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR REGIONAL TOURISM BOARD The number one tourist destination in France after Paris, Provence-Alpes-Côte d’Azur welcomes 31 million visitors each year, with 6 million of them from overseas. -

Le Pays De Grasse
LE PAYS DE GRASSE FLEURS ET PARFUMS CULTURE ET PATRIMOINE ART DE VIVRE ET GASTRONOMIE NATURE ET PLEIN AIR Carnet de route 1 Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Briançonnet, Cabris, Caille, Collongues, Escragnolles, Gars, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Mas, Le Tignet, Les Mujouls, Mouans-Sartoux, Pégomas, Peymeinade, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Séranon, Spéracèdes, Valderoure. WWW.PAYSDEGRASSETOURISME.FR Bienvenue ! Découvrez le caractère authentique des villages du Pays de Grasse qui font le charme tranquille de la Côte d’Azur. On s’émerveille par les paysages féériques qui défilent sous nos yeux. De la Vallée de la Siagne, où cette magnifique rivière serpente avec nonchalance aux villages du sud du territoire jusqu’au Haut Pays, où vous apprécierez les nombreuses richesses et vestiges patrimoniaux de nos villages médiévaux, le Pays de Grasse est un savant mélange de sérénité et de quiétude. On découvre de magnifiques vieilles maisons en pierre, on traverse d’immenses vallées, on découvre le patrimoine local, on savoure des spécialités, et surtout on prend son temps… Assurément, les villages du Pays de Grasse ont de quoi séduire nos visiteurs. Jérôme VIAUD, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Maire de Grasse 2 Vice-président du département des Alpes-Maritimes 3 SOMMAIRE À VOIR, À FAIRE P. 5 23 COMMUNES P. 6 LES MARCHÉS DU PAYS DE GRASSE P. 54 RESTONS CONNECTÉS P. 55 AGENDA P. 56 CHARTE ÉCOTOURISME P. 57 COMMENT VENIR ? P. 58 Crédits photos : CAPG, OT Pays de Grasse, Isabelle -

Les Étapes D'un Touriste En France. De Marseille À Menton / Par Jules Adenis
Les étapes d'un touriste en France. De Marseille à Menton / par Jules Adenis,... Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Adenis, Jules (1821-1900). Auteur du texte. Les étapes d'un touriste en France. De Marseille à Menton / par Jules Adenis,.... 1892. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. -

TRI De Nice – Cannes – Mandelieu
Territoires à Risques Importants d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée TRI de Nice – Cannes – Mandelieu Identifiant du TRI FRD_TRI_NICE TRI national non (traversé par le Rhône) Type d'aléa Submersions marines (à l'origine de l'identification Débordements de cours d'eau pour : du TRI) – le Var – les Paillons – le Riou de l'Argentière – la Siagne – la Brague – le Loup – la Cagne Région(s) Provence-Alpes-Côte-d'Azur Département(s) Alpes-Maritimes Liste des Intercommunalités CU Nice Côte d'Azur (NCA), CA de Sophia Antipolis, CA du Moyen Pays Provençal - Pôle Azur Provence, CC de la Vallée de l'Estéron, CC du Pays des Paillons, CC les Coteaux d'Azur. Liste des communes Drap, La Trinité, Castagniers, Nice, La Roquette-sur-Var, Saint-Blaise, Gattières, Colomars, La Gaude, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Bonson, Le Broc, Carros, Gilette, Saint-Martin-du-Var, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve- Loubet, Cannes, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule, Mougins, Pegomas, La Roquette-sur-Siagne, Vallauris, Grasse, Auribeau-sur-Siagne, Biot, La colle-sur-Loup, Contes, Cantaron. Critère d'Importance du Risque Impacts Santé Humaine Population Part de la population Emprise de l'habitat permanente Types de phénomènes permanente de plain-pieds en EAIP en EAIP en EAIP (en m²) (nb d'habitants) « Débordements de cours d'eau » 364 648 43,5% 828 028 « Submersions Marines » 22 024 2,6% 26 991 Impact Activité Économique Nombre d'emplois Part des emplois Surface bâtie en EAIP Types de phénomènes en EAIP en EAIP (en m²) « Débordements de cours d'eau » 231 240 67,1% 13 363 010 « Submersions Marines » 17 530 5,1% 1 011 201 Novembre 2012 – Fiche de caractérisation du TRI de Nice – Cannes – Mandelieu 1/3 Territoires à Risques Importants d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée Types de phénomènes Ruissellement et crues éclairs, crues rapides, submersions marines. -
LA ROQUETTE Guide 2021 (Internet
Sommaire MOT DU MAIRE .............................................................. 5 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE...........6 VIE MUNICIPALE ..........................................................8 n Le conseil municipal ..................................................P.8 n Les services municipaux ..........................................P.11 n La communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG).....................................P.13 ENFANCE ET JEUNESSE .................................... 14 n Structure multi-accueil ......................................... P.14 n ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) .P.16 n Service scolaire ........................................................P.16 ACTION SOCIALE...................................................... 18 ANIMATION ET CULTURE ...............................20 n Bibliothèque et médiathèque .............................P.20 n Point info tourisme .................................................. P.21 n Service animation et vie associative ..............P.22 n Site internet ..............................................................P.22 VIE ASSOCIATIVE ................................................... 24 n Équipements sportifs et de loisirs ..................... P.24 n Associations .............................................................. P.27 VIE PRATIQUE ............................................................ 38 n Formalités administratives .................................. P.38 n Police municipale .................................................... P.42 -

Amenagement De La Plaine De La Siagne, Enseignements Du
AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE LA SIAGNE, ENSEIGNEMENTS DU PRECEDENT PAPI ET ESQUISSE DE LA NOUVELLE STRATEGIE Le PAPI 2 d’intention « Siagne-Béal » a abouti à la proposition d’un programme d’aménagement, combiné sur la Siagne et le Béal, pour un montant d’investissement de 33 M€ (17,5 M€ de travaux et 15,6 M€ d’acquisitions foncières) et comprenait les aménagements suivants : Sur la Siagne en amont de l’autoroute A8 : la création d’une Zone d’Expansion de Crue (ZEC) ainsi qu’un recalibrage du cours d’eau et la création d’un chenal parallèle permettant de faire transiter une crue de 450 m3/s (occurrence cinquantennale) sans débordement. Un curage de la Siagne en aval de l’A8 était également intégré. Sur le Béal en amont de l’autoroute A8 : la création de deux ZEC, d’un bassin de rétention sur le Méayne (affluent du Béal), d’un recalibrage et d’un bras de délestage vers la Siagne. Figure 11: Localisation des aménagements envisagés sur la Siagne et le Béal dans le cadre du PAPI 2 d'intention "Siagne-Béal » (source: SAFEGE, 2017) Toutefois, l’analyse économique de ce programme d’aménagement a conclu à un coût d’investissement disproportionné compte tenu des enjeux protégés faiblement urbanisés. En conséquence, le programme de travaux envisagé n’a pas pu être mis en œuvre en l’état et il est aujourd’hui indispensable de repenser la stratégie de protection contre le risque inondation au regard des véritables enjeux du territoire, notamment à la lumière des événements météorologiques de novembre et décembre 2019. -

L'agglo En Rando
L’agglo en rando Votre guide des randonnées sur le territoire du Pays de Grasse Connaître les circuits de randonnées proches de chez vous Découvrir le Pays de Grasse autrement Partager un territoire et 2iéme ÉDITION 2011 une nature unique Les Randonnées naturalistes et patrimoniales, un loisir familial accessible à tous Le Pays de Grasse et ses nombreux chemins sont des perles de la na- ture qui se découvrent au gré des parcours. Cette terre de prédilec- tion nous offre la diversité et la richesse d’un territoire naturel que nous nous sommes engagés à préserver au travers de notre charte intercommunale pour l’environnement, signée en 2006. Dans ce sens, une des 76 actions de cette charte était notamment basée sur la promotion des randonnées existantes sur nos 5 communes. Du Canal de la Siagne en passant par les Traverses de Grasse ou en- core par le Mont Peygros, les multiples paysages du Pays de Grasse et plus particulièrement de la communauté d’agglomération sau- ront dévoiler leurs secrets et vous séduire par leur intense beauté. Randonneurs individuels ou promeneurs en famille, les 5 parcours proposés dans ce guide vous permettront de découvrir, par la pra- tique d’une activité nature adaptée à plusieurs niveaux, un autre visage de votre territoire et des espaces naturels encore préservés. Nous pouvons être fiers de notre patrimoine, et nous souhaitons permettre au grand public de le découvrir par lui même grâce à la deuxième édition de ce guide ludique utilisable au fil des saisons. La beauté de la nature nous entoure, ouvrons nos yeux pour mieux en profiter et écoutons-la pour mieux la respecter..