Multimodalite Avion - Tgv
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Interconnexions Des LGV Européennes
Sénateur Bernard Joly Interconnexions des LGV européennes R a p p o r t à M o n s i e u r l e P r e m i e r M i n i s t r e s u r l e s p r o j e t s d e l i g n e s à g r a n d e v i t e s s e e n E u r o p e , l e s e n j e u x d ’ i n t e r o p é r a b i l i t é e t l e s c o n s é q u e n c e s d e l ’ o u v e r t u r e à l a c o n c u r r e n c e O c t o b r e 2 0 0 3 Interconnexions des LGV européennes Sommaire Sommaire...................................................................................................................................3 Résumé du rapport ...................................................................................................................5 Avant-Propos ............................................................................................................................7 Introduction..............................................................................................................................9 Première partie - les moyens de réaliser des LGV .............................................................13 Premier chapitre - données économiques sur la grande vitesse ferroviaire.......................... 14 Domaine de pertinence de la grande vitesse.....................................................................14 Eléments de réflexion sur la rentabilité de la grande vitesse passagers...........................14 Eléments sur le besoin de financement des projets grande vitesse ..................................17 Estimation du besoin ........................................................................................................20 -

N° 2733 Assemblée Nationale
N° 2733 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 décembre 2005. AVIS PRÉSENTÉ AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTE PAR LE SENAT APRES DECLARATION D’URGENCE, relatif à la sécurité et au développement des transports (n° 2604) PAR M. Hervé MARITON, Député. —— Voir les numéros : Sénat : 9, 14 et T.A. 20 (2005-2006). Assemblée nationale : 2604, 2723. — 3 — SOMMAIRE ___ Pages INTRODUCTION ................................................................................................................. 5 I.– UN ENVIRONNEMENT PROPICE À LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS INNOVANTS ............. 7 A.– LE CONTEXTE NATIONAL EST FAVORABLE À LA MISE EN PLACE DE PPP POUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT............................................................................ 7 1.– La lancinante question du financement des infrastructures de transport.................... 7 a) Les priorités gouvernementales ............................................................................... 7 b) Les engagements du projet de loi de finances pour 2006 .............................................. 7 2.– Le recours aux capitaux et à l’expertise privés doit permettre de faire évoluer des mentalités encore frileuses et parfois suspicieuses .................................................. 8 a) Exploiter l’opportunité des PPP en matière de transport.............................................. 8 b) Sélectionner -

The Rail Market in France 2010
The Rail Market in France 2010 Brooks Market Intelligence Reports, part of Mack Brooks Exhibitions Ltd www.brooksreports.com Mack Brooks Exhibitions Ltd © 2010. All rights reserved. No guarantee can be given as to the correctness and/or completeness of the information provided in this document. Users are recommended to verify the reliability of the statements made before making any decisions based on them. CONTENTS INTRODUCTION 4 1. GOVERNMENT 5 Political funding environment 5 Subsidised services 6 Open access and regulation 6 Regional councils 6 2. MAIN LINE RAILWAY INFRASTRUCTURE 8 Réseau Ferré de France 8 Organisation 8 Finance 9 Key figures 10 Traffic 10 New lines 11 Renewals 11 Electrification 12 Selected new/major upgrading projects 12 High-speed line projects LGV Bordeaux-Spanish Border 13 LGV Bordeaux-Toulouse 13 LGV Bretagne/Pays de la Loire 14 LGV Est Européen (Phase 2) 14 LGV Paris-Orléans-Clermont Ferrand-Lyon 15 LGV Poitiers-Limoges 15 LGV Provence-Alpes-Côtes d’Azur 16 LGV Rhine-Rhône 16 LGV Sud Europe Atlantique 17 Other projects CDG Express 18 Haut-Bugey line 18 Lyon freight bypass 19 Lyon-Turin Transalpine Rail Link 19 Montpellier-Perpignan line 20 Nîmes/Montpellier bypass line 20 Roissy-Picardie link 21 Tangentielle Nord (Paris) 21 3. TRAIN OPERATING COMPANIES 23 Euro Cargo Rail 23 Eurporte France 23 Colas Rail 23 Mack Brooks Exhibitions Limited © 2010 2 Régie Autonome des Transport Parisiens (RATP) 23 Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) 24 4. URBAN RAILWAY SYSTEMS 28 Metro systems 28 Lille/Roubaix/Tourcoing 28 Lyon 29 Marseille 29 Paris 30 Rennes 31 Toulouse 31 Light rail systems 32 Angers 32 Aubagne 33 Besançon 34 Bordeaux 34 Brest 35 Dijon 35 Grenoble 36 Le Havre 36 Lens-Béthune 37 Lille/Roubaix/Tourcoing 37 Lyon 38 Le Mans 38 Marseille 39 Montpellier 40 Mulhouse 40 Nantes 41 Nice 42 Orléans 43 Paris: Line T1 (St-Denis─Bobigny) 43 Paris: Line T2 (La Défense─Issy Val-de-Seine) 45 Paris: Line T7 (Villejuif─Athis-Mons) 45 Reims 46 Rouen 46 St-Étienne 47 Strasbourg 47 Toulouse 48 Tours 49 Valenciennes 49 5. -
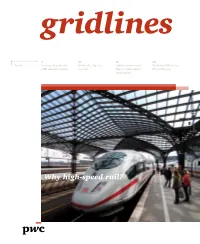
Why High-Speed Rail? Gridlines Is Pwc’S Magazine Devoted to Infrastructure
gridlines 2 12 14 22 Inside Sorting through the Under the Alps by Golden anniversary Tracking HSR in the HSR decision factors fast rail doesn’t slow Japan’s US and Russia silver bullet Why high-speed rail? Gridlines is PwC’s magazine devoted to infrastructure. Stories focus on four areas: emerging trends and technologies driving infrastructure transformation, ways to manage risks and seize opportunities, tactics that can help with day-to-day challenges, and inter- views with experts at the heart of thought and action. Gridlines combines PwC’s analysis and insight with reporting on critical developments and directions. Cover photo—An ICE train arrives in Cologne, Germany Photo above—The first .italo train, scheduled to begin HSR service in 2012 for the Italian operator NTV, leaves the La Rochelle plant in France where it was produced. www.pwc.com © 2011 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. OUTLOOK | WINTER 2011 Seizing the opportunities in high-speed rail demands rigorous thinking on a range of issues High-speed rail can mean many works best through an examination dramatic technical advances today things, depending on context. For a of the overarching considerations. in areas like magnetic levitation and traveler, HSR typically delivers com- We also look at several examples of safety, carrying more passengers fort, speed, punctuality, safety and HSR around the world. -

Luque-Ferrocarriles En Europa
Transportes Ferroviarios en Europa Lautaro Luque PDF generado usando el kit de herramientas de fuente abierta mwlib. Ver http://code.pediapress.com/ para mayor información. PDF generated at: Wed, 27 Jul 2011 22:47:13 UTC Contenidos Artículos Railteam 1 Infraestructuras de la Unión Europea 2 Eurotúnel 6 Autopista ferroviaria Perpiñán-Luxemburgo 9 Alta Velocidad Española 10 Train à Grande Vitesse 25 InterCityExpress 41 Eurostar Italia 45 Impacto ambiental de vías terrestres 46 Referencias Fuentes y contribuyentes del artículo 49 Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes 50 Licencias de artículos Licencia 52 Railteam 1 Railteam Railteam es una alianza de siete operadores ferroviarios de alta velocidad fundada en el año 2007. El objetivo del grupo es ofrecer servicios ferroviarios integrados de alta velocidad entre las principales ciudades europeas y competir con las compañías aéreas en puntualidad, protección del medio ambiente, precio y velocidad. Los miembros de Railteam planean lanzar un sistema integrado de venta de pasajes un un web site único en 2009.[1] [2] El 3 de febrero de 2009 del web site de ABTN (Air & Business Travel News) indicaba que existían serios rumores en la industria de que el proyecto había sido cancelado. Ante esto Eurostar anunció que el proyecto continuaba con vida aunque reconoció que ha habido serios problemas con la creación de una plataforma común de reservas. Por ello la implementación de la plataforma común de reservas ha sido aplazada y se ha transformado en una "ambición a largo plazo". En su lugar un sistema basado en internet se pondrá en marcha lo más rápido posible. -

La Grande Vitesse Ferroviaire : Un Modèle Porté Au-Delà De Sa Pertinence
LA GRANDE VITESSE FERROVIAIRE : UN MODÈLE PORTÉ AU-DELÀ DE SA PERTINENCE Rapport public thématique La grande vitesse ferroviaire – octobre 2014 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes Sommaire DÉLIBÉRÉ ................................................................................................. 9 INTRODUCTION .................................................................................. 11 CHAPITRE I - LES LIMITES D’UNE RÉUSSITE .......................... 13 I - Le modèle français ........................................................................ 13 A - Le succès commercial de la ligne Paris – Lyon a déclenché la construction du réseau des LGV .............................................................13 B - La grande vitesse a stabilisé la chute du trafic de voyageurs longue distance, désormais stagnant .................................................................21 II - Les leçons des exemples étrangers ....................................... 23 A - Chine, Espagne et Japon : les réseaux les plus longs ........................23 B - Une zone de pertinence comprise entre une heure trente et trois heures de trajet ......................................................................................24 C - Une vision européenne optimiste, des expériences nationales peu homogènes et un bilan contrasté ...........................................................26 III - La grande vitesse ferroviaire ne représente qu’une part minoritaire des déplacements ..................................................... -

A-XI Derailment Guard Practices
Ref: R00673 Report on the findings of: Current practice and effectiveness of derailment containment provisions on high speed lines Issue 1 Zoetermeer, Netherlands 30 September 2004 HSL-Zuid Submitted by: This report is confidential and intended solely for the use and information of the company to whom it is addressed. Executive Summary Overview of Current Practice The findings indicate that there is a general acknowledgment that Derailment Containment Provision (DCP) is a positive approach to minimising derailments although there was: • No single current practice to derailment containment provision, • No substantive reasons for the provision of DCP, • No standard used in applying DCP, • No definite opinion on the effectiveness of DCP, • No DCP is 100% effective. The majority of projects and organisations looked to use DCP Type 1 or DCP Type 3 at high risk locations and there was widespread agreement that DCPs are not used as a matter of course throughout the system. Estimation of Effectiveness of DCP There is insufficient information to make a quantified decision on the effectiveness of DCPs to confidently predict how a train will behave in a derailment at speeds above 200 km/h. Furthermore, determining effectiveness is problematical, due to the complex variable factors to be considered when trying to evaluate the effectiveness of DCP and every accident is unique. After a high level qualitative assessment, DCP Type 3 is the most effective form of DCP on high speed lines based on high level causal events. This high level assessment is supported by organisations which operate high speed lines such as CTRL and Skinkansen who implement DCP Type 3.