101303 Turcica 50 00 16 Comptesrendus.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Islamic Art from the Collection, Oct. 23, 2020 - Dec
It Comes in Many Forms: Islamic Art from the Collection, Oct. 23, 2020 - Dec. 18, 2021 This exhibition presents textiles, decorative arts, and works on paper that show the breadth of Islamic artistic production and the diversity of Muslim cultures. Throughout the world for nearly 1,400 years, Islam’s creative expressions have taken many forms—as artworks, functional objects and tools, decoration, fashion, and critique. From a medieval Persian ewer to contemporary clothing, these objects explore migration, diasporas, and exchange. What makes an object Islamic? Does the artist need to be a practicing Muslim? Is being Muslim a religious expression or a cultural one? Do makers need to be from a predominantly Muslim country? Does the subject matter need to include traditionally Islamic motifs? These objects, a majority of which have never been exhibited before, suggest the difficulty of defining arts from a transnational religious viewpoint. These exhibition labels add honorifics whenever important figures in Islam are mentioned. SWT is an acronym for subhanahu wa-ta'ala (glorious and exalted is he), a respectful phrase used after every mention of Allah (God). SAW is an acronym for salallahu alayhi wa-sallam (may the blessings and the peace of Allah be upon him), used for the Prophet Muhammad, the founder and last messenger of Islam. AS is an acronym for alayhi as-sallam (peace be upon him), and is used for all other prophets before him. Tayana Fincher Nancy Elizabeth Prophet Fellow Costume and Textiles Department RISD Museum CHECKLIST OF THE EXHIBITION Spanish Tile, 1500s Earthenware with glaze 13.5 x 14 x 2.5 cm (5 5/16 x 5 1/2 x 1 inches) Gift of Eleanor Fayerweather 57.268 Heavily chipped on its surface, this tile was made in what is now Spain after the fall of the Nasrid Kingdom of Granada (1238–1492). -

THE AMERICAN UNIVERSITY in CAIRO School of Humanities And
1 THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO School of Humanities and Social Sciences Department of Arab and Islamic Civilizations Islamic Art and Architecture A thesis on the subject of Revival of Mamluk Architecture in the 19th & 20th centuries by Laila Kamal Marei under the supervision of Dr. Bernard O’Kane 2 Dedications and Acknowledgments I would like to dedicate this thesis for my late father; I hope I am making you proud. I am sure you would have enjoyed this field of study as much as I do. I would also like to dedicate this for my mother, whose endless support allowed me to pursue a field of study that I love. Thank you for listening to my complains and proofreads from day one. Thank you for your patience, understanding and endless love. I am forever, indebted to you. I would like to thank my family and friends whose interest in the field and questions pushed me to find out more. Aziz, my brother, thank you for your questions and criticism, they only pushed me to be better at something I love to do. Zeina, we will explore this world of architecture together some day, thank you for listening and asking questions that only pushed me forward I love you. Alya’a and the Friday morning tours, best mornings of my adult life. Iman, thank you for listening to me ranting and complaining when I thought I’d never finish, thank you for pushing me. Salma, with me every step of the way, thank you for encouraging me always. Adham abu-elenin, thank you for your time and photography. -

Catergory : Turnover Upto 5 Lacs Association Verified List No: 45 Page 1 of 33
Catergory : Turnover Upto 5 Lacs Association Verified List No: 45 S. No Office Code Proprieter Name Business Unit Name With Style Business Unit Location Tehsil Association Name Address 32298-NA- QAMARWARI ALL TRADERS ASSOCIATION 1 18076 GH NABI BHAT ELECTRONICS SHOP QAMARABAD CENTRAL SHALTENG QAMARWARI 108902-CE- HILAL AHMAD ALL TRADERS ASSOCIATION 2 18236 WANGNOO SPARE PARTS QAMARWARI CENTRAL SHALTENG QAMARWARI 30570-NA- ALL TRADERS ASSOCIATION 3 18354 JAN MOHD SHAH JAN TAILORING HOUSE QAMARWARI CENTRAL SHALTENG QAMARWARI 108919-CE- DAILY NEEDS QAMAR ABAD ALL TRADERS ASSOCIATION 4 18238 ZAHOOR AHMAD BHAT PROVISIONAL STORE QAMARWARI CENTRAL SHALTENG QAMARWARI 12710-NA- COSMETICS AND ARTS BAZAR, LAL CHOWK 5 19477 ZULFIQAR ALI PROVISIONAL STORE BATAMALOO CENTRAL SHALTENG AMIRAKADL, SRINAGAR 12696-CE- ARTS BAZAR, LAL CHOWK 6 4118 BABIK MANZOOR READYMADE GARMENTS BATAMALOO CENTRAL SHALTENG AMIRAKADL, SRINAGAR 111973-CE- BATAMALOO TRADERS 7 17652 AB AHAD SHEIKH TENT HOUSE BATAMALOO CENTRAL SHALTENG ASSOCIATION 41988-NA- BATAMALOO TRADERS 8 21079 AB QADOOS MIR ELECTRICAL SHOP BATAMALOO CENTRAL SHALTENG ASSOCIATION 111970-CE- BATAMALOO TRADERS 9 17646 ADIL AMIN PLY SUPPLIER BATAMALOO CENTRAL SHALTENG ASSOCIATION 111978-CE- BATAMALOO TRADERS 10 17657 ADIL BASHIR FOOTWEAR BATAMALOO CENTRAL SHALTENG ASSOCIATION 111964-CE- BATAMALOO TRADERS 11 17637 AJAZ AH SHAH HARDWARE B P BATAMALOO CENTRAL SHALTENG ASSOCIATION 111990-CE- BATAMALOO TRADERS 12 17675 ARSHID BILAL ELECTRICAL GOODS B P BATAMALOO CENTRAL SHALTENG ASSOCIATION 111968-CE- BATAMALOO TRADERS -

From Church and Forum to Mosque And
Alcantara Vol XL-2 (009).qxp_Maquetación 1 13/4/20 13:18 Página 295 AL-QAnTArA XL 2, julio-diciembre 2019 pp. 295-313 ISSn 0211-3589 https://doi.org/10.3989/alqantara.2019.009 From Church and Forum to Mosque and Sūq: The Evolution of Mediterranean Cities during the Umayyad Period De la iglesia y el foro a la mezquita y el sūq: la evolución de las ciudades mediterráneas durante el periodo omeya Michael Ehrlich Bar-Ilan University https://orcid.org/0000-0002-5912-8450 This article’s aim is to explore the interplay El objetivo de este artículo es estudiar la inte- between the Muslim occupation of cities and racción entre la ocupación musulmana de ciu- those cities’ urban development during this pe- dades y su desarrollo urbano durante este riod. How did the Muslims manage to inte- período. ¿Cómo gestionaron los musulmanes grate themselves as a new ruling class in su integración como nueva élite gobernante en functioning urban tissues with almost no de- el funcionamiento de las estructuras urbanas struction of churches and synagogues? I sug- sin destruir las iglesias y las sinagogas? Los gest that the Muslims employed a uniform, musulmanes utilizaron una política uniforme premeditated policy, whose surviving physical y predeterminada, cuya manifestación física manifestation is the proximity between sobrevive en forma de la proximidad entre churches and mosques, mostly in cities’ cen- iglesias y mezquitas, sobre todo en los centros ters. I further suggest that this proximity trans- urbanos. Además, esta proximidad transformó formed the cities’ markets from fora and los mercados de los foros y cardisnes en cardisnes into aswāq. -
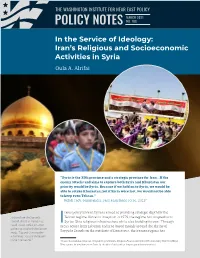
Policy Notes March 2021
THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY MARCH 2021 POLICY NOTES NO. 100 In the Service of Ideology: Iran’s Religious and Socioeconomic Activities in Syria Oula A. Alrifai “Syria is the 35th province and a strategic province for Iran...If the enemy attacks and aims to capture both Syria and Khuzestan our priority would be Syria. Because if we hold on to Syria, we would be able to retake Khuzestan; yet if Syria were lost, we would not be able to keep even Tehran.” — Mehdi Taeb, commander, Basij Resistance Force, 2013* Taeb, 2013 ran’s policy toward Syria is aimed at providing strategic depth for the Pictured are the Sayyeda Tehran regime. Since its inception in 1979, the regime has coopted local Zainab shrine in Damascus, Syrian Shia religious infrastructure while also building its own. Through youth scouts, and a pro-Iran I proxy actors from Lebanon and Iraq based mainly around the shrine of gathering, at which the banner Sayyeda Zainab on the outskirts of Damascus, the Iranian regime has reads, “Sayyed Commander Khamenei: You are the leader of the Arab world.” *Quoted in Ashfon Ostovar, Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Iran’s Revolutionary Guards (2016). Khuzestan, in southwestern Iran, is the site of a decades-long separatist movement. OULA A. ALRIFAI IRAN’S RELIGIOUS AND SOCIOECONOMIC ACTIVITIES IN SYRIA consolidated control over levers in various localities. against fellow Baathists in Damascus on November Beyond religious proselytization, these networks 13, 1970. At the time, Iran’s Shia clerics were in exile have provided education, healthcare, and social as Muhammad Reza Shah Pahlavi was still in control services, among other things. -

Evolution of Islamic Geometric Patterns
Frontiers of Architectural Research (2013) 2, 243–251 Available online at www.sciencedirect.com www.elsevier.com/locate/foar RESEARCH ARTICLE Evolution of Islamic geometric patterns Yahya Abdullahin, Mohamed Rashid Bin Embi1 Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia, Johor 81310, Malaysia Received 18 December 2012; received in revised form 27 March 2013; accepted 28 March 2013 KEYWORDS Abstract Islamic geometrical This research demonstrates the suitability of applying Islamic geometrical patterns (IGPs) to patterns; architectural elements in terms of time scale accuracy and style matching. To this end, a Islamic art; detailed survey is conducted on the decorative patterns of 100 surviving buildings in the Muslim Islamic architecture; architectural world. The patterns are analyzed and chronologically organized to determine the History of Islamic earliest surviving examples of these adorable ornaments. The origins and radical artistic architecture; movements throughout the history of IGPs are identified. With consideration for regional History of architecture impact, this study depicts the evolution of IGPs, from the early stages to the late 18th century. & 2013. Higher Education Press Limited Company. Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. 1. Introduction three questions that guide this work are as follows. (1) When were IGPs introduced to Islamic architecture? (2) When was For centuries, Islamic geometrical patterns (IGPs) have been each type of IGP introduced to Muslim architects and artisans? used as decorative elements on walls, ceilings, doors, (3) Where were the patterns developed and by whom? A domes, and minarets. However, the absence of guidelines sketch that demonstrates the evolution of IGPs throughout and codes on the application of these ornaments often leads the history of Islamic architecture is also presented. -

Ftyk Vksad Esa Flfkr Etkj@Edcjk@Njxkgksa Dh Lwph%&
ftyk Vksad esa fLFkr etkj@edcjk@njxkgksa dh lwph%& Sr No Property Name Location Area 1 Mazar Bala Syed Sahib qila Aligarh (CT)Uniara Tonk N.A.Sq. Metre 2 Mazar Bhai Khan Aligarh (CT)Uniara Tonk N.A.Sq. Feet 3 Mazar Asadullah Peer Aligarh (CT)Uniara Tonk N.A.Sq. Feet 4 Mazaar Khirki Darwaza Aligarh (CT)Uniara Tonk N.A.Sq. Feet 5 Mazar Allahdia Peer Sahib Aligarh (CT)Uniara Tonk N.A.Sq. Feet 6 Mazar Dadaji Sahib KhatoliUniara Tonk N.A.Sq. Metre 7 Dargah Uniara (Rural)Uniara Tonk N.A.Hectare 8 Mazar Peer Gulam Shah Uniara (Rural)Uniara Tonk N.A.Sq. Feet 9 Mazar Mohd. Peer Sahib Uniara (Rural)Uniara Tonk N.A.Sq. Feet 10 Mazar Islamia Uniara (Rural)Uniara Tonk 38.250000 Sq. Yard 11 Dargah Pukhta Hazi Peer Sahib BanethaUniara Tonk N.A.Sq. Feet 12 Mazar BanethaUniara Tonk N.A.Sq. Feet 13 Mazar KunderUniara Tonk N.A.Hectare 14 Mazar SoothraUniara Tonk N.A.Hectare 15 Dargah KakodUniara Tonk 2.000000 Biswa 16 Mazar KakodUniara Tonk 1.000000 Bigha 17 Mazar KakodUniara Tonk 1.000000 Bigha 18 Maqbara Peer Sahib Banjari BinjariUniara Tonk N.A.Hectare 19 Mazar Mohammad GarhUniara Tonk N.A.Hectare 20 Mazaar Pahari GharDeoli Tonk N.A.Sq. Feet 21 Mazar DooniDeoli Tonk N.A.Sq. Feet 22 Dargah Peer NasirdaDeoli Tonk N.A.Hectare 23 Dargah Kalu Peer RajmahalDeoli Tonk 67.350000 Bigha 24 Mazar Peer Ji SendiyawasDeoli Tonk N.A.Hectare 25 Hindu Mazar Deoli (M)DeoliTonk N.A.Hectare 26 Dargah DeoliDeoli Tonk N.A.Hectare 27 Mazar (Dargah) DeoliDeoli Tonk N.A.Hectare 28 Dargah 937, 938, 939, PanwarDeoli Tonk 1.250000 Bigha 29 Mazar Peer Ji SendiyawasDeoli Tonk N.A.Hectare 30 Dargah Nasurullah Shah Sahib Niwai (Rural)Niwai Tonk N.A.Hectare 31 Dargah 4018, 4019, JhilaiNiwai Tonk 6.250000 Bigha 32 Mazar 4017 JhilaiNiwai Tonk 1.900000 Bigha 33 Dargah Peer Ji 107, 108, 109, 110, 138, 139, 142, 143, SirasNiwai Tonk 10.850000 Bigha 34 Dargah Khaki Shah Peer MaharajpuraNiwai Tonk N.A.Hectare 35 Mazar 1, Malpura (Rural)Malpura Tonk N.A.Hectare 36 Mazar 1 Malpura (Rural)Malpura Tonk N.A.Sq. -

Mamluk Architectural Landmarks in Jerusalem
Mamluk Architectural Landmarks 2019 Mamluk Architectural in Jerusalem Under Mamluk rule, Jerusalem assumed an exalted Landmarks in Jerusalem religious status and enjoyed a moment of great cultural, theological, economic, and architectural prosperity that restored its privileged status to its former glory in the Umayyad period. The special Jerusalem in Landmarks Architectural Mamluk allure of Al-Quds al-Sharif, with its sublime noble serenity and inalienable Muslim Arab identity, has enticed Muslims in general and Sufis in particular to travel there on pilgrimage, ziyarat, as has been enjoined by the Prophet Mohammad. Dowagers, princes, and sultans, benefactors and benefactresses, endowed lavishly built madares and khanqahs as institutes of teaching Islam and Sufism. Mausoleums, ribats, zawiyas, caravansaries, sabils, public baths, and covered markets congested the neighborhoods adjacent to the Noble Sanctuary. In six walks the author escorts the reader past the splendid endowments that stand witness to Jerusalem’s glorious past. Mamluk Architectural Landmarks in Jerusalem invites readers into places of special spiritual and aesthetic significance, in which the Prophet’s mystic Night Journey plays a key role. The Mamluk massive building campaign was first and foremost an act of religious tribute to one of Islam’s most holy cities. A Mamluk architectural trove, Jerusalem emerges as one of the most beautiful cities. Digita Depa Me di a & rt l, ment Cultur Spor fo Department for e t r Digital, Culture Media & Sport Published by Old City of Jerusalem Revitalization Program (OCJRP) – Taawon Jerusalem, P.O.Box 25204 [email protected] www.taawon.org © Taawon, 2019 Prepared by Dr. Ali Qleibo Research Dr. -

Survey of Islamic Art in the Holy Shrine of Ghasem (As) Ureh in the Damavand City of Tehran Province
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC August 2016 Special Edition SURVEY OF ISLAMIC ART IN THE HOLY SHRINE OF GHASEM (AS) UREH IN THE DAMAVAND CITY OF TEHRAN PROVINCE Atieh Youzbashi Master of Visual Communication, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran [email protected] Seyed Nezam Oldin Emamifar Assistant Professor of Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran [email protected] ABSTRACT Islamic art or the arts of Muslims is a part of art in Muslim society and not necessarily by Muslims. Although in some cases, this arts may not go with the ethics and rules of Islam. The impact of Islamic and regional culture in this arts is obvious. Islamic art is not an art that is only related to Islam. The “Islamic” does not only refer to the religion but also it refers to the rich culture and different types of people who live in Islamic lands. Familiarity with Islamic art in the shrines and the pictorial motifs in them leads to getting familiar with semiology. Arts used in the shrines are one of the most obvious representatives of Islamic culture and spiritual atmosphere. The way of doing the research is based upon the descriptive and analytic nature, and the way of compiling information is combined. The way of taking sample is not random (Chosen) and the way of interpreting and analyzing the information is both qualitative. Initially in this research, the basic of Islamic art are introduced and then the example of Islamic art in the shrine of Ghasem (AS) which include, wood carving, fretwork, girih tile, illumination and reticulated metal. -

Spiritual Rituals at Sufi Shrines in Punjab: a Study of Khawaja Shams-Ud-Din Sialvi, Sial Sharif and Meher Ali Shah of Golra Sharif Vol
Global Regional Review (GRR) URL: http://dx.doi.org/10.31703/grr.2019(IV-I).23 Spiritual Rituals at Sufi Shrines in Punjab: A Study of Khawaja Shams-Ud-Din Sialvi, Sial Sharif and Meher Ali Shah of Golra Sharif Vol. IV, No. I (Winter 2019) | Page: 209 ‒ 214 | DOI: 10.31703/grr.2019(IV-I).23 p- ISSN: 2616-955X | e-ISSN: 2663-7030 | ISSN-L: 2616-955X Abdul Qadir Mushtaq* Muhammad Shabbir† Zil-e-Huma Rafique‡ This research narrates Sufi institution’s influence on the religious, political and cultural system. The masses Abstract frequently visit Sufi shrines and perform different rituals. The shrines of Khawaja Shams-Ud-Din Sialvi of Sial Sharif and Meher Ali Shah of Golra Sharif have been taken as case study due to their religious importance. It is a common perception that people practice religion according to their cultural requirements and this paper deals rituals keeping in view cultural practices of the society. It has given new direction to the concept of “cultural dimensions of religious analysis” by Clifford Geertz who says “religion: as a cultural system” i.e. a system of symbols which synthesizes a people’s ethos and explain their words. Eaton and Gilmartin have presented same historical analysis of the shrines of Baba Farid, Taunsa Sharif and Jalalpur Sharif. This research is descriptive and analytical. Primary and secondary sources have been consulted. Key Words: Khanqah, Dargah, SajjadaNashin, Culture, Esoteric, Exoteric, Barakah, Introduction Sial Sharif is situated in Sargodha region (in the center of Sargodha- Jhang road). It is famous due to Khawaja Shams-Ud-Din Sialvi, a renowned Chishti Sufi. -
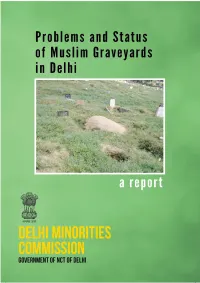
Problems and Status of Muslim Graveyards in Delhi
PROBLEMS AND STATUS OF MUSLIM GRAVEYARDS IN DELHI A REPORT DELHI MINORITIES COMMISSION Government of NCT of Delhi C- Block, First Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate New Delhi 110002 Cover photo: A scene from Batla House graveyard Study conducted for Delhi Minorities Commission By HUMAN DEVELOPMENT SOCIETY 27-O, Pocket 2, MIG Complex, Mayur Vihar, Phase 3, Delhi- 110096 Telephone: 011-22621867, 09971222966 Email: [email protected], [email protected] Website: www.hdsindia.org FOREWORD Delhi Minorities Commission is pleased to publish this study on Muslim graveyards in the NCT of Delhi. This study was commissioned by the previous Commission headed by Shri Qamar Ahmad but could not be finalised and published during its tenure. The new Commission, which took over on 20 July, 2017, found this study among the pending work. We took it up with due diligence and urgency. After going through the draft, we called a meeting with Human Development Society’s director and researcher. Now it is being published with some changes and addition of some information and data. This study is an eye-opener. It tells us that a majority of Muslim graveyards registered with Delhi Waqf Board (DWB) and other agencies has practically disappeared over the years. Both public and government agencies have occupied or encroached upon graveyards, while new land is not being earmarked for new qabristans in town-planning schemes. The study has found that the remaining space in the existing qarbristans is hardly enough for two more years. DMC will approach Govt. of NCT of Delhi and its agencies, especially Delhi Waqf Board and Delhi Development Authority, to quickly solve this grave problem before it is too late. -

Diversity and Transnational Links in Afghan Religious Education
Independent • International • Interdisciplinary PRIO PAPER 7 gate Hausmanns Address: Visiting Norway Oslo, NO-0134 Grønland, 9229 PO Box Peace Research Institute Oslo(PRIO) Beyond Borders: Diversity and Beyond Borders: Diversity and Transnational Links in Afghan Transnational Links in Afghan Religious Education Religious Education Visiting Address: Hausmanns gate 7 7 gate Hausmanns Address: Visiting Norway Oslo, NO-0134 Grønland, 9229 PO Box Peace Research Institute Oslo(PRIO) (CSCW) War Civil of Study the for Centre Do madrasas produce terror- han government has initiated the relationship between reli- ists? Are all madrasas funda- a comprehensive reform of the gious schools across the Afg- mentalist? In the aftermath of Islamic education sector, rais- han–Pakistani border. The 9/11, madrasas have become a ing important questions about present study hopes to remedy subject of great controversy. the independence of religious that, shedding light on some institutions and the role of the of the most critical issues and The growing insurgency in government in religious af- providing some recommenda- Afghanistan – and particularly fairs. That the religious educa- tions for change in policy. the increase in suicide attacks, tion sector in Afghanistan is coupled with the recruitment in need of change is a concern The report presents an over- of Afghan religious students shared by many within the view over the madrasas sector ISBN: 978-82-7288-362-0 978-82-7288-362-0 ISBN: www.studoisju.no 7 Studio Design: from Pakistani madrasas to government and the madrasa in Afghanistan; scrutinizes the the Taliban – has brought the sector. The question is what relationship between madra- topic of religious education to change should this entail, and sas in Pakistan and Afghanis- the centre of the Afghan state- how can it best be brought tan; examines the relationship building agenda.