Plan Local D'urbanisme Ou « P.L.U
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vide-Greniers Saison 2012
MARDI 3 AVRIL 2012 29 Vide-greniers Saison 2012 Dimanche 20 mai VERMENTON E5 Samedi 14 juillet Mercredi 15 août OUANNE D5 Mardi 1er mai VILLETHIERRY C2 PIFFONDS C3 CERISIERS D3 BRIENON-SUR-ARMANÇON D3 ARCES-DILO D3 CHAOURCE F3 SAINT-VALÉRIEN C2 CHAILLEY E3 Samedi 9 juin LINDRY D5 BEAUVOIR D5 ISLE-AUMONT F2 SENS (bd du Mail) C2 CHAMPIGNY (La Chapelle) C2 PARON C2 BEINE E4 MARAYE-EN-OTHE E2 AUXERRE CHICHERY D4 SAINT-LOUP-D’ORDON C3 GIVRY E6 Dimanche 23 septembre VAUCHASSIS E2 (Rugby-Club Auxerrois) D4 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE TAINGY D6 JOIGNY D3 CHÉU E4 Dimanche 6 mai (La Cour-Barrée) D5 Dimanche 10 juin MÉLISEY F4 Dimanche 15 juillet NAILLY C2 GRIMAULT F5 PONT-SUR-YONNE C2 AIX-EN-OTHE E2 BLEIGNY-LE-CARREAU E4 VALLERY C2 L’ISLE-SUR-SEREIN F6 GUERCHY D4 TANNERRE-EN-PUISAYE C5 JUNAY F4 JUSSY D5 VENOY (Montallery) E4 Dimanche 13 mai LAVAU B6 Dimanche 19 août PARLY D5 LAINSECQ C6 SAINT-LÉGER-VAUBAN F7 Dimanche 30 septembre AUXON E3 E5 NUITS G5 POILLY-SUR-SEREIN SENS (bd du Mail) C2 ARMEAU C3 MAROLLES-SOUS-LIGNIÈRES E4 C2 SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE D4 SENS (bddu Mail) G5 ASNIÈRES-SOUS-BOIS E6 APPOIGNY D4 E2 STIGNY MESNIL-SAINT-LOUP SERGINES C2 THIZY F6 E5 D4 NITRY AUXERRE (Club-Vert) PLANTY E2 TISSEY E4 TURNY E3 Samedi 21 juillet ORMOY D4 PRUNAY-BELLEVILLE E1 VILLEMANOCHE C2 POILLY-SUR-THOLON D4 Samedi 6 Samedi 26 mai SAINT-MARTIN-D’ORDON C3 YROUERRE F4 SAINTE-COLOMBE-SUR-LOING C6 et dimanche 7 octobre Jeudi 17 mai AUXERRE (Rivedroite) D4 Dimanche 22 juillet SENS (bd du Mail) -
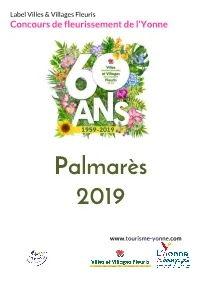
Palmarès 2019
Label Villes & Villages Fleuris Concours de fleurissement de l'Yonne Palmarès 2019 www. tourisme-yonne .com DÉPARTEMENT DE L'YONNE – CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2019 ______________________________________________________________________________________________________________________ LES COMMUNES DE L'YONNE LABELLISÉES VILLES ET VILLAGES FLEURIS LASSON - Yonne Tourisme © F. Dufer Communes Communes Communes Aillant-sur-Tholon/Montholon Bléneau Appoigny Arces-Dilo Cheny Avallon Champcevrais Chevannes Chablis Chichery-la-Ville Cravant/Deux Rivières Joigny Chitry-le-Fort Escamps Migennes Crain Gron Monéteau Étigny Lavau Paron Gland Quincerot Saint-Georges-sur-Baulches Gurgy Saint-Clément Saint-Julien-du-Sault L'Isle-sur-Serein Saint-Denis-lès-Sens Villebougis Lasson Saint-Privé Massangis Sauvigny-le-Bois Perrigny Tonnerre Commune Quarré-les-Tombes Toucy Sens Rogny-les-Sept-Écluses Villeneuve l'Archevêque Saint-Fargeau Saint-Florentin Sainte-Colombe-sur-Loing Val-de-Mercy Vaudeurs Villeneuve-sur-Yonne Yonne Tourisme - novembre 2019 DÉPARTEMENT DE L'YONNE – CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2019 ______________________________________________________________________________________________________________________ VILLES ET VILLAGES FLEURIS PROPOSITIONS DU JURY DÉPARTEMENTAL POUR 2020 Suite à ses visites du mois de juillet 2019, le Jury départemental a établi les propositions suivantes, qui seront évaluées en 2020 par le jury conjoint département-région mis en place en 2019 : Pour le label 1 fleur, les communes de : - CARISEY - 374 h. - COLLAN - 188 h. -

Evaluation of the Central Narthex Portal at Sainte-Madeleine De Vèzelay" (2005)
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2005 Evaluation of the central narthex portal at Sainte- Madeleine de Vèzelay Christine Ann Zeringue Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the Arts and Humanities Commons Recommended Citation Zeringue, Christine Ann, "Evaluation of the central narthex portal at Sainte-Madeleine de Vèzelay" (2005). LSU Master's Theses. 85. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/85 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. EVALUATION OF THE CENTRAL NARTHEX PORTAL AT SAINTE-MADELEINE DE VÉZELAY A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in The School of Art by Christine Ann Zeringue B.S., Louisiana State University, 2000 May 2005 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank Dr. Kirstin Noreen for her invaluable guidance and patience throughout the long process of creating this thesis. Without her continuing support I would never have completed my degree. Drs. Mark Zucker and Marchita Mauck also deserve my thanks for working me into their busy schedules by agreeing to serve on my graduate committee. I would also like to thank Professor H. Parrot Bacot for all the wonderful talks we had during the early preparations for my thesis. -

ANNUAIRE DES CLUBS (Présidents / Enseignants)
ANNUAIRE DES CLUBS (Présidents / Enseignants) AILLANT SUR THOLON AS SECTION JUDO STALPART Guillaume 13, rue des Autels 89710 SENAN 06.50.60.78.43 [email protected] http://perso.orange.fr/judoclubaillant ZIRNHELT Jean-Pierre Centre équestre du Centaure 8, rue des Presles 89410 CEZY 03.86.63.15.17 [email protected] APPOIGNY JUDO CLUB APPOIGNY BENIT Frédéric 14, rue du Jardin 89380 APPOIGNY 03.86.53.10.55 [email protected] CREVOT Mélanie 3, rue des Piochards 89250 SEIGNELAY 06.88.28.87.36 [email protected] AUGY FOYER RURAL D'AUGY COLIN Charles 1, rue des Bleuets 89290 AUGY 03.86.53.85.50 [email protected] PAPIN Patrick 3, faubourg Saint Laurent 89290 CHAMPS SUR YONNE 06.73.76.56.99 AUXERRE ARTS MARTIAUX STADE AUXERROIS PERREAU Stéphane Arts Martiaux Auxerrois / CSHA - Boulevard de Verdun 89000 AUXERRE 06.13.74.49.88. [email protected] http://www.amauxerre.com LAGERBE Jean-Marie 10, rue du Patis 89130 TOUCY 03.86.44.27.45 [email protected] AVALLON JUDO CLUB AVALLONNAIS CHARPENTIER Sylvain 28, rue des Rougelots 89200 ETAULES LE HAUT 06.75.08.47.03 [email protected] DE PINHO Pedro 28, rue de la Source - Vaux 89290 CHAMPS SUR YONNE 03.86.53.64.36 [email protected] BLENEAU JUDO CLUB POYAUDIN OLEJNIK Bruno 10, rue du Loing 89220 BLENEAU 03.86.74.84.17 [email protected] HUSSON Carole 45, faubourg de Dammarie 45230 CHATILLON COLIGNY 06.86.16.26.68 [email protected] BRIENON SUR ARMANCON SENTINELLE BRIENON HALLIEZ Eric 6, rue Racine 89400 MIGENNES 03.86.92.94.56 MICHOT Véronique 6, rue Racine -

Municipalité…………….…..………….….…1-7 Associations Et Manifestations…..…8-10
N°86 MAI JUIN 2019 SOMMAIRE Municipalité…………….…..………….….…1-7 Associations et manifestations…..…8-10 Municipalité Ouverture du bar « les 3 Cailloux » A louer - Local au cabinet médical Suite à un appel à candidatures, le bar des 3 cailloux Suite au départ de Mme Mandonnet, a trouvé des repreneurs : Laure et Yann. Le nouveau orthophoniste, un local au cabinet médical est à bar, qui a fait peau neuve, suite aux nombreux louer au tarif de 308,03€ / mois. Pour tous travaux entrepris par la commune, a été inauguré renseignements, veuillez prendre contact avec la le samedi 18 mai 2019 à 18h00. mairie. Venez-vous détendre et prendre un verre dans ce nouvel établissement, qui propose également de la restauration rapide, des soirées à thèmes (le vendredi et samedi) et de l’hébergement à l’étage. Ouverture du mardi au dimanche. Aménagement du centre bourg Le cabinet ECMO a présenté lors du dernier conseil municipal le projet d’aménagement du carrefour. Il a été décidé : - de sécuriser l’accès piéton, routier et cycliste aux établissements (écoles, maison de la jeunesse, commerces) - de mettre en cohérence le plan de circulation Laure et Yann, les repreneurs du bar « les 3 Cailloux » et le parcage des véhicules (vitesse excessive, 1 Municipalité stationnement anarchique, nombre de places Carte électorale de stationnement insuffisant), - de limiter la vitesse à 20 km/heure, - de créer 27 places de stationnement dédiées, - d’aménager et mettre en conformité l’accès des personnes handicapées et à mobilité réduite aux bâtiments et espaces publics, - de mettre en valeur la place principale de la commune, véritable carrefour de circulation pour les piétons accédant aux écoles, De nouvelles cartes électorales viennent d’être - d’identifier la place avec un revêtement de adressées à chaque électeur inscrit sur les listes surface différent de la voirie et des places de électorales. -

La Taxe D'aménagement
YONNE La Taxe d’Aménagement - TA - CompignyCompigny VinneufVinneuf Courlon-Courlon-Courlon- VilleneuveVilleneuve Plessis-Plessis- PerceneigePerceneige VilleneuveVilleneuve sur-sur-sur- sur-sur-sur- Saint-Saint- la-Guyardla-Guyardla-Guyard Saint-Saint- YonneYonne SerginesSergines YonneYonne JeanJeanJean PaillyPailly Saint-Maurice-aux-Saint-Maurice-aux- VilleblevinVilleblevin SerbonnesSerbonnes Riches-HommesRiches-Hommes ChampignyChampigny MicheryMichery ChaumontChaumont LaLa Thorigny-sur-OreuseThorigny-sur-Oreuse Saint-AgnanSaint-Agnan Saint-AgnanSaint-Agnan VillemanocheVillemanoche Chapelle-Chapelle- Gisy-les-Gisy-les- Chapelle-Chapelle- CourgenayCourgenay Pont-sur-Pont-sur- sur-sur- LaLa PostollePostolle Pont-sur-Pont-sur- NoblesNobles sur-sur-sur- LaLa PostollePostolle YonneYonne OreuseOreuse VillethierryVillethierry EEvvvrrryyy VillethierryVillethierry LaillyLailly BagneauxBagneaux VilleperrotVilleperrot CuyCuy VoisinesVoisines Saint-Saint- SoucySoucy LixyLixy VillenavotteVillenavotte Villeneuve-Villeneuve- SérotinSérotin Villeneuve-Villeneuve- Saint-Denis-lès-SensSaint-Denis-lès-Sens ValleryVallery Foissy-Foissy- l'Archevêquel'Archevêquel'Archevêque ValleryVallery Courtois-sur-Courtois-sur- Fontaine-la-Fontaine-la- LesLesLes Foissy-Foissy- BrannayBrannay Saint-ClémentSaint-Clément Gaillarde sur-sur-sur- NaillyNailly YonneYonne Saint-ClémentSaint-Clément GaillardeGaillarde ClérimoisClérimois sur-sur- MolinonsMolinons SalignySaligny DollotDollot Saint-Martin-Saint-Martin- VanneVanne FlacyFlacy VillebougisVillebougis Saint-Martin-Saint-Martin- -

Dossier De Presse
Dossier de presse Dossier de presse Sommaire La ville qui vous intéresse en 1 clic 3 | Communiqué de presse 4 | Sous le signe du numérique 5 | La programmation Bourgogne-Franche-Comté 5 > DOUBS 5 Besançon 6 Montbéliard 7 Valentigney 8 > JURA 8 Arbois 10 Dole 11 Gigny-sur-Suran 12 Moirans-en-Montagne 14 > HAUTE-SAÔNE 14 Fougerolles-Saint-Valbert 15 > CÔTE-D’OR 15 Dijon 17 Genlis 18 Saulieu 18 Semur-en-Auxois 19 > NIÈVRE 19 Cercy-la-Tour 19 Guérigny 20 Nevers 21 Pouilly-sur-Loire 23 Saint-Brisson 24 > SAÔNE-ET-LOIRE 24 Chalon-sur-Saône 24 Charnay-les-Mâcon 25 Dompierre-les-Ormes 25 Le Creusot 26 > YONNE 26 Auxerre 27 Étigny 28 Sens 28 Venoy 29 Villeneuve L’Archevêque 30 | Émilie Gauthier, ambassadrice 31 | Visuels téléchargeables 32 | La coordination et ses partenaires Fête de la science en Bourgogne-Franche-Comté — Dossier de presse — 16 Septembre 2020 — 16 Septembre Fête de la science en Bourgogne-Franche-Comté — Dossier presse 2 Communiqué de presse Texte pour CP Fête de la science 2020 29e Fête de la science « Planète Nature - Quelle relation entre l’Homme et la nature ? » Du 2 au 12 octobre 2020 Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la Fête de la science est le rendez-vous incontournable de tous les publics : familles, scolaires, étudiants, curieux, amateurs ou passionnés de sciences. Depuis 1991, la Fête de la science propose des milliers d’événements ouverts à tous, partout en France. Une thématique forte en prise avec l’actualité Cette année, la Fête de la science se décline selon une thématique qui fait écho à l’actualité récente : « Planète nature - Quelle relation entre l’Homme et la nature ? » L’interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale, rappelée de force avec la pandémie Covid-19, mais aussi le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité, nous poussent à nous interroger sur notre rapport à la nature et notre impact sur celle-ci. -

Recensement Des Bonnes Pratiques 2013
Réforme des Rythmes Scolaires et Éducatifs Groupe d’appui PEDT89 Recensement des bonnes pratiques 2013 Préambule Ce guide a vocation à accompagner les collectivités et leurs partenaires dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs et scolaires. Il a été élaboré par le groupe d’appui PEDT composé des partenaires suivants : DSDEN, DDCSPP, CAF, Francas, UDMJC, ACLM, Ligue de l’enseignement, USEP, PSY, à partir de l’étude des PEDT et d’une enquête réalisée en direction des territoires ayant appliqué la réforme à la rentrée 2013. Ce document reprend les choix faits par les collectivités lors des différentes étapes jugées indispensables à la mise en œuvre de la réforme. Il n’a pas vocation à être exhaustif et pourra être amendé autant que de besoin. Il peut venir en complément d’autres documents comme par exemple « Le guide pratique pour des activités périscolaires de qualité », téléchargeable, comme d’autres documents, sur les sites de la DSDEN ou de la DDCSPP en utilisant les liens suivants : • http://ia89.ac-dijon.fr/?reforme_des_rythmes_scolaires • http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse/Reforme-des-rythmes- educatifs-et-scolaires L’élaboration d’un PEDT n’est pas une démarche obligatoire pour la collectivité, toutefois il constitue une plus-value indéniable en permettant une large collaboration locale dont l’objectif est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire. Il permet un partenariat entre les collectivités, les acteurs éducatifs, les associations, les services de l’Etat, et favorise les échanges entre les acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs, …). -

Compte-Rendu Du 27 Octobre 2017
Commission Départementale F tball Compte rendu de la réunion du 27 octobre 2017 Membres présents José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Gilles BERNARD, Daniel FERTIN, Eric MASSÉ, Jean-Baptiste PEYRAUD Membres absents excusés Fany GILBERT, Jacky HERVOUET, Pascal CARLOT, David LAHAYE, Florence VIÉ Céline PARIGOT (représentante du comité directeur) Membre absent Nicolas BLAEVOET Thierry GILBERT a présenté sa démission pour convenance personnelle. Les membres de la commission le remercient pour son investissement durant toutes les années passées au sein de la CTD. La FFF a infligé à Christophe BONY une suspension de toutes fonctions officielles de 6 mois fermes, pour ne pas avoir noté les sanctions administratives sur un match. Christophe est suspendu également en UFOLEP jusqu’au 24 janvier 2018 de toutes fonctions officielles. Il reste par conséquent 2 places vacantes, jusqu’aux prochaines élections en fin de saison. Les membres de la commission souhaitent coopter 2 personnes pour intégrer la CTD. Les candidatures sont à envoyer à l’adresse mail suivante : [email protected] Point sur le championnat Seignelay : retrait de l'amende de 46 € pour manque d'arbitre lors de la saison précédente VENOY remplace l’exempt dans le groupe F SENS BRICOMAN remplace Domats 2 dans le groupe E 1ère journée de championnat du 24/09/17 Carton jaune (amende de 3 €) Rachid ACHOURI (Augy) Non communication du résultat dans les délais Esnon (amende de 4 €) Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Joigny (manque le nom de l’arbitre assistant) -

Liste Des Communes Du Territoire D'intervention De L'had Sud Yonne
Liste des communes du territoire d’intervention de l’HAD Sud Yonne Accolay Beugnon Chéu Aigremont Bierry-les-Belles-Fontaines Chevannes Aisy-sur-Armançon Billy-sur-Oisy Chevroches Alligny-Cosne Bitry Chichée Amazy Blacy Chitry Ancy-le-Franc Blannay Ciez Ancy-le-Libre Bleigny-le-Carreau Cisery Andryes Bléneau Clamecy Angely Bois-d'Arcy Collan Annay Bouhy Colméry Annay-la-Côte Branches Corvol-l'Orgueilleux Annay-sur-Serein Breugnon Cosne-Cours-sur-Loire Annéot Brèves Coulangeron Annoux Brosses Coulanges-la-Vineuse Appoigny Bulcy Coulanges-sur-Yonne Arbourse Bussières Couloutre Arcy-sur-Cure Butteaux Courcelles Argentenay Carisey Courgis Argenteuil-sur-Armançon Censy Courson-les-Carrières Armes Cessy-les-Bois Coutarnoux Arquian Chablis Crain Arthel Chailley Cravant Arthonnay Chamoux Cruzy-le-Châtel Arzembouy Champcevrais Cry Asnières-sous-Bois Champignelles Cuncy-lès-Varzy Asnois Champlemy Cussy-les-Forges Asquins Champlin Dampierre-sous-Bouhy Athie Champs-sur-Yonne Dannemoine Augy Champvoux Diges Auxerre Charbuy Dirol Avallon Charentenay Dissangis Baon Chasnay Domecy-sur-Cure Bazarnes Chassignelles Domecy-sur-le-Vault Beaumont Chastellux-sur-Cure Dompierre-sur-Nièvre Beaumont-la-Ferrière Châteauneuf-Val-de-Bargis Donzy Beauvilliers Châtel-Censoir Dornecy Beauvoir Châtel-Gérard Dracy Beine Chaulgnes Druyes-les-Belles-Fontaines Bernouil Chemilly-sur-Serein Dyé Béru Chemilly-sur-Yonne Égleny Bessy-sur-Cure Cheney Entrains-sur-Nohain www.hadfrance.fr CH d’Auxerre - 2 Bd de Verdun - 89000 AUXERRE - Tél : 03 86 48 45 96 - Fax : 03 86 48 65 50 -

Schéma Départemental Des Carrières De L'yonne 2012-2021
PRÉFET DE L'YONNE Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages Schéma départemental des carrières de l'Yonne 2012-2021 RAPPORT PRÉAMBULE Les activités de traitement et d’extraction de matériaux sont le premier maillon d’une filière économique indispensable au département. L’exploitation des roches meubles reste un élément essentiel de l’offre en matériaux nécessaires au développement des territoires. Toute région bénéficiant dans son sous sol de cette ressource se doit de la gérer dans les principes du développement durable. Outre les emplois directs (environ 500 personnes en 2010), l’activité induit également 1200 emplois locaux parmi les fournisseurs et entreprises sous traitantes (terrassement, transport routier, maintenance des équipements), dont le maintien sur le département est lié aux carrières locales. Par ailleurs, l’activité extractive répond aux besoins majoritairement de proximité, d’activités de transformation (béton, industrie du béton, production d’enrobés bitumineux) ou de construction et d’entretien des routes, de construction de bâtiments qui drainent un nombre important d’entreprises tant artisanales qu’industrielles pour lesquelles les modifications des chaines d’approvisionnement entrainent d’importantes perturbations qu’il est nécessaire d’anticiper et d’accompagner (formulations, adaptation des outils industriels, formation des artisans et des entreprises de mise en œuvre). Si l'importance économique du secteur ne peut être ignorée, en revanche, cette activité extractive ne peut se poursuivre ou se développer sans prendre en compte les préoccupations environnementales, et la nécessité de s'inscrire dans un développement durable par une gestion respectueuse et économe des ressources et une approche intégrée des enjeux eaux et biodiversité. -

Charbuy, Une Commune Rurale De Bourgogne Au Fil Du Temps
RECHERCHES & DOCUMENTS SUR LES PAYS DE L'YONNE COLLECTION THÉMATIQUE - N°3 @ Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne 1, rue Marie-Noël, 89000 Auxerre ILLUSTRATION DE COUVERTURE : Plan et contour de la paroisse de Charbuy (1765) Archives Départementales de l'Yonne G 1688 Composition et maquette : Hervé Chevrier Dépôt légal : 1er trimestre 2000 ISBN : 2-9511836-5-8 Denise NOËL CHARBUY, UNE COMMUNE RURALE DE BOURGOGNE AU FIL DU TEMPS Préface de Jean-Paul D ESAIVE, Président de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE L'YONNE i, rue Marie-Noël, 89000 Auxerre ULt-20031022-43253 2003-250520 a tradition des monographies de communes, villes ou villages, est particulièrement vivace en France, où elle a été illustrée par de nombreux L' travaux au XIX" siècle, dont beaucoup sous l'égide de sociétés savantes comme la Société des Sciences de l'Yonne. Si cette tradition persiste aujourd'hui, indifférente aux modes et aux changements de perspective qui ont profondément transformé l'historiographie, c'est sans doute qu'elle répond au désir qu'éprouvent les habitants de mieux connaître ou de découvrir le passé d'un lieu comme Charbuy, où certains (en minorité désormais) habitent depuis des générations, où d'autres (comme l'auteur lui- même) s'installent en nouveaux venus désireux comme on dit de « s'intégrer ». Le travail qu'a réalisé Mme Noël s'inscrit dans cette perspective classique et ses lecteurs trouveront probablement, rassemblées dans ce livre, les principales informations qu'ils en attendent. Elles sont, en gros, de deux sortes.