Dossier De Presse Jean Hélion 2004
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French
About the Table of Contents of this eBook. The Table of Contents in this eBook may be off by 1 digit. To correctly navigate chapters, use the bookmark links in the bookmarks panel. The Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French The Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French reveals the hidden cultural dimension of contemporary French, as used in the press, going beyond the limited and purely lexical approach of traditional bilingual dictionaries. Even foreign learners of French who possess a good level of French often have difficulty in fully understanding French articles, not because of any linguistic shortcomings on their part but because of their inadequate knowledge of the cultural references. This cultural dictionary of French provides the reader with clear and concise expla- nations of the crucial cultural dimension behind the most frequently used words and phrases found in the contemporary French press. This vital background information, gathered here in this innovative and entertaining dictionary, will allow readers to go beyond a superficial understanding of the French press and the French language in general, to see the hidden yet implied cultural significance that is so transparent to the native speaker. Key features: a broad range of cultural references from the historical and literary to the popular and classical, with an in-depth analysis of punning mechanisms. over 3,000 cultural references explained a three-level indicator of frequency over 600 questions to test knowledge before and after reading. The Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French is the ideal refer- ence for all undergraduate and postgraduate students of French seeking to enhance their understanding of the French language. -

Layout 1 (Page 5)
L’exercice imposé de l’Assemblée Générale n’a pas effrayé nombre d’entre vous et, lundi 17 mai, la Médiathèque du Centre Culturel Saint-Louis-de-France était comble pour faire le point sur la vie de notre association. Madame la Consul de France Hélène Larose, notre présidente d’honneur, nous a fait la joie d’être présente. Comme vous le constaterez dans le compte-rendu de cette assemblée publié dans les pages qui suivent, L’Union n’a pas failli, ces derniers mois, à sa vocation d’animer la communauté française de Rome, en lien avec ses amis italiens, et de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Les jours qui viennent, L’Union vous propose encore plusieurs rendez-vous, dont un tournoi de pétanque qui se terminera en fanfare devant notre Ambassade en Italie, le 13 juillet ! Notre cœur de Français devrait aussi vibrer au rythme des matchs de football de la Coupe du monde disputée en Afrique du Sud… Avant l’été, permettez alors que je pousse un cri que nos amis Italiens ne me reprocheront pas : Allez les Bleus édito (Forza Azzurri) !!! Antoine-Marie IZOARD Président sommaire No 462 / juin-juillet 2010 Revue de L’Union Français de Rome et du Latium publiée dix fois par an par l’association Directeur de la publication 3 Édito Carlo Rebecchi 4 Calendrier des activités Comité de rédaction Élodie Bauzon 5 Formulaire d’inscription à l’Union Anne-Sophie Bourgeois 6 79ème Assemblée Générale Francis Boussier Claire Boussier 12 Festival de musique - Le cinque perle del Barocco Anne-Laure Cartier de Luca 13 Programmation Centre culturel Saint-Louis -
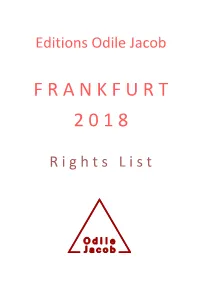
F R a N K F U R T 2 0
Editions Odile Jacob F R A N K F U R T 2 0 1 8 R i g h t s L i s t H I G H L I G H T S Jeanne SIAUD-FACCHIN Help Me to Live, Please! 4-5 Jacques TASSIN Think Like a Tree 6-7 Lucy VINCENT Make Your Brain Dance 8-9 L. & K. NACCACHE Do You Speak “Brain”? 10-11 Isabelle PERETZ The Power of Music 12-13 Alain CONNES The Specter of Atacama 14-15 Jean-Claude CARRIÈRE The Valley of Nothingness 16-17 Marc CRÉPON Inhuman Conditions 18-19 Alain EHRENBERG The Mechanics of Passions 20-21 Jacques DE LAROSIÈRE Ten Preconceived Notions That Are Leading Us to 22-23 Economic and Financial Disaster Kevin O’ROURKE A Short History of Brexit 24-25 Éric NATAF The Hidden Son of The Moon 26-27 Y O U M A Y H A V E M I S S E D Boris CYRULNIK God’s Psychotherapy Françoise HÉRITIER As Days Go By 28 Emmanuelle POUYDEBAT Animal Intelligence Jacques TASSIN What Do Plants Think About? Y. AGID & P. MAGISTRETTI Gial Man 29 Christophe ANDRÉ Come Meditate With Us Alain BRACONNIER Nobody Listens to Me! 30 Pierre GROSSER The History of The World Is Made in Asia Philippe ASKENAZY For A New Distribution of Wealth 31 S C I E N C E Jean-Didier VINCENT The Biology of Power 32 M. CASSÉ & M.-C. MAUREL Xenobiology 33 N. DERUELLE & J.-P. LASOTA Gravitational Waves 34 Anne-Lise GIRAUD The Brain and Speaking Disorders 35 É. -

Les Flandrin, Artistes Et Frères
HIPPOLYTE, PAUL, AUGUSTE LES FLANDRIN, ARTISTES ET FRÈRES NOTICES TECHNIQUES DÉTAILLÉES DES ŒUVRES Cette liste, établie par Elena Marchetti et Stéphane Paccoud, complète le catalogue publié dans le cadre de l’exposition organisée au musée des Beaux-Arts de Lyon en 2021. Liste des abréviations utilisées : b. : en bas h. : en haut Bibl. : bibliographie Hist. : historique c. : au centre Inscr. : inscription cat. : catalogue Inv. : inventaire d. : à droite loc. : localisé D. : daté repr. : reproduit Exp. : expositions S. : signé g. : à gauche Les numéros sont ceux employés dans le catalogue ; l’ordre dans lequel apparaissent ici les notices suit celui-ci. Les œuvres signalées par un astérisque ne sont pas présentées dans l’exposition. Les dimensions sont exprimées en centimètres, la hauteur précédant la largeur. La graphie originale a été respectée dans le relevé des inscriptions. La bibliographie indiquée, bien que se voulant la plus complète qui soit, ne prétend pas à l’exhaustivité. Les références abrégées renvoient à la bibliographie publiée en annexe du catalogue. Les listes d’œuvres en rapport ont été établies en ne prenant appui que sur un corpus connu de visu ou à tout le moins par des photographies. Les mentions anciennes imprécises, issues notamment de ventes, ont été délibérément écartées pour éviter le risque de méprise ou de doublon. 1 Hippolyte, Paul, Auguste. Les Flandrin, artistes et frères I. Trois frères artistes 1. PAUL FLANDRIN Portrait d’Auguste, vers 1829 Crayon graphite et estompe sur papier. 23 × 17 cm Hist. : fonds familial ; collection particulière. Exp. : Lyon 1904, no 595 (Portrait de A. F.). Collection particulière 2. -

À Quoi Sert La Philosophie ?
À quoi sert la philosophie ? François Dagognet, Jean-Pierre Faye, Robert Maggiori et Jacques Sojcher DOI : 10.4000/books.bibpompidou.1339 Éditeur : Éditions de la Bibliothèque publique d’information Année d'édition : 2006 Date de mise en ligne : 17 janvier 2014 Collection : Paroles en réseau ISBN électronique : 9782842461973 http://books.openedition.org Édition imprimée ISBN : 9782842460976 Nombre de pages : 28 Référence électronique DAGOGNET, François ; et al. À quoi sert la philosophie ? Nouvelle édition [en ligne]. Paris : Éditions de la Bibliothèque publique d’information, 2006 (généré le 02 février 2021). Disponible sur Internet : <http:// books.openedition.org/bibpompidou/1339>. ISBN : 9782842461973. DOI : https://doi.org/10.4000/ books.bibpompidou.1339. © Éditions de la Bibliothèque publique d’information, 2006 Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540 Paroles en réseau À quoi sert la philosophie ? François Dagognet Jean-Pierre Faye Jacques Sojcher Robert Maggiori À quoi sert la philosophie ? Actes de la manifestation organisée par la Bpi en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles le vendredi 18 juin 2004, dans la Petite Salle du Centre Pompidou. Cycle « Éclairages pour le XXIe siècle ». Président Débat du Centre Pompidou Conception Bruno Racine et organisation Florence Verdeille- Directeur général Osowski (Bpi) du Centre Pompidou Pierre Vanderstappen Bruno Maquart (Centre Wallonie- Bruxelles) Directeur de la Bpi Gérald Grunberg Publication Chargées d’édition Responsable du pôle Nathalie Nosny Action culturelle Arielle Rousselle et communication Dominique Tabah Mise en page Nathalie Nosny Responsable Édition / Diffusion Arielle Rousselle Catalogue disponible sur http : //www.bpi.fr, rubrique Publications de la Bibliothèque publique d’information Distribution numérique par GiantChair. com © Éditions de la Bibliothèque publique d’information / Centre Pompidou, 2005. -

Bruce Nauman Contrapposto Studies Punta Della Dogana Venezia 23.05.21 – 09.01.22
BRUCE NAUMAN CONTRAPPOSTO STUDIES PUNTA DELLA DOGANA VENEZIA 23.05.21 – 09.01.22 CURATORS: CARLOS BASUALDO AND CAROLINE BOURGEOIS 1 THE EXHIBITION 2 EXCERPTS FROM THE CATALOGUE 3 LIST OF WORKS 4 THE CATALOGUE 5 BIOGRAPHY OF BRUCE NAUMAN 6 BIOGRAPHY OF THE CURATORS APPENDICES 7 DIRECTOR OF PALAZZO GRASSI – PUNTA DELLA DOGANA 8 A FEW FIGURES 9 TEATRINO DI PALAZZO GRASSI 10 EDUCATIONAL SERVICES AND ACTIVITIES FOR THE PUBLIC 11 PALAZZO GRASSI ONLINE 12 DORSODURO MUSEUM MILE 13 MEMBERSHIP CARD 14 PRACTICAL INFORMATION 15 PINAULT COLLECTION 16 BOURSE DE COMMERCE 17 CHRONOLOGY OF THE EXHIBITIONS OF THE PINAULT COLLECTION PRESS OFFICES [email protected] France and international Italy and correspondents CLAUDINE COLIN COMMUNICATION PCM STUDIO 3, rue de Turbigo Via Farini 70 75001 Paris 20159 Milan Tel: +33 (0) 1 42 72 6001 [email protected] Dimitri Besse Tel: +39 02 3676 9480 [email protected] Federica Farci Thomas Lozinski Cell: +39 3420515787 [email protected] [email protected] www.claudinecolin.com www.paolamanfredi.com 1 THE EXHIBITION Palazzo Grassi—Punta della Dogana presents a major aimed to go beyond the limits imposed by the technol- exhibition dedicated to Bruce Nauman (1941, Indiana, ogy available in the late 1960s, the time when he pro- USA) at Punta della Dogana from 23 May 2021 to duced the firstWalk with Contrapposto. 9 January 2022. “Bruce Nauman: Contrapposto Studies” includes four “Bruce Nauman: Contrapposto Studies”, curated by recent works — one created specifically on the occasion Carlos Basualdo, the Keith L. and Katherine Sachs Sen- of the exhibition at Punta della Dogana and three which ior Curator of Contemporary Art at the Philadelphia have never been shown in Europe — that illustrate the Museum of Art, and Caroline Bourgeois, curator at Pin- artist’s modus operandi, consisting in the development ault Collection, is an homage to one of the major figures of themes and variations that often take the form of of the contemporary art international scene and focuses entire series. -

Press Kit Palazzo Grassi Punta Della Dogana Teatrino
PRESS KIT PALAZZO GRASSI PUNTA DELLA DOGANA TEATRINO 1 Biography of François Pinault 2 Biography of Bruno Racine 3 Pinault Collection 4 A few figures 5 Chronology of the exhibitions of Pinault Collection 6 Teatrino di Palazzo Grassi 7 Educational services and public programmes 8 Membership Card 9 Palazzo Grassi online 10 General information PRESS CONTACTS [email protected] France and international Italy and correspondents Claudine Colin Communication PCM Studio 3, rue de Turbigo Via Farini 70 75001 Paris 20159 Milan Tel : +33 (0) 1 42 72 60 01 Tel: +39 02 3676 9480 Dimitri Besse [email protected] [email protected] Paola C. Manfredi Thomas Lozinski Cell: +39 335 545 5539 [email protected] [email protected] www.claudinecolin.com www.paolamanfredi.com 1 BIOGRAPHY OF FRANÇOIS PINAULT François Pinault was born on August 21, 1936, in Champs-Géraux in Brittany. He established his first wood business in Rennes in 1963. Subsequently, he widened the scope of his activities and in 1988 the group went public on the French stock market. François Pinault decided to refocus the group’s activities on specialised sales before entering the luxury-goods sector worldwide in 1999, when he acquired the Gucci Group (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Boucheron…). In 2003, François Pinault entrusted the group to his son François-Henri Pinault who turned it into a world leader in the luxury goods sector. In 2013 the group is renamed Kering. In 1992, François Pinault created Artémis, a private company entirely owned by the Pinault fami- ly. Artémis owns the auction house Christie’s, the news magazine Le Point, the football club Stade Rennais, the leading cruise ship company Ponant and Artémis Domaine, which includes numerous vineyards in Bordeaux, including Château Latour. -

Charles Sandison Pour Le Quai Branly P.22
LI 180:Mise en page 1 08/04/2010 15:05 Page 1 DOSSIER REPORTAGE CHANSON QUATORZE RESTAURATION PRINTEMPS PROPOSITIONS DES VITRAUX DE BOURGES : NUMÉRISATION, FONDS... POUR DE LA SAINTE UN TREMPLIN LA PHOTOGRAPHIE LA LECTURE CHAPELLE VERS LE SUCCES AL’HEURE DES DÉFIS CULTURECOMMUNICATION LE MAGAZINE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION / AVRIL 2010 N° 180 « REGARDS CROISÉS SUR HAÏTI » DE JÉRÔME SESSINI ET PIERRE TERDJMAN EST PRÉSENTÉ AU MINISTÈRE DE LA CULTURE, ICI LE DÉTAIL D’UNE PHOTO DE PIERRE TERDJMAN ISSN : 1255-6270 LI 180:Mise en page 1 08/04/2010 15:05 Page 2 LE TEMPS FORT ACTUALITÉS Numérisation, collections, photojournalisme… La photographie à l’heure des défis CONSERVATION ET NUMÉRISATION DES FONDS PHOTOGRAPHIQUES, PROGRAMME DE NUMÉRISATION, PHOTOJOURNALISME… C’EST UNE RÉFLEXION « GLOBALE » SUR LA PHOTOGRAPHIE QUE FRÉDÉRIC MITTERRAND A LANCÉE LE 25 MARS LORS DE LA PRÉSENTATION DU PLUS ANCIEN FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE AU MONDE : LES RENCONTRES D’ARLES. EXPLICATIONS. EST une bonne nouvelle pour le photojourna- lisme français. Après sa mise en liquidation judiciaire, le groupe Eyedea – comprenant notamment les agences photographiques Gamma, Rapho ainsi que le fonds Keystone – a C’été repris le 6 avril par François Lochon, photographe chez Gamma depuis 1974. « Ce projet évite ainsi la dispersion d’un pan extrême- ment riche de notre patrimoine photographique et de l’histoire du photojournalisme français », s’est félicité Frédéric Mitterrand. Depuis plusieurs mois, la situation de ces sept agences de presse était particulièrement préoccupante. Les causes de leurs difficultés sont multiples, à commencer par l’évolution du marché de la presse © MCC/PLOWY et le développement des médias en ligne. -

Les 25 Ans De La Bpi Encyclopédisme, Actualité, Libre Accès
Les 25 ans de la Bpi Encyclopédisme, actualité, libre accès Dominique Arot, Chris Batt, Patrick Bazin, Martine Blanc-Montmayeur, Robert Damien, Claire Dartois, Christophe Evans, Françoise Gaudet, Claudia Lux, Michel Melot, Martine Poulain, Danielle Resche, Bernard Stiegler, Gary Strong, Valérie Tesnière, Caroline Wiegandt, Jean-Sébastien Dupuit, Gérald Grunberg, Racine Bruno et Jean-Pierre Seguin DOI : 10.4000/books.bibpompidou.866 Éditeur : Éditions de la Bibliothèque publique d’information Année d'édition : 2003 Date de mise en ligne : 17 janvier 2014 Collection : Paroles en réseau ISBN électronique : 9782842462062 http://books.openedition.org Édition imprimée ISBN : 9782842460785 Nombre de pages : 181 Référence électronique AROT, Dominique ; et al. Les 25 ans de la Bpi : Encyclopédisme, actualité, libre accès. Nouvelle édition [en ligne]. Paris : Éditions de la Bibliothèque publique d’information, 2003 (généré le 02 février 2021). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/bibpompidou/866>. ISBN : 9782842462062. DOI : https://doi.org/10.4000/books.bibpompidou.866. © Éditions de la Bibliothèque publique d’information, 2003 Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540 Les 25 ans de la Bpi Encyclopédisme, actualité, libre accès Les 25 ans de la Bpi Encyclopédisme Actualité Libre accès Actes du colloque international organisé par la Bibliothèque publique d’information au Centre Pompidou, les 23 et 24 octobre 2002. Président Chef du service des du Centre Pompidou relations internationales Bruno Racine Souad Hubert Directeur général Responsable Édition/Diffusion du Centre Pompidou Arielle Rousselle Bruno Maquart Colloque Directeur Conception et organisation de la Bpi Souad Hubert Gérald Grunberg Solange Harismendy Chef du pôle Publication Action culturelle Chargées d’édition et communication Juliette Lefebvre Dominique Tabah Anne Validire Cahier photos Juliette Lefebvre Mise en page, fabrication Anne Validire Nathalie Nosny Conception graphique de la couverture Claire Mineur Photos de couverture Page 1 : © Didier Loire/Bpi, 2002. -

Télécharger Le Livre Sur Notre Histoire
1 - LUIGI COMENCINI - JEAN-LOUIS COMOLLI - JOSÉE DAYAN - CLAIRE DENIS - DANTE DESARTHE - JÉRÔME DESCHAMPS - JACQUES DOILLON - XAVIER DOLAN - SERGE FRYDMAN - JEAN-CLAUDE GALLOTTA - CHRISTIANE GERHARDS - FRANCIS GIROD - JEAN-LUC GODARD - FIONA GORDON - ROMAIN GOUPIL - ŞERIF GÖREN - PIERRE GRANGE - RUY GUERRA - YiLMAZ GÜNEY - MICHAEL HANEKE - PASCAL HÉROLD - Pierre HODGSON - SERGE JULY - VITALI KANEVSKY - MARIN KARMITZ - A B Z E D I E L I L T L A A H T C I F E K N E N C E I H T I É C H - l E O - A R B B B A A H S C K E I A D R U O A S L T C A - M R I E - I K S R S Z O Y L S B Z K T O C I F R K T I A E P ś L - O C W N S A K L I B - C E É H D P R O I T C S I K R L A H P C I - S C T H N - O M M A L R E I B O N S E L L A I R N A E H - C P - H I N L O I P L P L E E B L E K C C L I E N R N C A - Y J - A L O I I L H C L C E S O L P L E E R B T O - K C E R N A L M O - A T C H A É - B P A S V E E L L L I L G O U - N S G A U B I N A E T R - L A O B U - I I S N M A A U L L L B E A - B M A A L C 40 ans apres.. -

Novembre-Décembre 2006
Bulletin officiel 158 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Bulletin officiel TEXTES ÉMIS EN NOVEMBRE DÉCEMBRE 2006 Bulletin officiel 158 Directrice de la publication : Martine Marigeaud Rédactrice en chef : Marie-Liesse Baudrez Secrétariat de rédaction : Centre de documentation juridique et administrative Mission de la coordination documentaire Contact : Véronique Van Temsche Contact abonnement : Ernestine Gomis Imprimerie du ministère de la culture et de la communication Ministère de la culture et de la communication Direction de l’administration générale Sous-direction des affaires financières et générales Centre de documentation juridique et administrative 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1. Tél : 01.40.15.38.29. Abonnement annuel : 50 ISSN : 1295-8670 2 Bulletin officiel 158 SOMMAIRE Mesures de publication et de signalisation Cabinet du ministre Page 7 Circulaire n° 2006/012 du 7 novembre 2006 relative à la mise en œuvre du programme « contrats d’accompagnement dans l’emploi - contrats d’avenir » dans le cadre du plan de cohésion sociale appliqué au secteur culturel. Page 8 Circulaire ministérielle n° 2006/013 du 18 décembre 2006 fixant les modalités de mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 3 juin 2004 relative aux dépôts d’œuvres d’art, mobiliers et objets d’art. Direction de l'architecture et du patrimoine Page 12 Arrêté n° MH.06-IMM.052 du 9 novembre 2006 portant classement parmi les monuments historiques de l’église de l’ancien couvent des Cordeliers à Valréas (Vaucluse). Page 12 Arrêté n° MH.06-IMM.053 du 12 décembre 2006 portant classement parmi les monuments historiques du demi rond-point et des murs de clôture du château de Bertangles (Somme). -

L'académie De France À Rome Fête Ses 350
LE QUOTIDIEN DE L'ART Pays : France Date : 12 FEV 16 Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.8-11 Journaliste : Carole Blumenfeld Page 1/4 Par Carole L'Académie de France à Rome Blumenfeld fête ses 350 ans À l'occasion des 350 ans de l'Académie de France à Rome fêtés ce week-end, les 13 et 14 février, Le Quotidien de l'Art a interrogé les quatre derniers directeurs de l'institution ainsi que la directrice actuelle, première femme occupant cette fonction. Au cours des vingt dernières années, le palais et ses jardins, où Balthus (directeur de 1961 à 1979) régnait toujours en maître dans les années 1980 et 1990, se sont considérablement transformés. Bruno Racine Directeur de 1997 à 2003 _•_ J'ai eté nommé en 1997 et j'avais alors deux priorités conforter l'Académie de France à Rome en tant que pôle d'excellence en histoire de l'art, et donner une plus grande visibilité à la création contemporaine À ce moment-là, la restauration de la façade de la terrasse du Bosco avait ete réalisée à titre un peu expérimental avec un enduit tres Une image : dense La façade sur jardin était déjà sous échafaudage et le conseil La photographie de scientifique etabli spécialement avait opte pour rendre à la Villa l'installation de Joseph Médicis son aspect du XVI5 siècle grâce à la technique un peu perdue Kosuth dans l'atelier du marmaino, ce mélange de stuc et de marbre J'ai mis en place pour du Bosco par daudio la première fois un schema directeur des travaux de restauration, afin Abate Bruno Racine de les prolonger de manière extrêmement méthodique et cohérente Photo D R sur 10 ou 15 ans, tout en lançant une réflexion avec Didier Repellin, Votre meilleur l'architecte en chef des monuments historiques, sur l'avenir des souvenir : décors Balthus.