Page 1 L E S F a V R E E N P a Y S D E T H O N E S Par
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cliquez Pour Visualiser Le Bulletin
Bulletin Municipal 2014 MENTHON-SAINT-BERNARD http://www.menthon-saint-bernard.fr/ Sommaire La lettre du Maire 2 Le conseil municipal 2014 - 2020 3 Les Finances de la Commune 4-5 Les travaux réalisés en 2013-2014 6-7 Les évènements de l’année à Menthon 8-9 La Communauté de Communes 10 de la Tournette Le SYANE 11 Le SCOT 12-13 1914 - 2014 14-15 enberg / Meythet • Papier écolabellisé enberg / Meythet • Papier 1944 - 2014 16 La vie scolaire 17 à 20 La vie associative 21 à 30 A l’honneur : Viviane Wolff 31-32 Photos couverture : Dominique Brione-Buland • Imprimerie Gut 1 La lettre du Maire Lors des élections municipales de mars 2014, vous m’avez renou- velé votre confiance et je tiens, une nouvelle fois, à vous en remercier. L’équipe municipale est ainsi à pied d’œuvre pour cette manda- ture 2014-2020 qui sera très vrais- semblablement concernée par la réforme territoriale annoncée par le Gouvernement. Lorsque nous en saurons davantage, je reviendrai vers vous pour vous en communiquer les grandes lignes, le calendrier et les conséquences pour notre Commune. nos recettes. Sur les exercices C’est dans ce contexte très 2014, 2015 et 2016, la baisse contraint que nous devons agir et, Quoi qu’il en soit, de nombreux des dotations de l’Etat dépas- vous l’aurez compris, nos marges dossiers sont sur la table du sera les 30 %, et se conjuguera de manœuvre vont être chaque Conseil Municipal et notamment avec l’effort spécifique demandé jour un peu plus réduites. celui de la reconstruction du aux Communes dites “riches” bâtiment de la plage pour lequel de participer à la péréquation Néanmoins nous avons la volonté l’équipe municipale devra se des recettes. -

Ocpyfdgv94dfk8.Pdf
Le Mot du Maire Après les élections de mars la nouvelle équipe municipale est en place avec neuf nouveaux conseillers. Sans atteindre la parité, le Conseil Municipal est nettement plus féminisé qu’auparavant (6 membres sur 15). Avec un fonctionnement déjà bien rodé, il est prêt à affronter les défis qui s’annoncent. 79 n° Communal Bulletin Ils prennent, dans certains domaines, des allures de révolution, comme si, 40 ans après mai 68, de grands changements s’imposaient mais initiés, cette fois, par les institutions. En matière d’environnement, la volonté de limiter la production de gaz à effet de serre (CO2 notamment) est bien réelle et se traduit par la loi du Grenelle I, votée en octobre et celle du Grenelle II prévue au printemps. Elles imposent des conceptions nouvelles dans l’aménagement du territoire, les modes de construction, la récupération et le traitement des déchets, etc., auxquelles l’adaptation sera parfois difficile. Dans le domaine de l’organisation administrative du territoire, des évolutions sont en cours qui augurent, à court terme, des changements radicaux. D’un côté la Réforme Générale des Politiques Publiques (RGPP) prévoit une restructuration de l’administration par la fusion entre services ou des concentrations et un renforcement du rôle de celle-ci au niveau régional. La traduction concrète, dans certains domaines, de cette évolution est celle du désengagement de l’État. D’autre part, une loi viendrait prochainement confirmer la volonté de restructurer le premier maillon de l’organisation territoriale en imposant un renforcement du rôle des communautés de communes au détriment progressif des communes. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial Du 06/07/2009
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS année 2009 date de parution 6 juillet 2009 ISSN 07619618 spécial Sommaire DELEGATIONS DE SIGNATURE...............................................................................................................................................3 Arrêté n° DDEA-2009-530 du 1er juillet 2009........ ................................................................................................................3 Objet : subdélégation de signature du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture (DDEA).....................3 Arrêté du 18 juin 2009..........................................................................................................................................................6 Objet : portant subdélégation de signature de M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes Centre-Est, en matière de compétence générale...............................................................................................................................6 Arrêté du 18 juin 2009..........................................................................................................................................................8 Objet : portant subdélégation de signature de M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes Centre-Est, pour l'exercice des compétences d'ordonnateur secondaire délégué..............................................................................8 Arrêté du 18 juin 2009..........................................................................................................................................................9 -

Inventaire Départemental Des Cavités Souterraines Hors Mines —R De La Haute-Savoie ' Rapport Final Convention MEDD N° CV04000065
•••, «> i, Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines —r de la Haute-Savoie ' Rapport final Convention MEDD n° CV04000065 ^ BRGM/RP-54130-FR V..,L , Septembre 2006 \ \ ' - - • :'11 ' "".. /^/ " -•/•..•'' F.9 3740/c-.t -615 5 l* íiwlii. RÉriJSLIQUt F brgGéosciencesm pour une Terre durable JÖ» Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Rapport final Convention MEDD n° CV04000065 BRGM/RP-54130-FR Septembre 2006 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2005 PSP04RHA06 O. Renault Avec la collaboration de D. Clairet Vérificateur : Approbateur : Nom : C. Lembezat Nom : F. Deverly Date : 12/10/06 Date : 14/11/06 Signature : Signature : Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. BRGM Geosciences pour une lene durable 2 0 DEC. 2006 BIBLIOTHEQUE brgm Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Mots clés : base de données, inventaire, département de la Haute-Savoie, cavités souterraines, cavités naturelles, carrières souterraines abandonnées, ouvrages civils et militaires En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : O. Renault avec la collaboration de D. Clairet (2006) - Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie. Rapport final. BRGM/RP-54130-FR, 47 p., 27 ill., 3 ann., 1 carte hors texte ® BRGM, 2006, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. BRGM/RP-54130-FR - Rapport final Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Synthèse Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des cavités souterraines, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD), a chargé le BRGM de réaliser l'inventaire des cavités souterraines abandonnées hors mines dans le département de la Haute-Savoie (Convention MEDD n° CV04000065). -

Publication of the Amended Single Document Following the Approval Of
16.3.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 89/19 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2021/C 89/08) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘REBLOCHON’/’REBLOCHON DE SAVOIE’ EU No: PDO-FR-0130-AM01 – 3.9.2020 PDO (X) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ is an uncooked cheese made from raw, whole cow’s milk, pressed in the form of a flattened, slightly tapered cylinder approximately 14 cm in diameter, 3,5 cm in height and 450 to 550 g in weight. It contains a minimum of 45 g of fat per 100 g after total desiccation and its dry matter must not be less than 45 g per 100 g of cheese. It has a fine, regular and uniform rind, which is washed during the maturing process. The rind is yellow to orangey- yellow in colour and may be fully or partly covered in a fine, short white bloom. -

Recueil Des Actes Administratifs N°74-2017-034
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°74-2017-034 HAUTE-SAVOIE PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 1 Sommaire 74_DDARS_Délégation départementale de l'Agence régionale de santé de Haute-Savoie 74-2017-02-02-010 - arrété A.R.S 2017- 0056 fixant la programmation prévisionnelle pour la période de 2017 à2021 des contrats pluriannuels d' objectifs et de moyens des établissements et services médico- sociaux accueillant des personnes handicapées relevant de la compétence conjointe de l' Agence Régionale de Santé Auvergne - Rhone- Alpes et du Conseil Départemental de la Haute - Savoie. (3 pages) Page 4 74-2017-03-16-002 - Arrêté n°2017-0630 du 6 mars 2017 confiant l'intérim des fonctions de directeur de l'Ehpad La Provenche à St-Jorioz (Haute-Savoie) et des Ehpad Alfred Blanc Faverges Chevaline à Faverges (Haute-Savoie) à M. Christian TRIQUARD, Directeur du Centre Hospitalier Gabriel Déplante à RUMILLY (Haute-Savoie) (2 pages) Page 8 74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie 74-2017-03-09-004 - Arrêté DDCS/PL/2017-0027 fixant pour l'année 2017 la valeur du seuil de ressources des demandeurs de logement social du 1er quartile prévu par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (2 pages) Page 11 74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie 74-2017-03-15-003 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources / arrêté 2017-0015 du 15 mars 2017 portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal donnée par Ludovic PEYTIER responsable de la trésorerie -
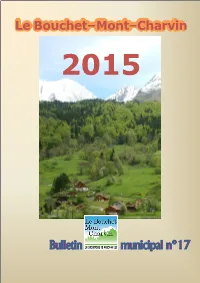
Bulletin N°17-12022015-V2docx
LeLe BouchetBouchet–- MontMont–Charvin-Charvin 20152015 1 Le mot du maire 2014 a été l’année du renouvellement de votre Conseil Municipal. Vous avez été nombreux à effectuer votre devoir citoyen. Je vous remercie de m’avoir accordé une nouvelle fois votre confiance. Je remercie également les conseillers qui se sont investis à mes cotés durant ces 6 dernières années. 2015, avec une nouvelle équipe toute aussi motivée, est un début de mandat qui s’annonce difficile et incertain pour nos communes rurales. Un climat économique et social morose a amené le gouvernement à mettre en place une réforme territoriale afin de réduire le déficit du budget de la France. Un profond remaniement territorial avec : - regroupement de régions et cantons - accroissement des compétences des intercommunalités - création de « commune nouvelle » Ceci sans aucune lisibilité sur les conséquences : qualité des services à la population, fiscalité, disparition programmée de nos communes rurales faute de moyens financiers. A ce jour, il est certain que cette réforme va impacter notablement notre budget communal : - Baisse de 10% sur la dotation globale de fonctionnement et ce pendant 3 ans. Et après !? - Augmentation du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales - Transfert obligatoire du service urbanisme à la CCVT en juillet 2015 ce qui va générer des frais de fonctionnement supplémentaires. Nous allons devoir préparer un budget en tenant compte des ces éléments. Nous devons continuer à investir pour maintenir la qualité des services rendus : mairie, école, routes, réseau d’eau, aménagement du cimetière, réhabilitation des assainissements non-collectifs… Depuis de nombreuses années, les taux de fiscalité de la commune n’ont pas augmentés et des travaux ont pourtant été réalisés. -

Liste Des Locations Vacances Sur Thônes Coeur Des Vallées
Liste des locations vacances sur Thônes Coeur des Vallées Nom Adresse Code postal / Ville Contact Tarif Le Grenier 40 route de la 74230 06 99 44 66 85 Charbonnière Les Clefs [email protected] m Le Grenier des José 12, Route du Manoir 74230 04 50 44 91 17 Thônes 07 68 62 88 46 [email protected] Débéduse 2 3 allée de 74230 04 50 02 03 58 Chantegrillet Thônes 06 81 20 68 08 06 83 64 49 03 [email protected] Chalet La Cha 147, Impasse Lachat 74230 04 50 02 15 95 d'En Haut Thônes 06 86 49 81 44 [email protected] La Clairière 9 rue du Lachat 74230 06 74 39 30 46 Résidence Les Thônes 06 72 48 53 84 Clairières A [email protected] https://www.gites-aravis.fr Chalet d'en Ô : l'Aiguille 34 route du Cropt 74230 06 19 21 00 21 Les Clefs [email protected] https://www.chaletsdonie.fr/ Les Besseaux B23 Résidence Les 74230 06 01 16 89 77 Besseaux B23 Thônes [email protected] 7 route des Besseaux om Les Picaillons - Le Gîte 248 route des 74230 07 68 39 60 68 Champs Courbes Les Villards-sur- emmanuelle.sylvestre@wanad Thônes oo.fr https://www.leschaletspicaillon s.com/ Location Charvin 4* 2 allée du Mont 74230 06 24 69 49 64 Charvin Thônes 06 11 07 74 30 [email protected] https://location- charvin.business.site/ Les Ecureuils Plan Vouthier 74230 04 50 23 35 24 Glapigny Thônes 06 87 73 59 18 Charmant T2 sur Thônes 11 rue Louis Haase 74230 06 66 58 74 45 Thônes 04 50 02 96 22 [email protected] Agréable deux pièces au coeur 5 route des Besseaux 74230 06 37 33 97 87 de Thônes Thônes [email protected] -
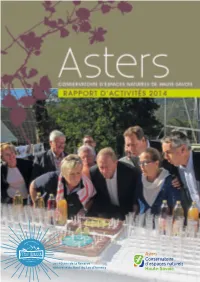
Asters-Ra 2014-V5.Pdf
Les 40 ans de la Réserve Naturelle du Bout du Lac d'Annecy Haute-Savoie PRÉSERVATION ET GESTION DU MILIEU NATUREL EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DES ESPÈCES p.13 les reserves naturelles, des “sites ateliers“ p. 6 Protéger et gérer P.19 Suivi faune : le Gypaète barbu p. 7 Connaître et suivre les évolutions P.20 Suivi flore p. 8 Sensibiliser et faire découvrir p. 9 Impliquer et intégrer P.21 Suivi des habitats p. 10 Les propriétés d'Asters PÉDAGOGIE ET COMMUNICATION Sommaire CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES TERRITORIALES p. 23 Animations pédagogiques p.12 Accompagner les territoires p. 24 La structure Asters p.13 Le réseau des espaces naturels sensibles p.26 Les réseaux et partenariats p.14 Action foncière p.27 Les partenaires privés p.15 Préservation des zones humides p.16 Eau en montagne POLITIQUE GÉNÉRALE Edito Par Christian SCHWOEHRER, directeur d’Asters Ce rapport d’activités illustre fort bien LE MOT DU PRÉSIDENT la diversité des activités conduites par Par Thierry LEJEUNE, président d'Asters Asters-Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie en 2014. NUL N’EST JAMAIS PERDU Malgré un contexte global difficile DANS LE DROIT CHEMIN (GOETHE) (perspectives de modification de l’organisation de la protection des Nous avons, les élus et les salariés de espaces naturels,…), les activités de notre association, eu plusieurs fois en notre association ont pu se poursuivre, 2014 l’occasion de nous demander si voire se développer comme prévu. Ces nous étions dans le DROIT CHEMIN. dernières sont en cohérence avec le projet Les doutes et les incertitudes sont associatif et nos quatre grandes missions qui structurent depuis nombreux, de plus en plus nombreux, liés 2013 ce bilan annuel. -

Recueil Des Actes Administratifs N°74-2016-030 Publié Le 6 Juillet 2016
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°74-2016-030 HAUTE-SAVOIE PUBLIÉ LE 6 JUILLET 2016 1 Sommaire 74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie 74-2016-06-15-009 - Convention de délégation CHORUS DDCS74 (4 pages) Page 4 74-2016-07-04-001 - DDCS/SG/2016 - 0114 portant attribution d'une subvention à l'association ASSFAM sise à Vénissieux pour des formations à l'accès aux droits (2 pages) Page 9 74-2016-07-04-002 - DDCS/SG/2016 - 0115 portant attribution d'une subvention à l'association YELEN sise à Ballaison pour des cours de gymnastique douce (2 pages) Page 12 74-2016-07-04-003 - DDCS/SG/2016 - 0116 portant attribution d'une subvention à l'université populaire Savoie Mont-Blanc sise à la Roche sur Foron pour des ateliers sociolinguistiques (2 pages) Page 15 74-2016-07-04-004 - DDCS/SG/2016-0117 portant attribution d'une subvention à l'IFAC de Thonon les Bains pour des ateliers sociolinguistiques (2 pages) Page 18 74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie 74-2016-06-28-009 - Arrêté n° DDT-2016-0996 portant déclaration sur les conditions d'exploitations et de rejet de la station d'épuration des eaux usées de l'agglomération d'assainissement de Serraval (350 EH) (10 pages) Page 21 74-2016-06-30-003 - Arrêté n° DDT-2016-1002 du 30 juin 2016 portant application et distraction du régime forestier à des parcelles - Demandeur : commune de THONON-LES-BAINS - Commune de situation : ARMOY (2 pages) Page 32 74-2016-06-27-007 - décision préfectorale au titre du contrôle des structures n° DDT SEA/CADR 2016-1001 -

European Commission
C 180/18 EN Offi cial Jour nal of the European Union 29.5.2020 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2020/C 180/12) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘EMMENTAL DE SAVOIE’ EU No: PGI-FR-0179-AM03 – 10.1.2020 PDO ( ) PGI (X) 1. Name(s) ‘Emmental de Savoie’ 2. Member State or Third Country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of product to which the name in (1) applies ‘Emmental de Savoie’ is a cooked pressed cheese made from cow's milk used in its raw state. It has a regular, wheel-like shape and a diameter ranging from 72 to 80 cm. It is more or less convex and has no edges or projecting parts. Its height varies from 14 cm (minimum vertical height at the outer rim) to 32 cm (maximum vertical height at the highest point). The wheel must weigh at least 60 kg after maturation. The finished product has a fat content of at least 28 %. The total dry extract, measured on a rindless part, is at least 62 % on the 75th day. -

HORAIRES ÉTÉ for Real Time Information TIMETABLES 2021 About Our Vehicles Please Do Not Hesitate to Consult the Geolocation Tool
Géolocalisez mon bus en temps réel HORAIRES ÉTÉ For real time information TIMETABLES 2021 about our vehicles please do not hesitate to consult the geolocation tool. — Du 19 juin au 4 septembre / From 19 June to 4 September — Information Covid-19 Nouvelles lignes New lines sur le territoire de la CCVT Édition juin 2021 - ©www.dsg-prod.fr - © Photos : D. Machet - Ne pas jeter sur la voie publique sur la voie : D. Machet - Ne pas jeter - © Photos Édition juin 2021 - ©www.dsg-prod.fr http://aravis.montblancbus.com [email protected] INFOS PRATIQUES SOMMAIRE USEFUL INFORMATION € Ligne payante € Ligne gratuite Vélos acceptés Service charged Service free of charge Bikes accepted Page • Tous les arrêts mentionnés sur les plans sont desservis, même s’ils Infos pratiques 2 Useful information ne figurent pas dans les tableaux horaires. / Every stop listed on the plan is served, even if not listed in the timetables. • Les horaires peuvent subir des retards en raison des difficultés Tarifs 4 Fares de circulation. En cas de mauvais temps ou de la fermeture d’une remontée mécanique, certains départs peuvent être supprimés. / Schedules may be delayed in case of traffic conditions. Some departures may be cancelled without notice in case of bad weather or ski lift closing. Plan de situation 5 Site plan • Les chiens sont acceptés à bord des véhicules. Tous doivent être tenus en laisse et les gros, obligatoirement muselés. / Dogs are Correspondances 6 Lines accepted on the bus. They must be kept on a lead. Big dogs have to be de lignes connections necessarily muzzled.