Cahiers D'ethnomusicologie, 25
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Toward a Theological Response to Prostitution: Listening to the Voices of Women Affected by Prostitution and of Selected Church Leaders in Addis Ababa, Ethiopia
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Middlesex University Research Repository Toward a Theological Response to Prostitution: Listening to the Voices of Women Affected by Prostitution and of Selected Church Leaders in Addis Ababa, Ethiopia Jennifer Andrea Singh OCMS, Ph.D. August 2018 ABSTRACT This feminist, qualitative research project explores how the voices of women affected by prostitution in Addis Ababa, Ethiopia, and of selected evangelical church leaders in that city, could contribute to a life- affirming theological response to prostitution. The thesis engages sociological and theological sources to interpret the data gathered; contextual Bible study sessions provided access to the women’s voices, and semi-structured interviews revealed church leaders’ perspectives. During conversations with the women, six core themes emerged, reflecting their contextual understanding of the social and theological ramifications of prostitution: their entrance into prostitution; God; sin; humanity (Christian anthropology); justice; and the church. The women articulated that: 1) prostitution was a means of survival; 2) God is a protective figure in their lives; 3) sin is equated with prostitution and uncleanliness; 4) humanity is rejecting; 5) injustice is a normalised experience; and 6) they are unwelcome in the church due to their status as ‘sinners,’ and have few expectations that the Christian church or its leaders would help them exit prostitution. These themes reportedly resonated with interviewed church leaders, who expressed empathy for the women. Bringing both sets of voices together in a discussion of the Story of the Prodigal Son (Luke 15:11-32), however, revealed several theological deficiencies held by the evangelical church that currently impede the formation of a life-affirming theological response to prostitution. -

Mondomix-58.Pdf
éDITO Mondomix.com A QUOI SERT LA MUSIQUE ? Benjamin MiNiMuM Au sein de certaines cultures, les musiques possèdent une fonc- tion précise. Air d´accompagnement de rituels, chants d’encou- ragements aux travaux agricoles, rythmes de guérisons... Cette conscience du rapport de l’homme au son organisé est, dans la musique classique indienne, poussée jusqu’à définir l’usage d’un raga en fonction d’une heure ou d’une saison. En Occident, LE SOMMAIRE ces notions ont disparu. Pourtant, à l’usage, on se rend compte DES MUSIQUES dans LE MONDE que l’on n’apprécie pas de la même façon un récital de kora, un concert de musique gitane ou un DJ set de cumbia electro selon le moment ou le lieu où ils se donnent. Les programmateurs des 04/08 - ACTUALITÉ festivals présentés dans ces pages ont connaissance de ces 07 - JOyce N’SANA // Bonne nouvelle données et les ont majoritairement appliquées dans la prépara- 08 - VALENTIN CLASTRIER // Live tion de leurs évènements. Ceci dit, il n’y a pas lieu d’établir de 10/19 - PORTRAITS règles strictes, car il n’est pas certain qu’il existe une heure et 10 - MARCO LACAILLE & SAMY PAGEAUX-WARO un lieu idéals à tous pour découvrir les musiques de Buika, Lo 12 - RAYESS BEK Griyo, Marco Lacaille, Rayess Bek, Tiganá Santana ou Fanfaraï. 13 - DJ TAGADA & RONA HARTNER A vous de voir (et d’entendre). 14 - FANFARAÏ 15 - TIGANA SANTANA 16 - BUIKA, en toute liberté 20/21 - TENDANCES AFRIQUE DU SUD : électro arc-en-ciel EN KIOSQUE 22 - DIS-MOI CE QUE TU ÉCOUTES ? ALAIN MABANCKOU 23/30 - CHRONIQUES DISQUES 33/49 - LE GUIDE DES FESTIVALS POUR LA Petite histoire… Avec l’aventure en kiosque démarre un nouveau chapitre de l’histoire de Mondomix, commencée le 21 mars 1998 sur Internet. -

The ABDC 2021 Workshop Descriptions and Bios
The ABDC 2021 Workshop Descriptions and Instructor Bios Table of Contents below alphabetical Ahava 2 Workshop Title: All the Feels 2 Workshop Title: Classical Egyptian Technique and Combos 2 Amara 3 Workshop Title: Let’s Prepare for an Amazing Week of Dance! - Free 3 Workshop Title: Let’s Talk about Swords 3 Amel Tafsout 4 Workshop Title: Nayli Dance of the Ouled Nayl 4 Workshop Title: City Dances: Andalusian Court Dance with Scarves 6 April Rose 8 Workshop Title: Dance as an Offering 8 Arielle 9 Workshop Title: Egyptian Street Shaabi: Mahraganat Choreography 9 Athena Najat 10 Workshop Title: Oriental Roots in Anatolia: Exploring the Greek branch of the Bellydance Tree 10 Bahaia 11 WorkshopTitle: Takht & Tahmila 11 DeAnna 12 Workshop Title: Spins and Turns! 12 Devi Mamak 14 Workshop Title: Hot Rhythms, Cool Head 14 Lily 15 WorkshopTitle: Rhythms 101 15 Loaya Iris 15 WorkshopTitle: Let’s Go Pop! Modern Egyptian Style Technique and Combos. 15 Nessa 16 WorkshopTitle: Finding the Muse Within 16 Mr. Ozgen 17 WorkshopTitle: Turkish Bellydance 17 WorkshopTitle: Romani Passion 17 Roshana Nofret 18 Workshop Title: Poetry in Motion: Exquisite Arms & Hands for All Dancers 18 Stacey Lizette 19 Workshop Title: By Popular Demand: A Customized Workshop Experience Based Exploring Common Challenges 19 Ahava Workshop Title: All the Feels Date/Time: Sunday, June 27, 2021,10-12pm Central Time Workshop Description: Do you need help with stage presence? Connecting to your audiences? Courage to push through the fourth wall on stage and fully entertain a crowd? Ahava presents exercises, tips and combinations on how to emote while on stage. -
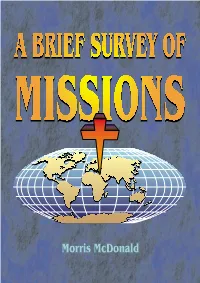
A Brief Survey of Missions
2 A Brief Survey of Missions A BRIEF SURVEY OF MISSIONS Examining the Founding, Extension, and Continuing Work of Telling the Good News, Nurturing Converts, and Planting Churches Rev. Morris McDonald, D.D. Field Representative of the Presbyterian Missionary Union an agency of the Bible Presbyterian Church, USA P O Box 160070 Nashville, TN, 37216 Email: [email protected] Ph: 615-228-4465 Far Eastern Bible College Press Singapore, 1999 3 A Brief Survey of Missions © 1999 by Morris McDonald Photos and certain quotations from 18th and 19th century missionaries taken from JERUSALEM TO IRIAN JAYA by Ruth Tucker, copyright 1983, the Zondervan Corporation. Used by permission of Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI Published by Far Eastern Bible College Press 9A Gilstead Road, Singapore 309063 Republic of Singapore ISBN: 981-04-1458-7 Cover Design by Charles Seet. 4 A Brief Survey of Missions Preface This brief yet comprehensive survey of Missions, from the day sin came into the world to its whirling now head on into the Third Millennium is a text book prepared specially by Dr Morris McDonald for Far Eastern Bible College. It is used for instruction of her students at the annual Vacation Bible College, 1999. Dr Morris McDonald, being the Director of the Presbyterian Missionary Union of the Bible Presbyterian Church, USA, is well qualified to write this book. It serves also as a ready handbook to pastors, teachers and missionaries, and all who have an interest in missions. May the reading of this book by the general Christian public stir up both old and young, man and woman, to play some part in hastening the preaching of the Gospel to the ends of the earth before the return of our Saviour (Matthew 24:14) Even so, come Lord Jesus Timothy Tow O Zion, Haste O Zion, haste, thy mission high fulfilling, to tell to all the world that God is Light; that He who made all nations is not willing one soul should perish, lost in shades of night. -

Dem (Däm) (A,Geez) 1. Blood; 2. Sap of Plant; Deem (O) Go ?? Dem Bahir
dem (däm) (A,Geez) 1. blood; 2. sap of plant; deem (O) go ?? Dem Bahir ../.. [Ch] Lake about a mile in diameter, formed in a depression on a lava field - lava blocks instead of mud can be seen on the bottom through the clear water. Close by is another similar lake, Kurt Bahir. [Cheesman 1936] HEF80 Dem Bet 11°36'/39°23' 1908 m 11/39 [Gz] HDK21 Dem Gijo 09°14'/37°41' 1688 m 09/37 [AA Gz] dema: demma (dämma) (A) bleed, make bleed; dema, deemaa (O) lustful, lewd, lecherous, promiscuous HED70 Dema, see Deyma HED92 Dema (area) 11/37 [WO] JEC50 Dema Lay Terara (Dema'lay T.) 11°19'/41°37' 831 m 11/41 [MS] JEC40 Demaali (Dema'ali), see Damahale JDC72 Demadegu, see Gicha GCU33 Demai 07/34 [WO] demb (dämb) (A) usage, established custom, rule HBL37 Demb (Uamore Demb?) (area) 03°54'/39°08' 03/39 [WO Gz] HFF23 Demba Mikael (church) 13°49'/39°41', east of Wikro 13/39 [Gz] dembal doro: dooro (Som), doro (A) chicken HBM73 Dembal Doro (Dembeldora, Dambaldoro) 04/39 [Gz LM WO] 04°19'/39°38' 1133 m HDE37 Dembala (area) 08/39 [WO] dembar (T) awkward, bashful; dembara (A) border, boundary; denbari (dänbari) (A) shy, skittish HCK78c Dembara, 2120 m, cf Denbera, Dimbira 07/38 [Gu] HCK79 Dembara 07°01'/38°20' 1789 m 07/38 [Wa Gz] HC... Dembara, see Denbara Kela ?? Dembaro ../.. [20] Menilek made submission to Yohannes IV at his camp at Dembaro on 20 March 1878 in an elaborate ceremony. Menilek was crowned King of Shewa on 26 March. -

Dissertation Draft 3
BIOMEDICAL DISENCHANTMENTS: PRACTICES, DISCOURSES, AND IMAGINARIES OF TRANSNATIONAL BIOMEDICALIZATION IN RURAL ETHIOPIA BY STEPHANIE MARGRIT RIEDER DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2016 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Associate Professor Zsuzsa Gille, Chair Associate Professor Claire Laurier Decoteau, University of Illinois Chicago Associate Professor Brian Dill Associate Professor Assata Zerai ABSTRACT This dissertation examines practices, discourses, and imaginaries of biomedicine within hospital spaces produced by transnational processes in a rural Ethiopian community. I examine how Ethiopian and volunteer American physicians navigate intersections of globalized standards and technologies with site-specific clinical realities and sociopolitical structures to provide patient care and engage in professionally-satisfying endeavors. Extending sociological theories of biomedicalization into this postcolonial space constructed by unpredictable mobilities of global health technologies, but largely disconnected from formal networks of biocapital reveals biomedical imaginaries of physicians in tension with severely limited material and symbolic resources. The instability that characterizes biomedicine in Gelel, Ethiopia, is evident in physician practices and discourses in two community hospitals, representing different forms of institutional governance and fraught engagements with -

Regaining a Perspective on Holistic Mission: an Assessment Ofthe Role Ofthe Wolaita Zone Kale Heywet Church in Southern Ethiopia
Regaining a perspective on holistic mission: An assessment ofthe role ofthe Wolaita Zone Kale Heywet Church in Southern Ethiopia H.T. Wotango, Rev. Student~o.210694l7-2007 Mmi-dissertation submitted in Partial fulfillment ofthe requirements ofMasters of Arts (Missiology) in the Faculty ofTheology ofthe North West University .... Supervisor: Prof. Dr. T.D. Mashau Co-Supervisor: Dr. ~adine Bowers Du Toit Potchefstroom Campus. ~ovember 2009 Acknowledgements The involvement of various people in the process of -writing this dissertation needs to be acknowledged. First, I would to extend my appreciation to Prof. T.D. Mashau who was my supervisor at the North West (NWU) and contributed an invaluable part in the structure and over all supervision ofthe work. Secondly, my warm and deep appreciation goes to Dr. Nadine Bowers Du Toit who is my co-supervisor. She has been involved in my work extensively making both grammatical and conceptual corrections with vigilant and inspiring approach. She worked with me almost each and every big and small steps and has been a source of great encouragement to me to work to its final stage. Thirdly Mrs. Lorraine Seccombe's commitment in editing this dissertation is a noteworthy input. She contributed a significant part to add flavor to the work language wise. I am also indebted to George Whitfield College (GWC) faculty and administration who have been involved in one or the other way in the course ofthis work, especially Dr. David Seccombe, the principal of the college, who closely followed up the process of the -writing in order to it on time and made possible my whole education through the financial support from sources related to the college. -

With Recourse to the Broader Ethiopian, Evangelical and Biographical Contexts, Identify the Missional Motivations and Strategies of Dick Mclellan
With recourse to the broader Ethiopian, evangelical and biographical contexts, identify the missional motivations and strategies of Dick McLellan. S.T.F. (the author is in a missionary location overseas and has asked that for security reasons his initials rather than his full name be indicated as the author of the article) Voyaging across the Indian Ocean, Dick and Vida McLellan wrote: ‘anyone on board that we mention to that we are going to Africa, looks at us as though we are crazy. With all the uncertainty in Africa today, we, too would much rather stay at home where we are free and safe’.1 Nevertheless, this self-confessedly ‘very ordinary Australian couple’ would serve for twenty years as missionaries with Serving in Mission (SIM) in Ethiopia (1954–1974).2 There, they would pioneer the evangelisation of unreached tribes and fan flames of revival. Thereafter, despite having returned to Australia with four children, and in the face of the Socialist uprising of 1974, Dick would visit Ethiopia over twenty times to encourage the underground church. This paper seeks to explain both the motivations and strategies of Dick McLellan as he ministered in this unique context. It is by analysis of early correspondences, later books, and recent interviews that his missional motivations and strategies will be identified. We will argue for five major motivators that inspired McLellan’s missionary endeavours: his conviction that there is only one way to be saved, that much of southern Ethiopia was unreached, that all Christians have a responsibility for mission, that he was personally called to go, and the encouragement received from observing church growth. -

Rhythms and Rhymes of Life
RHYTHMSRHYMES AND RHYTHMS AND RHYMES OF LIFE Rhythms and Rhymes of Life: Music and Identification Processes of Dutch- Moroccan Youth is a comprehensive anthropological study of the social significance of music among Dutch-Moroccan youth. In the Netherlands, a Dutch-Moroccan music scene has emerged, including events and websites. Dutch-Moroccan youth are often pioneers in the Dutch hip- OF hop scene, using music as a tool to identify with or distance themselves from others. They (re)present and position themselves in society through LIFE music and musical activities. The chapters deal with the development of the Dutch-Moroccan music scene, the construction of Dutch-Moroccan identity, the impact of Islam on female artists and the way Dutch- Moroccan rappers react to stereotypes about Moroccans. All along, Dutch society, its struggles with multiculturalism and its debates on integration, the position of Islam and fear of terrorism, form the backdrop to this story. RHYTHMS AND MIRIAM GAZZAH Miriam Gazzah has studied Mediterranean studies at the Radboud RHYMES OF LIFE University Nijmegen. She graduated in 2001. Her master thesis focused on the development of the raï music subculture in the seventies, eighties and nineties in Algeria. Between 2003 and 2007 she was a PhD Fellow at MUSIC AND IDENTIFICATION International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) in Leiden and the Radboud University Nijmegen. PROCESSES OF DUTch- ISBN 978 90 8964 062 8 MIRIA MOROCCAN YOUTH M GAZZAH Miriam Gazzah ISIM ISIM DISSERTATIONS ISIM AUP-ISIM-PS-Gazzah-OM-04.indd 1 17-07-2008 12:54:08 RHYTHMS AND RHYMES OF LIFE MUSIC AND IDENTIFICATION PROCESSES OF DUTCH- MOROCCAN YOUTH Miriam Gazzah Cover illustration: Bert Smits, www.bertsmits.com Cover design and lay-out: De Kreeft, Amsterdam ISBN 978 90 8964 062 8 E-ISBN 978 90 4850 649 1 NUR 761 © ISIM / Amsterdam University Press, Amsterdam 2008 Alle rechten voorbehouden. -

The Textuality of Contemporary Hiplife Lyrics
THE TEXTUALITY OF CONTEMPORARY HIPLIFE LYRICS by PETER ARTHUR A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Centre of West African Studies School of History and Cultures University of Birmingham Edgbaston Birmingham, B15 2TT University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. ABSTRACT This research looks at the textuality of hiplife - the Ghanaian version of hip hop - by investigating the hiplife discursive and non discursive practices. The thesis of this research is that hiplife provides the platform for self expression or a new culture for the Ghanaian youth. This ethnography of hiplife covers two main areas of investigation: hiplife as a syncretic and a protest culture. Chapter one presents the background and research design of the study while chapter two provides a broad scholarly exploration of hiplife, taking into account the history and culture of hiplife against the background of African hip hop literature. Chapter three explores the cultural production of hiplife while chapter four investigates the very core of hiplife rap, its oral rhythmic production. In chapter five, the hiplife culture, like all hip hop cultures, seeks to redefine the Ghanaian normative moral grounds. -

Local History of Ethiopia Gama - Garumuda © Bernhard Lindahl (2005)
Local History of Ethiopia Gama - Garumuda © Bernhard Lindahl (2005) ?? Gam (historically recorded area) ../.. [Pa] Emperor Bä'edä Maryam (1468-1478) despatched Jan Zeg, the local ruler of Bali, into the nearby country of Gam, but he was killed and his army routed. [Pankhurst 1997 p 110] gama, game (A) kind of shrub or small tree, Ehretia cymosa var. silvatica; gama (O) 1. joy, consolation; 2. other side, beyond /the border/; gamaa (O) militant; gama' (Som) fall asleep, sink; gama (T) bandage HDG02 Gama 1832 m, cf Geme 09/35 [WO] HED82 Gama (mountain) 2275/2680 m 11/37 [Gu] JCT35 Gama (area) 07/43 [WO] JDK22 Gama (Bur Gul Gama) (hill) 2135/2154 m 09/42 [Gu WO] JDK22 Gama, see under Jijiga gamaad: gemed (gämäd) (A) string JDE73 Gamaad (area) 08/43 [WO] JEG54 Gamabolu (mountains) 658 m 12/40 [WO] HCR38 Gamachisa (Gamacisa, Ghemachisa) 07/35 [+ Gu n] HCR38 Gamachisa 07°31'/37°22' 1949 m gamachisu (O) 1. joy, delight, pleasure; 2. glad, pleased HCN15 Gamadura, see Gemadura HDG48 Gamalimo, see under Nejo 09/35 [WO] HEH46 Gamandi Maryam (G. Mariam) (church) 12/36 [LM WO] HDL79 Gamanya (Gamania) 09°43'/39°19' 2681 m 09/39 [n] HCF05 Gamara (area) 05/39 [WO] gamarri: gamaari (Som) extinguish, put out fire JEC92 Gamarri (Gamari) (area) 11/41 [WO MS] JEB93 Gamarri (lake)coord.11°40'/41°00' wrong? 11/41 [x] JEH09 Gamarri (Ounda Gamarri) (high plateau) 11/41 [Gu WO] gamas (O) opposite, across from; (Som) small spear HDE95 Gamasa (area), cf Gemase 09/38 [WO] HCK93 Gambata (Gambatta, Cambatta) 07°20'/37°50' 2400 m 07/37 [WO Gz] (mountains) coordinates -

Tese Não Defendida Na Unila
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURAS ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA LARISSA FOSTINONE LOCOSELLI De rocks, murgas e maracatus: o fazer musical e a construção do “local” sob o neoliberalismo latino-americano da virada de século. Um estudo comparativo das bandas Bersuit Vergarabat (Argentina) e Chico Science & Nação Zumbi (Brasil) São Paulo 2019 Versão Corrigida LARISSA FOSTINONE LOCOSELLI De rocks, murgas e maracatus: o fazer musical e a construção do “local” sob o neoliberalismo latino-americano da virada de século: Um estudo comparativo das bandas Bersuit Vergarabat (Argentina) e Chico Science & Nação Zumbi (Brasil) Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Doutora em Letras. Orientador: Prof. Dr. Adrián Pablo Fanjul São Paulo 2019 Versão Corrigida Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Catalogação na Publicação Serviço de Biblioteca e Documentação Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo Locoselli, Larissa Fostinone L819r De rocks, murgas e maracatus: o fazer musical e a construção do “local” sob o neoliberalismo latino- americano da virada de século. Um estudo comparativo das bandas Bersuit Vergarabat (Argentina) e Chico Science & Nação Zumbi (Brasil) / Larissa Fostinone Locoselli ; orientador Adrián Pablo Fanjul. - São Paulo, 2019. 304 f. Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.