Chapitre 5 Abolition De L'esclavage Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Captivity and Identity in Aphra Behn's Oroonoko Or, the Royal Slave
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE جامعة مولود معمري - تيزي وزو UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU كلية اﻵداب واللغات FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES DEPARTEMENT D’ANGLAIS Domaine : Lettres et Langues Etrangères. Filière : Langue Anglaise. Spécialité: Media and Cultural Studies. Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in English Captivity and Identity in Aphra Behn’s Oroonoko or, The Royal Slave (1688) and Penelope Aubin’s The Noble Slaves (1722). Presented by: Supervised by:Mrs.Kahina LEGOUI Djamila BOUAZIZ Karima RAIAH Board of Examiners: Mrs. Tabti Kahina, M. A. A, Department of English, Chair. Mrs. Abdelli Fatima, M. A. A, Department of English, Examiner. Mrs. Legoui Kahina, M.A.A, Department of English, Supervisor Promotion: December 2016 N° d’Ordre : …………… N° de série : …………… Laboratoire de domiciliation du master: Etudes des Langues et Cultures Etrangères. To: my dear parents Ali and Baya my dear brother Salim my dear sister Houria my best friends Djamila To: my dear parents Said and Djouher my dear brothers especially Mouloud my dear sisters my best friends Karima I Acknowledgements We would like to thank our supervisor Mrs. LEGOUI for her precious help and assistance in the realization of this dissertation. We would like also to thank our teachers for their guidance and advice all along the academic year and for all the teachings they provided us with. Special thanks must go to our parents and our friends who have provided us with moral support and encouragement. II Content Acknowledgements ………………………………………………………………….………I Abstract………………………………………………………………………………………IV I. -

BEDDA Hafsia 2020 (Th) Le Déclin Des Systèmes De Production Camelins Et Les Conditions De Leur Survie Économique Au Sahara Se
UNIVERSITE KASDI MERBAH-OUARGLA Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Département des Sciences Agronomiques Année : 2020 N° d'enregistrement : /......../…....../…...../…....../ THESE pour l’obtention du Diplôme de Doctorat ES- Sciences en Sciences Agronomiques Spécialité : Agronomie Saharienne Le déclin des systèmes de production camelins et les conditions de leur survie économique au Sahara septentrional Algérien cas de la Cuvette de Ouargla, le M’zab et le Ziban Présentée et soutenue publiquement par : BEDDA Hafsia le 25/11/ 2020 Devant le jury composé de : Mr. SENOUSSI A. Professeur 8.02XDUJOD Président Mr. ADAMOU A. Professeur 8.02XDUJOD Directeur de thèse Mr. BOUAMMAR B. Professeur 8.02XDUJOD Co- Directeur de thèse 0U+8*8(1,1-'LUHFWHXUGH5HFKHUFKH&,5$')UDQFH &R(QFDGUDQWGH7KqVH Mr. ABBAS K. Professeur ,15$$6pWLI Rapporteur Mr. OUACHEM D. Professeur 8QLYHUVLWp%DWQD Rapporteur Mr. HARHOURA K. Professeur (169$OJHU Rapporteur Année universitaire : 2019/ 2020 La présente Thèse de Doctorat entre dans le cadre du projet CAMED Dz - ERANETMED 2-72-367 - intitulé : Roles of Camel Breeding in Modern Saharan Societies - Contributing to their Adaptive Capacities Face to Global Changes- Dédicaces À ma famille, mes enseignants, mes amis, mes collègues et toutes personnes ayant contribué à l’élaboration ce modeste travail. Remerciements Au terme de ce modeste travail, il m'est agréable de remercier vivement tous ceux et celles qui, grâce à leurs aides précieuses, m’ont permis la réalisation de ce travail. Je tiens à remercier mon directeur de thèse le Professeur ADAMOU Abdelkader, enseignant-chercheur, Département des Sciences Agronomiques, Université Kasdi Merbah Ouargla, pour le choix d’un sujet d’actualité et d’avoir accepté de m’encadrer ; je le remercie aussi pour ses orientations et pour sa patience avec moi. -

HIST 292H: Race and Slavery in North Africa Spring 2010
HIST 292H: Race and Slavery in North Africa Spring 2010 Instructor: Professor Ahmed El Shamsy ([email protected]; Hamilton 414; 962-3970) Office hours: Mondays, 1:00-2:00 pm; Tuesdays, 1:00-2:00 pm; and by appointment Class meetings: Mondays, 2:00-4:50 pm, in Davie 101 Final examination: Monday, May 3, 4:00 pm Course description: This course explores the historical record of slavery in North Africa, and analyzes its relationship to changing conceptions of race in North African societies. Between the Muslim conquest of North Africa in the seventh century and the official abolition of slavery in the region in the nineteenth century, millions of men, women, and children lived in or passed through North Africa as slaves. Many served as laborers, servants, concubines, and soldiers; others became artists, scholars, saints, and sultans, even founding dynasties based on slave rule. Today, in spite of official decrees, forms of slavery persist in North Africa, and perceptions of racial and ethnic differences play a role in present-day conflicts from Niger to Darfur. The course investigates the key factors that have shaped the varied institution of slavery in North Africa; these include the principles of Islamic law and prophetic ethics, the values and prejudices of particular cultures, the Roman system of slavery that predated Islam in the region, environmental change and economic stress, and the changing relations between minorities, majorities, and states. An examination of the phenomenon of slavery thus offers a window into the cultural and economic history of North African societies. In addition, it provides a contrast to the very different form of slavery—predicated on distinctive notions of race and racial superiority—that characterized the transatlantic world and that continues to dominate our vision of this major historical phenomenon. -

Captivity and Encounter: Thomas Pellow, the Moroccan Renegade By: Mark Celinscak
Captivity and Encounter: Thomas Pellow, The Moroccan Renegade By: Mark Celinscak …[A] feature of Oriental-European relations was that Europe was always in a position of strength, not to say domination.1 - Edward Said During the seventeenth and early eighteenth centuries, European powers came into close contact with a number of vibrant and dominant Islamic cultures. The Barbary Coast of North Africa was an area of particular significance. Due to its proximity to the Mediterranean Sea, North Africa became a zone of British imperial enterprise. The region was of strategic military importance, and because of the strength and reach of the Ottoman Empire, it was also a rich market for overseas trade. Nevertheless, the expansion of the empire into North Africa had considerable consequences for Britain. Between 1600 and the end of the eighteenth century there were approximately 20,000 British captives in North Africa.2 Barbary corsair fleets targeted Christian shipping vessels, pillaging the goods and detaining the people on board. Those who had been captured were returned to North Africa and either sold as slaves or imprisoned. While some individuals died in captivity or remained slaves, others managed to acclimatize and enter North African society. A small few were able to escape and return home. Among those few was Thomas Pellow, an English captive who managed to flee North Africa and tell his story. This paper will examine Pellow’s experiences before, during, and after his captivity in North Africa. The primary focus will be on his encounters with his Muslim masters, specifically on the ways in which Pellow responded to slavery, the religion of Islam, and Moroccan society in general. -

The ABDC 2021 Workshop Descriptions and Bios
The ABDC 2021 Workshop Descriptions and Instructor Bios Table of Contents below alphabetical Ahava 2 Workshop Title: All the Feels 2 Workshop Title: Classical Egyptian Technique and Combos 2 Amara 3 Workshop Title: Let’s Prepare for an Amazing Week of Dance! - Free 3 Workshop Title: Let’s Talk about Swords 3 Amel Tafsout 4 Workshop Title: Nayli Dance of the Ouled Nayl 4 Workshop Title: City Dances: Andalusian Court Dance with Scarves 6 April Rose 8 Workshop Title: Dance as an Offering 8 Arielle 9 Workshop Title: Egyptian Street Shaabi: Mahraganat Choreography 9 Athena Najat 10 Workshop Title: Oriental Roots in Anatolia: Exploring the Greek branch of the Bellydance Tree 10 Bahaia 11 WorkshopTitle: Takht & Tahmila 11 DeAnna 12 Workshop Title: Spins and Turns! 12 Devi Mamak 14 Workshop Title: Hot Rhythms, Cool Head 14 Lily 15 WorkshopTitle: Rhythms 101 15 Loaya Iris 15 WorkshopTitle: Let’s Go Pop! Modern Egyptian Style Technique and Combos. 15 Nessa 16 WorkshopTitle: Finding the Muse Within 16 Mr. Ozgen 17 WorkshopTitle: Turkish Bellydance 17 WorkshopTitle: Romani Passion 17 Roshana Nofret 18 Workshop Title: Poetry in Motion: Exquisite Arms & Hands for All Dancers 18 Stacey Lizette 19 Workshop Title: By Popular Demand: A Customized Workshop Experience Based Exploring Common Challenges 19 Ahava Workshop Title: All the Feels Date/Time: Sunday, June 27, 2021,10-12pm Central Time Workshop Description: Do you need help with stage presence? Connecting to your audiences? Courage to push through the fourth wall on stage and fully entertain a crowd? Ahava presents exercises, tips and combinations on how to emote while on stage. -

2019 Seminar Series
WSG seminars winter 2018-19 announced WSG is pleased to be able to share details of its forthcoming winter 2018/19 seminars. All seminars take place at the Foundling Museum, 40 Brunswick Square, WC1N 1AZ, starting promptly at 1pm and finishing at 4pm. Doors open at 12.30, and there is a break for tea, coffee and biscuits halfway through the session. The Foundling is a wheelchair accessible venue, and directions for getting to the Museum can be found here, including those who are partially sighted. All seminars are free and open to the public, though refreshments will cost £2 to those who aren’t WSG members. Those attending the seminars are welcome to look round the museum before or after. Saturday September 29, 2018 Madeleine Pelling: Negotiating the Portland Vase: Mary Hamilton, Sir William Hamilton and the Duchess of Portland On 5 February 1784, the little-known Bluestocking and diarist Mary Hamilton wrote in her journal, ” With ye Duchess [of Portland] till past 4 o’clock. My Uncle Wm [Sir William Hamilton] came some time after I had been there, we look’d over some Antique Medals. My Uncle & ye Dss settled about the Vase…entirely. The Dss made him give her an impression of his Arms, to have a Seal cut for me for ye Watch she had given me”. This extraordinary gift given Hamilton by the Duchess of Portland was in fact meant as a commemorative token of her services in negotiating the sale of the Barberini, subsequently Portland, vase from Sir William Hamilton to her patron. -

Butlletí Excursionista De Catalunya
ANY XXXV OCTUBRE- NOVEMBRE 1925 NúMS. 365-366 Butlletí Excursionista de Catalunya Sota el sol d'Àfrica EL VIATGE v cop passat Cerbère i rodant el tren per terres del Ros- selló, el departament es convertí ben aviat en centre de tota mena de converses i discussions: el que féíem, a on anàvem í què pensàvem de les coses del nostre país, varen ésser les qüestions que, provocades per un marsellès ros i esvalotat, ens feren passar l'estona fins al terme proper del nostre trajecte ferroviari. Port-Vendres. Les onze de la nit. La petita estació, fosca í solitària, sembla dormida; la llum d'un fanalet bellugadís se'ns acosta, í la veu d'un empleat gairebé invisible ens demana els bitllets; un so prim i ofegat de trompeta, i el tren que ens ha portat desapareix en la fosca. Ja soni a Port-Vendres. Pero, ja que hí som, í vosaltres que escolteu ens feu la mercè d'acompayar-nos-hí, bé mereixeu que us digui què és el que anem a fer-hi tots plegats; í per començar, el tràmit enfadós d'una pre- sentació és inevitable. Anem a fer-la. Una vegada eren tres amics catalans, catalans i amics de bo de bo; puc assegurar-ho; el primer d'ells, home pacífic, casolà i majestuós, vivía, de sempre, dintre la calma, estic per dir, més des- enfrenada; el segon, tot treballant coses de ferro, sentia el fetitxis- me de l'art í dels monuments, i el tercer, que viu normalment entre preocupacíoris de técnica molt del nostre temps, tenia la dèria 282 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i l'amor de les coses històriques i geogràfiques; d'amics tan dissem- blants, í units per tan bona amistat, convindreu que no se'n troben tots els dies. -
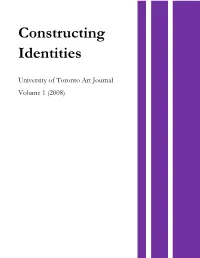
Constructing Identities
Constructing Identities University of Toronto Art Journal Volume 1 (2008) Constructing Identities: University of Toronto Art Journal Vol 1 (2008) This year will mark the inaugural publication of the "University of Toronto Art Journal." The journal publishes selected student papers from the Department of Art's annual graduate conference; the title of this year's conference was "Constructing Identities." Table of Contents Great Imaginations: Eugène Fromentin and Artistic Identity Davida Aronovitch The Artist as Critic: A Parodic Reading of Robert Morris's Writing and Minimalist Sculpture Leanne Carroll Captivity and Encounter: Thomas Pellow, The Moroccan Renegade Mark Celinscak Travel, Architects, and the Postwar "Grand Tour" Denise R. Costanzo The Role of Detective Fiction in the Construction of Turkish Identity David Mason Who is Picasso? The Question of Picasso's Identity in Brassaï's 1933 Minotaure Photo Essay Alma Mikulinsky Temptations of the Flesh: A Discussion of Gustave Courbet's Origin of the World Rebecca Weinfeld 1 Great Imaginations: Eugène Fromentin and Artistic Identity By Davida Aronovitch In speaking of Eugène Fromentin’s painterly skill, contemporary critics consistently invoke the artist’s noble and distinguished character. Moreover, an important extrapolation follows the comment: from his elevated disposition springs his grand artistic ambition. Whatever Fromentin’s own aspirations, his critics would have him consumed with an effort to reach the generic apex of history painting. Comment by Alexandre Dumas offers a first example. Always a great admirer of Fromentin, Dumas placed the artist both morally and artistically above his colleagues when he wrote that: “among those who represent the Orient at the Salon [he is] the most true, the most refined and above all the most distinguished…to the highest degree”.1 Critics who saw in Fromentin such natural nobility sought to coax an elevated ambition out of his artwork. -
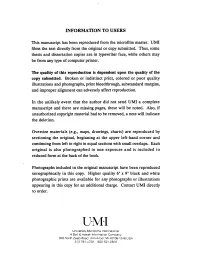
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms international A Bell & Howell Information Company 3 0 0 North Z e eb Roaa. Ann Arbor. Ml 48106-1346 USA 313 761-4700 800 521-0600 Order Number 0201662 Writing the decolonized self: Autobiographical narrative from the Maghreb Geesey, Patricia A., Ph.D. The Ohio State University, 1991 UMI 300 N. -

Seeking Chimera.Pdf
Seeking Chimera Christine Fasse Dominique Fasse Peter Stickland in collaboration with Clare Carolan Published in Great Britain 2011 by 77 books 69 Osbaldeston Road, London N16 7DL www.77books.co.uk Copyright © 2011 Christine Fasse, Dominique Fasse and Peter Stickland The authors have asserted their right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988 to be identified as the authors of this work. ISBN 978-0-9560121-5-9 This book is sold subject to the condition that it shall not by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher’s prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. Front cover: Photograph by Bougaul from Les Merveilles de l’Autre France, Edited by Prosper Richard, published by Hachette, 1924. For the Ouled Nail dancers; the women who inspired dreams Finally, at the extreme limit of the flattened plain, we were surrounded by an indecisive mirage. Here the earth no longer has either solidity or colour. It is a place where the dazzled eye reads the solid mountains as wisps of mist. A vague sequence of images replaces the seven heads of the Seba Rous, the Guest-Esthel and the mountainous entrance to the land of the Ouled Nail. Eugene Fromentin, October 1953 We would like to acknowledge the following people who supported us during the making this work: Clare Carolan, who with characteristic insight and delight, engaged the editorial process with remarkable insight. -

'White Gold: the Extraordinary Story of Thomas Pellow and Islam's One Million White Slaves'
H-Albion Refford on Milton, 'White Gold: The Extraordinary Story of Thomas Pellow and Islam's One Million White Slaves' Review published on Thursday, February 1, 2007 Giles Milton. White Gold: The Extraordinary Story of Thomas Pellow and Islam's One Million White Slaves. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2005. 305 pp. $25.00 (cloth), ISBN 978-0-374-28935-5. Reviewed by Brian W. Refford (Indiana University of Pennsylvania)Published on H-Albion (February, 2007) More than a Cabin Boy's Ripping Good Yarn In the aftermath of September 11, Islam has often been tarred with the brush of fanaticism. This is nothing new. A combination of fear and loathing, European attitudes towards Islam have deep roots in the western historical consciousness. Medieval and early modern Europeans dreaded Islam as the infidel faith of a brutal enemy intent upon destroying the mother church. The "Islamic threat" nourished the European fear of the dangerous other, and distant Islam became an overbearing symbol of menace. In White Gold, Giles Milton suggests that such fear was not without cause, as nearly one million white Europeans were captured by Muslim pirates between 1530 and 1780, and sold in the slave markets of Morocco, Algiers, Tunis, and Tripoli. Author of several well-received works, Milton recounts the harrowing tale of Thomas Pellow, an eleven-year-old Cornish cabin boy captured at sea by "Barbary corsairs" in 1716.[1] Employing the letters, journals, and manuscripts of Pellow and other escaped and redeemed English captives, Milton describes the white slave trade as "one of individuals caught up in a nightmare far beyond their control" (p. -

Slavery in New York and the United States
READINGS ON SLAVERY: Library Resources This guide will help you find books and other materials at the San Francisco Public Library related to the topic of Slavery. If you need further help finding materials, be sure to ask the librarian staff for guidance. You can pick up a copy of this bibliography at the Museum of the African Diaspora. Materials can be found throughout the SFPL’s 27 branches as well as at the Main Library. You will especially want to check out the African American Center on the third floor of the Main Library as well as the Bayview Branch Library. Africans in America: America's Journey through Slavery A companion volume to the public television series. This extraordinary examination of slavery in America features a four-part history by poet and performance artist Patricia Smith and a dozen fictional narratives by National Book Award-winning novelist Charles Johnson. 973.0496 J63a (Check library holdings for availability of the video of the PBS television series) Bullwhip Days: The Slaves Remember Mellon, James, ed. 29 oral histories and additional excerpts, selected from 2,000 interviews with former slaves conducted in the 1930s for a WPA Federal Writers Project, document the conditions of slavery that, Mellon maintains, lie at the root of today's racism. 326.973 B876 California, the Civil War, and the Indian Problem Kibby, Leo One of the earlier written books highlighting the social and political climate of California during the U.S. Civil War. 979.4 K533c Carry Me Back: The Domestic Slave Trade in American Life Deyle, Steven Originating with the birth of the nation itself, in many respects, the story of the domestic slave trade is also the story of the early United States.