Tab Number: 10
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE 1 Faculté Des Sciences Economiques Et Sociales Institut De Sociologie
N° d’ordre : 4311 UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE 1 Faculté des Sciences Economiques et Sociales Institut de Sociologie Doctorat Changement social – option Ethnologie Mélanie SOIRON LA LONGEVITÉ POLITIQUE. Ou les fondements symboliques du pouvoir politique au Gabon. Sous la direction de Rémy BAZENGUISSA-GANGA Professeur de Sociologie, Université de Lille 1 Membres du Jury : Joseph TONDA (rapporteur et Président du Jury), Professeur de Sociologie et d’Anthropologie, Université de Libreville, Gabon. André MARY (rapporteur), Professeur d’Anthropologie. Directeur de recherches au CNRS. Alban BENSA, Professeur d’Anthropologie. Directeur d’études à l’EHESS. Bruno MARTINELLI, Professeur d’Anthropologie, Université de Provence. Thèse soutenue publiquement le 28 janvier 2009 Tome 1 sur 2 Résumé A partir d’une question initiale portant sur les raisons de la longévité politique du président de la République gabonaise, nous avons mis en lumière les fondements symboliques du pouvoir politique au Gabon. Ceux-ci sont perceptibles au sein des quatre principales institutions étatiques. Ainsi, une étude détaillée des conditions de création, et d’évolution de ces institutions, nous a permis de découvrir la logique de l’autochtonie au cœur de l’Assemblée nationale, celle de l’ancestralité au sein du Sénat, tandis qu’au gouvernement se déploie celle de la filiation (fictive et réelle), et que le symbolisme du corps présidentiel est porté par diverses représentations. A ce sujet, nous pouvons distinguer d’une part, une analogie entre les deux corps présidentiels qui se sont succédés et d’autre part, le fait que le chef de l’Etat actuel incarne des dynamiques qui lui sont antérieures et qui le dépassent. -

Jeremy Mcmaster Rich
Jeremy McMaster Rich Associate Professor, Department of Social Sciences Marywood University 2300 Adams Avenue, Scranton, PA 18509 570-348-6211 extension 2617 [email protected] EDUCATION Indiana University, Bloomington, IN. Ph.D., History, June 2002 Thesis: “Eating Disorders: A Social History of Food Supply and Consumption in Colonial Libreville, 1840-1960.” Dissertation Advisor: Dr. Phyllis Martin Major Field: African history. Minor Fields: Modern West European history, African Studies Indiana University, Bloomington, IN. M.A., History, December 1994 University of Chicago, Chicago, IL. B.A. with Honors, History, June 1993 Dean’s List 1990-1991, 1992-1993 TEACHING Marywood University, Scranton, PA. Associate Professor, Dept. of Social Sciences, 2011- Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN. Associate Professor, Dept. of History, 2007-2011 Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN. Assistant Professor, Dept. of History, 2006-2007 University of Maine at Machias, Machias, ME. Assistant Professor, Dept. of History, 2005-2006 Cabrini College, Radnor, PA. Assistant Professor (term contract), Dept. of History, 2002-2004 Colby College, Waterville, ME. Visiting Instructor, Dept. of History, 2001-2002 CLASSES TAUGHT African History survey, African-American History survey (2 semesters), Atlantic Slave Trade, Christianity in Modern Africa (online and on-site), College Success, Contemporary Africa, France and the Middle East, Gender in Modern Africa, Global Environmental History in the Twentieth Century, Historical Methods (graduate course only), Historiography, Modern Middle East History, US History survey to 1877 and 1877-present (2 semesters), Women in Modern Africa (online and on-site courses), Twentieth Century Global History, World History survey to 1500 and 1500 to present (2 semesters, distance and on-site courses) BOOKS With Douglas Yates. -

Etat D'avancement Des Travaux De These
UNIVERSITE BORDEAUX SEGALEN FACULTE DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES SOCIALES. (E.D. 303) Année : 2011 Thèse n° : 1838 ETUDE DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS SPORTIVES AU GABON. GENESE ET ANALYSE PROSPECTIVE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE THESE POUR LE DOCTORAT DE L’UNIVERSITE DE BORDEAUX SEGALEN Mention : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives STAPS Présentée et soutenue publiquement par : Célestin ALLOGHO-NZE Sous la Direction de Madame Marina HONTA Et Monsieur Jean-Paul CALLEDE Membres du Jury - Mr Gilles FERREOL, Professeur Université de Franche-Comté, Président - Mr Pierre CHAZAUD, Professeur Université de Lyon 1, Rapporteur - Mr Dominique CHARRIER, Maître de conférences HDR Université Paris Orsay, Rapporteur - Mr André MENAUT, Professeur Université Bordeaux Segalen - Mr Jean-Paul CALLEDE, Chargé de recherche CNRS, MSHA Co Directeur - Mme Marina HONTA, Maître de conférences HDR Université Bordeaux Segalen Co Directrice Bordeaux, Novembre 2011 1 ETUDE DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS SPORTIVES AU GABON GENESE ET ANALYSE PROSPECTIVE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE RESUME Les activités physiques, et les jeux traditionnels font partis de la culture universelle, et appartiennent à l’humanité. Les peuples d’Afrique ont dû abandonner les leurs avec l’arrivée des sports modernes pendant la période de colonisation. Les activités physiques et jeux traditionnels du Gabon avaient dans la plus part des cas un but utilitaire allant de la préparation physique des jeunes au service de la communauté, aux activités de loisirs pour tous comme des danses lors des évènements commémoratifs ou des cérémonies rituelles et initiatiques. -

The World Factbook
The World Factbook Africa :: Gabon Introduction :: Gabon Background: El Hadj Omar BONGO Ondimba - one of the longest-serving heads of state in the world - dominated the country's political scene for four decades (1967-2009) following independence from France in 1960. President BONGO introduced a nominal multiparty system and a new constitution in the early 1990s. However, allegations of electoral fraud during local elections in 2002-03 and the presidential elections in 2005 exposed the weaknesses of formal political structures in Gabon. Following President BONGO's death in 2009, new elections brought Ali BONGO Ondimba, son of the former president, to power. Despite constrained political conditions, Gabon's small population, abundant natural resources, and considerable foreign support have helped make it one of the more prosperous and stable African countries. Geography :: Gabon Location: Central Africa, bordering the Atlantic Ocean at the Equator, between Republic of the Congo and Equatorial Guinea Geographic coordinates: 1 00 S, 11 45 E Map references: Africa Area: total: 267,667 sq km country comparison to the world: 77 land: 257,667 sq km water: 10,000 sq km Area - comparative: slightly smaller than Colorado Land boundaries: total: 2,551 km border countries: Cameroon 298 km, Republic of the Congo 1,903 km, Equatorial Guinea 350 km Coastline: 885 km Maritime claims: territorial sea: 12 nm contiguous zone: 24 nm exclusive economic zone: 200 nm Climate: tropical; always hot, humid Terrain: narrow coastal plain; hilly interior; savanna -

Journée De Souvenir Du Décès De Feu Pierre Mamboundou Resserrer Les Rangs Pour Les Futures Échéances
Mardi 17 Octobre 2017 2 P o l i t i q u e Journée de souvenir du décès de feu Pierre Mamboundou Resserrer les rangs pour les futures échéances J-C. A Libreville/Gabon réflexion, les participants l’entrée de Sébastien Mam- base et d’un protocole d’ac- C’est l’une des consignes ont suivi avec attention boundou Mouyama au cord écrit avec le pouvoir. que le président du parti, quatre communications gouvernement mis en Toutefois, ont poursuivi les Mathieu Mboumba Nzie- n portant sur l’historique de place après les Accords de deux anciens ministres, si o i n gnui, a donnée aux mili- U l’UPG, le cadre juridique, la Paris (…) et le décès le 15 l’entrée au gouvernement ' L tants. récente participation au octobre 2011 de Pierre ne peut être l’occasion de / A C J gouvernement de deux de Mamboundou. résoudre tous les pro- : o ses dirigeants, la crise poli- Pour le deuxième thème, la blèmes du parti (…), il n’en t o "Journée de souve- h DÉBUTÉES tique et le climat au sein du Commissaire déléguée aux demeure pas moins que P parti. Affaires sociales a fait ob- dniers d aec tfeioun Psi eimrrpeo Mrtaamntbeosu enn- Une vue du directoire de l'UPG à l'ouverture des Pour ce qui est de l’histo- server que le commissaire sdao ufa"veur ont été posées. journées de réflexion. rique de l'UPG, son prési- général à l’Éthique a du Dimanche, était célébrée la dent, Mathieu Mboumba mal à remplir sa mission, sixième le 10 octobre Nziengui est revenu sur les faute de budget et d’une par des journées de ré- moments forts qui ont absence de rigueur dans , sur l'esplanade du flexion, les festivités mar- marqué la vie du parti: sa l’application des règles sta- siège d'Awendjé. -
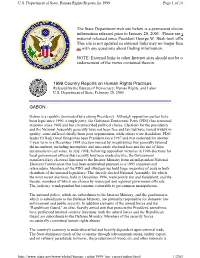
1999 Page 1 of 14
U.S. Department of State, Human Rights Reports for 1999 Page 1 of 14 The State Department web site below is a permanent electro information released prior to January 20, 2001. Please see w material released since President George W. Bush took offic This site is not updated so external links may no longer func us with any questions about finding information. NOTE: External links to other Internet sites should not be co endorsement of the views contained therein. 1999 Country Reports on Human Rights Practices Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor U.S. Department of State, February 25, 2000 GABON Gabon is a republic dominated by a strong Presidency. Although opposition parties have been legal since 1990, a single party, the Gabonese Democratic Party (PDG) has remained in power since 1968 and has circumscribed political choice. Elections for the presidency and the National Assembly generally have not been free and fair but have varied widely in quality; some suffered chiefly from poor organization, while others were fraudulent. PDG leader El Hadj Omar Bongo has been President since 1967 and was reelected for another 7-year term in a December 1998 election marred by irregularities that generally favored the incumbent, including incomplete and inaccurate electoral lists and the use of false documents to cast votes. In July 1998, following opposition victories in 1996 elections for local government offices that recently had been made elective, the Government transferred key electoral functions to the Interior Ministry from an independent National Electoral Commission that had been established pursuant to a 1995 constitutional referendum. -

La Mobilisation Politique Transnationale Pour Une Alternance Démocratique Au Gabon Par Delphine Lecoutre PAGE 2
BulletinFrancoPaix Vol. 5, n° 7 Septembre 2020 La mobilisation politique transnationale pour une alternance démocratique au Gabon Par Delphine Lecoutre PAGE 2 Décryptage. Burkina Faso : des élections dans un contexte de fragilité particulier PAGE 11 Nouvelles et annonces PAGE 13 ARTICLE La mobilisation politique transnationale pour une alternance démocratique au Gabon : opposition politique, société civile et diaspora (2009-2016) Par Delphine Lecoutre RÉSUMÉ EXÉCUTIF Le décès du président Omar Bongo Ondimba en 2009, après 42 ans au pouvoir, a fait naître une réelle effervescence politique et a favorisé une mobilisation civique tant au Gabon que dans la diaspora. Son fils Ali Bongo Ondimba est devenu chef de l’État la même année suite à une élection contestée. L’opposition, la société civile locale et la diaspora se sont mobilisées Delphine Lecoutre depuis 2009 pour mener des actions collectives transnationales visant à provoquer une alternance démocratique au Gabon. La période 2009-2016 est révélatrice des ambitions, du mode opératoire et des faiblesses de ces Politologue africaniste acteurs. Enseignante au Centre d’études Entre 2009 et 2015, André Mba Obame ou « AMO » chercha par tous diplomatiques et stratégiques les moyens à contraindre le président Ali Bongo Ondimba à entamer des et au Centre international de négociations avec l’opposition : il tenta une mutualisation transnationale des acteurs d’opposition. formation de l’École militaire de Saint Cyr Coetquidan, France L’une des erreurs d’« AMO » est probablement de n’avoir pas compris qu’Ali Bongo Ondimba n’était pas un homme de compromis, mais plutôt un Coordinatrice et porte-parole adepte du clivage et de la confrontation. -

Rapport De La Mission D'observation De L'election
RAPPORT DE LA MISSION D’OBSERVATION DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE AU GABON : SCRUTIN DES 25 ET 27 NOVEMBRE 2005. ________________________________________________________________________ INTRODUCTION Son Excellence Monsieur Abdou Diouf, Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, a décidé de répondre favorablement à la demande de Monsieur le Ministre de l’Intérieur de la République du Gabon en vue de l’envoi d’une Mission d’observation à l’occasion de l’élection présidentielle des 25 et 27 novembre 2005. Depuis le retour au multipartisme, au début des années 1990, c’est la troisième fois qu’était organisée une élection présidentielle au Gabon, conformément aux articles 4, 9 et 10 de la Constitution du 26 mars 1991, révisés le 19 août 2003, l’article 4 nouveau disposant que l’élection présidentielle a lieu selon le système du scrutin majoritaire à un tour et l’article 9 nouveau disposant que le Président de la République peut être candidat à sa propre succession autant de fois qu’il le souhaite. La Mission d’observation francophone est arrivée à Libreville le 23 novembre dans la matinée. Elle a quitté la ville le 29 novembre dans la soirée. Elle était composée de la façon suivante : • Chef de la Délégation et porte parole Monsieur Pierre FIGEAC Secrétaire permanent honoraire de l’AIMF Membre du Conseil Economique et Social FRANCE • Membres Monsieur Pandeli VARFI Membre de la Commission Electorale Centrale ALBANIE Monsieur Sébastien AGBOTA Journaliste Ancien Vice-Président de la HAAC BENIN Madame Imelda NZIRORERA -

2016 Country Review
Gabon 2016 Country Review http://www.countrywatch.com Table of Contents Chapter 1 1 Country Overview 1 Country Overview 2 Key Data 3 Gabon 4 Africa 5 Chapter 2 7 Political Overview 7 History 8 Political Conditions 9 Political Risk Index 23 Political Stability 38 Freedom Rankings 53 Human Rights 65 Government Functions 67 Government Structure 69 Principal Government Officials 72 Leader Biography 73 Leader Biography 73 Foreign Relations 77 National Security 82 Defense Forces 83 Chapter 3 85 Economic Overview 85 Economic Overview 86 Nominal GDP and Components 88 Population and GDP Per Capita 90 Real GDP and Inflation 91 Government Spending and Taxation 92 Money Supply, Interest Rates and Unemployment 93 Foreign Trade and the Exchange Rate 94 Data in US Dollars 95 Energy Consumption and Production Standard Units 96 Energy Consumption and Production QUADS 97 World Energy Price Summary 98 CO2 Emissions 99 Agriculture Consumption and Production 100 World Agriculture Pricing Summary 102 Metals Consumption and Production 103 World Metals Pricing Summary 105 Economic Performance Index 106 Chapter 4 118 Investment Overview 118 Foreign Investment Climate 119 Foreign Investment Index 122 Corruption Perceptions Index 135 Competitiveness Ranking 147 Taxation 156 Stock Market 157 Partner Links 157 Chapter 5 158 Social Overview 158 People 159 Human Development Index 162 Life Satisfaction Index 166 Happy Planet Index 177 Status of Women 186 Global Gender Gap Index 188 Culture and Arts 198 Etiquette 199 Travel Information 199 Diseases/Health Data 209 Chapter 6 216 Environmental Overview 216 Environmental Issues 217 Environmental Policy 218 Greenhouse Gas Ranking 219 Global Environmental Snapshot 230 Global Environmental Concepts 241 International Environmental Agreements and Associations 255 Appendices 280 Bibliography 281 Gabon Chapter 1 Country Overview Gabon Review 2016 Page 1 of 293 pages Gabon Country Overview GABON Gabon is one of West Africa's more stable countries. -

AC Vol 43 No 25
www.africa-confidential.com 20 December 2002 Vol 43 No 25 AFRICA CONFIDENTIAL MOZAMBIQUE 2 KENYA/ZIMBABWE A flood of mud The trial of the alleged murderers The big men look to the future of journalist Carlos Cardoso has As President Moi prepares to retire, his fellow septuagenarian thrown the spotlight on President President Mugabe continues the battle for power Chissano’s son and much of the Holding their collective breath, Kenyans expect a new government by the new year and the peaceable Maputo elite. This is helping presidential hopeful Armando retirement of their leader of 24 years, 78-year-old Daniel arap Toroitich Moi. Zimbabweans are in the Guebuza to distance himself from midst of their country’s worst economic crisis since the liberation war and face the determination of Chissano’s failures and to form an another 78-year-old, Robert Gabriel Mugabe, to remain in power until the third chimurenga (the war alliance with his former Renamo against invaders) has been completed. A decade ago, the possibility that Moi would hand over power to enemy, Raul Domingos. an opposition leader after multi-party elections looked remote. Zimbabwe has proved more predictable: few doubted that Mugabe would seize white farms and ruthlessly suppress dissent if an opposition party CÔTE D’IVOIRE 3 gained political ground. Economic collapse and corruption may prove to be the most dangerous of Moi’s legacies, storing up A new front opens mass social unrest as his successors battle to reform the threadbare public services and create jobs. Much As West African mediation efforts will depend on the energy of Kenya’s business class, increasingly marginalised during the Moi years by falter, France is stepping up its a cabal of commission agents which drove productive investment away. -
Country Reports on Human Rights Practices - 2005 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor March 8, 2006
Gabon Page 1 of 9 2005 Human Rights Report Released | Daily Press Briefing | Other News... Gabon Country Reports on Human Rights Practices - 2005 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor March 8, 2006 Gabon is a republic dominated by a strong presidency and the Gabonese Democratic Party (PDG), which has remained in power since 1968. The population was 1.3 million. On November 27, PDG leader El Hadj Omar Bongo Ondimba, president since 1967, was reelected for a seven-year term in an election marred by irregularities. The civilian authorities generally maintained effective control of the security forces. The country's human rights record remained poor, although there were improvements in several areas. An extreme disparity in wealth contributed to some of the following human rights problems: • limited ability of citizens to change their government • use of excessive force, including torture, on prisoners and detainees • harsh prison conditions • violent dispersal of demonstrations • arbitrary arrest and detention • an inefficient judiciary susceptible to government influence • restrictions on the right of privacy • restrictions on freedom of the press, association, and movement • widespread harassment of refugees by security forces • widespread government corruption • violence and societal discrimination against women and noncitizen Africans • trafficking in persons, particularly children • forced labor and child labor The government conducted an aggressive campaign during the year to combat trafficking in persons. RESPECT FOR HUMAN RIGHTS Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From: a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life Security forces killed persons during the year, and there were unconfirmed reports that police committed politically motivated killings. -

Thèse En Ligne 4 Juin.Rtf
La formation à distance au Gabon : Enjeux et perspectives UNIVERSITE DE ROUEN UFR de Sociologie, de Psychologie et de Sciences de l’Education Laboratoire CIVIIC Discipline : Sciences de l’Education THÈSE Pour obtenir le grade de docteur de l’Université de Rouen Présentée et soutenue publiquement par : OBONO MBA Anasthasie (épouse ESSONO MVÉ) ******************************** LA FORMATION À DISTANCE AU GABON. ENJEUX ET PERSPECTIVES *********************************** Directeur de thèse Jacques WALLET, Professeur des universités, Université de Rouen 16 mai 2008 Jury Membres Alain Jaillet, Professeur des universités, Université Louis Pasteur de Strasbourg 1, Ambroise Edou Minko, Directeur Général, Ecole Normale Supérieure de Libreville Georges-Louis Baron, Professeur des universités, Université Paris V 1 La formation à distance au Gabon : Enjeux et perspectives Remerciements Cette thèse est le résultat de l’engagement de plusieurs personnes qui ont décidé de m’accompagner résolument dans cet exaltant parcours. Arrivée aujourd’hui à la fin de cette aventure, je voudrais profiter de cet espace pour remercier, en tâchant de n’oublier personne, les différents maillons qui ont contribué à la réussite et au bon déroulement de ces travaux. Je dois mes premiers remerciements à Georges Louis Baron, Professeur de sciences de l'éducation à l’Université René Descartes - Paris 5, directeur de mon mémoire de DEA. Il a été la première personne, en répondant positivement, en 2001, à mon courriel lui demandant de diriger mon mémoire, à me faire croire que je pouvais migrer vers une culture de chercheur. Je voudrais aussi remercier Jean Houssaye, Directeur du laboratoire Centre Interdisciplinaire sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences en éducation et en formation (CIVIIC) de l’UFR Sociologie, Psychologie et Sciences de l’éducation de l’Université de Rouen et aux membres dudit laboratoire pour m’avoir accueilli pour mes recherches.