1Aspects Quantitatifs Des Ressources En Eau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Réseau Départemental Des Transports Des Bouches-Du-Rhône Réseau
57 Réseau départemental des transports plus de CG13 57 moins de CO2 des Bouches-du-Rhône 57 59 59 Ecopôle DIRECTION DES TRANSPORTS ET DES PORTS / JANVIER 2012 ET DES PORTS DIRECTION DES TRANSPORTS 17 240 ZA La M1 Valentine La Fourragère 240 Euroméditerranée 240 Arenc T2 allôcartreize Athélia Zone d’Activités d’industrie et de commerce 0810001326 Numéro Azur - prix d’un appel local Navettes rapides Lignes interurbaines départementales Points de vente N° Lignes organisées par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône Exploitants Téléphone du réseau Cartreize 6 Saint Chamas - Salon-de-Provence par Grans TRANSAZUR 04 90 53 71 11 ● Gare Routière de Marseille St Charles 11 La Bouilladisse - Aix-en-Provence par La Destrousse - Peypin - Cadolive - Gréasque Fuveau TELLESCHI 04 42 28 40 22 Pôle d’Echanges St Charles - Rue Honnorat 12 Meyreuil - Aix-en-Provence par Gardanne Autocars BLANC - 13003 Marseille - Tél.: 04 91 08 16 40 15 Berre l’Etang - Aix-en-Provence par Rognac et Velaux SUMA 04 42 87 05 84 ACCUEIL-INFO BILLETTERIE DÉPARTEMENTALE : Du lundi au samedi de 6h à 20h / Le dimanche et les jours fériés (sauf le 25 décembre, 16 Lançon de Provence - Aix-en-Provence par La Fare Les Oliviers SUMA 04 42 87 05 84 le 1er janvier et le 1er mai) de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 17 Salon-de-Provence - Aéroport Marseille Provence par Lançon - Rognac - Vitrolles SUMA 04 42 87 05 84 Navette Aéroport Tous les jours de 5h30 à 21h30 18 Arles - Aix-en-Provence par Raphèle les Arles - St Martin de Crau - Salon-de-Provence TELLESCHI 04 42 28 40 22 ● Envia &Vous -

Dangers Du Canal De Marseille
Le canal de Marseille traverse 23 communes Canal DE Marseille ATTENTION DANGER ! Le canal de Marseille assure l'alimentation en eau de plus d'un million et demi de provençaux. Mais s'il est source de vie, cet ouvrage d'apparence paisible recèle aussi de nombreux dangers. eaudemarseille-metropole.fr Plus d'infos sur eaudemarseille-metropole.fr Eau de Marseille Métropole - Avril 2017 -V1.2 Eau de Marseille Métropole - Avril Le canal de Marseille Interdiction Un domaine privé et réglementé De se baigner Près de 180 millions de mètres cubes d’eau de la Durance transitent A cause de la vitesse de l’eau. chaque année dans le canal de Marseille. Après un passage dans les Elle y est, en moyenne, de 0,7 mètre à la seconde. centres de traitement d’eau potable, elle est acheminée jusqu’au robi- Mais elle peut s’élever à tout moment lors d’une net des consommateurs. ouverture de vannes. C’est dire l’importance de cet ouvrage d’utilité publique que gère la Société Eau de Marseille Métropole pour le compte de la Métropole Et de la profondeur du canal. Aix-Marseille Provence. Comme tout domaine privé, son accès est inter- Elle varie de 2 mètres à 2,40 mètres. dit et protégé par des arrêtés préfectoraux. Et, notamment, ceux du 25 Ce qui empêche quiconque d’y avoir pied. février 1856 et du 22 avril 1867 qui interdisent : > de s’y baigner ou d’y pêcher ; > de circuler sur ses berges ; De se promener sur les berges > de puiser l’eau ; > de le dégrader ; Les risques de chute, de blessures et de noyade > d’y jeter des ordures. -

Chaîne Des Côtes La Roque D'anthéron : Vallon De La Baume
Informations Chaîne des Côtes Accès : En arrivant d’Aix-en- Provence par la N7 en direc- tion Avignon, prenez la D543 en direction Rognes. Avant le bassin de Saint-Christophe tournez à gauche en direc- tion de La-Roque-d’Anthéron (D 66e). Parking : Centre La-Roque- d’Anthéron ou devant le cimetière. Contacts utiles : > N° accès massif : 08 11 20 13 13 > Tourisme : www.visitprovence.com > Transport : www.lepilote. com > Office de Tourisme La-Roque-d’Anthéron tél. : 04 42 50 70 74 La Roque d'Anthéron : Distance Marseille : 60 km Vallon de la Baume - Distance Aix en Provence : 28 km Distance Martigues : 73 km Vallon de Castellas Distance Arles : 77 km Distance Manosque : 59 km Autoroutes Routes Nationales Tarascon Saint Rémy de Provence > Boucle avec variante ITINERAIRE Durée : 3H - 3H Arles Salon de Provence Longueur : 13 Km - 12 Km Dénivelé : 400 m - 360 m Niveau : moyen Istres Aix en Provence Les Saintes Martigues Maries de la Mer Carry-le-Rouet Marseille Aubagne En collaboration avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre Cassis Tél. : 04 91 32 17 10 La Ciotat Itinéraire : Balisage jaune Sens de l’itinéraire Par le Vallon de La Baume… Stationnez au centre de La Roque- (variante) d’Anthéron ou devant le cime- Optez pour la branche de droite, tière. Cheminez en bordure de et remontez légèrement. Vous route (boulevard de la Paix, puis retournerez au village par une D 561A). Laissez à droite l’em- piste très carrossable et sans dif- branchement pour le village de ficulté aucune. vacances de La Baume. Trouvez La descente est bien boisée, à et suivez un sentier qui longe la travers le quartier de La Bastide route (côté nord). -

Questions 21 24 L’Activité Économique Et Les Échanges
questions 21 24 L’activité économique et les échanges 21 Quelle est la structure de l’économie métropolitaine ? 22 Dans quels réseaux (européens, mondiaux) s’inscrit-on ? 23 D’où vient l’énergie et les ressources dont la Métropole a besoin ? 24 Qui vient séjourner dans la Métropole et pour faire quoi ? Quelle est la structure de l’économie métropolitaine ? 21 secteurs d’activités et évolution de l’emploi planche 22 Un tissu économique diversifié, moins de cadres exerçant Emplois salariés privés en 2019 Source structure : Ursaff / Acoss de l’économie métropolitaine : emplois privés par secteur d’activité des « fonctions supérieures » et plus de « déclassés » La Métropole peut se prévaloir d’un tissu économique diversifié, mieux capable d’encaisser les chocs conjoncturels. S’agissant des secteurs d’activités, elle compte proportionnellement plus d’emplois dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action % % % % sociale que dans les autres grandes métropoles françaises et moins % % d’emplois dans les secteurs du commerce / transport / services. Au 7 6 niveau industriel, elle se situe dans la moyenne dans les autres mé- 12 16 44 15 tropoles. Comme ailleurs, l’emploi agricole est très faible (moins de 1%). Industrie construction Commerce hôtellerie autres services Services non marchands restauration marchands (administration publique, défense, S’agissant de certains emplois dits « supérieurs », la Métropole enseignement, santé, action sociale) compte également moins de cadres exerçant des « fonctions mé- % tropolitaines » (emploi tertiaire supérieur dans les domaines de la % 1,5 INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 9,3 transport conception-recherche, le conseil, le commerce inter-entreprises, la gestion, la culture et les loisirs) que dans les autres grandes métro- % % poles françaises : 11,3% dans la Métropole contre plus de 15% à Paris, 0,2 raffinage et cokéfaction 4,1 information et télécommunications Lyon ou Toulouse. -

Aix-En-Provence La Bouilladisse Aix-En-Provence
La Bouilladisse Aix-en-Provence Horaires valables du 24/08/15 au 21/08/16 Jours de fonctionnement LàV LàS LàS LàV LàS LàS LàV LàS LàS lignes Période de fonctionnement H1 AN2 AN2 H1 AN2 AN2 H1 AN2 AN2 PEYPIN - Auberge Neuve 06:41 07:35 12:25 régulières CADOLIVE - L'Ortolan 06:44 07:34 12:34 11 CADOLIVE - Armel Maroc 06:45 07:35 12:35 CADOLIVE - La Reyne 06:42 07:36 12:26 CADOLIVE - Chantecoucou 06:43 07:37 12:27 CADOLIVE - Le Stade 06:44 07:38 12:28 CADOLIVE - Saint Joseph 06:45 07:39 12:29 ST SAVOURNIN - La Chavatine 06:46 07:40 12:30 Belcodène ST SAVOURNIN - La Valentine 06:47 07:41 12:31 ST SAVOURNIN - Le Collet Blanc 06:49 07:43 12:33 La Bouilladisse ST SAVOURNIN - Centre 06:51 07:45 12:35 ST SAVOURNIN - L'Etoile 06:52 07:46 12:36 ST SAVOURNIN - Les Rampauds 06:54 07:48 12:38 LA BONNE ETOILE ST SAVOURNIN - La Patancline 06:55 07:49 12:39 ST SAVOURNIN - Les Gilets 06:56 07:50 12:40 St-Savournin PEYPIN - Les Oliviers 06:47 07:37 12:37 PEYPIN - Les Termes 06:51 07:41 12:41 Cadolive PEYPIN - Jas de Valèze 06:52 07:42 12:42 PUBLIC / ALTÉDIA PEYPIN - Halte Routière 06:55 07:45 12:45 PEYPIN - Les Pegoulières 06:57 07:47 12:47 Peypin PEYPIN - Le Château 06:58 07:48 12:48 PEYPIN - Les Hermites 06:59 07:49 12:49 PEYPIN - Valdonne 2 07:01 07:55 12:45 PEYPIN - Baume de Marron 07:02 07:57 12:46 La Destrousse BELCODENE - Les Hauts 06:53 07:45 12:40 BELCODENE - Les Cantonniers 06:53 07:45 12:40 BELCODENE -La Poste 06:54 07:46 12:41 BELCODENE - Ecole 06:55 07:47 12:42 BELCODENE - L'Albinos 06:56 07:48 12:43 LA BOUILLADISSE - Les Benezits 06:58 07:50 -

Publication of an Application for Registration of a Name Pursuant to Article 50(2)(A) of Regulation (EU) No 1151/2012 of The
C 26/8 EN Offi cial Jour nal of the European Union 27.1.2020 Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2020/C 26/05) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT ‘BROUSSE DU ROVE’ EU No: PDO-FR-02424 – 28.6.2018 PDO (X) PGI () 1. Name(s) ‘Brousse du Rove’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product [as in Annex XI] Class 1.3: Cheeses 3.2. Description of product to which the name in (1) applies ‘Brousse du Rove’ is a goat’s cheese presented in its original cornet used for moulding. The cornet is a truncated cone mould measuring 32 mm (diameter at the top) x 22 mm (diameter at the bottom) x 85 mm (height), with three holes pierced in the base. The cheese is produced using the milk flocculation method after heating and adding white alcohol vinegar as an acidifier. It contains a maximum of 30 grams of dry matter per 100 grams of cheese, and a minimum of 45 grams of fat per 100 grams of cheese when completely dry. Its weight is 45 to 55 grams at the end of the moulding process. -

Recueil Des Actes Administratifs N°13-2017-157
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°13-2017-157 BOUCHES-DU-RHÔNE PUBLIÉ LE 20 JUILLET 2017 1 Sommaire Agence régionale de santé 13-2017-07-18-002 - Décision tarifaire n° 1174 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de l'ESAT LA MANADE (3 pages) Page 4 13-2017-07-18-003 - Décision tarifaire n° 1176 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de l'ESAT LES ARGONAUTES (3 pages) Page 8 13-2017-07-18-004 - Décision tarifaire n°1175 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de l'ESAT ATELIER SAINT JEAN (3 pages) Page 12 Direction départementale de la protection des populations 13-2017-07-06-027 - Arrêté procédant au retrait du registre de sécurité de CTS (chapiteaux, tentes et structures) numéro d'identification t-13-2012-78 (2 pages) Page 16 13-2017-07-06-028 - Arrêté procédant au retrait du registre de sécurité de CTS (chapiteaux, tentes et structures) numéro d'identification t-13-2012-79 (2 pages) Page 19 13-2017-07-06-029 - Arrêté procédant au retrait du registre de sécurité de CTS (chapiteaux, tentes et structures) numéro d'identification T-13-2014-104 (2 pages) Page 22 Préfecture-Cabinet 13-2017-07-14-001 - Arrêté accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à l'occasion de la promotion du 14 juillet 2017 (56 pages) Page 25 Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité publique et de l’environnement 13-2017-07-17-005 - Arrêté portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées (prélèvements échantillons de peau et de gras sur espèces de Cétacés) (3 pages) Page 82 13-2017-07-18-006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable de 8 logements pour ouvriers agricolesAppartenant à la SCEA REVENYMas du Grand Bel AirLieu-dit « Campagne » sur la commune de SAINT ETIENNE DU GRES (13103) (2 pages) Page 86 13-2017-07-18-005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable par forage de deux logements destinés à l’hébergement d’ouvriers agricoles appartenant à M. -

Recueil Des Actes Administratifs N°13-2015-036 Publié Le 12
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°13-2015-036 BOUCHES-DU-RHÔN E PUBLIÉ LE 12 DÉCEMBRE 2015 1 Sommaire DIRECCTE Provence Alpes Côte d’Azur 13-2015-12-11-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail ARGENT au titre de la promotion du 1er janvier 2016 (84 pages) Page 3 13-2015-12-11-004 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail GRAND OR au titre de la promotion du 1er janvier 2016 (25 pages) Page 88 13-2015-12-11-005 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail VERMEIL au titre de la promotion du 1er janvier 2016 (47 pages) Page 114 13-2015-12-11-002 - Arrêté accordant la médaille d'honneur agricole à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2016 (4 pages) Page 162 13-2015-12-11-001 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur de travail "OR" au titre de la promotion du 1er janvier 2016 (45 pages) Page 167 13-2015-12-07-006 - Arrêté portant autorisation individuelle de déroger à la règle du repos dominical des salariés sollicitées par la Sté MAIA SONNIER à Marseille 13006 (3 pages) Page 213 13-2015-12-10-002 - Arrêté reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production à GYPTIS FORMATION 19 rue Léon Blum – 13090 AIX EN PROVENCE (2 pages) Page 217 13-2015-12-10-003 - Arrêté reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production à LE FUNICULAIRE 17 rue André Poggido – 13006 MARSEILLE (2 pages) Page 220 Préfecture des Bouches-du-Rhône 13-2015-12-11-006 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°6 à la Convention Constitutive du Groupement -

L'exploitation Dans Le Bassin Minier De
2 TOHM L’EXPLOITATION DANS LE BASSIN MINIER DE PROVENCE QUARTIERS PUITS ET GALERIES Jacques AUTRAN Thierry LOCHARD Raymond MONTEAU Travaux de l’Observatoire Hommes-Milieux du Bassin Minier de Provence de l’Observatoire Travaux TOHM 2 - L’exploitation dans le bassin minier de Provence : quartiers, puits et galeries Les TOHM Les TOHM (Travaux de l’Observatoire Hommes-Milieux du Bassin minier de Provence) constituent une collection de mémoires d’études, de notes de synthèse et de documents à caractère scientifique et technique produits dans le cadre de l’OHM du bassin minier de Provence. Ils sont téléchargeables sur le site Internet de l’Observatoire à l’adresse : http://www.ohm-provence.org Les auteurs Jacques AUTRAN est architecte et géomaticien au Laboratoire ABC, École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille. Thierry LOCHARD est architecte et historien de l’architecture au Laboratoire INAMA, École Natio- nale Supérieure d’Architecture de Marseille. Raymond MONTEAU, géologue, a travaillé aux Charbonnages de France dans les Houilières du Bassin du Centre et du Midi au siège de Gardanne. Pour citer ce document Jacques Autran, Thierry Lochard, Raymond Monteau, 2014. L’exploitation dans le bassin minier de Provence : quartiers, puits et galeries. Aix-en-Provence, CNRS – OHM Bassin minier de Provence, TOHM, 2, 88 pages. Photo de couverture Peinture du Puits Z, Gardanne, France, © François JAUJARD, le samedi 9 octobre 2010. Site internet de l’auteur : http://francois.jaujard.free.fr/ Le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 dans sa version consolidée du 1er janvier 2011 réserve à l’auteur le droit de divulgation. -

Nom De L'entite – N°
PAC06L – MASSIFS CALCAIRES CRÉTACÉS DES COSTES, DE LA BARBEN ET DE LA FARE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE INFORMATIONS PRINCIPALES Les chaines des Costes et de la Fare se situent dans le département des Bouches-du-Rhône, et sont entourées, au nord par la vallée de la Durance, à l’ouest par la plaine de Crau, et au sud par l’étang de Berre et le bassin de l’Arc. Ces massifs présentent une structure orientée est-ouest et encadrent la vallée de la Touloubre. Ce cours d’eau s’écoule depuis Nature : Système aquifère Venelles à l’est jusqu’à Salon-de-Provence à l’ouest, puis s’oriente vers le sud dans le secteur de Grans, avant de se jeter dans l’étang de Berre, à Saint-Chamas. L’altitude des massifs calcaires atteint environ 250 m pour le chainon de la Fare, 200 m pour le massif de la Barben, et 480 m pour la chaine des Costes. Dans le secteur de Pelissanne, la plaine alluviale de la Touloubre se situe à une altitude d’environ 100 m NGF. Thème : Sédimentaire karstique Les massifs calcaires constituent principalement des espaces naturels (garrigue) ; les terrains sont arides donc défavorables à l’agriculture, et peu habités. A contrario, la plaine de la Touloubre est largement urbanisée (Lambesc, Salon-de-Provence). Par ailleurs, une grande partie des sols est vouée à l’agriculture (vigne, vergers, grandes cultures). Type : Fissuré/karstique Le bassin de la Touloubre est soumis à un climat méditerranéen. Il reçoit des précipitations de forte intensité sur un temps très court. -

Curriculum Haiddi SERRAYE
Computer engineer Haiddi SERRAYE ASSETS : 37, Boulevard Mouton Writing and teaching skills, attendance, team spirit, 13014 Marseille organization and good integration French Nationality LANGUAGES : Born on 07/20/1989. English : technical, conversational, current. [email protected] Italian : conversational, current. Arabic : conversational, current.. 06.35.36.88.64 Berber : conversational, current. Malagasy : conversational (some basic knowledge) Geographical mobility : Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques, Septèmes-les-Vallons, Saint- Victoret, Gignac-la-Nerthe, Marignane, Châteauneuf-les- Martigues, Le Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le Rouet, Sausset- les-Pins, Gémenos, Roquefort-la-Bédoule, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, Cassis, La Ciotat, Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuge-les-Pins, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur- Huveaune, Peypin, Roquevaire, St-Savournin, St-Zacharie SKILLS IN COMPUTER SCIENCE Imperative programming : C, BASH, PERL Object oriented programming : JAVA (JEE), PYTHON Functional programming : HASKELL, LISP Logic programming : PROLOG Languages models : SRILM Web development : (X)HTML, XML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, PHP, AJAX technology Databases : SQL, MySQL, PgAdmin Frameworks et IDEs : CodeBlocks, Eclipse, Netbeans, Forms, SQL Developpers, JUnit, Maven, Selenium Operating systems : Windows, Linux Office automation (Offices…) DIPLOMAS AND CAREER PATH 2019 Engineering degree in computer science passed in Polytech Marseille School, Aix-Marseille University (campus of Luminy) Sandwich course with -
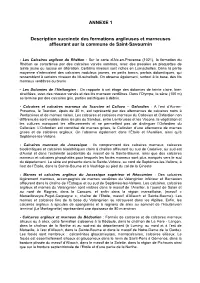
ANNEXE 1 Description Succincte Des Formations Argileuses Et Marneuses
ANNEXE 1 Description succincte des formations argileuses et marneuses affleurant sur la commune de Saint-Savournin - Les Calcaires argileux du Rhétien : Sur la carte d’Aix-en-Provence (1021), la formation du Rhétien se caractérise par des calcaires varvés sombres, avec des passées en plaquettes de teinte jaune ou rousse en altération. Certains niveaux sont riches en Lumachelles. Dans la partie moyenne s’intercalent des calcaires noduleux jaunes, en petits bancs, parfois dolomitiques, qui ressemblent à certains niveaux du Muschelkalk. On observe également, surtout à la base, des lits marneux verdâtres ou bruns - Les Dolomies de l’Hettangien : On rapporte à cet étage des dolomies de teinte claire, bien stratifiées, avec des niveaux varvés et des lits marneux verdâtres. Dans l’Olympe, la série (100 m) se termine par des calcaires gris, parfois oolithiques à débris. - Calcaires et calcaires marneux du Toarcien et Callovo – Oxfordien : A l’est d’Aix-en- Provence, le Toarcien, épais de 30 m, est représenté par des alternances de calcaires noirs à Pentacrines et de marnes noires. Les calcaires et calcaires marneux du Callovien et Oxfordien non différenciés sont visibles dans les plis du Sambuc, entre Lambruisse et les Vacons, la végétation et les cultures masquant les affleurements et ne permettant pas de distinguer l’Oxfordien du Callovien. L’Oxfordien est constitué de marnes grises, le Callovien d’une alternance de marnes grises et de calcaires argileux. On l’observe également dans l’Étoile et l’Aurélien, ainsi qu’à Septèmes-les-Vallons. - Calcaires marneux du Jurassique : Ils comprennent des calcaires marneux, calcaires biodétritiques et calcaires biodétritiques clairs à chailles affleurant au sud de Cadolive, au sud-est d’Auriol et dans l’extrémité occidentale du massif de la Sainte-Baume, ainsi que des calcaires marneux et calcaires phosphatés pour lesquels les faciès marneux sont plus marqués vers le sud du département.