L'exploitation Dans Le Bassin Minier De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Réseau Départemental Des Transports Des Bouches-Du-Rhône Réseau
57 Réseau départemental des transports plus de CG13 57 moins de CO2 des Bouches-du-Rhône 57 59 59 Ecopôle DIRECTION DES TRANSPORTS ET DES PORTS / JANVIER 2012 ET DES PORTS DIRECTION DES TRANSPORTS 17 240 ZA La M1 Valentine La Fourragère 240 Euroméditerranée 240 Arenc T2 allôcartreize Athélia Zone d’Activités d’industrie et de commerce 0810001326 Numéro Azur - prix d’un appel local Navettes rapides Lignes interurbaines départementales Points de vente N° Lignes organisées par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône Exploitants Téléphone du réseau Cartreize 6 Saint Chamas - Salon-de-Provence par Grans TRANSAZUR 04 90 53 71 11 ● Gare Routière de Marseille St Charles 11 La Bouilladisse - Aix-en-Provence par La Destrousse - Peypin - Cadolive - Gréasque Fuveau TELLESCHI 04 42 28 40 22 Pôle d’Echanges St Charles - Rue Honnorat 12 Meyreuil - Aix-en-Provence par Gardanne Autocars BLANC - 13003 Marseille - Tél.: 04 91 08 16 40 15 Berre l’Etang - Aix-en-Provence par Rognac et Velaux SUMA 04 42 87 05 84 ACCUEIL-INFO BILLETTERIE DÉPARTEMENTALE : Du lundi au samedi de 6h à 20h / Le dimanche et les jours fériés (sauf le 25 décembre, 16 Lançon de Provence - Aix-en-Provence par La Fare Les Oliviers SUMA 04 42 87 05 84 le 1er janvier et le 1er mai) de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 17 Salon-de-Provence - Aéroport Marseille Provence par Lançon - Rognac - Vitrolles SUMA 04 42 87 05 84 Navette Aéroport Tous les jours de 5h30 à 21h30 18 Arles - Aix-en-Provence par Raphèle les Arles - St Martin de Crau - Salon-de-Provence TELLESCHI 04 42 28 40 22 ● Envia &Vous -

Aix-En-Provence La Bouilladisse Aix-En-Provence
La Bouilladisse Aix-en-Provence Horaires valables du 24/08/15 au 21/08/16 Jours de fonctionnement LàV LàS LàS LàV LàS LàS LàV LàS LàS lignes Période de fonctionnement H1 AN2 AN2 H1 AN2 AN2 H1 AN2 AN2 PEYPIN - Auberge Neuve 06:41 07:35 12:25 régulières CADOLIVE - L'Ortolan 06:44 07:34 12:34 11 CADOLIVE - Armel Maroc 06:45 07:35 12:35 CADOLIVE - La Reyne 06:42 07:36 12:26 CADOLIVE - Chantecoucou 06:43 07:37 12:27 CADOLIVE - Le Stade 06:44 07:38 12:28 CADOLIVE - Saint Joseph 06:45 07:39 12:29 ST SAVOURNIN - La Chavatine 06:46 07:40 12:30 Belcodène ST SAVOURNIN - La Valentine 06:47 07:41 12:31 ST SAVOURNIN - Le Collet Blanc 06:49 07:43 12:33 La Bouilladisse ST SAVOURNIN - Centre 06:51 07:45 12:35 ST SAVOURNIN - L'Etoile 06:52 07:46 12:36 ST SAVOURNIN - Les Rampauds 06:54 07:48 12:38 LA BONNE ETOILE ST SAVOURNIN - La Patancline 06:55 07:49 12:39 ST SAVOURNIN - Les Gilets 06:56 07:50 12:40 St-Savournin PEYPIN - Les Oliviers 06:47 07:37 12:37 PEYPIN - Les Termes 06:51 07:41 12:41 Cadolive PEYPIN - Jas de Valèze 06:52 07:42 12:42 PUBLIC / ALTÉDIA PEYPIN - Halte Routière 06:55 07:45 12:45 PEYPIN - Les Pegoulières 06:57 07:47 12:47 Peypin PEYPIN - Le Château 06:58 07:48 12:48 PEYPIN - Les Hermites 06:59 07:49 12:49 PEYPIN - Valdonne 2 07:01 07:55 12:45 PEYPIN - Baume de Marron 07:02 07:57 12:46 La Destrousse BELCODENE - Les Hauts 06:53 07:45 12:40 BELCODENE - Les Cantonniers 06:53 07:45 12:40 BELCODENE -La Poste 06:54 07:46 12:41 BELCODENE - Ecole 06:55 07:47 12:42 BELCODENE - L'Albinos 06:56 07:48 12:43 LA BOUILLADISSE - Les Benezits 06:58 07:50 -

Publication of an Application for Registration of a Name Pursuant to Article 50(2)(A) of Regulation (EU) No 1151/2012 of The
C 26/8 EN Offi cial Jour nal of the European Union 27.1.2020 Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2020/C 26/05) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT ‘BROUSSE DU ROVE’ EU No: PDO-FR-02424 – 28.6.2018 PDO (X) PGI () 1. Name(s) ‘Brousse du Rove’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product [as in Annex XI] Class 1.3: Cheeses 3.2. Description of product to which the name in (1) applies ‘Brousse du Rove’ is a goat’s cheese presented in its original cornet used for moulding. The cornet is a truncated cone mould measuring 32 mm (diameter at the top) x 22 mm (diameter at the bottom) x 85 mm (height), with three holes pierced in the base. The cheese is produced using the milk flocculation method after heating and adding white alcohol vinegar as an acidifier. It contains a maximum of 30 grams of dry matter per 100 grams of cheese, and a minimum of 45 grams of fat per 100 grams of cheese when completely dry. Its weight is 45 to 55 grams at the end of the moulding process. -

Recueil Des Actes Administratifs N°13-2017-157
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°13-2017-157 BOUCHES-DU-RHÔNE PUBLIÉ LE 20 JUILLET 2017 1 Sommaire Agence régionale de santé 13-2017-07-18-002 - Décision tarifaire n° 1174 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de l'ESAT LA MANADE (3 pages) Page 4 13-2017-07-18-003 - Décision tarifaire n° 1176 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de l'ESAT LES ARGONAUTES (3 pages) Page 8 13-2017-07-18-004 - Décision tarifaire n°1175 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de l'ESAT ATELIER SAINT JEAN (3 pages) Page 12 Direction départementale de la protection des populations 13-2017-07-06-027 - Arrêté procédant au retrait du registre de sécurité de CTS (chapiteaux, tentes et structures) numéro d'identification t-13-2012-78 (2 pages) Page 16 13-2017-07-06-028 - Arrêté procédant au retrait du registre de sécurité de CTS (chapiteaux, tentes et structures) numéro d'identification t-13-2012-79 (2 pages) Page 19 13-2017-07-06-029 - Arrêté procédant au retrait du registre de sécurité de CTS (chapiteaux, tentes et structures) numéro d'identification T-13-2014-104 (2 pages) Page 22 Préfecture-Cabinet 13-2017-07-14-001 - Arrêté accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à l'occasion de la promotion du 14 juillet 2017 (56 pages) Page 25 Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité publique et de l’environnement 13-2017-07-17-005 - Arrêté portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées (prélèvements échantillons de peau et de gras sur espèces de Cétacés) (3 pages) Page 82 13-2017-07-18-006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable de 8 logements pour ouvriers agricolesAppartenant à la SCEA REVENYMas du Grand Bel AirLieu-dit « Campagne » sur la commune de SAINT ETIENNE DU GRES (13103) (2 pages) Page 86 13-2017-07-18-005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable par forage de deux logements destinés à l’hébergement d’ouvriers agricoles appartenant à M. -

Recueil Des Actes Administratifs N°13-2015-036 Publié Le 12
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°13-2015-036 BOUCHES-DU-RHÔN E PUBLIÉ LE 12 DÉCEMBRE 2015 1 Sommaire DIRECCTE Provence Alpes Côte d’Azur 13-2015-12-11-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail ARGENT au titre de la promotion du 1er janvier 2016 (84 pages) Page 3 13-2015-12-11-004 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail GRAND OR au titre de la promotion du 1er janvier 2016 (25 pages) Page 88 13-2015-12-11-005 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail VERMEIL au titre de la promotion du 1er janvier 2016 (47 pages) Page 114 13-2015-12-11-002 - Arrêté accordant la médaille d'honneur agricole à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2016 (4 pages) Page 162 13-2015-12-11-001 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur de travail "OR" au titre de la promotion du 1er janvier 2016 (45 pages) Page 167 13-2015-12-07-006 - Arrêté portant autorisation individuelle de déroger à la règle du repos dominical des salariés sollicitées par la Sté MAIA SONNIER à Marseille 13006 (3 pages) Page 213 13-2015-12-10-002 - Arrêté reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production à GYPTIS FORMATION 19 rue Léon Blum – 13090 AIX EN PROVENCE (2 pages) Page 217 13-2015-12-10-003 - Arrêté reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production à LE FUNICULAIRE 17 rue André Poggido – 13006 MARSEILLE (2 pages) Page 220 Préfecture des Bouches-du-Rhône 13-2015-12-11-006 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°6 à la Convention Constitutive du Groupement -

Curriculum Haiddi SERRAYE
Computer engineer Haiddi SERRAYE ASSETS : 37, Boulevard Mouton Writing and teaching skills, attendance, team spirit, 13014 Marseille organization and good integration French Nationality LANGUAGES : Born on 07/20/1989. English : technical, conversational, current. [email protected] Italian : conversational, current. Arabic : conversational, current.. 06.35.36.88.64 Berber : conversational, current. Malagasy : conversational (some basic knowledge) Geographical mobility : Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques, Septèmes-les-Vallons, Saint- Victoret, Gignac-la-Nerthe, Marignane, Châteauneuf-les- Martigues, Le Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le Rouet, Sausset- les-Pins, Gémenos, Roquefort-la-Bédoule, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, Cassis, La Ciotat, Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuge-les-Pins, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur- Huveaune, Peypin, Roquevaire, St-Savournin, St-Zacharie SKILLS IN COMPUTER SCIENCE Imperative programming : C, BASH, PERL Object oriented programming : JAVA (JEE), PYTHON Functional programming : HASKELL, LISP Logic programming : PROLOG Languages models : SRILM Web development : (X)HTML, XML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, PHP, AJAX technology Databases : SQL, MySQL, PgAdmin Frameworks et IDEs : CodeBlocks, Eclipse, Netbeans, Forms, SQL Developpers, JUnit, Maven, Selenium Operating systems : Windows, Linux Office automation (Offices…) DIPLOMAS AND CAREER PATH 2019 Engineering degree in computer science passed in Polytech Marseille School, Aix-Marseille University (campus of Luminy) Sandwich course with -
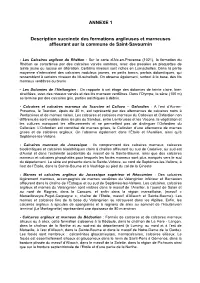
ANNEXE 1 Description Succincte Des Formations Argileuses Et Marneuses
ANNEXE 1 Description succincte des formations argileuses et marneuses affleurant sur la commune de Saint-Savournin - Les Calcaires argileux du Rhétien : Sur la carte d’Aix-en-Provence (1021), la formation du Rhétien se caractérise par des calcaires varvés sombres, avec des passées en plaquettes de teinte jaune ou rousse en altération. Certains niveaux sont riches en Lumachelles. Dans la partie moyenne s’intercalent des calcaires noduleux jaunes, en petits bancs, parfois dolomitiques, qui ressemblent à certains niveaux du Muschelkalk. On observe également, surtout à la base, des lits marneux verdâtres ou bruns - Les Dolomies de l’Hettangien : On rapporte à cet étage des dolomies de teinte claire, bien stratifiées, avec des niveaux varvés et des lits marneux verdâtres. Dans l’Olympe, la série (100 m) se termine par des calcaires gris, parfois oolithiques à débris. - Calcaires et calcaires marneux du Toarcien et Callovo – Oxfordien : A l’est d’Aix-en- Provence, le Toarcien, épais de 30 m, est représenté par des alternances de calcaires noirs à Pentacrines et de marnes noires. Les calcaires et calcaires marneux du Callovien et Oxfordien non différenciés sont visibles dans les plis du Sambuc, entre Lambruisse et les Vacons, la végétation et les cultures masquant les affleurements et ne permettant pas de distinguer l’Oxfordien du Callovien. L’Oxfordien est constitué de marnes grises, le Callovien d’une alternance de marnes grises et de calcaires argileux. On l’observe également dans l’Étoile et l’Aurélien, ainsi qu’à Septèmes-les-Vallons. - Calcaires marneux du Jurassique : Ils comprennent des calcaires marneux, calcaires biodétritiques et calcaires biodétritiques clairs à chailles affleurant au sud de Cadolive, au sud-est d’Auriol et dans l’extrémité occidentale du massif de la Sainte-Baume, ainsi que des calcaires marneux et calcaires phosphatés pour lesquels les faciès marneux sont plus marqués vers le sud du département. -

15. Le Massif De L'étoile Garlaban
15 : le massif de L’Étoile-Garlaban Le Pilon-du-Roy domine la chaîne centrale. Hameau des Putis à Simiane-Collongue Les communes L es reliefs calcaires qui séparent Marseille dans les Bouches-du-Rhône du pays d'Aix composent l'unité de paysage du Allauch massif de l'Étoile-Garlaban. Aubagne Belcodène Cabriès Ces paysages naturels sont marqués par un relief Cadolive La Bouilladisse spectaculaire et puissant. La Destrousse L'eau y est rare ou absente. Fuveau Gardanne Le paysage végétal s’est adapté à cette situation et Gréasque les anciens terroirs secs se restreignent aux Marseille Mimet franges des piémonts. Peypin L’espace central est déserté. Plan-de-Cuques Roquevaire Saint-Savournin La position en belvédère offre des panoramas Septèmes-les-Vallons Simiane-Collongue spectaculaires sur le littoral marseillais et sur les bassins intérieurs du pays d’Aix. 2 Ces reliefs constituent les horizons des deux cités. Superficie :..................... 360 km :.................. 20 km d’Est en Ouest Dimensions 18 km du Nord au Sud :......... 781 m, Tête du Grand Pech Altitude maximale :.......... 87 m, piémont de la Muscatelle à Altitude minimale Allauch 955 000 habitants Population :.................... environ 1 Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 15 - Le Massif de L’Étoile-Garlaban - 2007 Premières impressions Depuis Aix-en-Provence, l'horizon Sud est barré par une ligne Le paysage est sauvage. Dans la garrigue parcourue de sentes sombre et continue. se mêlent thym et kermès, argeiras et romarin, cades, aspic et La crête, déchiquetée, irrégulière, s'identifie par un chicot pins tortueux aux puissantes odeurs. Les hauts plateaux rocheux érigé en son centre : le Pilon du Roi. -

135 E Aubagne
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES BOUCHES-DU-RHONE Archives communales déposées 135 E AUBAGNE Classement Emile Isnard Archiviste municipal de Marseille 1929 Répertoire numérique détaillé Adrien Biéchy 1967 Bibliographie, sources complémentaires et index Laurence Fumey Assistante de conservation du patrimoine 1995 Saisie informatique 1995 Mise en forme Olivier Gorse Attaché de conservation du patrimoine 2000 2 135 E - archives communales d’Aubagne ___________________________________________________________________________________________ SOMMAIRE Bibliographie p 3 Sources complémentaires p 4-11 Cartes et plans p 11 AA Actes constitutifs de la commune p 12 BB Administration communale p 12-14 CC Finances, impôts, comptabilité p 14-23 DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie p 23-25 EE Affaires militaires p 25 FF Justice, procédures, police p 26 GG Cultes, instruction publique, assistance publique p 26-28 HH Agriculture, industrie, commerce p 28-29 JJ Documents divers p 29 Index p 30-34 135 E - archives communales d’Aubagne 3 ___________________________________________________________________________________________ BIBLIOGRAPHIE Dr L. Barthélémy : Histoire d'Aubagne, chef-lieu de baronnie, depuis son origine jusqu'en 1789, Marseille, Barlatier, 1889, 2 volumes, in 8° Dr L. Barthélémy : Une émeute à Aubagne contre l'impôt des farines au XVIIe siècle, Marseille, Cayer, 1880, 1 pl., 12 p Abbé H. Blanc : Quelques sites de la vallée de l'Huveaune, Marseille, Imp. mars., 1911, in 8°, 304 p C. Couvet : Histoire d'Aubagne, Aubagne, 1860, in 8°, 129 p P. Gaffarel : La bande d'Aubagne sous la Révolution, in "Annales de Provence" (janvier-avril 1920), Aix, Nicollet, 1920 Michel Gazenbeek : Le site castral d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), dans "Archéologie du midi médiéval", tome VIII-IX, 1990-1991 Alexandre Gilly : Histoire de l'occupation et de la libération d'Aubagne, Peypin, Cadolive, Cassis..., 1942-1944, vers l'épopée "Rhin et Danube", 1944-1945, Marseille, Imp. -

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET Le
NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET Le demandeur est : Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune ZI des Paluds - 932 av de la Fleuride 13400 Aubagne 04 42 62 82 63 – [email protected] www.syndicat-huveaune.fr Portage tripartite commune de La Destrousse / SIBVH / Aix-Marseille-Provence Métropole en substitution des communes de Peypin, La Bouilladisse, Cadolive, Saint Savournin DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE valant : Demande d’autorisation au titre des articles L.214.1 à L.214.6 du Code de l’Environnement Déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211.7 du Code de l’Environnement OBJET de la demande : PROGRAMME 2018-2022 DE TRAVAUX SUR LE MERLANCON ET SES AFFLUENTS, LE MERLANCON DE ROQUEFORT À AUBAGNE Référence Contrat de Rivière : B.1.1 Etude préalable au schéma directeur de gestion globale des milieux aquatiques : DIG DOSSIER DE DECLARATION D’INTERÊT GENERAL ET AUTORISATION LOI SUR L'EAU LIEU : Bouches-du-Rhône Communes : Cadolive La Destrousse La Bouilladisse Aubagne Auriol Saint Savournin Peypin PREAMBULE ET RAISON DU CHOIX DU PROJET Le SIBVH crée en 1963 assure les missions de réduction du risque inondation, d’entretien, de restauration et de préservation des cours d’eau ainsi que la mise en œuvre d’une gestion concertée sur le bassin versant de l’Huveaune depuis l’évolution de ses statuts en 2013. Le SIBVH regroupe à l’heure actuelle les communes de Plan-d’Aups Sainte Baume, Saint-Zacharie, Auriol, Roquevaire, Aubagne, La Penne sur Huveaune et Marseille, et assure des travaux sur l’Huveaune et les affluents des communes membres du SIBVH. -

Bouches Du Rhône 13.Xlsx
Nom de l'association Domaine d'activité de l'association Adresse de l'association CP Ville Montant +Avenir le patronage Formation et éducation 7 avenue André Roussin Le Ponant Littoral Bâtiment C 13016 Marseille 2000 Amicale CNL du Clos des Figuiers Politique de la ville 11 Rue Augustin Roux Le Clos des Figuiers BATIMENT A 13015 Marseille 1000 SAINT HENRI FOOTBALL CLUB Sport 21 TRAVERSE DE L'HERMITAGE 13015 Marseille 3000 Judo Guide 13 Sport Résidence Fondacle Bât Port Pin 3 23 rue professeur Marcel Arnaud 13013 Marseille 8000 BA BALEX Point d'appui Vie Associative 84 RUE SYLVABELLE 13006 Marseille 15000 AMITIES MARSEILLAISES CULTURES ET PARTAGES Politique de la ville C/O VERA TUR 20 rue de Crimée 13003 Marseille 2000 Culture du Coeur 13 Culture Le Phocéen Bat D 32 rue de Crimée 13003 Marseille 2000 ASJ Ecole jaoide Sport Le Margarita 1 Jas de Bouffan 13090 Aix-en-Provence 8000 Les films du Delta Culture 2 rue Marie Mauron (Résidence Les Vignes) 13790 Rousset 1000 A voix haute Défense des droits cité des Associations - 93 La Canebière - BP 163 13001 Marseille 1000 Cancer Aide Infos Reseau Entrepreneurs Santé 11 rue de la république 13002 Marseille 1000 Grand Braquet Sport 462 rue Mireille Lauze 13011 Marseille 1500 Destination familles Politique de la ville 43 rue d'Aubagne 13001 Marseille 7000 Asso GV mieux vivre Sport Maison de la vie associative - Le ligoures - Place Romée de Villeneuve 13090 Aix en Provence 800 Rap N boxe Sport 1 boulevard Finat DUCLOS - Le petit Canet 13014 Marseille 8000 Basket club des remparts Sport 32 boulevard -

Aix-En-Provence La Bouilladisse Aix-En-Provence
Ce dépliant a coûté 0,15€ Merci de ne pas le jeter, ni le gaspiller. Aix-en-Provence Retrouvez-le en téléchargement sur www.lepilote.com La Bouilladisse Où acheter vos Horaires valables du titres de transport ? 05/01/15 au 23/08/15 Jours de fonctionnement LàV LàV LàV LàV LàV LàS LàS LàS LàS LàS LàS • AIX-EN-PROVENCE lignes Gare routière - Avenue de l’Europe Période de fonctionnement SCOL AN2 SCOL VAC AN2 AN2 AN2 AN2 AN2 AN2 AN2 régulières • CADOLIVE BELCODENE - Les Hauts 06:50 07:40 12:30 Tabac Presse - Place Armel Maroc BELCODENE - Les Cantonniers 06:51 07:41 12:31 11 BELCODENE - La Poste 06:52 07:42 12:32 • LA DESTROUSSE BELCODENE - Ecole 06:53 07:43 12:33 Thieblemont presse - Centre commercial Casino BELCODENE - L’Albinos 06:54 07:44 12:34 LA BOUILLADISSE - Les Benezits 06:55 07:45 12:35 LA BOUILLADISSE - Marius Boyer 06:59 07:46 12:39 Exemples de tarification LA BOUILLADISSE - La Gare - PMR 07:00 07:47 12:40 Belcodène ST SAVOURNIN - Les Gilets 06:45 06:50 07:35 12:30 Billet Carnet 6 Carte Carte Carte Carte Carte Carte Annuelle ST SAVOURNIN - La Patancline 06:46 06:51 07:36 12:31 unité voyages* 7J 7J+ 30J 30J+ Annuelle + ST SAVOURNIN - Les Rampauds 06:47 06:52 07:37 12:32 La Bouilladisse Aix vers : - Belcodène ST SAVOURNIN - L’Etoile 06:49 06:54 07:39 12:34 - St Savournin 3,00 € 12,60 € 11,00 € 15,70 € 37,40 € 53,40 € 374 € 531 € ST SAVOURNIN - Centre 06:50 06:55 07:40 12:35 LA BONNE ETOILE - Cadolive ST SAVOURNIN - Maison Neuve 06:51 06:56 07:41 12:36 - Peypin ST SAVOURNIN - Le Collet Blanc 06:52 St-Savournin St Savournin vers : ST SAVOURNIN - La Valentine 06:54 - Cadolive 1,10 € 4,60 € 5,90 € 20,10 € 201 € - Peypin ST SAVOURNIN - La Chavatine 06:55 - La Destrousse CADOLIVE - L’Ortolan 06:50 06:58 07:43 12:38 Cadolive ALTÉDIA PUBLIC / ALTÉDIA En vigueur au 05/01/2015 (non contractuel sous réserve CADOLIVE - Armel Maroc 06:51 06:59 07:44 12:39 de modifi cation).