Jacques Rigaut, Le Suicidé Magnifique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
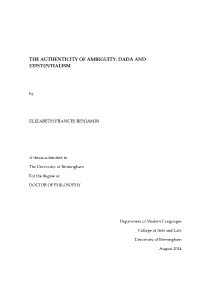
The Authenticity of Ambiguity: Dada and Existentialism
THE AUTHENTICITY OF AMBIGUITY: DADA AND EXISTENTIALISM by ELIZABETH FRANCES BENJAMIN A thesis submitted to The University of Birmingham For the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Modern Languages College of Arts and Law University of Birmingham August 2014 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. ii - ABSTRACT - Dada is often dismissed as an anti-art movement that engaged with a limited and merely destructive theoretical impetus. French Existentialism is often condemned for its perceived quietist implications. However, closer analysis reveals a preoccupation with philosophy in the former and with art in the latter. Neither was nonsensical or meaningless, but both reveal a rich individualist ethics aimed at the amelioration of the individual and society. It is through their combined analysis that we can view and productively utilise their alignment. Offering new critical aesthetic and philosophical approaches to Dada as a quintessential part of the European Avant-Garde, this thesis performs a reassessment of the movement as a form of (proto-)Existentialist philosophy. The thesis represents the first major comparative study of Dada and Existentialism, contributing a new perspective on Dada as a movement, a historical legacy, and a philosophical field of study. -

Lacing up the Gloves: Women, Boxing and Modernity Irene Gammel Ryerson University, Toronto
Lacing Up the Gloves: Women, Boxing and Modernity Irene Gammel Ryerson University, Toronto Abstract This article explores women’s early twentieth-century engagement with boxing as a means of expressing the fragmentations and contradictions of modern life. Equally drawn to and repelled by the visceral agonism of the sport, female artists and writers of the First World War and post- war era appropriated the boxer’s virile body in written and visual autobiographies, effectively breaching male territory and anticipating contemporary notions of female autonomy and self- realization. Whether by reversing the gaze of desire as a ringside spectator or inhabiting the physical sublime of boxing itself, artists such as Djuna Barnes, Vicki Baum, Mina Loy and Clara Bow enlisted the tropes, metaphors and physicality of boxing to fashion a new understanding of their evolving status and identity within a changing social milieu. At the same time, their corporeal and textual self-inscriptions were used to stage their own exclusion from the sport and the realm of male agency and power. Ultimately, while modernist women employ boxing to signal a radical break with the past, or a reinvention of self, they also use it to stage the violence and trauma of the era, aware of limits and vulnerabilities. Keywords: boxing, women, modernity, self-representation, gender 1 Lacing Up the Gloves: Women, Boxing and Modernity No man, even if he had earlier been the biggest Don Juan, still risks it in this day and age to approach a lady on the street. The reason: the woman is beginning to box! - German boxing promoter Walter Rothenburg, 19211 Following Spinoza, the body is regarded as neither a locus for a consciousness nor an organically determined entity; it is understood more in terms of what it can do, the things it can perform, the linkages it establishes, the transformations and becomings it undergoes, and the machinic connections it forms with other bodies, what it can link with, how it can proliferate its other capacities – a rare, affirmative understanding of the body. -

Black Humour” at French and Greek Writers
International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) Volume 2 / Issue 3/ 2015 The Concept of “Black Humour” at French and Greek Writers NIKA Maklena University of Tirana, Albania E-mail: [email protected] Received 29.01.2015; Accepted 12.02. 2015 Abstract In the article in question, it will be analyzed the concept of “black humour”, one of the four main pillars, which sustained the surrealist creativity. In more specific terms, they are: automat writing, insane love and objective chance. As one of the strongest expressive means of surrelist writers, black humour turned into their symbol in order to better convey the objection against the reality of time. Colorations of black humour will be analyzed in comparative platform at the following writers: Francis Picabia, Jacques Rigaut and Nikos Engonopoulos, who converge into a common thematic point – death. Through the analysis of several parts selected by them, I will also reveal the similarities in expression, poetical images used, but on the other side, their particularities as well. Keywords: Surrealism, black humour, poetical image, death, unaware. 1. Introduction The first resource of this term’s origin in English humour derives from the theory of Hippocrates on "body liquids". According to such medical theory, there are four mixtures in the human body, where each of them is related to the prevalence of one of these four liquids. When a hamonic mixture of such liquids exists, the man is healthy and in good mood (humour)... Several people cannot fairly perceive what role jokes and humour play in their lives, even though Freud called it a display of the unawareness (Z.I. -

Saturday Purpose, Generating Explorations of Altered States of Consciousness Through Art and Sound
MORE details AND Updates CAN BE Uncovered at 8p Cesar Vallejo. KBOO poet Barbara LaMorticella reads from the 9p Cable Access Dada/Surrealist Film Simulcast. As we 10:30p Antonin Artaud’s Artaud the Momo. After It’s 1918. You’re young and living in Berlin. You’re a works of this great Peruvian poet who helped to invent surrealism, pronounced it go to press, KBOO has coordinated time with Portland Cable Access for Channel 23 spending 8.5 years in insane asylums, Artaud reemerged to literary Paris in 1946 www.kboo.fm/dada little dazed to have survived the mass-slaughter of World War I. dead, and then produced a body of passionate Communist/Surrealist work. from 9p-3a. We plan to show silent Dada and Surrealist films and invite any and all to with this account of his Phoenix-like rise after receiving massive electro-shock You feel sorrow and anger that so many of your friends and fam- come to our radio station at 20 SE 8th to help us provide soundtracks for the films. treatments. “In Artaud the ancient, black springs of poetry are graspable, like a ily were killed, mutilated, driven mad by the first mechanized 9p provide music and spoken word. writhing piece of star gristle. Antonin Artaud is the stamina of poetry to enact in maginewar with weapons of mass slaughter, the first with a new mental damage called “shell shock.”• The Dead Air Fresheners a machine-gunned hearth the ember of song.” A radio-theater dramatization of Like your surviving friends, you have only contempt for your “civilization” and its masters whom 11p Naughty Bits: Ubu Roi by Alfred Jarry. -

Lacing up the Gloves: Women, Boxing and Modernity
03 Gammel Cash 9.3:02Jackson 6/7/12 10:16 Page 369 LACING UP THE GLOVES WOMEN, BOXING AND MODERNITY Irene Gammel Ryerson University, Toronto ABSTRACT This article explores women’s early twentieth-century engagement with boxing as a means of expressing the fragmentations and contradictions of modern life. Equally drawn to and repelled by the visceral agonism of the sport, female artists and writers of the First World War and post-war era appropriated the boxer’s virile body in written and visual autobiographies, effectively breaching male territory and anticipating contemporary notions of female autonomy and self-realization. Whether by reversing the gaze of desire as a ringside spectator or inhabiting the physical sublime of boxing itself, artists such as Djuna Barnes, Vicki Baum, Mina Loy and Clara Bow enlisted the tropes, metaphors and physicality of boxing to fashion a new understanding of their evolving status and identity within a changing social milieu. At the same time, their corporeal and textual self-inscriptions were used to stage their own exclusion from the sport and the realm of male agency and power. Ultimately, while modernist women employ boxing to signal a radical break with the past, or a reinvention of self, they also use it to stage the violence and trauma of the era, aware of limits and vulnerabilities. Keywords: boxing, women, modernity, self-representation, gender No man, even if he had earlier been the biggest Don Juan, still risks it in this day and age to approach a lady on the street. The reason: the woman is beginning to box! German boxing promoter Walter Rothenburg, 1921 1 Following Spinoza, the body is regarded as neither a locus for a consciousness nor an organically determined entity; it is understood more in terms of what it can do, the things it can perform, the linkages it establishes, the transformations and becomings it undergoes, and the machinic connections it forms with other bodies, what it can link with, how it can proliferate its other capacities – a rare, affirmative understanding of the body. -

Download Download
Vol 1 (2011) | ISSN 2155-1162 (online) | DOI 10.5195/contemp.2011.27 http://contemporaneity.pitt.edu “The Man of these Infinite Possibilities” Max Ernst’s Cinematic Collages Abigail Susik Abstract On more than one occasion in his critical writings of the 1920’s, surrealist leader André Breton compared Max Ernst’s collages to cinema. In his first essay on the artist in 1921, Breton aligned Ernst’s collages with cinematic special effects such as slow and accelerated motion, and spoke of the illusionistic ‘transformation from within’ that characterized Ernst’s constructed scenes. For Breton, Ernst’s collages employing found commercial, scientific and journalistic images approximated the naturalistic movement of film, and thereby contributed to the radical obsolescence of traditional two-dimensional media such as painting and drawing, which remained frozen in stillness. Thus, Ernst’s images were provocative witnesses to the way in which modern technology fundamentally altered the perspectivally-ordered picture plane. But at the same time that Ernst’s collages rendered painting obsolete, they likewise depended upon fragments of outmoded popular culture themselves. For Breton, Ernst was a magician, “the man of these infinite possibilities,” comparable to cinematic prestidigators like turn-of-the-century filmmaker Georges Méliès. By drawing on the influence of recently outmoded popular culture such as early trick films, Ernst provides a crucial early example of the post-war fixation on counter-temporalities and anti-production. At once technologically advanced and culturally archeological, Ernst’s collages cannily defy strict categorization as “Modernist.” About the Author Abigail Susik is the 2009-2011 Postdoctoral Teaching Fellow in Art History at Millsaps College in Jackson, Mississippi. -

„WER SORGEN HAT, DER LESE DADAGLOBE“ Zum 100. Dada-Jubiläum Erscheint Erstmals Die Rekonstruktion Der Geheimnisumwitterten Anthologie „Dadaglobe“
„WER SORGEN HAT, DER LESE DADAGLOBE“ Zum 100. Dada-Jubiläum erscheint erstmals die Rekonstruktion der geheimnisumwitterten Anthologie „Dadaglobe“ „Was dada ist, wissen nicht einmal die Dada- kannten Ägyptologen Georg Moritz Ebers isten, sondern nur der Oberdada, und der sagt stammt. Ebers, Vertreter des deutschen Pro- es niemand“, heißt es beim selbsternannten fessorenromans, publizierte 1885 seinen Oberdada Johannes Baader, und ob die regel- Roman Serapis, der 1893 bereits seine 10. rechte Dada-Hype des Jahres 2016, in dem der Auflage erlebte (Georg Moritz Ebers: Serapis. 100. Dada-Geburtstag gefeiert wurde, bei der Historischer Roman. Stuttgart und Leipzig: Beantwortung dieser Frage wirklich geholfen Deutsche Verlags-Anstalt 1885). Der Roman hat, sei dahin gestellt. Schon die Herkunft des spielt im Jahr 391, als Theodosius I. im römi- Namens Dada bleibt umstritten – die Dadais- schen Reich das Christentum zur Staatsreligi- ten selbst, stets auf die Deutungshoheit über on erhoben hatte und handelt von Konflikten ihre Bewegung bedacht, haben bekannterma- mit den heidnischen Traditionen. Dabei steht ßen unterschiedliche und mit einander konkur- eine aus Rom gerade in Alexandria angelangte rierende Erklärungen geliefert: Dada ist das wandernde Sängerfamilie im Mittelpunkt – französische Wort für Steckenpferd, Dada gilt und zu dieser Familie gehört eine Tochter als Zufallsfund im Lexikon, als kindlicher namens Dada. Dada ist eine der tragenden Lall-Laut, als Name einer seinerzeit in Zürich Handlungsfiguren, sie ist Heidin, hübsch, erhältlichen Seife. kann gut singen – und niemand stößt sich an Aber: „Bevor Dada da war, war Dada da“, ihrem merkwürdigen Namen Dada. Womit dekretierte wiederum der Dada-Mitbegründer nicht behauptet werden soll, dass dieser mit Hans Arp, und auch das ist nicht von der den Zürcher Dadaisten etwas zu tun haben Hand zu weisen. -

The Uncensored Writings of Elsa Von Freytag-Loringhoven
introduction “Say it with—— — Bolts! Oh thunder! Serpentine aircurrents—— — Hhhhhphssssssss! The very word penetrates! —LS e a von Freytag-Loringhoven, “a dozen cocktaiLS—pLeaSe” The immense cowardice of advertised literati & Elsa Kassandra, “the Baroness” von Freytag etc. sd/several true things in the old days/ driven nuts, Well, of course, there was a certain strain On the gal in them days in Manhattan the principle of non-acquiescence laid a burden. — ezra pound, canto 95 t he FirSt aMerican dada The Baroness is the first American Dada. — jane heap, 19201 “All America is nothing but impudent inflated rampantly guideless burgers—trades people—[…] as I say—: I cannot fight a whole continent.”2 On April 18, 1923, after having excoriated American artists, citizens, and law enforcement for more than a decade, the German-born Dadaist Elsa von Freytag-Loringhoven (1874–1927) was leaving New York. Waving farewell from the Port Authority pier was magazine editor Jane Heap, who had steadfastly championed the Baroness’s poetry in the pages of The Little Review. The water churning beneath the S.S. York that was carrying the Baroness back to Germany was nothing compared to the violent turbulences she had whirled up during her thirteen-year sojourn in America. No one had ever before seen a woman like the Baroness (figure I.1). In 1910, on arrival from Berlin, she was promptly arrested for promenading on Pittsburgh’s Fifth Avenue dressed in a man’s suit and smoking a cigarette, even garnering a headline in the New York Times: “She Wore Men’s Clothes,” it proclaimed aghast.3 Just as they were by her appearance, Americans were flabbergasted by the Baroness’s verse. -

DADA / USA. Connections Between the Dada Movement and Eight American Fiction Writers
TESIS DOCTORAL Título DADA / USA. Connections between the Dada movement and eight American fiction writers Autor/es Rubén Fernández Abella Director/es Carlos Villar Flor Facultad Facultad de Letras y de la Educación Titulación Departamento Filologías Modernas Curso Académico DADA / USA. Connections between the Dada movement and eight American fiction writers, tesis doctoral de Rubén Fernández Abella, dirigida por Carlos Villar Flor (publicada por la Universidad de La Rioja), se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright. © El autor © Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2017 publicaciones.unirioja.es E-mail: [email protected] UNIVERSIDAD DE LA RIOJA Facultad de Letras y de la Educación Departamento de Filologías Modernas PHD THESIS DADA / USA CONNECTIONS BETWEEN THE DADA MOVEMENT AND EIGHT AMERICAN FICTION WRITERS Rubén Fernández Abella Supervisor: Dr. Carlos Villar Flor 2016 Contents Acknowledgements 4 1. Introduction 1. 1. Purpose and Structure 5 1. 2. State of the Art 11 1. 3. Theoretical Framework 19 2. A Brief History of Dada 2. 1. The Birth of Dada 28 2. 2. New York Dada 36 2. 3. Paris Dada: The Demise of the Movement? 42 2. 4. Dada and Surrealism 45 3. Dada, Language, and Literature 3. 1. Dada’s Theory of Language 49 3. 2. Dada and the Novel: A Survey of Dadaist Fiction 52 3. 2. 1. Hugo Ball: Flametti oder vom Dandysmus der Armen and Tenderenda der Phantast 55 3. 2. 2. Kurt Schwitters: “Die Zwiebel” and Franz Müllers Drahtfrühling 60 3. -

Jacques Rigaut's Happiest Birthday (A Dada Bedtime Story)
Jacques Rigaut's Happiest Birthday (A Dada Bedtime Story) by Edward Desautels Jacques Rigaut: le plus Dada des Dadaists Chronology: Arrangement of events in time. Map: 1. Plane surface representation of a region of the earth or sky. 2. Something resembling a map in clarity of representation. 3. Slang. The face. The Face Chronologie? C'est une carte de temps. Where, exactly, is your web site? Where will it be in a billion million? Where will it be come 2010? 1898 December 30 at two o'clock in the morning in Paris: birth of Jacques-George Rigaut, second son of George-Maurice Rigaut and Madeleine-Berthe Pascal. So much blew away over the mud, so much horse tripe: steaming, bloated garlands strewn over culverts strangled with the detritus of Marshal Foch's articulate rebuttal: choked rivers of men, belching jalopies, panicked mules scrambling from rotted planking to groan and despair in the deep, sucking mire, petrol fumes and smoke: footnotes in the slow plow to Verdun, Ypres, Chateau Thierry, Tierra del Feugo, wherever-the-hell to dig a trench, grit teeth, shrug shoulders, abandon hope, stagger home. Rigaut, full of it, knelt down in the mud, the tattered hem of his trench coat absorbing stench and stain, and filled his canteen with the culvert's nectar, diffidently sweeping away the flies swirling above it, drunk on the culvert's vapors. This was the way he made his way home to Paris: palpating for an ultimate alibi, for paradis artificiels, for nourritures terrestres. I am an apprentice-warrior, he thought, and then dwelled for several moments on the image of Max's exploding face, on the way the brains felt as they splattered his own face and neck: the luke-warm patter of rendered chicken fat and splintered porcelain. -

Arthur Cravan
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works Publications and Research CUNY Graduate Center 2021 Arthur Cravan Mary Ann Caws CUNY Graduate Center How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_pubs/631 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] . Interval : Arthur Cravan “I have twenty countries in my memory and I drag the colours of a hundred cities in my soul.”1 And now arrives Arthur Cravan, just presented as, perhaps, he would have wished. 2And so Maintenant, with its five issues has arrived and taken over. A personal confession: I have to say, that during a time in Rome in 2016, in a corner bookshop, far from everything I found a copy of Maintenant, which by happenstance convinced me to write this book. It was happenstance, for I was in Rome, doing something else entirely (I was there to speak on Pablo Echaurren, and his remaking of Marcel Duchamp’s toilet and such and I had exhausted myself climbing up the steps to see the exhibition, prompted by my friend Daniela Daniele) but there I was. 3So the Arthur Cravan interruption was totally unforeseen, and for that reason continues to seem somewhat miraculous. So Arthur Cravan. Fabian Avenarius Lloyd a.k.a. Arthur Cravan, about whom almost everything should be, has to be, in capitals with exclamation points following. Sometimes he was also Edouard Archinard, 4and some others (Isaac Cravan, Dorian Hope, Sebastian Hope, B. -

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE • 2017 |1 KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE RDLM S ÉS IRODALOM- a Százéves Dada 2017 1
Ára: 1300 Ft Előfizetés egy évre: 5200 Ft 1 | IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE A százéves dada KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE • 2017 ÉS Folyóiratunknak ez a száma az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága 2017 és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. HELIKON • IRODALOM- 1 Helikon2017_1_borito.indd 161 5/23/2017 2:10:53 PM Terjeszti a Magyar Posta Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága (1089 Budapest, Orczy tér 1.). Előfizethető valamennyi postán, a kézbesítőknél; e-mailen: [email protected]; faxon +36-1-303-3440. HELIKON További in for máció: +36-80-444-444. Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában (1061 Buda- pest, Andrássy út 45.), az MTA BTK Penna Bölcsész Könyvesboltjában (1053 Budapest, Magyar u. 40., tel.: +36-30-203-1769), a fo lyó irat korábbi számai beszerezhetők az Argumentum Kiadónál (1085 Bu- IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI REVUE dapest, Mária u. 46., tel.: +36-1-485-1040, fax: +36-1-485-1041). Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur- Press Kft. (H-1014 Budapest, Szentháromság tér 6., tel./fax: +36-1-201-8891). SZEMLE DE L’INSTITUT D’ÉTUDES LITTÉRAIRES A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DU CENTRE DE RECHERCHE Előfizetési díj 2017-re: 5200 Ft BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DES SCIENCES HUMAINES Egy szám ára: 1300 Ft IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK DE L’ACADÉMIE HONGROISE FOLYÓIRATA DES SCIENCES SZERKESZTŐBIZOTTSÁG / COMITÉ DE RÉDACTION Földes Györgyi főszerkesztő / directrice de la revue Varga László a szerkesztőbizottság elnöke / président du comité de rédaction T. Erdélyi Ilona Hites Sándor Kalavszky Zsófia Karafiáth Judit könyvrovat / livres Rákai Orsolya Szentpéteri Márton Szili József Sőrés Zsolt technikai szerkesztő / révision des textes SZERKESZTŐSÉG / SECRÉTARIAT DE LA RÉDACTION 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.