Traditions Orales Et Archives Au Gabon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gabon Poverty Assessment
Report No: AUS0001412 . Gabon Poverty Assessment . MARCH 2020 . POVERTY AND EQUITY GLOBAL PRACTICE . © 2017 The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433 Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org Some rights reserved This work is a product of the staff of The World Bank. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Rights and Permissions The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for noncommercial purposes as long as full attribution to this work is given. Attribution—Please cite the work as follows: “World Bank. {YEAR OF PUBLICATION}. {TITLE}. © World Bank.” All queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2625; e-mail: [email protected]. 2 Gabon Poverty Assessment March 2020 3 Acknowledgement The members of the core team that prepared this report are Nadia Belhaj Hassine Belghith (GPV07, TTL), Pierre de Boisséson (GPV01) and Shohei Nakamura (GPV01). -

Gabon 24 April 2020
Directorate General of Customs and Indirect Taxes – Gabon 24 April 2020 Measures adopted to combat the COVID-19 pandemic 1. Measures to facilitate the cross-border movement of relief consignments and essential supplies 1.1. Designation of a Customs Focal Point/COVID-19 Monitoring Unit. 1.2. Note granting relief from Customs duties on imports of products to be used in fighting COVID-19 (gloves, bibs, alcohol-based hand sanitizers, Thermoscans (ear thermometers), etc.). 1.3. Appointment of a Customs representative to the Steering Committee for the Fight against the CORONAVIRUS, for the emergency procedure (signing BAEP (automatic temporary clearance note) forms on behalf of the Director General). 2. Measures to support the economy and ensure supply chain continuity 2.1. An emergency funding window for companies, to help incorporated SMUs and micro-enterprises (and, on an exceptional basis, large companies) that are up-to-date with their tax and social security obligations and affected by the COVID-19 crisis and which undertake to maintain jobs. This does not involve budget funding but bank credit offered to companies on favourable terms. 2.2. A tax window open to socially responsible companies and workers. There are three (3) measures relating to this window, namely: ✓ The fall in trading licences and in combined withholding tax (ISL); ✓ Tax rebates to socially responsible companies (Corporation Tax and Personal Income Tax); ✓ Tax exemption for all bonuses awarded to workers who engage in their professional activity during lockdown. The object of this tax window is to help companies that keep on their workers to display solidarity and set a good example, and to motivate workers exposed to risk during lockdown. -

Pdf | 699.42 Kb
Emergency Plan of Action Final Report Gabon: Elections Preparedness DREF operation No. MDRGA007 Date of disaster: 15 July – 28 August 2016 Date of Issue: 28 February 2017 Operation start date: 15 July 2016 Operation end date: 21 November 2016 Operation manager (responsible for this EPoA): Josuane Point of contact: Léonce-Omer Mbouma, National Flore Tene, Disaster and Crisis Prevention, Response and Director for Organisational Development and Disaster Recovery Coordinator and Risk Management Overall operation budget: CHF 257,240 Initial budget: CHF 41,854 Additional budget: CHF 215,386 Number of people assisted: 5,000 people Host National Society: Gabonese Red Cross Society with 2,700 volunteers, 15 local committees, 54 branches and 14 employees. Red Cross Red Crescent Movement partners currently actively involved in the operation: International Committee of Red Cross, and International Federation of Red Cross and Crescent Societies Other partner organizations involved in the operation: Ministry of Interior, Gabon’s Civil Protection/medical emergency services (SAMU, SMUR - which joined the Red Cross teams in a coordinated manner a few days after the beginning of the hostilities) and United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (collecting and relaying information), African Union (in a mediation role) Summary: On 15 July 2016, with a DREF allocation of CHF 41,854, the Gabonese Red Cross started to train and equip its emergency teams as part of its contingency plan for election preparedness. The initial DREF was set to end on 21 September 2016. Expenses were at 90 percent and the remaining activities were as follows: (1) A lessons learnt exercise; and (2) Finance control and closure exercise by Central Africa Country Cluster office in Yaoundé. -

Aménagement Forestier Au Gabon
8°0'E 9°0'E 10°0'E 11°0'E 12°0'E 13°0'E 14°0'E Cameroun AMÉNAGEMENT MINVOUL ") BITAM ") 2°0'N 2°0'N FORESTIER Minkébé TTIB AU GABON Guinée ") SOGASCIC Equatoriale OYEM Situation en Décembre 2008 SDO Toujours Vert SDO FOREEX Légende Bordamur "/ Bordamur SUNRY Mekambo Capitale HTG Monts de Cristal MEDOUNEU ") STIBG ") ") 1°0'N COCOBEACH ") Naike 1°0'N Chef lieu de Province FOREEX MEKAMBO Wood Grand Bois OLAM TLP SOGASCIC GEB- ") Philia Intl BSG TLP ASSALA- Chef lieu de Département GEB-ASSALA-CBK TBNI MITZIC CBK ") BSO Chemin de fer OLAM HTG Greenedge FOREEX TBNI HTG Naike Wood Forêt classée TLP BSG SEEF BSO Route publique principale Akanda HTG TBNI de la Mondah MAKOKOU Rougier CFA ") HTG Rougier H-A O-I HTG Route publique secondaire BSO Mwagna OLAM SUNRY NTOUM SEEF LIBREVILLE "/ ") Mekambo RFM Aménagement des permis forestiers ") OVAN HTG HTG KANGO Bitoli RFM CFAD - Plan d'aménagement produit ") Chambrier CFA Rougier HTG BSG O-I Ivindo Pongara Philia Intl Greenedge CPAET GEB-ASSALA-CBK TBNI BSO TBNI 0°0' 0°0' BSG BSG CPAET (PAPPFG) IFK ") HTG BOOUE Autre permis NDJOLE") Hua Jia SEEF TNC HTG CORA Aires protégées RFM CEB SUNLY FBA Wood Okondja Parc National Leroy Lopé EFM CFA CORA Wood ABOUMI OKONDJA CEB ") SBL ") Végétation ") CEB ") Bordamur LAMBARENE ") PORT-GENTIL Leroy ONGA ") Forêt dense humide Bonus CORA Harvest LASTOURSVILLE CEB Wood Végétation autre que forêt SUNLY SUNLY Eau 1°0'S Leroy 1°0'S Mouila Mouila CFA Bordamur Rimbunan Hijau KOULAMOUTOU ") Source: les données relatives aux concessions forestières proviennent ") FOUGAMOU CIPLAC -
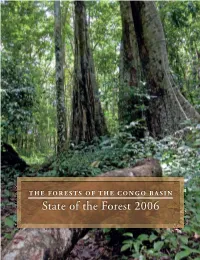
State of the Forest 2006
THE FORESTS OF THE FORESTS THE CONGO BASIN: For the Congo Basin Forest Partnership (CBFP), prepared in collaboration with: • COMIFAC and the forestry ministers of Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, Central African Republic, Republic of Congo, and the Democratic Republic of Congo • Conservation NGOs active in the Landscapes (African Wildlife Foundation, Conservation International, Wildlife Conservation Society, World Wildlife Fund/World Wide Fund for Nature) • Institutions and offi ces working on the implementation of sustainable exploitation (CIFOR, CIRAD, Forêt Ressources Management) • Governmental and non-governmental institutions monitoring resources through remote sensing (Joint Research Center, Université catholique de Louvain, South Dakota State University, University of Maryland, World Resources Institute) 2006 of the Forest State THE FORESTS OF THE CONGO BASIN State of the Forest 2006 680670 www.lannooprint.com THE FORESTS OF THE CONGO BASIN State of the Forest 2006 Th e Congo Basin Forest Partnership Partners (CBFP) Governments Th e CBFP is a non-binding Type II part- · Republic of South Africa (DWAF) nership composed of approximately 30 govern- · Germany (BMZ, GTZ) mental and non-governmental organizations. · Belgium (MAECECD) It was launched at the 2002 World Summit on · Cameroon (ONADEF) Sustainable Development in Johannesburg, South · Canada (ACDI) Africa in order to promote the sustainable man- · European Union (EC, ECOFAC, JRC) agement of the forests of the Congo Basin and · USA (DSPI, CARPE-USAID) improve the quality of life of the region’s inhabit- · France (MAE, AFD, MEDD, CIRAD) ants. Th e CBFP’s main objectives are to improve · Equatorial Guinea communication among its members and support · Gabon coordination between members’ projects, pro- · Japan (Embassy of Japan in France) grams, and policies. -

Plan Opérationnel Gabon Vert Horizon 2025
Plan Opérationnel GABON VERT Horizon 2025 Donner à l’Emergence une trajectoire durable Le mot du chef de l’Etat ALI BONGO ONDIMBA 4 Extrait du projet de société « L’Avenir en confiance » du Président Ali BONGO ONDIMBA Le pilier Gabon Vert s’appuiera sur la valorisation du « pétrole vert » que constitue notre formidable écosystème (nos 22 millions d’hectares de forêt, nos terres agricoles, nos 800 kilomètres de littoral maritime). Appartenant au bassin du Congo, deuxième « poumon » de la planète, le Gabon a consacré 11% de son territoire aux parcs nation- aux en vue de participer à l’effort mondial de préservation de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Cet effort sera maintenu tout en tenant compte des impératifs de développement et d’industrialisation de notre pays. L’économie verte s’annonce, en effet, comme un des vecteurs de l’économie mondiale du XXIème siècle et notre pays dispose des atouts pour y devenir un grand acteur. Pour cela, nous devons préserver notre forêt et nous assurer que sa contribution à la lutte mondiale contre le changement climatique est rémunérée à sa juste valeur. Nous devons transformer entièrement notre bois localement à travers un artisanat et une industrie dynamiques. Nous devons bâtir une agriculture, une pêche et une aquaculture modernes, garantissant notre sécurité alimen- taire. Nous devons exploiter pleinement nos fortes potentialités dans l’écotourisme que nous confèrent nos im- menses espaces forestiers. Au demeurant, la préservation de ce précieux écosystème se fera dans un souci profond de respect de l’environ- nement, qui doit transparaître aussi bien dans l’intégration de la dimension environnementale dans chacun de nos projets, que dans les actes au quotidien de chaque Gabonais. -

Catalogue Produits
CATALOGUE PRODUITS Chimie Industrielle Agriculture - ElevageÉlevage Sécurité - Environnement ZI OLOUMI, BP 20 375 - TéL. +241 01 76 48 99 / 72 17 61 - LIBREVILE/GABON CARREFOUR FORASOL, BP 20 375 - TéL. +241 01 56 87 98 - PORT-GENTIL/GABON Site Web: www.gciae.com Sommaire Présentation Localisation 1 Chimie Industrielle Acide Base Dégraissant Forage Gaz réfrigérant Résines / Stratification Savonnerie / Senteurs Solvants / diluants Traitement des eaux (industrielles, potables, usées et piscines) Traitement des bois Chimie de spécialité 2 Agriculture / Élevage 2.1 Agriculture Engrais et amendements Matériel agricole Phytosanitaire / semence / nutrition des plantes 2.2 Élevage Alimentation et compléments Matériel d’élevage Matériel d’abattage Produits vétérinaires 3 Sécurité - Environnement 3.1 Équipements de protection individuel (EPI) Protection antichute et du corps Protection de la tête Protection des mains Protection des pieds 3.2 Équipements de protection environnemental (EPE) Absorption des fuites et déversements Collecte et tri des déchets Équipements d’obturation Protection et sécurité des Hommes Sécurité du site Stockage de sécurité 3.3 Lutte incendie Extincteurs «EXPERT» Extincteurs «PERFEX» La Gabonaise de Chimie pour l’Industrie, l’Agriculture et l’Élevage (GCIAE), est dirigée par des investisseurs et hommes d’affaires ayant foi en l’Afrique et particulièrement dans le GABON depuis 1989. La société est spécialisée dans le négoce des produits chimiques, agro - fournitures et équipements de protection individuelle (EPI) destiné aux professionnels et aux particuliers. NOS AGENCES ET POINTS DE VENTES: EPI ZI OLOUMI POINT VERT AKANDA POINT VERT OYEM POINT VERT LA PEYRIE POINT VERT PK 8 POINT VERT NTOUM POINT VERT LAMBARENE POINT VERT LA MAIN VERTE POINT VERT MANDJI POINT VERT MOANDA POINT VERT MOUILA DEUX AGENCES: ZI OLOUMI, BP 20 375 - TéL. -

La Commande Publique Face Aux Urgences De La Covid-19
PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY AGENCY Public Procurement in Emergency Covid-19: The Experience of GABON ARMP- NOVEMBER, 2020 “ COVID-19 : CURRENT STATUS • March 2020, the date of the first coronavirus case notification in Gabon • May 23, 2020, the date when the peak was reached with 373 new cases recorded a day for a total of 1931 cases ” before decreasing as of June. • From November 29, 2020, the country recorded as of the beginning of the pandemic, 9, 173 cases with 9, 016 cases healed and 59 deaths. Source COPIL RESPONSE MEASURES Adoption by the Government of a national response plan comprising: Declaration of health emergency state all over the country on April 9, 2020 Adoption of the act n°003/2020 of May 11, 2020 setting out prevention, control and response measures against health disasters Total lockdown of Grand Libreville (Communes de Libreville, Owendo, Akanda and Ntoum as well as the seaside resort of Pointe Denis on April, 12, 2020 with 57 infected cases including one death Institution of a curfew between 6 p.m. and 6 a.m. over the country Traffic ban between Grand Libreville and the inland“(except for special authorization) Wearing a mask becoming compulsory in public places everywhere in the country with a fine for the offenders ” Gathering ban for more than 10 persons Population movement limited to the strict essential one Land borders closure with the first cases in the neighboring countries and later on air and maritime borders closure MODIFICATION OF PUBLIC AND PRIVATE “ SERVICES FUNCTIONING Reduction of work rhythm and the opening of services to three days a week (Monday-Wednesday-Friday) from 7:30 a.m. -

Preventive Measures Against the Vectors of Malaria in Akanda, Southwest Gabon: Knowledge, Attitudes, Practices, and Beliefs
ESJ Natural/Life/Medical Sciences Preventive Measures Against The Vectors Of Malaria In Akanda, Southwest Gabon: Knowledge, Attitudes, Practices, And Beliefs Richard Pamba, Silas Lendzele Sevidzem, Ecole Doctorale des Grandes Ecole de Libreville (EDGE), Libreville, Gabon Laboratoire d’Ecologie Vectorielle (LEV), Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET), Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Libreville, Gabon Aubin Armel Koumba, Laboratoire d’Ecologie Vectorielle (LEV), Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET), Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Libreville, Gabon Faculté des Sciences et Techniques (FAST), Université d’Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin Christophe Roland Zinga-Koumba, Audrey Prisca Melodie Ovono, Rodrigue Mintsa-Nguema, Jacques François Mavoungou, Laboratoire d’Ecologie Vectorielle (LEV), Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET), Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Libreville, Gabon Alexis Mbouloungou, Laboratoire de Géomatique, de Recherche Appliquée et de Conseil (LAGRAC), Université Omar Bongo (UOB), Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), Libreville, Gabon Felicien M’Foubou Kassa, Institut d’Hygiène Publique et Assainissement, Ministère de la Santé, Libreville, Gabon Pyazzi Obame Ondo Kutomy, Programme National de Lutte contre le Paludisme, Ministère de la santé, Libreville, Gabon Doi:10.19044/esj.2021.v17n21p169 Submitted: 05 August 2020 Copyright 2021 Author(s) Accepted: 27 May 2021 Under Creative Commons BY-NC-ND Published: 30 June 2021 4.0 OPEN ACCESS www.eujournal.org 169 European Scientific Journal, ESJ ISSN: 1857-7881 (Print) e - ISSN 1857-7431 June 2021 edition Vol.17, No.21 Cite As: Pamba R., Sevidzem S.L., Koumba A.A., Zinga-Koumba C.R., Ovono A.P.M., Mintsa- Nguema R., Mavoungou J.F., Mbouloungou A., M’Foubou Kassa F. -

Fish Biodiversity Assessment of the Rapids of Mboungou Badouma and Doumé Ramsar Site and Surrounding Areas in Gabon
Fish Biodiversity Assessment of the Rapids of Mboungou Badouma and Doumé Ramsar Site and Surrounding Areas in Gabon Joseph Cutler, Colin Apse, Thibault Cavelier de Cuverville, Yves Fermon, Jean-Hervé Mvé-Beh, Marie-Claire Paiz, Brian Sidlauskas, John P. Sullivan Suggested Citation Cutler J., Apse C., Cavelier T., Fermon, Y., Mvé-Beh, J-H., Paiz, M-C., Sidlauskas, B., and Sullivan, J.P. 2015. Fish Biodiversity Assessment of the Rapids of Mboungou Badouma and Doumé Ramsar Site and Surrounding Areas in Gabon. The Nature Conservancy, Arlington, VA. Table of Contents Acknowledgments ii Executive Summary ii Introduction 1 About this Report 1 Expedition Team 2 Geographic Context 2 The Human Context 4 Socio-Economic Uses and Threats 4 History of Ichthyological Exploration 5 Field and Identification Methods 9 Results from Field Sampling 12 Sampling Sites 12 Taxon-Based Results 14 Osteoglossiformes 14 Characiformes 19 Cyprinodontiformes 23 Cypriniformes 25 Perciformes 29 Siluriformes 31 Synbranchiformes 36 Clupeiformes 37 Fishing-Gear Based Results 37 Results from Data Analysis 40 Species Distribution Analysis 40 Relationship between Substrate and Species 41 Notable Fishes and Problematic Identifications 42 Notes on Use of Social Media 44 Conclusion and Initial Recommendations 45 Reference Literature 47 Appendix 1. Sampling at Doumé: Comparing Modern and Historic Collections 51 Appendix 2. List of Species Known and Collected from the Ogooué River and its Major Tributaries around the Ramsar Site 55 Appendix 3. Ecology and Status of the Fishes from the Ogooué River Basin 62 Appendix 4. All Sampling Sites 69 Acknowledgments The authors of this report would like to express their gratitude to the community leaders, local authorities and citizens of the villages and towns visited during this expedition for their welcome and tremendous support and assistance in facilitating both the successful sampling and the well-being of the researchers. -

World Bank Document
REPUBLIQUE GABONAISE Union – Travail – Justice Public Disclosure Authorized MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ----------------- COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE ----------------- SECRETARIAT PERMANENT ----------------- PROJET « ACCES AUX SERVICES DE BASE EN MILIEU RURAL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES » (PASBMRC) ELECTRIFICATION RURALE ET PERIURBAINE PAR EXTENSION ET Public Disclosure Authorized RENFORCEMENT DES RESEAUX HTA/BT DES PROVINCES DE L’ESTUAIRE, DU HAUT-OGOOUE, DE LA NGOUNIE ET DU WOLEU-NTEM ----------- PROVINCE DE L’ESTUAIRE Public Disclosure Authorized ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) RAPPORT FINAL BRAZ03/BG/TIPPEE/EIES-ELEC/RP-12-19 Public Disclosure Authorized Mai 2020 PROJET D’ACCES AUX SERVICES DE BASES EN MILIEU RURAL ET RENFORCEMENT DE CAPACITES – PASBRC –VOLET ELECTRICITE / (PROVINCE DE L’ESTUAIRE) ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) SOMMAIRE LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS .................................................................................................................. 5 LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................................ 6 LISTE DES PHOTOS ............................................................................................................................................ 6 LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................................................... 7 LISTE DES ANNEXES .......................................................................................................................................... -

Download Publication
REPORT OF THE AFRICAN for Indigenous Affairs Indigenous for International Work Group Group Work International COMMISSION’S WORKING GROUP ON INDIGENOUS POPULATIONS/COMMUNITIES N O RESEARCH AND INFORMATION VISIT TO et des Peuples des et des Droits de l’Homme l’Homme de Droits des THE REPUBLIC OF GABON Commission Africaine Africaine Commission 15-30 September 2007 REPUBLIC OF GAB REPUBLIQUE DU GAB 15-30 Septembre 2007 Septembre 15-30 EN REPUBLIQUE DU GABON DU REPUBLIQUE EN African Commission on Human and Peoples’ Rights VISITE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION D’INFORMATION ET RECHERCHE DE VISITE O N COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES COMMUNAUTÉS SUR LES POPULATIONS / / POPULATIONS LES SUR International Work Group for Indigenous Affairs DE LA COMMISSION AFRICAINE AFRICAINE COMMISSION LA DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE GROUPE DU RAPPORT REPORT OF THE AFRICAN COMMISSION’S WORKING GROUP ON INDIGENOUS POPULATIONS/COMMUNITIES RESEARCH AND INFORMATION VISIT TO THE REPUBLIC OF GABON 15-30 September 2007 The African Commission on Human and Peoples’ Rights adopted this report at its 45th Ordinary Session, 13-27 May 2009 African Commission on International Work Group Human and Peoples’ Rights for Indigenous Affairs (ACHPR) 2010 REPORT OF THE AFRICAN COMMISSION’S WORKING GROUP ON INDIGENOUS POPULATIONS/COMMUNITIES: RESEARCH AND INFORMATION VISIT TO THE REPUBLIC OF GABON 15-30 September 2007 © Copyright: ACHPR and IWGIA Typesetting and Layout: Jorge Monrás Prepress and Print: Eks-Skolens Trykkeri, Copenhagen, Denmark ISBN: 978-87-91563-74-4 Distribution in North