Controverse De L'atomisme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vida Y Obra De Eugen Kolisko 255 Peter Selg
ABRIL · MAYO · JUNIO 2016 53 sumario Editorial 254 Joan Gasparin Vida y obra de Eugen Kolisko 255 Peter Selg Manual de Agrohomeopatía 269 Radko Tichavsky Joan Gamper 22 · 08014 BARCELONA TEL. 93 430 64 79 · FAX 93 363 16 95 [email protected] www.sociedadhomeopatica.com 253. Boletín53 Editorial Apreciado Socio/a, Este Boletín, está conformado por un interesante Dossier sobre Agroho- meopatía. Ha sido por casualidad que podamos contar con el profesor Radko Tichavsky, una de las personas que más está contribuyendo al desa- rrollo de la homeopatía para los cultivo y para las plantas. Creemos que es un profesional con unas ideas que van muy en la línea que seguimos en la escuela; y, además, es un tema poco desarrollado a nivel bi- bliográfico. Es por esta razón, que estamos muy contentos de poder contar con la posibilidad de organizar un Seminario sobre Holohomeopatía para la Agricultura, los próximos 23 y 24 de Julio. Estamos seguros que será una buena oportunidad de conocer a este maestro. Esperemos que nos pueda aclarar las dudas sobre la utilización de los remedios homeopáticos para la mejora y el rendimiento de las plantas. Hemos incluido también la biografía del matrimonio Kolísko. Fueron discí- pulos de Rudolf Steiner, pionero en la utilización de los remedios homeopá- ticos para las plantas; sus ideas de biodinámica son aún, hoy en día, de máxima actualidad. Los estudios de los austriacos Eugen y Lili Kolísko, y, posteriormente, de cientos de investigadores más, marcaron una línea científica en agrohomeopatía. Reciban un saludo. Joan Gasparin Presidente de la Sociedad Española Homeopatía Clásica .254 Boletín53 PETER SELG VIDA Y OBRA DE EUGEN KOLISKO 21. -

Colloquium on World History
Proceedings Colloquium on World History Symptomatolgy and Shifts in the Evolution of Consciousness Sponsored by the Waldorf High School Research Project 3 Also Available from AWSNA Publications: Research Project #1: Survey Report (Portfolios, College Alternatives, Scholarship Websites, Social Emotional Skills) Research Project #2: Proceedings of the Chemistry Colloquium Research Project #3: Proceedings of the Mathematics Colloquium Research Project #4:: Proceedings of the Colloquium on the Computer and Informational Technology Research Project #5: Proceedings of the Colloquium on Life Sciences and Environmental Studies Research Project #6:The Andover Proceedings: Tapping the Wellsprings of Health in Adolescence Research Project #7: Proceedings of the World History Colloquium—Symptomatology Research Project #9: Proceedings of the English Colloquium Soon to be released: Research Project #8:: Proceedings of the Colloquium on United States History Title: Colloquium on World History—Symptomatology and Shifts in the Evolution of Consciousness © AWSNA Publications Planning Group: Andy Dill, Douglas Gerwin, David Mitchell, Leonore Russell, and Betty Staley May: 2004 Compiled and edited by Betty Staley Layout and final edit: David Mitchell Proofreader: Colleen Shetland Colloquium Participants: Meg Gorman, Anne Greer, David Sloan, Eric Philpott, Karl Fredrickon Douglas Gerwin, Betty Staley, John Wulsin 4 Table of Contents Waldorf High School Research Project- Description and Mission Statement ........................... 7 Schedule ................................................................................................................................. -

When Healing Becomes Educating
When Healing Becomes Educating Selected Articles from the Journal of Anthroposophical Medicine (1986 -1998) Volume VI: School Health and School Doctor 1 2 When Healing Becomes Educating Selected Articles from the Journal of Anthroposophical Medicine (1986 -1998) Volume 6: SCHOOL HEALTH AND SCHOOL DOCTOR RESEARCH INSTITUTE FOR EDUCATIONWaldorf 3 Published by: The Research Institute for Waldorf Education PO Box 307, Wilton, NH 03086 When Healing Becomes Educating Volume 6: School Health and School Doctor ISBN # 978-1-936367-38-2 Editor: Douglas Gerwin Layout: Ann Erwin Articles originally published in the Journal for Anthroposophical Medicine c/o Anthroposophical Society in America 1923 Geddes Avenue Ann Arbor, MI 48104 © 1986–1998 Reprinted with permission from the Physicians’ Association for Anthroposophic Medicine 4801 Yellowwood Avenue Baltimore, MD 21209 4 Table of Contents The Physician’s Path . 7 Philip Incao Eugen Kolisko and the Role of the School Physician . 12 Gisbert Husemann The School Doctor’s Vocation . 28 Eugen Kolisko Medical Examination of School Entrants at Waldorf Schools . 31 Karl-Reinhard Kummer Concerning Childhood Vaccinations Today . 39 Lore Deggeller Sport – A Surrogate Religion? . .. 52 Gisbert Husemann 5 6 The Physician’s Path* PHILIP F . INCAO, MD “The physician’s path is one of knowledge of the human being in health and illness, and knowledge of the whole world of nature from which our remedies derive.” The path on which the physician walks through life and through the world is a path of healing, both for himself and for the patient . We can look at healing from many aspects, but I would like to take the historical ap proach . -

Pacifica Journal a Bi-Annual Newsletter Published by the Anthroposophical Society in Hawai'i No
Pacifica Journal A bi-annual newsletter published by the Anthroposophical Society in Hawai'i No. 54, Vol.2 2018 Gross National Happiness: Together with my wife Lisi and our two children, we lived An Alternative Paradigm for many years in a Camphill community in Switzerland: Per- ceval. I consider these years of community practice, sharing our for Community Wellbeing life and work with people living with intellectual disabilities, Ha Vinh Tho, PhD., Switzerland as some of the most formative experiences on which all my later work and social understanding are built. After Camphill, In the course of history, there comes a time when humanity I worked for the International Committee of the Red Cross: the is called to shift to a new level of consciousness, to reach a higher part of the Red Cross, Red Crescent Movement, working in war moral ground. A time when we have to shed our fear and give zones. From Afghanistan to Palestine, from Darfur to Pakistan, hope to each other. That time is now.— Wangari Maathai, Nobel I spent time in most of the conflict areas of the beginning of Peace Laureate the 21st Century. These experiences led me to the conclusion that the physical violence that I was witnessing was but the tip My path from Camphill to Vietnam and Bhutan of the iceberg and that I had to uncover the underlying root over the war zones of our time causes that were not addressed in the humanitarian response Anthroposophical Society in Hawai'i, 2514 Alaula Way, Honolulu, Hawai'i Email: [email protected] , www.anthrohawaii.org to these tragic events. -

NEWBOOKS by Rudolf Steiner and Related Authors AUTUMN 2019
NEWBOOKS By Rudolf Steiner and related authors AUTUMN 2019 to order direct from Booksource call 0845 370 0067 or email: [email protected] 2 www.rudolfsteinerpress.com ORDER INFORMATION RUDOLF STEINER PRESS ORDER ADDRESS Rudolf Steiner Press is dedicated to making available BookSource the work of Rudolf Steiner in English translation. We 50 Cambuslang Rd, Glasgow G32 8NB have hundreds of titles available – as printed books, Tel: 0845 370 0067 ebooks and in audio formats. As a publisher devoted to (international +44 141 642 9192) anthroposophy, we continually commission translations of Fax: 0845 370 0068 previously-unpublished works by Rudolf Steiner and (international +44 141 642 9182) invest in re-translating, editing and improving our editions. E-mail: [email protected] We are also committed to publishing introductory books TRADE TERMS as well as contemporary research. Our translations are authorised by Rudolf Steiner’s estate in Switzerland, to Reduced discount under £30 retail (except CWO) whom we pay royalties on sales, thus assisting their critical United Kingdom: Post paid work. Do support us today by buying our books, or contact Abroad: Post extra us should you wish to sponsor specific titles or to support NON-TRADE ORDERS the charity with a gift or legacy. If you have difficulty ordering from a bookshop or our website you can order direct from BookSource. Send payment with order, sterling cheque/PO made out TEMPLE LODGE PUBLISHING to ‘BookSource’, or quote Visa, Mastercard or Eurocard number (and expiry date) or phone 0845 370 0067. Temple Lodge Publishing has made available new thought, ideas and research in the field of spiritual science for more UK: than a quarter of a century. -

THE PRESENT AGE a Monthly Journal Edited and Published By
THE PRESENT AGE A Monthly Journal Edited and Published by Walter J. Stein 1935 - 1939 KEY VOL. # ISSUE # MONTH YEAR PAGE # - 1- WORK ON ANTHROPOSOPHICAL MATERIAL Earliest Childhood and Its Memories (Caroline von Heydebrand) The Rose Gardner (Flora Anne Steel) The Present Age-Editorial (Walter J. Stein) Recent Research on Sight The History of the Rose Is King Arthur an Historical Character? (W. J. Stein) Alternations in the Earth's Surface The Individual and the Modern Church (Rom Landau) Historical Periods and the Fate of Nations (W. J. Stein) On Innocence and Sin in Childhood (Cecil Harwood) Kasper Hauser (Fevosa) Childhood Dreams (Caroline von Heydebrand) Portugal as Preparer for the British Mission (Walter Johannes Stein) Reminiscences of Life as an Aid to the Under— standing of Our Time (W.J. Stein) School of Spiritual Science and Its Application in Art and Life (M. Wheeler and E. Kolisko) A School of Spiritual Science (W.J. Stein) Bread (Herbert Hahn) A Continuation of My Biography (W.J. Stein) Twelve Months of the Present Age (W.J. Stein) What Is Europe? (W.J. Stein) Questions and Answers "And On Earth Peace Towards Men of Good Will" (W.J. Stein ) Through Spiritual Science and Art to World Wide Religious Life Thirty Three Backward and Forward (W.J. Stein) On the Reality of Moral Forces (W.J. Stein) Religion and Science (Marcia Dodwell) The Mahabharata (W.J. Stein) New Year's Eve (W.J. Stein) Sun and Earth (W.J. Stein) Questions and Answers Babylonian Gods and Heroes (W.J. Stein) Heredity (Eugen Kolisko) Geology (W.J. -

Chemistry Reader
Chemistry Reader An Orientation to Developing Chemistry Instruction In Waldorf Schools Compiled by Dr. Dirk Rohde Freie Waldorfschule Marburg, Germany 2013 1 Chemistry Reader Contents 1. Introduction (Dirk Rohde) 2. The Development and Design of Science Instruction in the Waldorf School (Eugen Kolisko) 3. Grade 7 (Eugen Kolisko) 4. Grade 8 I: Protein, Fats, and Carbohydrates (Rudolf Steiner) 5. Grade 8 II (Frits Julius) 6. Grade 9 I (Manfred von Mackensen) 7. Grade 9 II (Dirk Rohde) 8. Grade 10 (Frits Julius) 9. Grade 11 I: Electrolysis (Rudolf Steiner) 10. Grade 11 II: Electrolysis (Günther Heuschkel) 11. Grade 11 III: Electrolysis (Gerhard Ott) 12. Grade 11 IV: Periodic System, Types of Bindings (Wolfgang Schad) 13. Grade 11 V: Periodic System (Friedrich Kipp) 14. Grade 11 VI: Formulas (Manfred von Mackensen) 15. Grade 11/12: Chemical Elements of Protein (Rudolf Steiner) 16. Grade 12: Formic and Oxalic Acid (Manfred von Mackensen) 17. Conclusion: Suggestions for Further Work (Rudolf Steiner) 2 Dirk Rohde, Marburg Waldorf School, Christmas 2013 Introduction to the Waldorf Chemistry Reader I General Notes Chemistry is a very exciting and interesting science that is highly relevant to each one of us. In health and illness, in medicine and nutrition, in all sorts of technological aspects, in global climate issues, in space travel – almost everywhere we look, we encounter not only the many possible positive applications of various directions in chemistry but also the risks they entail, which must not be overlooked. Chemistry, therefore, is included in all school curriculums today as a matter of course. By exposing young people to multiple points of contact with this important science and introducing them to its very fluid reasoning, Waldorf schools aim to empower their students to deal with the subject of chemistry as self-reliant, discriminating personalities. -

The Fourth Dimension
I The Bodily Foundation of Thinking The Fourth Dimension II The Bodily Foundation of Feeling Rudolf Steiner III The Bodily Foundation of the Human Will th IV Man’s Connection with the whole Universe Berlin 24 March 1905 1944 Nutrition I The Transformation of Matter Translator’s note: this lecture by Rudolf Steiner is the first lecture from the volume: Die Vierte II The Difference Between Vegetable and Animal Food Dimension. Mathematik und Wirklichkeit (Rudolf Steiner Verlag, Dornach, Switzerland, 1995; III The specific Effects of Various Foods on the Different Human Organs GA 324a in the collected works in German). The volume was edited by Dr. Renatus Ziegler and 1944 I Zoology for Evetbody Ulla Trapp. All the editor’s additions are enclosed in square brackets […]. The detailed end-notes II Birds below originate from Dr. Ziegler, and we are extremely grateful for his kind permission in both 1945 Geology allowing us to make use of them, and his reading through of the present translation. David Wood. I Review of Various Geological Theories II The Ice Age – The Existence of an Atlantean Continent Before you become disappointed with what you are about to hear, let me first of all say that today I will discuss very elementary things [about the fourth dimension]. Whoever Translated by David Heaf from the original German article which appeared in Beitraege desires to penetrate more deeply into this problem must be thoroughly acquainted with zu einer Erweiterung der Heilkunst 31. Jahrgang, heft 2, March-April 1978, pp37-55. the higher concepts of mathematics. I would like to give you a few very elementary and The editor would like to thank Uwe Werner and Peter Braithwaite of the Goetheanum general concepts. -
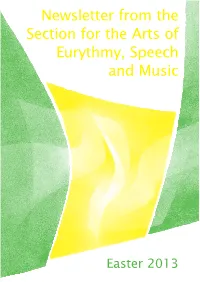
Newsletter from the Section for the Arts of Eurythmy, Speech and Music
Newsletter from the Section for the Arts of Eurythmy, Speech and Music Easter 2013 TABLE OF CONTENTS Topical Forum and Sabine Wiedemann) ................................................. 45 Stuttgart MA “Eurythmy in Education” starts The Search in Music for Threshold Experiences: (Sabine Eberleh) ................................................................. 3 Conference for Composers, at the Goetheanum Introducing Silke Kollewijn as a new co-worker in our Sec- (Wolfram Graf) ................................................................. 45 tion (Silke Kollewijn) .......................................................... 4 Section for the Performing Arts: Singing Conference “The World of Singing” Singing, listening, fashioning (Rita Jacobs, Ammersbek, DE) ........................................ 45 Articles Restorative Justice through the Power of Music: The Cambridge Music Conference, Vancouver, 2012 The Evolutionary Sequence as the essential expression of (Alan Stott) ........................................................................ 46 the human being of movement and speech, between soul and world – as between “I” and spirit-world (Werner Barfod) ................................................................. 5 Obituaries Rudolf Steiner‘s “L” is not yet done (Brigitte Schreckenbach) ................................................... 6 Ekkehart Wacker (21 Sept. 1938 – 1 Oct. 2012) The number of occurrences of I – A – O and the sounds for The master of my apprenticeship the Sun and Moon in the Foundation Stone Verse with -
Cows Speak Sun Hive Maria Thun
JOURNAL OF THE BIODYNAMIC ASSOCIATION n ISSUE NO: 117 n SUMMER 2012 n ISSN NO: 1472-4634 n £4.50 COWS SPEAK SUN HIVE MARIA THUN - A TRIBUTE INTERVIEW WITH DENNIS KLOCEK THE Biodynamic Agricultural College STAR & FURROW BIODYNAMIC The Biodynamic Agricultural College at Emer- Journal of the Biodynamic Association ASSOCIATION (BDA) son Campus in Forest Row is now part of the Published twice yearly Biodynamic Association.. The College offers full Issue Number 117 - Summer 2012 The Association exists in order to support, time accredited two year courses in Biody- ISSN 1472-4634 promote and develop the biodynamic approach namic Agriculture and Horticulture. to farming, gardening and forestry. This unique STAR & FURROW is the membership form of organic growing seeks to improve the Seed development project magazine of The Biodynamic Association. nutritional value of food and the sustainability The Association is working to develop a It is issued free to members. of land by nurturing the vitality of the soil sustainable on-farm plant breeding programme, through the practical application of a holistic increase the availability of high quality seed and spiritual understanding of nature and the varieties suited to organic growing conditions Non-members can also purchase Star and human being. Put simply, our aim is greater and encourage the establishment of a coopera- Furrow. For two copies per annum the rates are: vitality for people and planet through more tive network of biodynamic seed producers. UK £11.00 including postage biodynamic acres, more biodynamic food and The breeding and development of appropriate Europe (airmail) £16.00 more understanding of biodynamics. -

The Golden Blade the Golden Blade TWENTY-SEVENTH (1975) ISSUE
The Golden Blade The Golden Blade TWENTY-SEVENTH (1975) ISSUE The Golden Blade E d i t o r i a l N o t e s 3 The Twelve Senses and the Seven* Copies of the following back issues are still available from the Rudolf Sieiner Bookshops—35 Park Road. London NWl 6XT and 38 Museum Life-Processes . Rudolf Steiner 7 Street, London WCIA ILP—or other bookshops The Sense-Organs and Aesthetic Experience . Rudolf Steiner 22 1973 1974 O n C o m i n g t o o u r S e n s e s . J o h n D a v y 3 9 The Recovery of the Living Source C o m e t s a n d t h e M o o n of Speech Rudolf Steiner Rudolf Steiner Evolution of Light, Darkness and The Forming of Destiny in L e t t e r s o n C o m e t s Colour Michael Wilson 53 Sleeping and Waking E l i s a h e t m V r e e d e Rudolf Steiner Initiation: Old and Modern Modern Theories of the Cosmos . Georg Unger 70 Language and Discovery A. W. Mann Owen Barfield Some Uses of Language in Threefold Ideas in English Life Nicholas Roerich .... John Fletcher 84 Modern Poetry Paul Matthews A. C. Harwood Eurythmy and the Word Economics and Consciousness Three Estranged Sisters . Charles Davy 100 Cecil Harwood A d a m B i t t l e s t o n The Eurythmy Figures The White and the Black Races A Grail Castle in the Brain Inner Language and Outer L. -

Eugen-Kolisko-Academy International School of Anthroposophic Medicine
Eugen-Kolisko-Academy International School of Anthroposophic Medicine Clinical Foundation Course 2017 – 2019 One 4-week module per year Implemented in Medizinische Sektion cooperation with: am Goetheanum “Anthroposophy is a path of knowledge, to guide the Spiritual in the human being to the Spiritual in the universe.” Rudolf Steiner ,, “ Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” ,, Mahatma Gandhi “ The highest task of education is to take command of one's transcendental self, to be the I of one's I. Our lack of complete insight into - and understanding of - others is thus not surprising: without perfect self-understanding one will never learn to truly understand others.” Novalis 2 Welcome ,, Eugen Kolisko 1893-1939 Welcome to the Eugen-Kolisko-Academy! With the new international Clinical Foundation Course we wish to offer doctors and students from around the world a chance to deepen their faculties of perception, clinical thinking and therapy. Based on 30 years of experience in teaching, the Clinical Foundation Course strives to enable an artistic and scientific understanding of what we really are as human beings and how nature and our own inner resources can complement modern medicine in enabling health and development. We look forward to hearing from you! Dr. med. Armin Husemann Prof. Dr. med. David Martin 3 A Welcome from the Medical Section at the Goetheanum The Medical Section is one of 11 specialist sections of the School of Spiritual Science at the Goetheanum in Dornach/Switzerland. Its tasks comprize: Coordinating and supporting research and development of anthroposophic medicine and its different forms of therapy worldwide.