RAPPORTFINAL VFF EST&SO AOUT2007 Format
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport Évaluation
Burkina Faso MINISTERE DE LA SANTE Direction Générale de la Santé Publique Coopération Allemande au Développement Email: [email protected] (C. T.) Adresse postale: Tél: + (226) 30.02.25 [email protected] (Secrét.) 01 BP 1485 Ouagadougou 01 Fax: + (226) 31.45.52 Projet Planification Familiale PN : 93.2569.7-001.00 Evaluation des programmes de Distribution a Base Communautaire (DBC) en cours dans le cadre du projet PF DGSP/GTZ RAPPORT Dr DOUTI Kombaté Monfomba Mme DA SILVEIRA VIMBAMBA Clémentine 2 Liste des Abréviations AA Accoucheuse Auxiliaire ADBC Agent de Distribution à Base Communautaire AIS Agent Itinérant de Santé ATN Association Tontines de Nouna ASC Agent de Santé Communautaire AV Accoucheuse Villageoise CAMEG Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques CIPD Conférence Internationale sur la Population et le Développement CM Centre Médical CMA Centre Médical avec Antenne chirurgicale COGES : Comité de Gestion de Santé CRESA : Centre Régional d’Education pour la Santé et l’Assainissement CSPS Centre de Santé et de Promotion Sociale CTP Conseiller Technique Principal DBC Distribution à Base Communautaire DGSP Direction Générale de la Santé Publique DRS Direction Régionale de la Santé DS District DSF Direction de la Santé et de la Famille ECD Equipe Cadre de District FNUAP : Fond des Nations Unies pour les Activités en matière de Population FS Formation Sanitaire GTZ Coopération Allemande au Développement IBE Infirmier Breveté d’Etat ICP Infirmier Chef de Poste IEC Information Education et Communication IST Infection Sexuellement -

Notice Tiankoura
Programme d’Investissement Forestier du Burkina Faso NOTICE COMMUNALE DE TIANKOURA Résultats des diagnostics socio-fonciers et des planifications participatives Septembre 2017 NOTICE COMMUNALE DE TIANKOURA Notice communale de Tiankoura Résultats des diagnostics socio-fonciers et des planifications participatives Septembre 2017 Directeur de projet : Dr. Peter Hochet Assistant à la coordination : Dr. Simone Carboni Cartographe : Romain Ronceray Coordonnateur/trices d’équipe d’animation : Charles Guissou, Yéri Kambiré, Denise Hien, Honoré Somé, Jean-Renaud Sanou, Ibrahim Sanou, Paul Ilboudo 1 NOTICE COMMUNALE DE TIANKOURA Table des matières 1. Etat de lieux socio-foncier ................................................................................. 3 1.1. Présentation générale de la commune .................................................................. 3 1.1.1. Situation administrative et démographique ......................................................... 3 1.1.2. Pédologie, climat et bassins hydrologiques ........................................................ 4 1.2. Structuration foncière de la commune .................................................................. 4 1.2.1. Histoire du peuplement ....................................................................................... 4 1.2.2. Occupation et usages des sols ........................................................................... 5 1.3. Les enjeux fonciers ................................................................................................. 6 -

Carte Sanitaire 2010
MINISTERE DE LA SANTE BURKINA FASO -------------- Unité-Progrès-Justice Carte sanitaire 2010 Janvier 2012 SOMMAIRE SIGLES ET ABBREVIATIONS ................................................................................................................................ 5 INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 6 I. SITUATION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES .......................................................................... 7 I.1. Carte de la région sanitaire de la Boucle du Mouhoun ........................................................... 7 I.1.1. Carte district sanitaire de Boromo ........................................................................................ 8 I.1.2. Carte district sanitaire de Dédougou .................................................................................... 9 I.1.3. Carte du district sanitaire de Nouna ...................................................................................11 I.1.4. Carte district sanitaire de Solenzo .......................................................................................12 I.1.5. Carte district sanitaire de Toma ...........................................................................................14 I.1.6. Carte district sanitaire de Tougan .......................................................................................15 I.2. Carte de la région des Cascades .....................................................................................................16 -

N°-219 Page Résultats.Qxd
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers BURKINA FASO N° 2622 - Lundi 22 juillet 2019 — 200 F CFA S o m m a i r e * Résultats de dépouillements : . P. 3 à 22 - Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d’ouvrages déléguées . P. 3 à 11 - Résultats provisoires des régions . P. 12 à 22 * Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . P. 23 à 26 - Marchés de fournitures et services courants . P. 23 & 24 - Marchés de travaux . P. 25 - Marchés de prestations intellectuelles . P. 26 * Avis d’Appels d’offres des régions : . P. 27 à 34 - Marchés de fournitures et services courants . P. 28 & 29 - Marchés de travaux . P. 30 à 34 La célérité dans la transparence LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS Revue des OUAGADOUGOU SODIPRESSE : 50 36 03 80 Marchés Publics Kiosque (entré coté Est du MEF) Alimentation la Shopette : 50 36 29 09 Diacfa Librairie : 50 30 65 49/50 30 63 54 392 Avenue Ho Chi Minh Ouaga contact et service : 50 31 05 47 01 B.P. 6444 Ouagadougou 01 Prix choc cite en III (alimentation) : 50 31 75 56 /70 26 13 19 Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25 Ezama paspanga : 50 30 87 29 Alimentation la Surface : 50 36 36 51 E-mail : [email protected] Petrofa cissin : 76 81 28 25 Site web : www.dgmp.gov.bf Sonacof Dassasgho : 50 36 40 65 Alimentation la ménagère : 50 43 08 64 Librairie Hôtel Indépendance : 50 30 60 60/63 Directeur de publication -

11-Taux De Fonctionnalité Des Forages En 2017 Par Village
11_Taux de fonctionnalité des forages en 2017 par village NOM_REGION NOM_PROVINCE NOM_COMMUNE BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE -

Epidemiology of Malaria in an Area with Pyrethroid-Resistant Vectors in South-Western Burkina Faso: a Pre-Intervention Study
medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20120105; this version posted June 5, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted medRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under a CC-BY-NC 4.0 International license . Epidemiology of malaria in an area with pyrethroid-resistant vectors in south-western Burkina Faso: a pre-intervention study. Anthony Somé1,2*, Issaka Zongo1, Bertin N’cho Tchiekoi3,5, Dieudonné D. Soma1,5, Barnabas Zogo3,5, Mamadou Ouattara4, Anyirékun F. Somé1, Amal Dahounto1,5, Alphonsine A. Koffi3, Cédric 3,5 1,5 1,6 1 Pennetier , Nicolas Moiroux , Seni Kouanda , and Roch K. Dabiré 1 Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 2 Université Saint Thomas d’Aquin (USTA), Ouagadougou, Burkina Faso. 3 Institut Pierre Richet (IPR), Bouaké, Côte d’Ivoire. 4 Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN), Nouna, Burkina Faso. 5 Institut de Recherche pour le Développement - Maladies Infectieuses et Vecteurs Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle (IRD - MIVEGEC), Montpellier, France. 6 Institut Africain de Santé Publique (I.A.S.P.), Ouagadougou, Burkina Faso. *Corresponding author: Anthony Somé E-mail address: [email protected] Abstract Background: The objective of this study was to update malaria epidemiological profile prior to the implementation of a randomized controlled trial aiming to evaluate the efficacy of new vector control tools in complementary to the use of long-lasting insecticidal nets in Burkina Faso. Methods: We carried out active and passive cross-sectional surveys to estimate the prevalence and incidence of malaria infection from August 2016 to July 2017 in 27 villages of the Diebougou health district. -
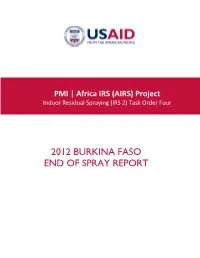
IRS Technical Report Template
PMI | Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four 2012 BURKINA FASO END OF SPRAY REPORT Recommended Citation: PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four. October 2012. 2012 Burkina Faso End of Spray Report. Bethesda, MD. PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four, Abt Associates Inc. Contract and Task Order Number.: GHN-I-00-09-00012-00 Task Order: AID- GHN-I-00-09-00013 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI Abt Associates Inc. 1 4550 Montgomery Avenue 1 Suite 800 North 1 Bethesda, Maryland 20814 1 T. 301.347.5000 1 F. 301.913.9061 1 www.abtassociates.com 2012 BURKINA FASO END OF SPRAY REPORT CONTENTS Acronyms .............................................................................................................................................. vii Executive Summary ................................................................................................................................... ix 1. Country Background ........................................................................................................................... 1 1.1 Objectives For 2012 IRS Campaign ................................................................................................................................... 1 1.2 District Selection .................................................................................................................................................................... 2 -

Admissibilité Cap 2020
VU l'Arrêté n°2015-00196/MENA/SG/DECEB 16 juillet 2015, portant modalités d'administration et de notation des épreuves de l'examen du Certificat Elémentaire d'Aptitude Pédagogique et de l'examen du Certificat d'Aptitude Pédagogique ; VU la Décision n°2019-004/MENAPLN/SG/DGEC du 25 juillet 2019 , portant inscription des enseignants à l'examen professionnel du Certificat d'Aptitude Pédagogique (CAP), session de 2020 ; VU le procès verbal de délibélation du 09 octobre 2019 SUR Proposition du Directeur général des Examens et Concours; D E C I D E ARTICLE1: Sont déclarés admissibles aux épreuves pratiques et orales du Certificat d'Aptitude Pédagogique (CAP), session de 2020, les candidats dont les noms suivent : DREPPNF BOUCLE: DU MOUHOUN DPEPPNF :BALÉS CIRCONSCRIPTION DEBAGASSI N°Mle NOM PRENOM EN SERVICE A 276366 V BADO Roger Haho 274609 W BAKYONO Emile Yaramoko A 274274 E BAMBIO Ouarèsè Bounou B 268780 Z BARRY Safiatou Haho 274260 C BAZIE Lambert Kaho 274785 T BONDE Latifatou Kahin 255012 K GNOUMOU Louise N'Nawouyé Kaho 268749 E ILBOUDO Rayénemanegré Adeline Kaho 290563 N KONATE Abas Assio A 252638 B OUEDRAOGO Assami Pahin 270013 N OUEDRAOGO Fatoumata Raïna Bagassi A 290564 C SANOU Korotimi Sayaro 273933 J SOME Anobètèro Romaric Pahin 274779 F TAONSA Marcéline Vy A 252440 X TRAORE/BANI Lucie Scholastique Assio B 275045 N WARMA Thomas Gnakongo ARRETE LA PRESENTE LISTE A 16 NOMS DE LA CEB CIRCONSCRIPTION DEBANA N°Mle NOM PRENOM EN SERVICE A 255015 Z BAZIN Karafa Danou 275072 S COULIBALY Soumana Bana Classique 273757 V DABIRE Wilépoutièrwè -

-

BURKINA FASO - Carte De Référence De La Région Du Sud-Ouest a La Date Du 07 Juillet 2020
BURKINA FASO - Carte de référence de la région du Sud-Ouest A la date du 07 juillet 2020 4°0'W 3°0'W BONI HOUNDE SATIRI KOTI FARA Yerefe Fafo Zintio Gaima Wahable Nieregoua FOUNZAN Gouatere Poulaba Nigteba Binkili ORONKUA Oronkua NIABOURI Bisserke Nienka Iwara LENA Kankane Ganion Bankandi Nyieme Ningbouma Dianvour Sorkon Fitingue Seguele KOUMBIA Donkoro Nanblegane Zoner Kabouti Saboure Bagane Nimare Mebare Bakara Batiara Badiere Tanpour Nakari Naro Tiekon Bouni Dakouration Navronkue Gbaba Tanbiri Beni Lopal BOBO-DIOULASSO Dabole Tanloule Dano Memere Dadounin Kondon DANO Mounioupele Nahirindio Gueguere Dahoure Tamikpuere Toulpouo GUEGUERE Tankiedougou Gora Gane Batiele Pontieba Danbagan PirkonKpe Gorgane Kabarvaro Niego Wakanale NIEGO KOPER Dianle Tamagan Lebiele Moulourou Dakoula Ioba Soriane Bilanbar Bobora Dandere Bakotourou Doumole Sarba Gouri DianvorKoper Simou Bakotinga BOURA OUESSA Nabere Foret Classee de Nabere Kolkol Yo Kobare Biengane OuessaWassa Kolinka Dableteon Baforo Navirikpoue Gohipoua BONDIGUI Nabene Manzour Gakola Kiri DIEBOUGOU Nabale Naborgane Pekoua Mian 11°0'N 11°0'N Mougue Zanawa Moule Navrigbe Zodoum Tintilo Tanpe Diebougou Nakpale Bagane Kpoumane Bilbale Gorperegora Wizin Kpoperi Banfare KARANGASSO - VIGUE Nisseo Milpo Bambako Kpakpara Djipologo Dissini Wizini Loto DISSIN Bondigui Ktedia Baplakola Ipal Kokolibou Gora Forgane Tangsie Lokodia Koleka Diarkadougou Siaore Dandere Nakare Nakieteon Kouleteon Dakole Win DOLO Bontioli Dagou Gbassamo Mou Saala Moua Gbonfiasso Dolo Bapla Habri Tolepere Borgane Tanpour ZAMBO -

Etude De Reference De La Region Du Sud-Ouest Dans Le Cadre De La Mise En Œuvre Du Padel
MINISTERE DE L’ECONOMIE, BURKINA FASO DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT Unité-Progrès-Justice ………..………... SECRETARIAT GENERAL ………..……….... DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ETUDE DE REFERENCE DE LA REGION DU SUD-OUEST DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PADEL Version Finale Octobre 2020 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES....................................................................................................................... 1 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ........................................................................................... 3 LISTE DES CARTES ............................................................................................................................. 6 LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................... 8 LISTE DES TABLEAUX ..................................................................................................................... 10 LISTE DES PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES .............................................................................. 13 AVANT-PROPOS ................................................................................................................................ 14 RESUME ............................................................................................................................................... 15 INTRODUCTION ................................................................................................................................ -

Annuaire Statistique De La Décentralisation 2016
BURKINA FASO MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA DÉCENTRALISATION 2016 Septembre 2018 BURKINA FASO Unité –Progrès- Justice -=======- MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION Annuaire statistique de la décentralisation 2016 Septembre 2018 BURKINA FASO MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA DÉCENTRALISATION 2016 Avec l’appui du Sous-programme Statistiques du Programme d’appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS/SPS) financé par l’Union européenne Septembre 2018 AVANT-PROPOS [5] SOMMAIRE AVANT-PROPOS .................................................................................................................. 5 LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS .............................................................................. 9 LISTE DES TABLEAUX .......................................................................................................11 MÉTHODOLOGIE ................................................................................................................15 1. DECOUPAGESOMMAIRE ADMINISTRATIF ...................................................................................17 2. POPULATIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ...........................................49 2.1. Découpage administratif et population....................................................................49 AVANT-PROPOS .................................................................................................................