1 Chambre De Première Instance I Devant
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Press Clippings
SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE OUTREACH AND PUBLIC AFFAIRS OFFICE PRESS CLIPPINGS Enclosed are clippings of local and international press on the Special Court and related issues obtained by the Outreach and Public Affairs Office as at: Tuesday, 21 June 2011 Press clips are produced Monday through Friday. Any omission, comment or suggestion, please contact Martin Royston-Wright Ext 7217 2 Local News Whos’s Special Court Security Chief / Sierra Express Media Page 3 International News 'Ractliffe Judgment Won’t Affect Charles Taylor Case' / Eye Witness News Page 4 Legal Man Robin Loses Cancer Fight / Worcester News Pages 5-6 Former Interahamwe Militia Leader Pleads Not Guilty to Genocide / Hirondelle News Agency Page 7 STL Refuses Comment About End-June Indictment Rumors / The Daily Star Pages 8-9 3 Sierra Express Media Tuesday, 21 June 2011 4 Eye Witness News Tuesday, 21 June 2011 'Ractliffe judgment won’t affect Charles Taylor case' Rahima Essop War crimes accused Charles Taylor’s defence on Monday said Jeremy Ractliffe’s acquittal is significant but will not affect his client’s case in The Hague at this stage. It is alleged the former Liberian leader used blood diamonds to buy weapons and three of those stones ended up in Ractliffe’s possession while he was the head of the Nelson Mandela Children’s Fund. Last week, the Alexandra Magistrate's Court found Ractliffe not guilty of contravening the Diamond Act. Taylor’s defence counsel Courtenay Griffiths said he has been following events in South Africa with great interest. “Mr. Ractliffe featured in the testimony of Naomi Campbell and it is note worthy that he was in fact acquitted,” he said. -
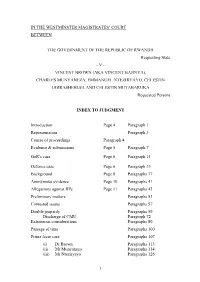
Rwandan Five Judgment
IN THE WESTMINSTER MAGISTRATES’ COURT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA Requesting State - V - VINCENT BROWN (AKA VINCENT BAJINYA), CHARLES MUNYANEZA, EMMANUEL NTEZIRYAYO, CELESTIN UGIRASHEBUJA AND CELESTIN MUTABARUKA Requested Persons INDEX TO JUDGMENT Introduction Page 4 Paragraph 1 Representation Paragraph 3 Course of proceedings Paragraph 4 Evidence & submissions Page 5 Paragraph 7 GoR’s case Page 6 Paragraph 11 Defence case Page 6 Paragraph 33 Background Page 8 Paragraphs 37 Anonymous evidence Page 10 Paragraphs 41 Allegations against RPs Page 11 Paragraphs 43 Preliminary matters Paragraphs 53 Contested issues Paragraphs 57 Double jeopardy Paragraphs 59 Discharge of CMU Paragraph 72 Extraneous considerations Paragraphs 80 Passage of time Paragraphs 100 Prima facie case Paragraphs 107 (i) Dr Brown Paragraphs 113 (ii) Mr Munyaneza Paragraphs 114 (iii) Mr Nteziryayo Paragraphs 126 1 (iv) Mr Ugirashebuja Paragraphs 129 (v) Mr Mutabaruka Paragraphs 136 Section 87 Human Rights Paragraph 137 (i) Article 3 Paragraph 138 Conclusion Paragraphs 147 (ii) Article 6 Paragraphs 150 Brown & others Paragraphs 157 Cases up to 2009 Paragraphs 163 Defence case – summary Paragraph 166 Political situation Paragraph 168 Tables Paragraph 172 Osman warnings Paragraph 197 Experts’ politics Paragraph 205 Conclusions Paragraph 221 Evidence of trials Paragraph 224 Ingabire’s trial Paragraph 231 Conclusions Paragraph 263 Mutabazi’s trial Paragraph 271 Five transfers Paragraph 273 Ahurogeze Paragraph 276 Uwinkindi Paragraph 285 In Rwanda Paragraph -

Press Clippings
SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE OUTREACH AND PUBLIC AFFAIRS OFFICE Chewing bottle!! PRESS CLIPPINGS Enclosed are clippings of local and international press on the Special Court and related issues obtained by the Outreach and Public Affairs Office as at: Friday, 31 June 2013 Press clips are produced Monday through Friday. Any omission, comment or suggestion, please contact Martin Royston-Wright Ext 7217 2 Local News Africa and The International Criminal Court / PEEP! Pages 3-4 ICC Stretched To Its Limit In Africa / Sierra Express Media Page 5 International News Kenya: Raila Dismisses Race Slur Against ICC / The Star Page 6 International Criminal Tribunal Born as Bastard? / Huffington Post Pages 7-9 When Grave Crimes Elude Justice / The New York Times Pages 10-11 Rwanda: ICTR Last Detainee to Be Transferred Rwanda / The New Times Page 12 3 PEEP! Friday, 31 May 2013 4 5 Sierra Express Media Friday, 31 May 2013 6 The Star Friday, 31 May 2013 Kenya: Raila Dismisses Race Slur Against ICC FORMER Prime Minister Raila Odinga has dismissed accusations of racism levelled against the International Criminal Court by the African Union. Raila described as "hogwash" claims that The Hague court is unfairly targeting African leaders while ignoring war crimes suspects in other parts of the world. "Members of the ICC joined freely, signed the Rome Statute independently which was ratified by their national Parliaments. None was forced to join," he said. The AU on Monday accused the ICC of targeting Africans on the basis of race and called for the termination of criminal proceedings against President Uhuru and Deputy President William Ruto. -

Country Report on Human Rights and Justice in Rwanda
Netherlands Ministry of Foreign Affairs Country Report on Human Rights and Justice in Rwanda Date 18 August 2016 Page 1 of 64 Country Report | August 2016 Edited by Sub-Saharan Africa Department, The Hague Disclaimer: The Dutch version of this report is leading. The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands cannot be held accountable for misinterpretations based on the English version of the report. Page 2 of 64 Country Report on Rwanda | August 2016 Contents Contents ....................................................................................................... 3 1 Human Rights .............................................................................................. 6 1.1 Human Rights in General ................................................................................ 6 1.2 Torture and Abuse ....................................................................................... 11 1.2.1 Legislation .................................................................................................. 11 1.2.2 Torture by Military Personnel ......................................................................... 11 1.2.3 Police Abuse ................................................................................................ 13 1.2.4 Local Defence Forces .................................................................................... 13 1.2.5 Monitoring and Assistance ............................................................................. 14 1.3 Disappearances .......................................................................................... -
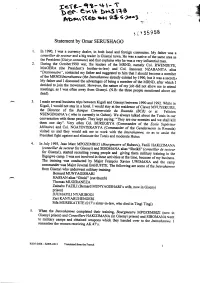
The Rwanda Documents Project
~,t: ~ :55 958, Statementby Omar SERUSHAGO In 1990,I wasa currencydealer, in bothlocal and foreign currencies. My father was a conseillerdesecteur and a bigtrader in Gisenyi town. He was a nativeof thesame area as thePresident (Giciye commune) and that explains why he wasa veryinfluential man. 2. Dudng the Octoberl990war, the leadersof the MRND, namelyCol. RWENDEYE, MAGERA(the President’sbrother-in-law) and Col. InnocentNZABANITA alias "Dictionnaire",contacted my fatherand suggested to himthat I shouldbecome a member of theMRND/Interahamwe (theInterahamwe already existed by 1990,but it wasa secret)» My fatherand I discussedthe advantages of beinga memberof theMRND, after which I decidedto jointhe movement. However, the nature of my jobdid not allow me to attend meetings,as I wasoften away from Gisenyi. (N.B: the three people mentioned above are dead). 3. I madeseveral business trips between Kigali and Gisenyi between 1990 and 1992. While in Kigali,I would not stay in a hotel.I wouldstay at theresidence of CIaverMVUYEKURE, the Director of the Banque Commercialedu Rwanda (BCR) or at Felicien NSENGIMANA’s( who is currentlyin Gabon).We alwaystalked about the Tutsis in our conversationwith these people. They kept saying: "They are our enemies and we shallkill them one day". Very often Col. BUREGEYA(Commander of the Ecole Supérieur Militaire)and Col. NGAYINTERANYA(Commander of the Gendarmeriein Rwanda) visitedus and theywould ask me to workwith the Interahamwe, so as to assistthe Presidentfight against and eliminate the Tutsis and moderate Hutus. 4. In July1993, Jean Marc MPOZEMBIZI(Bourgmestre of Rubavu),Fazili HAKIZIMANA (conseillerde secteur for Gisenyi) and SIBOMANA alias "Sheikh" (conseiller de secteur forGisenyi), started recruiting young people and giving them military training in the Bigogwecamp. -

Complementarity in Action: Lessons Learned from the ICTR Prosecutor's
International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal Pénal International pour le Rwanda Office of the Prosecutor/Bureau du Procureur Arusha International Conference Centre UNITED NATIONS P.O. Box 6016, Arusha, Tanzania NATIONS UNIES Tel: 255 27 2504207-11/2504367-72 or 1 212 963 2850 — Fax: 255 27 2504000/2504373 or 1 212 963 2848 COMPLEMENTARITY IN ACTION: LESSONS LEARNED FROM THE ICTR PROSECUTOR’S REFERRAL OF INTERNATIONAL CRIMINAL CASES TO NATIONAL JURISDICTIONS FOR TRIAL FEBRUARY 2015 Any part of this publication may be reproduced without permission for limited distribution provided it is distributed without charge, and the Office of the Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda is acknowledged as its source. The Office of the Prosecutor would appreciate receiving a copy of any materials in which the text is used. Official Release Date: 10 February 2015 TABLE OF CONTENTS FOREWORD I. INTRODUCTION ..................................................................................................................... 1 II. PREVENTING IMPUNITY BY RESTORING NATIONAL CAPACITY ............... 4 A. SETTING THE CONTEXT ........................................................................................................... 4 B. CHALLENGES TO REFERRAL ................................................................................................... 8 C. FINDING WILLING AND ABLE STATES ................................................................................. 12 1. Referrals to France ........................................................................................................ -

(C{;:T - 1-0 \ International Criminal "F1ibunal for Rwanda Tribunal Penal International Pour Ie Rwanda
\UR-05-~~cr-I o 3 - \\) - 20" (C{;:t - 1-0 \ International Criminal "f1ibunal for Rwanda Tribunal Penal International pour Ie Rwanda Before: The Trial Chamber Designated Under Rule 11 bis (A) Registrar: Adama Dieng Date filed: 3 October 2011 THE PROSECUTOR v. BERNARD MUNYAGISHARI Case No. ICTR-2005-89-1 PROSECUTOR'S REQUEST FOR THE REFERRAL OF THE CASE OF BERNARD MUNYAGISHARI TO RWANDA PURSUANT RULE 11 BIS OF THE RULES OF PROCEDURE AND EVIDENCE Office ofthe Prosecutor Counsel for the Accused Hassan Bubacar Jallow Philippe Moriceau James J. Arguin George Mugwanya Inneke Onsea Abdoulaye Seye Francois Nsanzuwera NATURE OF THE APPLICATION 1. The Prosecutor files this application pursuant to Rule 11 bis of the Rules of Procedure and Evidence ("Rules") seeking orders for the referral of the indictment and case of Bernard Munyagishari ("the Accused") to the competent authorities of the Republic of Rwanda ("Rwanda") for trial. RELEVANT PROCEDURAL BACKGROUND 2. The Indictment against the Accused was confirmed by the Tribunal on 8 September 2005 and charges the Accused with conspiracy to commit genocide; genocide or, in the alternative, complicity in genocide; murder as a crime against humanity; and rape as a crime against humanity. A copy of the Indictment is attached hereto as Annex A. 3. The Accused was arrested, pursuant to a warrant issued by the Tribunal, on 25 May 2011 in the Democratic Republic of the Congo. On 14 June 2011, he was transferred to the United Nations Detention Facility in Arusha and is currently awaiting trial. GROUNDS FOR THE APPLICATION 4. By this application, the Prosecutor requests the President of the Tribunal, pursuant to Rule 11 bis (A), to designate a Trial Chamber to hear and determine, on the grounds set out below, whether the case should be referred to the Republic of Rwanda for trial. -

Press Clippings, 8 June 2012
SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE OUTREACH AND PUBLIC AFFAIRS OFFICE Rainstorm in northern Sierra Leone PRESS CLIPPINGS Enclosed are clippings of local and international press on the Special Court and related issues obtained by the Outreach and Public Affairs Office as at: Friday, 8 June 2012 Press clips are produced Monday through Friday. Any omission, comment or suggestion, please contact Martin Royston-Wright Ext 7217 2 International News Obasanjo and Charles Taylor’s Sentencing in The Hague / Nigerian Tribune Page 3 Charles Taylor, Arms Dealers and Reparations / Jurist Pages 4-6 Justice Must be Re-cast / The Phnom Penh Post Pages 7-8 Cases Given Go-Ahead At ICC / Institute for War & Peace Reporting Pages 9-11 UN Genocide Tribunal Transfers Former Rwandan Official…/ UN News Service Page 12 Ex-Ivory Coast Leader Seeks War Crimes Trial Delay / Reuters Page 13 On Tyrants, Justice for Some, Honors for Others / Reuters Page 14 3 Nigerian Tribune Friday, 8 June 2012 Obasanjo and Charles Taylor’s sentencing in The Hague It is a good development that former Liberian President, Charles Taylor, has been sentenced in The Hague for crimes committed while he reigned as a president of the tiny West African country. This will go a long way in sounding a note of warning to despots in other parts of the world, especially those in Africa, that they will be accountable for whatever they do while in power. Another leader that should be expecting nemesis to catch up with him soon is the Syrian President, Mr Basser Al Assad, who has been allegedly killing innocent citizens in order to suppress their call for political change. -

Genocide Convict Munyagishari Appeal Case Begins on Thursday
Genocide convict Munyagishari appeal case begins on Thursday Hudson Kuteesa The New Times, November 11, 2020 Tribunals. In its ruling, the High Court affirmed that the sus- pect attended several meetings in which the Geno- cide was prepared in 1994 ; and played a major role in drawing up lists of Tutsi to be killed. He also facilitated the setting up of roadblocks where Tutsi were slaughtered, mainly in Gisenyi, cur- rently Rubavu District. During his trials in the high court, witnesses tes- tified that he used to train Interahamwe militia and Munyagishari Bernard supplied them with weapons to use in the killings. He was arrested in May 2011 in the Democratic Re- The Court of Appeal will on Thursday November public of Congo, following an arrest warrant from the 12 begin the hearing of an appeal lodged by genocide International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). convict Bernard Munyagishari against the life impri- In the early days of the trial, Munyagishari had sonment sentence that was handed down by the High maintained that he was not Rwandan but a Congolese Court in 2017. citizen, despite several witnesses who knew him well Munyagishari, 60, was convicted by High Court on pinning him. two counts : participation in the Genocide against the According to an indictment issued by the ICTR, Tutsi, and killing as a crime against humanity. Munyagishari welded a lot of powers during the geno- According to the law of criminal procedure, this is cide, which he mainly derived from his close associa- the final jurisdiction that Munyagishari can appeal tion with the then government and military officials. -

Munyagishari
International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda ORIGINAL: ENGLISH REFERRAL CHAMBER DESIGNATED UNDER RULE 11 BIS Before: Judge Lee Gacuiga Muthoga, presiding Judge Seon Ki Park Judge Gberdao Gustave Kam Registrar: Adama Dieng Date: 6 June 2012 THE PROSECUTOR v. BERNARD MUNYAGISHARI Case No. ICTR-2005-89-R11bis DECISION ON THE PROSECUTOR’S REQUEST FOR REFERRAL OF THE CASE TO THE REPUBLIC OF RWANDA Rule 11 bis of the Rules of Procedure and Evidence Office of the Prosecutor: Counsel for the Defence: Hassan Bubacar Jallow Philippe Moriceau James J. Arguin Natache Fauveau-Ivanović George Mugwanya Majda Dautović Inneke Onsea Abdoulaye Seye Franćois Nsanzuwera Erica Bussey The Prosecutor v. Bernard Munyagishari, Case No. ICTR-2005-89-R11bis TABLE OF CONTENTS 1. PROCEDURAL HISTORY ...................................................................................... 1 2. APPLICABLE LAW ................................................................................................. 2 3. JURISDICTION ........................................................................................................ 2 4. ALLEGED VIOLATION OF PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW ........... 5 4.1 Security Council Resolutions ..................................................................................... 5 4.2 General Principles of International Law .................................................................... 7 4.3 The Possibility of Referral to the Democratic Republic of the Congo ...................... 9 4.4 Undue -
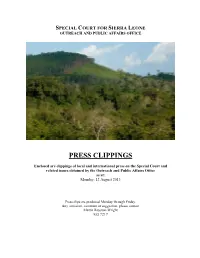
12 August 2013
SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE OUTREACH AND PUBLIC AFFAIRS OFFICE PRESS CLIPPINGS Enclosed are clippings of local and international press on the Special Court and related issues obtained by the Outreach and Public Affairs Office as at: Monday, 12 August 2013 Press clips are produced Monday through Friday. Any omission, comment or suggestion, please contact Martin Royston-Wright Ext 7217 2 Local News Ernest Koroma Helps Warlord Escapes Trial / Independent Observer Pages 3-4 Koroma Helps Warlord Escape Trial / Global Times Pages 5-6 International News Liberia Remembers Taylor’s Departure / Associated Press Pages 7-8 Liberia Ex-fighters in Push to Reopen Charles Taylor Farm / Africa Review Page 9 A Decade of Peace: Take A Bow Liberia / Front Page Africa Pages 10-13 Nazi War Crimes Suspect Laszlo Csatary Dies / BBC Pages 14-15 Kigali Keeps Munyagishari in Jail Hirondelle News Agency Page 16 64th Anniversary of Geneva Conventions / Tempo Page 17 Justice is Still Teething, 15 Years On / The Hindu Pages 18-20 3 Independent Observer Monday, 12 August 2013 4 5 Global Times Monday, 12 August 2013 6 7 Associated Press Monday, 12 August 2013 Liberia remembers Taylor’s departure By Jonathan Paye-Layleh In this August 11, 2003, file photograph, Charles Taylor leaves with his wife, Jewel Howard-Taylor, after officially handing over the power of the presidency to Moses Blah, at the Executive Mansion in the Liberian capital, Monrovia. File photo: Ben Curtis, AP Monrovia - The ex-wife of former Liberian president Charles Taylor said the convicted war criminal made “the ultimate sacrifice” by exiting the country 10 years ago on Sunday, an event that effectively ended a brutal 14-year civil war that claimed 250 000 lives. -

The Transfer Cases of the ICTR to the Republic of Rwanda: the Challenges of Implementing Rule 11 Bis
The Transfer Cases of the ICTR to the Republic of Rwanda: The challenges of implementing Rule 11 bis Likim Ng Master’s Thesis University of Helsinki Faculty of Law Public International Law Supervisor: Dr Magdalena Kmak May 2014 II Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion – Faculty Laitos - Institution – Department Faculty of Law Tekijä - Författare – Author Likim Ng Työn nimi - Arbetets titel – Title The Transfer Cases of the ICTR to the Republic of Rwanda: The challenges of implementing Rule11bis Oppiaine - Läroämne – Subject Public International Law Työn laji - Arbetets art – Level Aika - Datum – Month and year Sivumäärä - Sidoantal – Number of pages Master’s Thesis May 2014 80 Tiivistelmä - Referat – Abstract This thesis addresses the complex process of transferring cases from the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) to Rwanda. After a decade of prosecuting the leaders and organisers of the 1994 Rwandan Genocide that killed an estimated 500,000 to 1 million ethnic Tutsis, the Security Council of the United Nations called for the closure of the Tribunal. In an effort to complete all trial activities, the Completion Strategy has involved transferring the indictments of low to mid-level accused to national jurisdictions for trial. With donor fatigue, frustration with the efficiency of the Ad-Hoc tribunals and the desire for states to manage their own issues, there is a shift in enforcement of international criminal law away from international tribunals. The outcome is that national courts will be increasingly responsible for the accountability of international crimes and the application of fair trial rights. As a result, the importance of cases being prosecuted domestically with the appropriate level of fair trial standards and the capacity of national systems will be increasingly important.