Schema Directeur D'amenagement Communal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cahier Des Villages Et Quartiers De Ville Du Mono.Pdf
REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT &&&&&&&&&& INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DU MONO (RGPH-4, 2013) Août 2016 REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DU MONO Août 2016 Prescrit par relevé N°09/PR/SGG/REL du 17 mars 2011, la quatrième édition du Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Bénin s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national en mai 2013. Plusieurs activités ont concouru à sa réalisation, parmi lesquelles la cartographie censitaire. En effet, la cartographie censitaire à l’appui du recensement a consisté à découper tout le territoire national en de petites portions appelées Zones de Dénombrement (ZD). Au cours de la cartographie, des informations ont été collectées sur la disponibilité ou non des infrastructures de santé, d’éducation, d’adduction d’eau etc…dans les villages/quartiers de ville. Le présent document donne des informations détaillées jusqu’au niveau des villages et quartiers de ville, par arrondissement et commune. Il renseigne sur les effectifs de population, le nombre de ménage, la taille moyenne des ménages, la population agricole, les effectifs de population de certains âges spécifiques et des informations sur la disponibilité des infrastructures communautaires. Il convient de souligner que le point fait sur les centres de santé et les écoles n’intègre pas les centres de santé privés, et les confessionnels, ainsi que les écoles privées ou de type confessionnel. -

Monographie Des Communes Des Départements Du Mono Et Du Couffo
Spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin : Monographie des communes des départements du Mono et du Couffo Note synthèse sur l’actualisation du diagnostic et la priorisation des cibles des communes Une initiative de : Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement Durable (DGCS-ODD) Avec l’appui financier de : Programme d’appui à la Décentralisation et Projet d’Appui aux Stratégies de Développement au Développement Communal (PDDC / GIZ) (PASD / PNUD) Fonds des Nations unies pour l'enfance Fonds des Nations unies pour la population (UNICEF) (UNFPA) Et l’appui technique du Cabinet Cosinus Conseils Note synthèse réalisée dans le cadre de la mission mise en œuvre par le cabinet Cosinus Conseils Sarl Tables des matières Sigles et abréviations ............................................................................................................................................ 3 1.1. BREF APERÇU SUR LE DEPARTEMENT ....................................................................................................... 4 1.1.1. INFORMATIONS SUR LES DEPARTEMENTS MONO-COUFFO .................................................................................... 4 1.1.1.1. Aperçu du département du Mono ........................................................................................................... 4 1.1.1.1.2. Aperçu du département du Couffo ................................................................................................. 5 1.1.2. RESUME DES INFORMATIONS SUR LE DIAGNOSTIC -

Sujet Les Facteurs Explicatifs De La
Thèse de LOKONON Paul, Soutenue, le 09, novembre 2018, Bénin UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI ************ ÉCOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE (EDP) « ESPACES, CULTURES ET DÉVELOPPEMENT » ************ FORMATION : SOCIOLOGIE-ANTHROPOLOGIE ************ OPTION : SOCIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT ************ Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi SUJET LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA PERSISTANCE DE LA FAIBLE SCOLARISATION DES FILLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU MONO ET DU COUFFO AU BÉNIN Présenté par : Paul LOKONON Co-directrice de thèse : Directeur de thèse : Dr Élisabeth FOURN, Professeur Cyriaque S. C. Maître de Conférences des AHODÉKON, Université d’Abomey- Universités (CAMES) Calavi Jury : Président : Professeur BOKO Koovi Gabriel, Université d’Abomey-Calavi Premier Rapporteur : Professeur AHODEKON SESSOU C. Cyriaque, Université d’Abomey-Calavi Deuxième Rapporteur : Dr FOURN Elisabeth née GNANSOUNOU, Maître de conférences, Université d’Abomey-Calavi Membres : 1 Professeur AMOUZOU Essè, Université d e Lomé/Togo 2 Dr GBEMOU Kokou Mawulikplimi , Maître de conférences, Université d e Lomé/Togo Soutenue publiquement : le 09 novembre 2018 Mention : très honorable Année académique 2017-2018 1 [email protected] tel: 00229 97 07 68 53 « L’Université d’Abomey-Calavi n’entend ni approuver ni désapprouver les informations contenues dans cette thèse ; elles n’engagent que son auteur.» 2 SOMMAIRE SOMMAIRE ........................................................................................... 3 DÉDICACES ........................................................................................................... -

Presentation Des Regions De Developpement
Ministère de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme Délégation à l’Aménagement du Territoire Mission d’Identification des « régions » comme unités de planification territoriale et de gestion du développement au Bénin. Rapport final LARES- Avril 2005 Table des matières Introduction…………………………………………………………………………..3 1- Objectif du travail…………………………………………………………………4 2- Démarche méthodologie…………………………………………………………...4 3- Les Espaces de développement partagé…………………………………………..5 3-1- Définition…………………………………………………………………5 3-2- Les scénarios alternatifs…………………………………………………6 4- Esquisse d’Espaces de développement Partagé………………………………….9 4-1- la Vallée du Niger……………………………………………………….10 4-2- Pays des trois rivières …………………………………………………..12 4-3- Pays des monts du Borgou……………………………………………...14 4-4- Cœur du Pays Bariba…………………………………………………...16 4-5- Ouémé supérieur……………………………………………………..…18 4-6-Pays de la Pendjari………………………………………………………20 4-7-Pays de la Mékrou……………………………………………………….22 4-8-L’Atacora………………………………………………………………...24 4- 9-La Donga………………………………………………………………...26 4-10-Pays de l’Okpara……………………………………………………….28 4-11-Pays des 41 Collines……………………………………………………30 4-12- Pays du Pacte de Terre………………………………………………..32 4-13-Plateau du Danxomè…………………………………………………...34 4-14-Pays Agonli……………………………………………………………..36 4-15-Le Mono………………………………………………………………...38 4-16-Le Moyen Couffo………………………………………………………40 4-17-Zone Interlacustre……………………………………………………..42 4-18-Pays Nagot……………………………………………………………..44 4-19-Vallée de l’Ouémé……………………………………………………..46 4-20-Pays Gun……………………………………………………………….48 -

N° Numéro De Table Nom Et Prénoms Sexe Date Et Lieu De Naissance
BEPC Session de Juillet 2018 : Normale Numéro de Date et lieu de N° Nom et Prénoms Sexe Série Etablissement Centre Département Statut Table naissance 19/06/2000 à CEG 1 18E1000001 ABALLO Gisèlle Djidjolé F Mod.Long CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE DEDEKPOE ADOHOUN ACCLOMBESSIBellavine 2 18E1000004 F 01/01/1998 à OUMAKO Mod.Long CEG ATHIEME CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE Jeanne 3 18E1000012 ADODO Florence Stéphanie F 24/10/1999 à ATHIEME Mod.Long CEG ATHIEME CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE COLLEGE 31/12/2001 à 4 18E1000013 ADOGONY Gildas M Mod.Long CATHOLIQUE CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE KPOMASSÈ ATHIEME 16/09/2000 à CEG 5 18E1000015 AFFATODJI Amavi Yahvé M Mod.Long CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE DEDEKPOE DEDEKPOE 15/02/2003 à CEG 6 18E1000021 AGBEKO Amévi Claudia F Mod.Long CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE DEDEKPOE DEDEKPOE CEG 7 18E1000024 AGBOGBO Yvette F 19/01/2000 à ATHIEME Mod.Long CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE ADOHOUN CEG 8 18E1000026 AGLASSOU Rodrigue Comlan M 13/03/2001 à ADAME Mod.Long CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE DEDEKPOE 9 18E1000028 AGOSSA Yao Marcellin M 06/04/2001 à ATHIEME Mod.Long CEG ATHIEME CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE 22/05/1998 à CEG 10 18E1000029 AGOSSOU Coffi Eric M Mod.Long CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE ADOHOUN ADOHOUN 18/06/2003 à 11 18E1000033 AHOUSSI Arnaud M Mod.Long CEG ATHIEME CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE ATCHANNOU 01/08/2001 à 12 18E1000035 AKABASSI SITHONEunock M Mod.Long CEG ATHIEME CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE AGBANGNIZOUN 13 18E1000036 AKAKPO Kocou Toussaint M 01/11/1995 à KPINNOU Mod.Long CEG KPINNOU CEG ATHIEME MONO ADMISSIBLE -

Cahier Spécial Des Charges Enabel Ben 566 Du 18/02/2019 Marché De Services Relatif À L'audit Technique Et Financier D'inv
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES ENABEL BEN 566 DU 18/02/2019 MARCHÉ DE SERVICES RELATIF À L’AUDIT TECHNIQUE ET FINANCIER D’INVESTISSEMENTS COMMUNAUX REALISES DANS 23 COMMUNES DES DEPARTEMENTS DU MONO, DU COUFFO, DE L’ATACORA ET DE LA DONGA » CODE NAVISION : BEN1302611 PROFI Enabel • Agence belge de développement • Société anonyme de droit public à finalité sociale 1 Rue Haute 147 • 1000 Bruxelles • T +32 (0)2 505 37 00 • enabel.be Table des matières 1 Généralités ................................................................................................................................ 5 1.1 Dérogations aux règles générales d’exécution .................................................................. 5 1.2 Pouvoir adjudicateur .......................................................................................................... 5 1.3 Cadre institutionnel d’Enabel ............................................................................................ 5 1.4 Règles régissant le marché ................................................................................................. 6 1.5 Définitions ........................................................................................................................... 6 1.6 Confidentialité .................................................................................................................... 7 1.6.1 Obligations déontologiques ................................................................................................ 7 1.6.2 Droit applicable et tribunaux compétents -

Cholera Epidemic
DREF operation update Benin: Cholera Epidemic DREF operation n° MDRBJ010 GLIDE n° EP-2012-000186-BEN Update n° 1– 13 February, 2013 The International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC) Disaster Relief Emergency Fund (DREF) is a source of un-earmarked money created by the Federation in 1985 to ensure that immediate financial support is available for Red Cross and Red Crescent emergency response. The DREF is a vital part of the International Federations disaster response system and increases the ability of National Societies to respond to disasters. Period covered by this update: 10 November 2012 to 31 January 2013. Summary: CHF 112,195 was allocated from the IFRC`s Disaster Relief Emergency Fund (DREF) on 9 November 2012, to support the National Society in delivering immediate assistance to some 25,000 people in 5,000 households. From October 2012, the municipality of Comé in the south western part of Benin experienced a cholera epidemic, and a few cases were also identified in the neighbouring municipality of Houéyogbé. After the first cases were discovered, the Red Cross society of Benin (BRCS) initiated community-based social mobilization activities Awareness sessions in the presence of local elected focused on epidemics awareness raising, hygiene officials in the town of Dohi in Comé. Photo/ BRCS promotion and water and sanitation activities. To date, a total of 50 trained BRCS volunteers have implemented the project activities, so far reaching 13,542 persons with health education, cholera prevention and hygiene promotion awareness. Additionally, 17,000 persons, including students and teachers, in 50 schools, have been provided with hygiene sessions on hand washing as a way to reduce health risks, while 720 households (3,600 persons) have increased awareness on safe water treatment and storage and have been provided with water treatment tablets in order for them to access clean water. -

Deuxieme Recensement General De La Population Et De L'habitation Fevrier 1992
MINISTERE DU PLAN FONDS DES NATIONS UNIES ET DE LA RESTRUCTURATION ECONOMIQUE POUR LA POPULATION INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION FEVRIER 1992 VOLUME 1 RESULTATS DEFINITIFS (PRINCIPAUX TABLEAUX) Décembre 1993 . MINISTERE DU PLAN FONDS DES NATIONS UNIES ET DE LA RESTRUCTURATION ECONOMIQUE POUR LA POPUL.ATION INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE- L'ANALYSE ECONOMIQUE BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT DEUXIEJ~ RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION FEVRIER 1992 VOLUME 1 RESULTATS DEFINITIFS (PRINCIPAUX TABLEAUX) Décembre 1993 AVANT PROPOS Le ,Deuxième" Recensement ".Général" de la Population et de l'aabitation,.(R.-G.P~'H.2) a été réalisé au-Bénin du 15 au 29 Février ,1992. Il fait suite'â·l'opération du-même genre effectuée en Mars 1979 et â une série d'enquêtes démographiques qui ont, eu liéU dans le pays entre 1979 et 1982. Il s'agit notamment de : - l'Enquête Démographique sur la Petite Enfance â Cotonou de 1979-1981 - l'Enquête â' Passages Répétés 1981-1983 - l' EnquêterFécondité au ,·Bénin 1982 Toutes:: ces études visentâapprofondir 'la connaissance des ressqurces humaines généralement considérée comme la principale variable :sur,-laquelledoit ~ se, baser.. la planification du développement d'un pays. Notre conviction est que l'homme est l'acteur principalcde la création-de la richesse et doit en être le premier bénéficiaire.' Aussi tous nos efforts sont-ils constamment orientés dans une telle vision de l'organisation du développement. Les principaux tableaux statistiquesdu~DeuxièmeRecensement Général de la 'Population et de l'Habitation, . -

Villages Arrondissement D~GARADEBOU: 14 Villages 1
REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 2013-05 DU 27 MAI2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 15 février 2013. Suite la Décision de conformité à la Constitution DCC 13-051 du 16 mai 2013, Le Président de la République Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, la commune est démembrée en unités administratives locales sans personnalité juridique ni autonomie financière. Ces unités administratives locales qui prennent les dénominations d'arrondissement, de village ou de quartier de ville sont dotées d'organes infra communaux fixés par la présente loi. Article 2 : En application des dispositions des articles 40 et 46 de la loi citée à l'article 1er, la présente loi a pour objet : 1- de déterminer les conditions dans lesquelles les unités administratives locales mentionnées à l'article 1er sont créées; 2- de fixer la formation, le fonctionnement, les compétences du conseil d'arrondissement et du conseil de village ou quartier de ville d'une part et le statut et les attributions du chef d'arrondissement, du chef de village ou quartier de ville d'autre part. Article 3: Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la commune est divisée en arrondissements. -

Programmation Mensuelle Des Marchés Béninois
Cellule Technique de Suivi et d’Appui à la Gestion de la Sécurité Alimentaire (CT-SAGSA) Programmation Mensuelle des marchés Mois : juin 2021 Jour Marchés mardi 1Dantokpa, Sinendé mercredi 2Comè, Nikki, Ouando jeudi 3Akodéha, Djougou, Sinendé vendredi 4Danhoué, Dogbo, Ouando samedi 5Bougou, Dantokpa, Sè, Sinendé dimanche 6Nikki, Ouando lundi 7Comè, Djougou, Sinendé mardi 8Akodéha, Dogbo, Ouando mercredi 9Danhoué, Dantokpa, Sinendé jeudi 10 Nikki, Ouando, Sè vendredi 11 Bougou, Djougou, Sinendé samedi 12 Comè, Dogbo, Ouando dimanche 13 Akodéha, Dantokpa, Sinendé lundi 14 Danhoué, Nikki, Ouando mardi 15 Djougou, Sè, Sinendé mercredi 16 Dogbo, Ouando jeudi 17 Bougou, Comè, Dantokpa, Sinendé vendredi 18 Akodéha, Nikki, Ouando samedi 19 Danhoué, Djougou, Sinendé dimanche 20 Dogbo, Ouando, Sè lundi 21 Dantokpa, Sinendé mardi 22 Comè, Nikki, Ouando mercredi 23 Akodéha, Bougou, Djougou, Sinendé jeudi 24 Danhoué, Dogbo, Ouando vendredi 25 Dantokpa, Sè, Sinendé samedi 26 Nikki, Ouando dimanche 27 Comè, Djougou, Sinendé lundi 28 Akodéha, Dogbo, Ouando mardi 29 Bougou, Danhoué, Dantokpa, Sinendé mercredi 30 Nikki, Ouando, Sè mercredi 2 juin 2021 Page 1 sur 1 Cellule Technique de Suivi et d’Appui à la Gestion de la Sécurité Alimentaire (CT-SAGSA) =-=-=-=-=-=-=-= MARCHES DE PERIODICITES ET CORRESPONDANTS MARCHES DE PERIODICITES 5 JOURS ET MARCHES DE PERIODICITE 6 JOURS MARCHES CORRESPONDANTS Comè : Doutou Akodéha : Honhoué Bougou : pas de correspondant Danhoué : pas de correspondant Sè : Adjaha, Lobogo, [Bétail] Lobogo MARCHES DE PERIODICITE 4 JOURS -
La Marche Vers Le Développement
1 Urgent: AVIS DE RECRUTEMENT POUR SERVIR UNE ENTREPRISE PARTENAIRE DE LA MVD QUI SE TROUVE DANS UN BESOIN D'URGENCE. -*-*-*-*-*- La Marche Vers le Développement - MVD recrute de toute urgence au profit d'une entreprise, 94 agents commerciaux pour le recensement des écoles, collèges, lycées, complexes scolaires (publics et privés) du Bénin. Les agents commerciaux sont répartis sur toute l'étendue du territoire nationale selon les tableaux ci-après: Veuillez les consulter afin de choisir votre localité. Il s'agit de : 2 Tableau: Liste des commerciaux des communes, des arrondissements et des villages (ou quartiers de villes) du département de l'Alibori Département Communes Arrondissements Villages ou quartiers de ville Commerciaux BANIKOARA ARBONGA, OKIRE, YADIKPAROU, WETEROU, DEMANOU, OROU GNONROU, DEROU GAROU, KOMMON, KORI GINGUIRI, WAGOU, TOKEY BANTA. FOUNOUGO BOFOUNOU- PEULH, FOUNOUGO A, FOUNOUGO B, FOUNOUGO PEULH, GNINGNIMPOGOU, GOUGNIROUBARIBA, GOUGNIROU PEULH, IGGRIGGOU, KANDEROU, KPAKO GBARI, SAMPETO. GOMPAROU BOUHANROU, GOMPAROU A, GOMPAROU B, GOMPAROU PEULH, KPESSANROU, NIEKOUBANTA, PAMPIME, TIGASSOUNON, GOUROUEDE. GOUMORI DOMBOURE BARIBA, DOMBOURE PEULH, GBANGBANGA, GBASSA, GOUMORI A, GOUMORI B, 1 GOUMORI PEULH, MONDOUKOKA. BANIKOARA SOROKO GBENIKI, SOROKO A, SOROKO B, SOROKO PEULH. TOURA ATABENOU, TINTINMOU-BARIBA, TINTINMOU-PEULH, TOURA-A, TOURA-B, T O URA-PEULH. BAGOU BAGOU, BANIGOURE, BAGOU I, BAGOU II, BAGOU PEULH, DIADIA, GANDOBOU, KALI, KEROU, NAFAROU. KOKEY KOKEY A, KOKEY B, NIMBERE PEULH, PIGUIRE PEULH. KOKIBOROU KOKIBOROU A, KOKIBOROU B, KOKIBOROU PEULH, SIKIROU. OUNET OUNET A, OUNET B, OUNET PEULH, SONNOUBARIBA, SENNOU PEULH. 1 SOMPEREKOU POTO, SIMPEROU, SIMPEROU-PEULH, SOMPEREKOU-A, SOMPEREKOU-B, SOMPEREKOU-PEULH, KEGAMONROU. ALIBORI GOGOUNOU GOGOUNOU, KOSSENIN, OUERE, OUERE PEULH. GOUNAROU BORO, BORODAROU, DIGUISSON, GOUNAROU. -
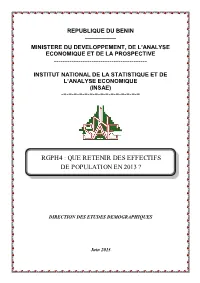
Resultats Definitifs RGPH4.Pdf
REPUBLIQUE DU BENIN _____________ MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L’ANALYSE ECONOMIQUE ET DE LA PROSPECTIVE ------------------------------------------ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RGPH4 : QUE RETENIR DES EFFECTIFS DE POPULATION EN 2013 ? DIRECTION DES ETUDES DEMOGRAPHIQUES Juin 2015 La nécessité de disposer de données pertinentes, fiables, diversifiées et désagrégées jusqu’au niveau géographique le plus fin et à jour, est unanimement reconnue par la communauté internationale. Appréciant ce besoin d’information, de nombreuses opérations statistiques se réalisent dans le but de disposer de données fiables facilitant une prise de décision éclairée, tant au niveau des décideurs politiques, qu’au niveau de la communauté scientifique et économique. Au titre de ces opérations, le Recensement Général de la Population et de l’Habitation est la source qui permet de disposer de façon exhaustive des données jusqu’aux plus petites unités administratives. Les travaux de dénombrement du RGPH4 au Bénin se sont déroulés du 11 au 31 Mai 2013 sur toute l’étendue du territoire national. Cette grosse opération a mobilisé près de 17.500 agents de terrain : agents recenseurs, chefs d’équipes, contrôleurs et superviseurs. En dehors des ressources du Budget National, elle a bénéficié de l’appui des partenaires au développement du Bénin, notamment la Coopération Suisse, la Banque Mondiale, l’UNICEF et l’UNFPA. A la suite de la collecte, les travaux de traitement ont démarré avec l’archivage des questionnaires, la vérification, la codification, la saisie et l’apurement des données. Après plusieurs étapes de validation par le Conseil Scientifique de l’INSAE, le Conseil des Ministres en sa séance du jeudi 21 mai 2015 a adopté les résultats définitifs du RGPH4.