Les Licences Nationales : Tentative De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Master of Imaging, Robotics And
↗ 5 introductory courses for and by research ↗ Access to PhD studies ↗ Globally-driven ↗ Adjustable program ↗ Support by excellence international research institutes MasterDiplôme of d’ingénieurImaging, Robotics généraliste and Biomedical Engineering (MSc degree) PURPOSES / SKILLS This research- and innovation- oriented Master’s course aims at Research institutes and technology transfer providing the future Engineer with in-depth skills in the following organizations: area: ↗ control theory, medical and surgical robotics ↗ ICube research institute (CNRS, National Cen- ↗ data processing and analysis ter for Scientific Research) – Engineering, ↗ control of complex systems and development of robotic solu- Computer and Imaging Sciences, 625 active tions members, 263 permanent employees, 183 ↗ computer vision and imaging modalities PhD students ↗ photonics and nanotechnologies for healthcare ↗ IRCAD (Research Institute Against Digestive ↗ topography and photogrammetry Cancer) and its branches in Asia (Taiwan), South America (Brazil) and Africa This program allows for the acquisition of skills in solving scien- tific and technological usually complex problems, in the fields of ↗ CRT (Technology Resource Center) for laser R&D or discovery research. processing (IREPA LASER) ↗ IHU (Hospital University of Strasbourg) for image-guided mini-invasive surgery CAREER AND INTERNSHIP PROSPECTS ↗ The Master of Imaging, Robotics and Biome- dical Engineering is jointly accredited by the ↗ Industry: Airbus, Alcatel-Lucent, Daimler, EDF, General Motors, INSA -

The High Level of Maturity of the Elsa CFD Software for Aerodynamics Applications
DOI: 10.13009/EUCASS2019-434 8TH EUROPEAN CONFERENCE FOR AERONAUTICS AND SPACE SCIENCES (EUCASS) The High Level of Maturity of the elsA CFD Software for Aerodynamics Applications Sylvie Plot ONERA, University Paris Saclay 7-92322 Châtillon – France [email protected] Abstract The elsA CFD software developed at ONERA is both a software package capitalizing the innovative results of research over time and a multi-purpose tool for applied CFD and for multi-physics. elsA is used intensively by the Safran and Airbus groups and ONERA, as well as other industrial groups and research partners. This paper presents the main capabilities of elsA and recent numerical simulations using elsA for a wide range of challenging aeronautic applications. The simulations address aerodynamics computations as well as aero-structure and aeroacoustics ones. Each simulation enables to underline differentiating modelling and numerical methods implemented within elsA and shows that this software has reached a very high level of maturity and reliability. Nomenclature CFD Computational Fluid Dynamics elsA ensemble Logiciel de Simulation en Aérodynamique UHB/UHBR Ultra-High Bypass/Ultra-High Bypass Ratio CROR contra rotating open rotor (U)RANS (unsteady) Reynolds Averaged Navier-Stokes EARSM/DRSM Explicit Algebraic/Differential Reynolds Stress Model (Z)DES/LES (Zonal) Detached/Large Eddy Simulation DNS Direct Numerical Simulation OO Object-Oriented MFA Multiple Frequency phase-lagged Approach 1. Introduction Advanced CFD is one key differentiating factor for designing efficient transportation systems. Accuracy and efficiency are crucial for aeronautical manufacturers to optimize the design of their products so that the limit of the aircraft flight envelopes is extended. -

Continuing Professional Education in Open Access
Continuing Professional Education in Open Access. A French-German Survey Achim Oßwald, Joachim Schöpfel, Bernard Jacquemin To cite this version: Achim Oßwald, Joachim Schöpfel, Bernard Jacquemin. Continuing Professional Education in Open Access. A French-German Survey. LIBER Quarterly. The journal of the Association of European Research Libraries, LIBER, the Association of European Research Libraries., 2016, 26 (2), pp.43-66. 10.18352/lq.10158. hal-01367898 HAL Id: hal-01367898 https://hal.univ-lille.fr/hal-01367898 Submitted on 17 Sep 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. A. Oßwald et al., Continuing Professional Education in Open Access Continuing Professional Education in Open Access a French-German Survey ¹Achim Oßwald ²Joachim Schöpfel, ²Bernard Jacquemin ¹Technische Hochschule Köln / Technology, Arts, Sciences, DE ²GERiiCO, Université de Lille, FR ¹[email protected] ²{Joachim.Schopfel,Bernard.Jacquemin}@univ-lille3.fr While open access (OA) has become a significant part of scientific communication and academic publishing, qualification issues have been out of focus in the OA community until recent years. Based on findings about the qualification for OA within university-based programs in France and Germany the authors surveyed continuing professional education activities regarding OA in both countries in the years 2012-2015. -

Modeling, Design and Fabrication of Diffractive Optical Elements Based on Nanostructures Operating Beyond the Scalar Paraxial Domain Giang Nam Nguyen
Modeling, design and fabrication of diffractive optical elements based on nanostructures operating beyond the scalar paraxial domain Giang Nam Nguyen To cite this version: Giang Nam Nguyen. Modeling, design and fabrication of diffractive optical elements based on nanos- tructures operating beyond the scalar paraxial domain. Optics / Photonic. Télécom Bretagne; Uni- versité de Bretagne Occidentale, 2014. English. tel-01187568 HAL Id: tel-01187568 https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01187568 Submitted on 27 Aug 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. N° d’ordre : 2014telb0336 Sous le sceau de l’Université européenne de Bretagne Télécom Bretagne En accréditation conjointe avec l’Ecole Doctorale Sicma MODELING, DESIGN AND FABRICATION OF DIFFRACTIVE OPTICAL ELEMENTS BASED ON NANOSTRUCTURES OPERATING BEYOND THE SCALAR PARAXIAL DOMAIN Thèse de Doctorat Mention : Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication Présentée par Giang-Nam Nguyen Département : Optique Directeur de thèse : Kevin Heggarty Soutenue le 9 décembre 2014 Jury : M. Pierre Ambs – Prof., Université de Haute-Alsace (Rapporteur) M. Nicolas Guérineau – HDR, ONERA Palaiseau (Rapporteur) M. Kevin Heggarty – Prof., Télécom Bretagne (Directeur de thèse) M. Patrick Meyrueis – Prof., Université de Strasbourg (Co-directeur de thèse) M. -

French Aeronautical Players to Fly 100% Alternative Fuel on Single-Aisle Aircraft End of 2021
French aeronautical players to fly 100% alternative fuel on single-aisle aircraft end of 2021 Toulouse, Paris, 10 June 2021- Airbus, Safran, Dassault Aviation, ONERA and Ministry of Transport are jointly launching an in-flight study, at the end of 2021, to analyse the compatibility of unblended sustainable aviation fuel (SAF) with single-aisle aircraft and commercial aircraft engine and fuel systems, as well as with helicopter engines. This flight will be made with the support of the “Plan de relance aéronautique” (the French government‘s aviation recovery plan) managed by Jean Baptiste Djebbari, French Transport Minister. Known as VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux), this project is the first time that in-flight emissions will be measured using 100% SAF in a single-aisle aircraft. Airbus is responsible for characterising and analysing the impact of 100% SAF on-ground and in- flight emissions using an A320neo test aircraft powered by a CFM LEAP-1A engine1. Safran will focus on compatibility studies related to the fuel system and engine adaptation for commercial and helicopter aircraft and their optimisation for various types of 100% SAF fuels. ONERA will support Airbus and Safran in analysing the compatibility of the fuel with aircraft systems and will be in charge of preparing, analysing and interpreting test results for the impact of 100% SAF on emissions and contrail formation. In addition, Dassault Aviation will contribute to the material and equipment compatibility studies and verify 100% SAF biocontamination susceptibility. The various SAFs used for the VOLCAN project will be provided by TotalEnergies. Moreover, this study will support efforts currently underway at Airbus and Safran to ensure the aviation sector is ready for the large-scale deployment and use of SAF as part of the wider initiative to decarbonise the industry. -

Improving the Chances of Success of Its ANR Project Thanks to Open Science
Improving the chances of success of its ANR project thanks to Open Science Guide produced by the Research Data Working Group of the GTSO-Couperin April 2020 Version 1 DOI: 10.5281/zenodo.3749577 About the authors Romain Féret (ORCID ID: 0000-0002-1527-1482) is in charge of research data management and Open Access at the Library of the University of Lille. Since 2017, he has regularly supported the writing of grant proposals for ANR and H2020 projects. He also follows several ANR and H2020 on-going projects. He pilots the Working Group on Research Data of the GTSO-Couperin and represents the University of Lille in OpenAIRE. Laetitia Bracco (ORCID ID: 0000-0002-2939-9110) is data librarian at the Library of the University of 2 Lorraine. She supports PhD students and researchers in the management of research data and she produces data visualization for the monitoring of Open Science in her institution. Cécile Arènes (ORCID ID: 0000-0002-1839-3530) is data librarian at the library of Sorbonne Université. She is in charge of research data management and digital humanities. She assists researchers to write their data management plans and trains researchers and PhD students in open science. Stéphanie Cheviron is data librarian in charge of research data management at the Library of the University of Strasbourg since 2015. She's also functional project manager in charge of the development of scientific databases with researchers. Since 2019, she follows ANR and H2020 projects. Élise Lehoux (ORCID ID: 0000-0003-2929-6768) is project manager “Scientific and Technical Information and Research Data” at the University of Paris. -
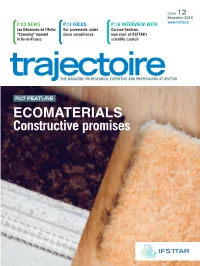
ECOMATERIALS Constructive Promises
Issue 12 November 2016 P.03 NEWS P.11 FOCUS P.16 INTERVIEW WITH www.ifsttar.fr Les Décennies de l’Ifsttar Our pavements under Corinne Gendron, “Crowning” moment close surveillance new chair of IFSTTAR’s in Île-de-France scientific council THE MAGAZINE ON RESEARCH, EXPERTISE AND PROFESSIONS AT IFSTTAR P.07 FEATURE ECOMATERIALS Constructive promises contents DIARY 6 DECEMBER • Feedback seminar on the Predic mobilletic project IFSTTAR and the Department of the General Commissioner for Sustainable Development (CGDD/DRI/Research department) of the French Ministry for Environment, Energy and the Sea will organise a half-day meeting dedicated to the use of ticketing data. http://www.gart.org/evenement/seminaire-de-restitution-projet-predic- mobilletic 7-9 DECEMBER • IFAC2016 The first IFAC conference on Cyber-Physical & Human-Systems P.03 NEWS: (CPHS 2016) will be held in Florianopolis, Brazil. Les Décennies de l’Ifsttar http://www.cphs2016.org “Crowning” moment in Île-de-France 7 FEBRUARY • “Challenges and alternatives in urban environments?” P.04 SCIENTIFIC CROSSROADS: Rencontres des Savoirs (“Knowledge encounters”) Conference cycle • Bridges and troubled waters District composts in Lyon • Testing ever greener roads http://www.ville-bron.fr/editorial.php?Rub=644 • Improving the opérations at Paris - 21 FEBRUARY • Seminar of the GRETS group (research Charles de Gaulle airport group on Energy, Technology and Society) • Virolo++ taking a new turn Revisiting the analysis of social inequalities in terms of access to the city – Thoughts about the -

Multidisciplinary Design and Performance of the ONERA Hybrid
Multidisciplinary Design and performance of the ONERA Hybrid Electric Distributed Propulsion concept (DRAGON) Peter Schmollgruber, David Donjat, Michael Ridel, Italo Cafarelli, Olivier Atinault, Christophe François, Bernard Paluch To cite this version: Peter Schmollgruber, David Donjat, Michael Ridel, Italo Cafarelli, Olivier Atinault, et al.. Multi- disciplinary Design and performance of the ONERA Hybrid Electric Distributed Propulsion concept (DRAGON). AIAA Scitech 2020 Forum, Jan 2020, Orlando, United States. 10.2514/6.2020-0501. hal-03125217 HAL Id: hal-03125217 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03125217 Submitted on 29 Jan 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Multidisciplinary design and performance of the ONERA Hybrid Electric Distributed Propulsion concept (DRAGON) P. Schmollgruber, D. Donjat, M. Ridel, ONERA, the French Aerospace Lab F-31055 Toulouse, France I. Cafarelli ONERA, the French Aerospace Lab F-92322 Châtillon, France O. Atinault, C. François ONERA, the French Aerospace Lab F-92190 Meudon, France B. Paluch ONERA, the French Aerospace Lab F-59045 Lille, France The reduction of carbon emissions is a key objective for the entire Air Transportation ecosystem. At aircraft level, many options are investigated to reduce fuel burn. -

Background Specific Objectives Eligibility Criteria
Joint call to strengthen collaboration between Ghent and Lille/Hauts-de-France Region: short-term mobility This joint call aims to reinforce collaborations between I-SITE Université Lille Nord-Europe (members & national partners) and Ghent University by providing funding for professors, teachers and researchers who wish to carry out a short-term mobility (maximum of 15 days, consecutive or not) at international partner participating in this call. The main goal is to deepen and broaden interactions between institutions in the framework of research and/or academic projects. The mobility must be carried out between July 2019 and August 2020. The project leader must submit the application in English by June 13, 2019 at 10.00 am, GMT+1, by email to: [email protected] (for I-SITE Université Lille Nord-Europe members & French national partners) or [email protected] (for staff from Ghent University). Background Cross-border regions offer their higher education institutions unique opportunities to collaborate with nearby international partners in order to share experiences and jointly build expertise on the challenges facing their common region and the broader world. In this context, several higher education Institutions in northern France, Belgium and the southern United Kingdom are working on the creation of a Euro-regional cross-border campus in which cooperation will be reinforced for the benefit of their communities. As part of this project, the 14 members of I-SITE Université Lille Nord-Europe Foundation located in the Hauts-de-France Region and Ghent University in Belgium are launching a common call designed to further stimulate cooperation among their researchers. -

Field Dissertation 4
OUTLANDISH AUTHORS: INNOCENZO FEDE AND MUSICAL PATRONAGE AT THE STUART COURT IN LONDON AND IN EXILE by Nicholas Ezra Field A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Music: Musicology) in the University of Michigan 2013 Doctoral Committee: Associate Professor Stefano Mengozzi, Co-Chair Associate Professor Mark Clague, Co-Chair Professor Linda K. Gregerson Associate Professor George Hoffmann ACKNOWLEDGEMENTS In writing this dissertation I have benefited from the assistance, encouragement, and guidance of many people. I am deeply grateful to my thesis advisors and committee co-chairs, Professor Stefano Mengozzi and Professor Mark Clague for their unwavering support as this project unfolded. I would also like to extend my heartfelt gratitude to my dissertation committee members, Professor Linda Gregerson and Professor George Hoffmann—thank you both for your interest, insights, and support. Additional and special thanks are due to my family: my parents Larry and Tamara, my wife Yunju and her parents, my brother Sean, and especially my beloved children Lydian and Evan. ii TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS................................................................................................ ii LIST OF FIGURES ............................................................................................................ v ABSTRACT....................................................................................................................... vi CHAPTER ONE: Introduction -

2019 06 20 AG COUPERIN Présentation Diffusion
Assemblée Générale 20 juin 2019 - Strasbourg AG Couperin.org – 20 juin 2019 Strasbourg Ordre du jour Ø Rapport moral 2018 Ø Rapport financier 2018 Ø Rapport des vérificateurs aux comptes Ø Election du conseil d’administration Ø Election du bureau professionnel Ø Election des vérificateurs aux comptes Ø Montant des cotisations 2019 Ø Budget 2019 Ø Informations sur les négociations Ø Bilan des informations collectées concernant les dépenses d’APC dans les établissements Ø Présentation de Consortia Manager : nouvel outil de gestion pour le consortium et ses membres Ø Questions diverses 2 AG Couperin.org – 20 juin 2019 Strasbourg Département des services et de la prospective AG Couperin.org – 20 juin 2019 Strasbourg LE DSP : MUTUALISATION DES SERVICES ET PARTAGE D’EXPÉRIENCES En appui et collaboration avec le Responsable : Département des négociations documentaires ® Françoise Rousseau-Hans, CEA Coordinateur Couperin : Des partenaires : INIST/CNRS, CCSD, ABES, Partenaires internationaux, … ® André Dazy Projets MESURE, EZPaarse, EZMesure, OpenAire,… Collaborateurs Couperin ® Thomas Porquet, ® Yannick Schurter GTI Membres Couperin Animer un réseau Animateur : ® Plus de 100 participants aux d'expertise et de partage Thomas Jouneau différents GT 45 personnes d’expérience sur les questions d’IST. GTAO/GTSO CeB Animatrice : Animateur : Participer à la mise en Christine Ollendorf Sébastien Respingue-Perrin place de projets et 4 sous-groupes 25 personnes des services 30 personnes mutualisées aux utilisateurs, AG Couperin.org – 20 juin 2019 Strasbourg -

Communique Sur La Negociation Elsevier
COMMUNIQUE SUR LA NEGOCIATION ELSEVIER Le consortium Couperin.org, après avoir consulté son conseil d’administration, a signifié le 11 avril 2019 à l’éditeur Elsevier son accord de principe pour une licence nationale 2019-2022 couvrant plusieurs ressources : les revues de la Freedom complete collection, la Bibliothèque médicale française, les revues Cell Press et un certain nombre de revues souscrites en titre-à-titre par quelques établissements. Le contenu de ce courrier a été communiqué à l’ensemble des établissements membres du consortium. Il a par ailleurs été rendu public sur un blog, à l’encontre des principes de la charte de l’adhérent de Couperin.org. Une lettre d’accord constitue une étape intermédiaire de la négociation et n’a pas vocation à être publiée car provisoire : la négociation se poursuit par la rédaction d’un protocole d’accord qui précise et peut faire évoluer les éléments de la proposition. Le protocole, signé par les différentes parties (Couperin.org, l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES), qui portera le marché de licence nationale, et l’éditeur), donnera lieu à un marché négocié reposant sur un groupement de commandes qui engagera juridiquement l’ABES et les établissements. Le contenu de la lettre d’accord ayant été rendu public, nous considérons utile d’apporter des éléments de contextualisation et d’explication que la lettre n’intègre pas de façon détaillée. Cette publication a entraîné l’expression publique d’observations critiques, nous souhaitons y apporter des réponses. ELABORATION DES OBJECTIFS DE LA NEGOCIATION ET MANDAT AUX NEGOCIATEURS Les différentes orientations possibles pour la négociation ont été présentées en assemblée générale et communiquées aux membres en novembre 2017 ; une Accords transformants ou « Publish and Read » enquête a permis de recueillir le positionnement des établissements sur les différentes orientations et sur les Les accords transformants constituent un nouveau priorités de négociation.