Rapport D'évaluation De L'école Centrale De Lyon (Ecl)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Continuing Professional Education in Open Access
Continuing Professional Education in Open Access. A French-German Survey Achim Oßwald, Joachim Schöpfel, Bernard Jacquemin To cite this version: Achim Oßwald, Joachim Schöpfel, Bernard Jacquemin. Continuing Professional Education in Open Access. A French-German Survey. LIBER Quarterly. The journal of the Association of European Research Libraries, LIBER, the Association of European Research Libraries., 2016, 26 (2), pp.43-66. 10.18352/lq.10158. hal-01367898 HAL Id: hal-01367898 https://hal.univ-lille.fr/hal-01367898 Submitted on 17 Sep 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. A. Oßwald et al., Continuing Professional Education in Open Access Continuing Professional Education in Open Access a French-German Survey ¹Achim Oßwald ²Joachim Schöpfel, ²Bernard Jacquemin ¹Technische Hochschule Köln / Technology, Arts, Sciences, DE ²GERiiCO, Université de Lille, FR ¹[email protected] ²{Joachim.Schopfel,Bernard.Jacquemin}@univ-lille3.fr While open access (OA) has become a significant part of scientific communication and academic publishing, qualification issues have been out of focus in the OA community until recent years. Based on findings about the qualification for OA within university-based programs in France and Germany the authors surveyed continuing professional education activities regarding OA in both countries in the years 2012-2015. -

Improving the Chances of Success of Its ANR Project Thanks to Open Science
Improving the chances of success of its ANR project thanks to Open Science Guide produced by the Research Data Working Group of the GTSO-Couperin April 2020 Version 1 DOI: 10.5281/zenodo.3749577 About the authors Romain Féret (ORCID ID: 0000-0002-1527-1482) is in charge of research data management and Open Access at the Library of the University of Lille. Since 2017, he has regularly supported the writing of grant proposals for ANR and H2020 projects. He also follows several ANR and H2020 on-going projects. He pilots the Working Group on Research Data of the GTSO-Couperin and represents the University of Lille in OpenAIRE. Laetitia Bracco (ORCID ID: 0000-0002-2939-9110) is data librarian at the Library of the University of 2 Lorraine. She supports PhD students and researchers in the management of research data and she produces data visualization for the monitoring of Open Science in her institution. Cécile Arènes (ORCID ID: 0000-0002-1839-3530) is data librarian at the library of Sorbonne Université. She is in charge of research data management and digital humanities. She assists researchers to write their data management plans and trains researchers and PhD students in open science. Stéphanie Cheviron is data librarian in charge of research data management at the Library of the University of Strasbourg since 2015. She's also functional project manager in charge of the development of scientific databases with researchers. Since 2019, she follows ANR and H2020 projects. Élise Lehoux (ORCID ID: 0000-0003-2929-6768) is project manager “Scientific and Technical Information and Research Data” at the University of Paris. -

Field Dissertation 4
OUTLANDISH AUTHORS: INNOCENZO FEDE AND MUSICAL PATRONAGE AT THE STUART COURT IN LONDON AND IN EXILE by Nicholas Ezra Field A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Music: Musicology) in the University of Michigan 2013 Doctoral Committee: Associate Professor Stefano Mengozzi, Co-Chair Associate Professor Mark Clague, Co-Chair Professor Linda K. Gregerson Associate Professor George Hoffmann ACKNOWLEDGEMENTS In writing this dissertation I have benefited from the assistance, encouragement, and guidance of many people. I am deeply grateful to my thesis advisors and committee co-chairs, Professor Stefano Mengozzi and Professor Mark Clague for their unwavering support as this project unfolded. I would also like to extend my heartfelt gratitude to my dissertation committee members, Professor Linda Gregerson and Professor George Hoffmann—thank you both for your interest, insights, and support. Additional and special thanks are due to my family: my parents Larry and Tamara, my wife Yunju and her parents, my brother Sean, and especially my beloved children Lydian and Evan. ii TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS................................................................................................ ii LIST OF FIGURES ............................................................................................................ v ABSTRACT....................................................................................................................... vi CHAPTER ONE: Introduction -

Communique Sur La Negociation Elsevier
COMMUNIQUE SUR LA NEGOCIATION ELSEVIER Le consortium Couperin.org, après avoir consulté son conseil d’administration, a signifié le 11 avril 2019 à l’éditeur Elsevier son accord de principe pour une licence nationale 2019-2022 couvrant plusieurs ressources : les revues de la Freedom complete collection, la Bibliothèque médicale française, les revues Cell Press et un certain nombre de revues souscrites en titre-à-titre par quelques établissements. Le contenu de ce courrier a été communiqué à l’ensemble des établissements membres du consortium. Il a par ailleurs été rendu public sur un blog, à l’encontre des principes de la charte de l’adhérent de Couperin.org. Une lettre d’accord constitue une étape intermédiaire de la négociation et n’a pas vocation à être publiée car provisoire : la négociation se poursuit par la rédaction d’un protocole d’accord qui précise et peut faire évoluer les éléments de la proposition. Le protocole, signé par les différentes parties (Couperin.org, l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES), qui portera le marché de licence nationale, et l’éditeur), donnera lieu à un marché négocié reposant sur un groupement de commandes qui engagera juridiquement l’ABES et les établissements. Le contenu de la lettre d’accord ayant été rendu public, nous considérons utile d’apporter des éléments de contextualisation et d’explication que la lettre n’intègre pas de façon détaillée. Cette publication a entraîné l’expression publique d’observations critiques, nous souhaitons y apporter des réponses. ELABORATION DES OBJECTIFS DE LA NEGOCIATION ET MANDAT AUX NEGOCIATEURS Les différentes orientations possibles pour la négociation ont été présentées en assemblée générale et communiquées aux membres en novembre 2017 ; une Accords transformants ou « Publish and Read » enquête a permis de recueillir le positionnement des établissements sur les différentes orientations et sur les Les accords transformants constituent un nouveau priorités de négociation. -
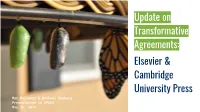
Update on Transformative Agreements: Elsevier & Cambridge
Update on Transformative Agreements: Elsevier & Cambridge University Press Mat Willmott & Rachael Samberg Presentation to SPCKG May 15, 2019 WHAT PAGE ARE WE ON? • For UC: Constrain rapidly escalating journal costs • For UC authors: Make it easier and more UC’s GOALS affordable to publish open access and retain copyright • For the advancement of knowledge: Accelerate new knowledge and discoveries available immediately upon publication • For the future: Advance a more open and sustainable scholarly publishing ecosystem UCOLASC PRINCIPLES SLASIAC, UCOLASC, CoUL CALL TO ACTION OA2020 Repurposing Funds CoUL Pathways to OA Toolkit PILOTING TRANSFORMATIVE AGREEMENTS What does this look like? ● Library financial transactions are handled in aggregate each quarter ● Components of the UC model Fixed at start of agreement Reading Fee Library subvention (on every article) Variable total based on author choices + Publishing Fees Grant-paid remainders (where grant available) _________________ Base set Library-paid remainders at start of agreement (where grant Total Contract Cost unavailable) Control by restricting variance to +/- X% ELSEVIER Negotiations: UC’s final proposal ● Cost-neutral with discounted APCs ($12M total UC payment) ● Default 100% OA ● Multi-payer: ○ Library $1000 + author research funding ○ OR Library pays all if author unfunded ○ OR author opts out of OA Negotiations:July 2018-Feb 2019 Today No contract since 31 Dec 2018 Negotiations ended 28 Feb 2019 Access not yet terminated Alternative access prepared Remember, UC owns permanent access to most existing Elsevier content: 86% of articles we currently license, representing 95% of UC’s use ● France (Couperin consortium): Subscription discount of 13.3 percent over the next four years, but not OA ● Norway: Reached OA terms w/$10M deal, Meanwhile.. -

Declaration on Open Science at Sciences Po
DECLARATION ON OPEN SCIENCE AT SCIENCES PO June 2021 The intention of the declaration on Open Science1 at Sciences Po is to describe the University’s vision, commitments and actions for making the results of research conducted at the University as widely accessible as possible. It harmonises with the recommendations and best practices for research ethics at Sciences Po as well as being in keeping with an ambitious public policy in this area. Vision The University supports research systems and tools that promote collaboration, knowledge dissemination and accessibility, and the re-use of research outputs based on the principle of ‘as open as possible, as closed as necessary’, within an appropriate legal and ethical framework. This principle takes into account confidentiality requirements related to data protection and privacy law, data security (fundamental state interests and sovereignty of research data), respect for academic freedom, and scientific integrity. Commitments Sciences Po joined the open access movement in 2008 with the creation of an open access institutional repository and is committed to providing and maintaining infrastructures that respect the FAIR2 principles for depositing publications and data. The second major focus of the University’s commitment is to train doctoral students and raise awareness among the academic community and support staff on integrating open research practices. Finally, by implementing Open Science governance, Sciences Po aims to ensure coherence between information provision, attention to needs, the coordination of stakeholders, discussion with the whole community, and support for research projects on a subject that is evolving rapidly at both the national and international levels. 1 Open Science refers here to the unrestricted dissemination of research publications and data. -

Sciences Po Grenoble
Évaluation des établissements RAPPORT D’ÉVALUATION DE L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020 VAGUE A Rapport publié le 06/05/2020 Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : Le Président du Hcéres Stéphane Mottet, Président du comité Par intérim, la Secrétaire générale Nelly Dupin En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). Sommaire Évaluation des établissements ......................................................................................................... 2 Présentation de l’établissement ...................................................................................................... 4 1/ Caractérisation du territoire d’implantation ................................................................................................................ 4 2/ Structuration de la coordination territoriale portée par la Comue UGA ............................................................... 4 3/ Caractérisation de l’Institut d’études politiques de Grenoble ................................................................................. 5 4/ Contexte de l’évaluation ................................................................................................................................................ 6 Le positionnement institutionnel -

Negotiations 2020 - Guidelines
Negotiations 2020 - Guidelines Hereunder some guidelines as defined by the Couperin.org professional board for the negotiation of documentation resources in 2020 (to be effective in 2021 and after). Nature of price agreements and requirements Changes in publication methods, alongside Europe and France’s willing adoption of Open Science, mean stronger demands are being placed on publishers regarding the content of cost agreements and conditions proposed to members of the Couperin.org consortium. Publishers’ proposals must conform to the requirements of Plan S, and be in line with the national plan for Open Science. Publishers are encouraged to think outside the box regarding their proposals for providing access to content on a subscription basis, and for safeguarding the transition towards Open Access. The consortium expects publishers to submit proposals which consistently include some element relating to Open Science. The proposals, which facilitate the development of Open Science, will be looked into for a fixed cost, that is, on the condition that no cost increase is incurred. In the absence thereof, regarding the renewal of pre-existing agreements, the proposals whose subject matter is limited to subscription access will only be approved on a cost- reduction basis: they must therefore include a clear reference to the percentage by which the cost will be reduced, at the end of the contract. Archives: access to the previously subscribed resources after unsubscribing In order to enable the institutions which chooses to end its subscription to a given documentation to retain access to documentation published during their period of subscription, suppliers must state the terms and conditions guaranteeing this access. -

CONTRAT DE SITE Université Paris-Saclay
CONTRAT DE SITE Université Paris-Saclay GRIGNON AGROPARISTECH AGROPARISTECH ENSAE INRA INRA TÉLÉCOM PARISTECH KREMLIN INSERM -BICÊTRE VERSAILLES UNIVERSITÉ PARIS-SUD FONTENAY -AUX-ROSES ENS CACHAN CEA SAINT-QUENTIN- VÉLIZY EN-YVELINES CHÂTENAY JOUY-EN-JOSAS -MALABRY UNIVERSITÉ INRA CENTRALESUPÉLEC VERSAILLES–ST–QUENTIN UNIVERSITÉ PARIS-SUD HEC PARIS SACLAY PALAISEAU MASSY Orly CEA ÉCOLE POLYTECHNIQUE ENSTA PARISTECH AGROPARISTECH GIF-SUR-YVETTE ONERA ; INRIA CENTRALESUPÉLEC INSTITUT D’OPTIQUE UNIVERSITÉ PARIS-SUD ORSAY CNRS ; IHÉS ; INRA ÉVRY ENSIIE TÉLÉCOM SUDPARIS UNIVERSITÉ D’ÉVRY VAL D’ESSONNE CONTRAT PLURIANNUEL 2015 - 2019 Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Communauté d’Universités et Établissements Université Paris-Saclay CONTRAT DE SITE UNIVERSITE PARIS-SACLAY 2015-2019 Entre, Le ministère de l'éducation nationale, de La Communauté d’universités et l'enseignement supérieur et de la recherche établissements Université Paris-Saclay Après délibération de son conseil d'administration du 24 juin 2015 d'une part, d'autre part, Il est établi le présent contrat pour les années 2015 à 2019. Ce contrat fera, avant son renouvellement, l'objet d'une évaluation de ses résultats au regard des objectifs poursuivis et des engagements pris. Fait à Paris, le 20 juillet 2015 Le président de la Communauté Le secrétaire d'État chargé de d’universités et établissements l'enseignement supérieur et de la recherche Université Paris-Saclay Thierry MANDON Gilles BLOCH Page 1 Page 2 Les établissements d’enseignement -
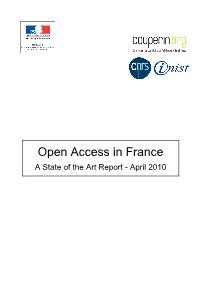
Open Access in France
Open Access in France A State of the Art Report - April 2010 Table of content Introduction ........................................................................................................... 3 Part 1. Institutional background .......................................................................... 4 Part 2. Historical background .............................................................................. 8 Part 3. Open Access journals in France ............................................................ 11 Part 4. Open Archives in France ........................................................................ 23 Part 5. Large digitisation programs ................................................................... 32 Conclusions ........................................................................................................ 34 Open Access in France: a state of the art report – April 2010 page 2 Introduction This report has been collaboratively produced by representatives of several bodies: the scientific and technical information and libraries network Unit of the Ministry of Higher Education and Research (Francis ANDRE, Rachel CREPPY) the academic consortium Couperin (Emilie BARTHET, Jean-François LUTZ, Mariette NAUD), the Institute for scientific and technical information INIST-CNRS (Anne-Marie BADOLATO, Jean-François NOMINE, Christine WEIL-MIKO). It is the wish of the SELL consortium (Southern European Libraries Link) to produce a state of the art of Open Access in the participating countries. It will serve as -

Historical Performance Practice of the Prélude
HISTORICAL PERFORMANCE PRACTICE OF THE PRÉLUDE NON MESURÉ AND ITS RELATIONSHIP TO RECORDING AND PERFORMANCE Ariana Jane Odermatt Australian National University A thesis submitted for the partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Philosophy, School of Music, The Australian National University. © Copyright by Ariana Jane Odermatt 2018 All Rights Reserved 1 Unless otherwise acknowledged in the text, this thesis represents the original research of the author SIGNED: ........................................... DATE: ............................................... 2 HISTORICAL PERFORMANCE PRACTICE OF THE PRÉLUDE NON MESURÉ AND ITS RELATIONSHIP TO RECORDING AND PERFORMANCE ABSTRACT ‘A Prelude is a free composition, in which the imagination gives rein to any fancy that may present itself’ (François Couperin: L'art de toucher Le Clavecin, 1716)1 The enigmatic prélude non mesuré was a short-lived genre characterised by rhythmically free croches blanches (‘flagged white notes’, rather than white quavers)2 and sweeping lines and slurs that were generally notated without specific reference to rhythm or metre. Some of the lines appear to bind the tones into harmonic groups and to articulate cadential and rhythmic units, but the inherent freedom encoded in the notation presents a broad, complex interpretive scope to present-day performers. Given composers' scant written and notational indications as to how they intended the works to be performed, this research seeks to address ways of interpreting the genre in an informed historical sense, whilst surveying current performing practices within Louis Couperin’s Prélude non mesuré in D minor to inform the author’s own performance. Extant préludes non mesurés are contained within two manuscript sources (Parville and Bauyn), while commentary addressing performance interpretation of the notation is limited to three source documents specifically referencing the prélude non mesuré: Nicolas Lebègue’s preface to his Pièces de clavessin (1677), correspondence between Lebègue and an Englishman called Mr. -

École Supérieure D'électricité Privée Supelec
École supérieure d’électricité privée Supelec Rapport Hcéres To cite this version: Rapport d’évaluation d’un établissement. École supérieure d’électricité privée Supelec. 2009. hceres- 02026491 HAL Id: hceres-02026491 https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02026491 Submitted on 20 Feb 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Section des établissements Rapport d'évaluation de Supélec septembre 2009 Rapport d'évaluation de Supélec Le Président de l’AERES Section des établissements Le Directeur Jean-François Dhainaut Michel Cormier septembre 2009 2 Sommaire Présentation 5 La stratégie en matière de recherche et de valorisation 7 I – L’existant et la stratégie 7 II – Une recherche qui reste encore largement à structurer 7 III – Une recherche influencée par l’aval 9 IV – Les doctorants 9 La stratégie en matière de formation 11 I – Le pilotage 12 II – Le recrutement 12 III – L’appui recherche de la formation 13 IV – La formation continue 13 V – Les partenariats avec les milieux économiques 13 VI – L’insertion professionnelle 14 VII