Les Abbayes Laïques
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
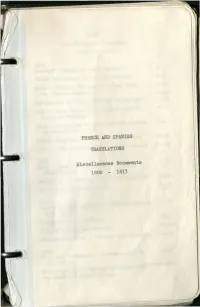
Mi S Cel L Aneous Documents 1800 - 1813 INDEX Miscellaneous Documents 1800 181~
FRENCH AND SPANISH TRANSLATIONS Mi s cel l aneous Documents 1800 - 1813 INDEX Miscellaneous Documents 1800 181~ 1800 Passport issued to Paul Cadroy l-~l Claim for relief by Joseph Brebiou 5-~ Suit - Roberto Cochran and John Rhea 5-16 vs. Reuben Kemper $...l.6.* Succession of Pedro Phelipe de Marigny 5-24 Suit - Juan Cottard vs . Succession of 9-19 Pedro de Marigny Suit - Guillermo Stephen vs . Succession 10-4 of Antonio Bonnabel Suit - Rosalia Picou vs . Juan Gravier Suit - Juan Gravier vs . Nicolas Gravier 1801 Suit - Juan RabIe vs . Succession of 2-9 Juan Faguier Ending of document , first part missing 5-29 Succession of Bard Genois 8-18 1802 Last will and testament - 1tts Balthazar 1-20 Marc (Mark) Statement -D. Bouligny 2-1 Will of Julien Le Sassier If-16 Contract between J . Gernon and J .F1eury 11-22 180~ Will and testament - Pierre Joseph M. 180~ de Favrot 5 loti Case of-RObeI to aucla au and Jutlli Rhea vs, rtel1 b e n Kemper and Co 11 2 1803, cont'd. Succession of Julien Le Sassier 2-8 .. .. .. .. .. 2-16 Passport of Bartholome Dubuisson ~ 2-22 Proclamation of Laussat 3-26 Report of Captain of boat La Felicite 3-27 Remittance ~ Delahite 5-6 Bill for food , medicine and pro 5-10 fessional services, signed Lablancherie Letter of Roustan in reference to law 5-16 suit pending between Farnnel, Meri cul t and himself Suit - Felix Arnaud ve , Pierre P. 5-31 Bonnefoy Statement of foods bought for vessel 6-6 La Felicite Itemized statement of disbursements 6-6 made for La Felicite Report of Captain Plavian of Le Chery 6-7 Certification of damage to linen con 6-8 signed to Commagere Succession of Julien Le Sassier 6-11 Certificate by Dr Fortin of Charity 7-27 Hospital relative to Angelique Letter - Laussat to Favrot 8-6 Duplicate letter - Laussat to Favrot 8-6 Power of attorney from Magdeleine 8-21 Leblanc to Jean B. -
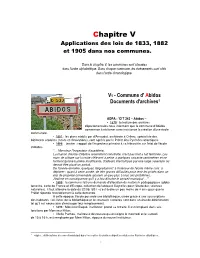
Chapitre V Applications Des Lois De 1833, 1882 Et 1905 Dans Nos Com M Unes
Chapitre V Applications des lois de 1833, 1882 et 1905 dans nos com m unes. Dans le chapitre V, les communes sont classées dans l'ordre alphab étiq ue. Dans chaq ue commune, les év è nements sont cités dans l'ordre chronolog iq ue. V1 - Co m m u n e d ' Ab id o s D o c u m e n ts d 'a rc h iv e s 1 AD P A : 12 T 2 43 – Ab id o s – 1879 : la lecture des archives départementales nous informent que la commune d'Abidos commence à réclamer avec insistance la création d'une école communale. 1881 : les plans établis par d'Arnaudat, architecte à Orthez, spécialiste des bâtiments scolaires (neufs et rénovations), sont agréés par le Préfet des Pyrénées atlantiques. 1886 – janvier : rapport de l'inspecteur primaire à sa hiérarchie sur l'état de l'école d'Abidos. "… Monsieur l'Inspecteur d'académie, La maison d'école d'Abidos récemment construite, n'est pas tout à fait terminée. Les murs de clôture sur la route s'élèvent à peine à quelques soixante centimètres et ne forment qu'une barrière insuffisante, d'ailleurs interrompue par une large ouverture où devrait être placé un portail. De l'année dernière, quelques 'dégradations' à l'intérieur de l'école même sont à déplorer : quant à cette année, de très graves difficultés pour tenir les privés dans un état de propreté convenable ajoutent un peu plus à tous ces problèmes. J'estime en conséquence qu'il y a lieu d'inviter le conseil municipal …" 1888 : la commune fait une demande d'allocation de matériels pédagogiques (globe terrestre, carte de France et d'Europe, collection de tableaux Deyrolles pour l'étude des sciences naturelles). -

Archives Du Centre D'étude Du Protestantisme Béarnais
1 ARCHIVES DU CENTRE D'ÉTUDE DU PROTESTANTISME BÉARNAIS déposées aux Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques. Sous-série 60 J 2 RÉPERTOIRE des ARCHIVES DU CENTRE D'ÉTUDE DU PROTESTANTISME BÉARNAIS déposées aux Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques. Sous-série 60 J Tome 1 60J 1 - 60J 329 Préface Jacques STAES Directeur des Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques Réalisé par Anne-Catherine MARIN, Isabelle PÉBAY, Suzanne TUCOO-CHALA, Philippe CHAREYRE et Christian SANDOVAL CENTRE D ’É TUDE DU PROTESTANTISME BÉARNAIS 2006 3 © C ENTRE D 'É TUDE DU PROTESTANTISME BÉARNAIS Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques Boulevard Tourasse, 64000 Pau 2007 ISBN : 2-9511441-3-X 4 PRÉSENTATION Le présent Répertoire couvre l'ensemble de la sous-série 60 J des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, consacrée au Centre d’Étude du protestantisme béarnais. Dans cette sous-série, sont regroupés tous les fonds déposés ou donnés au C.E.P.B., chaque fonds faisant l'objet d'une sous-sous-série au fur et à mesure des entrées : le premier fonds entré a reçu la cote 60 J 1, le second la cote 60 J 2, le troisième la cote 60 J 3, etc. Chaque fonds est ensuite classé et les différents articles qui le constituent sont numérotés de 1 à x, ce numéro devenant le 4 e élément de la cote, séparé des trois éléments précédents par un trait oblique (/). A titre d'exemple, la cote 60 J 113/8 désigne le 8 e article du fonds 60 J 133, qui est celui de l'architecte Jean-Roger Francq. 1 Près de 300 fonds constituent, à la date de publication de ce Répertoire , la sous-série 60 J, mais il faut signaler que leur importance matérielle est très variable : certains sont seulement composés de quelques articles (voire d'un seul), alors que d'autres en comptent plus de cent. -

Ion Batteries: Stoichiometric KVPO4F Haegyeom Kim, Dong-Hwa Seo, Matteo Bianchini, Raphaële J
FULL PAPER Potassium-Ion Batteries www.advenergymat.de A New Strategy for High-Voltage Cathodes for K-Ion Batteries: Stoichiometric KVPO4F Haegyeom Kim, Dong-Hwa Seo, Matteo Bianchini, Raphaële J. Clément, Hyunchul Kim, Jae Chul Kim, Yaosen Tian, Tan Shi, Won-Sub Yoon, and Gerbrand Ceder* tems. However, the question of whether The exploration of high-energy-density cathode materials is vital to the Li reserves[1] or the metal required for [2] practical use of K-ion batteries. Layered K-metal oxides have too high a the cathode compounds can meet voltage slope due to their large K+–K+ interaction, resulting in low specific the demand for large-scale applications + remains under debate. In response, Na-ion capacity and average voltage. In contrast, the 3D arrangement of K , with batteries (NIBs) and K-ion batteries (KIBs) + + polyanions separating them, reduces the strength of the effective K -K have been studied as alternative energy repulsion, which in turn increases specific capacity and voltage. Here, stoichi- storage technologies systems because of [3–7] ometric KVPO4F for use as a high-energy-density K-ion cathode is developed. the global abundance of Na and K. −1 When compared to NIBs, KIBs are par- The KVPO4F cathode delivers a reversible capacity of ≈105 mAh g with an ticularly interesting because (i) K/K+ has average voltage of ≈4.3 V (vs K/K+), resulting in a gravimetric energy density a lower standard redox potential than Na/ −1 of ≈450 Wh kg . During electrochemical cycling, the KxVPO4F cathode goes Na+, which can be translated into a higher through various intermediate phases at x = 0.75, 0.625, and 0.5 upon K working voltage,[5] and (ii) graphite can extraction and reinsertion, as determined by ex situ X-ray diffraction charac- intercalate K ions, forming a stable KC8 terization and ab initio calculations. -

Signataires PETITION Sécurisation RN 134 Et Voie Rapide Oloron
Signataires PETITION Sécurisation RN 134 et Voie rapide Oloron-Lescar 2018-2019 NOMS FONCTIONS Frédérique ESPAGNAC Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques Denise SAINT PE Sénatrice des P-A, Conseillère Régionale Max BRISSON Sénateur des Pyrénées-Atlantiques David HABIB Député des Pyrénées-Atlantiques Jean-Paul MATTEI Député Pyrénées-Atlantiques Jean LASSALLE Député des Pyrénées-Atlantiques Florence LASSERRE-DAVID Députée des Pyrénées-Atlantiques Josy POUEYTO Députée des Pyrénées-Atlantiques Vice-Président Conseil Régional. Conseiller Municipal et Bernard UTHURRY Communautaire d'Oloron Jean-Paul CASAUBON Président de la Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau Jacques CASSIAU-HAURIE Président Communauté de Communes Lacq-Orthez Jean-Pierre MIMIAGUE Président de la Communauté de Communes des Luys en Béarn Daniel LACRAMPE Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn Marc OXIBAR Conseiller Régional de la Nouvelle Aquitaine François HUN Représentant UIS CFDT Béarn Thierry DIETRICH Représentant UD64 CFE-CGC Josette CAZAUBON LATERCE Psdte Asso Habitants de Cette-Eygun RN 134 Jean-Pierre MAISONNAVE Pdt Asso Riverains Rue Jéliote Route de Pau Gabarn/RN134-E7 Jacques LEVEQUE Pdt ARDA Thierry de VERBIZIER Psdt Asso Berlanne Entreprises Didier LAPORTE Psdt Chambre de Commerce et d'Industrie Pau Béarn Pierre NERGUARARIAN Psdt GIP CHEMPARC LACQ Mohamed AMARA Psdt UPPA Psdt honoraire CCI Pau Béarn, MEDEF Béarn et Soule, MEDEF Patrick de STAMPA Aquitaine Bernard LAYRE Président de la Chambre d'Agriculture 64 Romain CEYRAC Directeur des Services . Chambre de Métiers et de l'Artisanat 64 Charles PELANNE Vice-Président Conseil Départemental Marie Lyse GASTON Cons.Dép. Oloron 1 Jean-Claude COSTE Cons. Dép. Oloron 1 Anne BARBET Cons.dép. -

Eradication of Measurable Residual Disease in AML: a Challenging Clinical Goal
cancers Review Eradication of Measurable Residual Disease in AML: A Challenging Clinical Goal Paolo Bernasconi 1,2,* and Oscar Borsani 1 1 Department of Molecular Medicine, University of Pavia, 27100 Pavia, Italy; [email protected] 2 Hematology Department, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 27100 Pavia, Italy * Correspondence: [email protected] Simple Summary: Relapse is still a major problem in AML because it occurs in about 60–80% of patients, even those who have previously achieved complete remission (CR), defined by the presence of ≤5% bone marrow (BM) leukemic cells. Thus, since CR is unable to predict the relapse risk, significantly more sensitive techniques aimed at identifying AML cells in BM or peripheral blood, a parameter termed measurable residual disease (MRD), have been developed. Among them, RT-qPCR, which analyses appropriate molecular markers, and multiparameter flow cytometry (MFC), which analyses aberrantly expressed antigens, have been identified as the methods of choice for MRD detec- tion. Nowadays, various studies that assessed MRD by these techniques have provided compelling evidence that MRD positivity (MRD+) after standard induction/consolidation chemotherapy and before allo-HSCT is predictive of a very poor clinical outcome. In addition, other studies, which showed that MRD+ clearance even at late time points of the course of the disease may improve the disease clinical outcome, have further strengthened the relevance of MRD+. Thus, a complete MRD eradication, potentially attainable -

January 26, 2021; 5:00 P.M
Campus Recreation Advisory Council Meeting Meetings Zoom Meeting ID: 941 6772 6322 Tuesday, January 26, 2021; 5:00 p.m. I. Secretary Brooklyn Fiddelke called role: Present: Aline Abayo, Ben Aniello, Jack Aniello, Monica Babcock, Bella Breck, Kelcey Buck, Nolan Casey, Japhet Dushimeyesu, Brooklyn Fiddelke, Ethan Forcade, Aime Leandre, Taylor Schendt, Jenn Sheppard, Eli Soell, and Amy Lanham (Advisor), and Stan Campbell (Director, joined the meeting late) Absent: Ellis Johnson, Andromede (Andy) Uwase (excused) II. Meeting was called to order at 5:09 p.m. by president Taylor Schendt III. Review and Approval of December 1, 2020 Meeting Minutes Japhet Dushimeyesu made and Ethan Forcade seconded a motion to approve the minutes from the December 1, 2020 meeting. IV. Open Forum and Announcements: A. Outdoor recreation field/opening access policy (Ben Hohensee) Ben Hohensee was unable to attend tonight’s meeting; however, in a previous conversation he mentioned the possibility of opening Campus Recreation outdoor venues (weather permitting) throughout the winter. The council had a short conversation about considering a temperature requirement and maybe having specific workers who are willing to be called in to observe the outdoor fields during those times. We decided to continue this conversation at the next meeting if Mr. Hohensee was able to attend. B. Winter Interim Offerings review During the two 3-week interim sessions, online participation was higher in December and in person/reservations were used more in January. Both sessions had similar overall participation levels. Meal prep Monday’s involvement has been growing exponentially. We are increasing to two sessions per month. -

Mariages Orthez 1685-1715
ORTHEZ MARIAGES 1685-1715 CEPB relevés par Magalie Baylion MARI FEMME TEMOINS DATE Nom Prénom Origine Profession Nom Prénom Origine Nom Prénom Origine 1 11/02/1685 FOURCADE BERNARD BOURDERE EN COMMENGE habite à Sallies LACOSTE MARIE PAU habite à Orthez DUFFAU JEAN RIBEAUX JEAN MASSOUE DAVID AUTRES TEMOINS 2 28/02/1685 CASENAVE PIERRE CONSEILLER DU ROI EN LACAPDEVILLE CHAMBRE DES COMPTES ANNE DE NAVAORTHEZ?(RRE de la présenteCAPDEVILLE ville) CAPDEVILLE DIT MILLADE AUTRES TEMOINS 3 10/05/1685 PEYREGNE BENOIT VALENTINE DIOCESE DE COMMENGE DAUBAGNA CATHERINE ORTHEZ?(de la présenteDAUBAGNA ville) PIERRE CASTETARBE LAROCHE POPILLEAUJEAN DIT PARISIEN ORTHEZ AUTRES TEMOINS 4 04/06/1685 St PAU ETIENNE ORTHEZ ROUYER SUSANNE ORTHEZ DUFFAU JEAN DUFFAU JEAN PIERRE MAUPOY D'HERETERJUDITH AUTRES TEMOINS 5 27/08/1685 DARGELER BERNARD DEPART LASBASSES CATHERINE ORTHEZ FORSANS ETIENNE SALLES MERICAM JEAN DUTILH JEAN ORTHEZ AUTRES TEMOINS 6 27/08/1685 ESTIENNE JEAN SALLES RONTIGNON MARIE ORTHEZ FORSANS JEAN SALLES LAROCHE POPILLEAUJEAN DIT PARISIEN ORTHEZ AUTRES TEMOINS 7 20/10/1685 BONNECASE ESTIENNE CONSEILLER DU ROI AU PARLEMENTDARRIGRAND DE NAVARRECASTERAMARIE ORTHEZ BONNECASE LICHIGARAY LAROCHE POPILLEAUJEAN DIT PARISIEN AUTRES TEMOINS 8 05/11/1685 LAHARGOU ISAAC ORTHEZ SAUTIER DITE DE JEANNECATALOGNE DEPART LAHARGOU PIERRE MANES PIERRE ORTHEZ AUTRES TEMOINS 9 08/11/1685 LALANNE DIT NABAILLESDAVID ORTHEZ CASTAGNA JEANNE SOARNS DUFFAU LAPOUSTERLE ABRAHAM PERSILLAN Femme du Sr Casalis 1 MARI FEMME TEMOINS DATE Nom Prénom Origine Profession Nom Prénom -
![[Flags of Europe]](https://docslib.b-cdn.net/cover/1836/flags-of-europe-1771836.webp)
[Flags of Europe]
Flags of Europe Item Type Book Authors McGiverin, Rolland Publisher Indiana State University Download date 06/10/2021 08:52:56 Link to Item http://hdl.handle.net/10484/12199 Flag Flags of Europe: A Bibliography Rolland McGiverin Indiana State University 2016 i Contents Country 14 Flags of Europe: Andorra 15 European Union 1 Country 15 NATO 1 Andorra la Vella 15 European Contenant 1 Parish 15 Armed forces 6 Armenia 15 Merchant marine 9 Country 15 Navy 10 Asti 17 Abkhazia 11 Country 17 Partially Recognized State 11 Austria 17 Adjara 12 Country 17 Autonomous Republic in Georgia 12 Nagorno-Karabakh 19 Region 19 Aland 12 Autonomous part of Finland 12 Austro-Hungarian Empire 19 Political 12 Country 19 Ethnic 19 Albania 13 Navy 19 Country 13 Belarus 20 Alderney 13 Country 20 British Crown dependency 13 Air Force 21 Amalfi Republic 13 Armed forces 21 Country 13 Ethnic 21 Armed forces 14 Government 22 Ethnic 14 Azerbaijan 22 Political 14 Country 22 Tirana 14 Ethnic 22 County 14 Political 23 Cities and towns 14 Talysh-Mughan 23 Region 23 Anconine Republic 14 Grodno 23 ii Region 23 Cospaia, Republic 33 Barysaw 24 Country 33 Gomel 24 Krasnasielski 24 Croatia 33 Smarhon 24 Country 33 Hrodna 24 Region 24 Ethnic 33 Dzyatlava 24 Karelichy 24 Cyprus 34 Minsk 25 Country 34 Region 25 North Cyprus 34 Minsk 25 Nicosia 34 Mogilev 25 Czech Republic 34 Belgium 25 Country 34 Country 25 Cities and Towns 35 Armed forces 26 Prague 35 Ethnic 27 Czechoslovakia 35 Labor 27 Country 35 Navy 28 Armed forces 37 Political 28 Cities and Towns 37 Religion 29 Ethnic 38 Provinces -

Secours Aux Colons De Saint-Domingue. Indemnisation Des Colons Spoliés
Secours aux colons de Saint-Domingue. Indemnisation des colons spoliés Inventaire analytique (F/12/2740-F/12/2790, F/12/7627-F/12/7632/1) Par Ch. Douyère-Demeulenaere Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2002 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000199 Cet instrument de recherche a été encodé en 2012 par l'entreprise Numen dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) Sommaire Secours aux colons de Saint-Domingue. Indemnisation des colons spoliés. 422 A 427 ABBADIE, voir : DABBADIE. 427 ABBAYE (de L'), voir : L'ABBAYE (de). 427 ABBAYE-QUENIOT (de L'), voir : L'ABBAYE-QUENIOT (de). 427 ABEILLE (François Louis Honoré Barthélémy) colon réfugié de Saint-Domingue. 427 ABEILLE (Honoré Jean Adolphe) né à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). ayant droit 427 de colon de Saint-Domingue. (dossier ABEILLE Jean Antoine) ABEILLE (Jean Antoine) né vers 1770, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ; décédé 427 le 27 août 1826, à Lausanne (Suisse). colon réfugié de Saint-Domingue. ABEILLE (Jean Joseph André) né le 23 août 1756, à La Ciotat (Bouches-du- 427 Rhône). colon réfugié de Saint-Domingue. ABEL (Jean Baptiste) né le 13 mars 1762, au Cap-Français (Saint-Domingue) ; 427 décédé le 15 février 1834, à Paris. colon réfugié de Saint-Domingue. ABNOUR, voir : RICHARD d'ABNOUR. 427 ABZAC (Mme d') ayant droit de colon de Saint-Domingue. -

Cultes. Culte Catholique : Dossiers Individuels Des Coadjuteurs, Évêques in Partibus Et Auxilières, Aumôniers, Prêtres Étrangers Et Clergé Colonial (Xixe-Xxe Siècles)
Cultes. Culte catholique : dossiers individuels des coadjuteurs, évêques in partibus et auxilières, aumôniers, prêtres étrangers et clergé colonial (XIXe-XXe siècles) Inventaire index des cotes F/19/2475-F/19/2478,F/19/2597- F/19/2608,F/19/3090-F/19/3092,F/19/3112-F/19/3113,F/19/3123- J. Charon-Bordas Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1969, 1983 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_003968 Cet instrument de recherche a été encodé par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Mentions de révision : • 2020: Réencodage et indexation (Maïwenn Bourdic) 3 Archives nationales (France) Sommaire Cultes. Culte catholique : dossiers individuels des coadjuteurs, évêques in partibus 5 et auxilières, aumôniers, prêtres étrangers et clergé colonial ... Coadjuteurs 7 Coadjuteurs, évêques in partibus et évêques auxiliaires 9 Evêques in partibus et évêques auxiliaires 9 Cardinaux, archevêques et évêques : bulles et brefs 20 Aumôniers civils 21 Supérieurs des petits séminaires (Monarchie de Juillet) 29 Prêtres étrangers ou d'origine étrangères (circulaire du 30 juillet 1887) 45 Prêtres ayant renoncé à l'état ecclésiastique et prêtres politiciens 154 Dossiers personnels des chanoines de Saint-Denis et des candidats à un canonicat 161 dans ce chapitre Affaires du culte dans les colonies 221 4 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence F/19/2475-F/19/2478,F/19/2597-F/19/2608,F/19/3090-F/19/3092,F/19/3112-F/19/3113,F/19/3123- F/19/3128,F/19/6068-F/19/6069,F/19/6176-F/19/6188,F/19/6200-F/19/6209 Niveau de description fonds Intitulé Cultes. -

Bastida Seu Populatio”
”Bastida seu populatio”. Notes sur les bastides fondées par l’abbaye de l’Escaladieu (1274-1328). Stéphane Abadie To cite this version: Stéphane Abadie. ”Bastida seu populatio”. Notes sur les bastides fondées par l’abbaye de l’Escaladieu (1274-1328).. L’abbaye de l’Escaladieu, 2018, 2018, L’abbaye de l’Escaladieu. Des jalons pour l’Histoire. Association Guillaume Mauran. halshs-02056703 HAL Id: halshs-02056703 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02056703 Submitted on 4 Mar 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Copyright Les bastides fondées par l’Escaladieu Doc. 1. La partie urbaine de la bastide de Masseube sur le plan cadastral napoléonien (1829). AD Gers, 3P_MASSEUBE_16. Archive en ligne. On distingue bien l’emplacement des fossés défensifs et le plan régulier de la structure urbaine. 28 Stéphane Abadie Introduction Les bastides fondées par l'abbaye de l'Escaladieu relèvent d'une historiographie ancienne : dès les années 1950, Charles Higounet a proposé une cartographie des bastides médiévales, notant l'importance du rôle des abbayes cisterciennes et prémontrées dans le phénomène de transformation des espaces ruraux du Sud-Ouest aux XIIIe et XIVe siècles1.