Les Stratégies De Communication De L'institut De Magnus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

INFORMATION to USERS the Most Advanced Technology Has Been Used to Photo Graph and Reproduce This Manuscript from the Microfilm Master
INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photo graph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the original text directly from the copy submitted. Thus, some dissertation copies are in typewriter face, while others may be from a computer printer. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyrighted material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are re produced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each oversize page is available as one exposure on a standard 35 mm slide or as a 17" x 23" black and white photographic print for an additional charge. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. 35 mm slides or 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. AccessingiiUM-I the World's Information since 1938 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA Order Number 8812304 Comrades, friends and companions: Utopian projections and social action in German literature for young people, 1926-1934 Springman, Luke, Ph.D. The Ohio State University, 1988 Copyright ©1988 by Springman, Luke. All rights reserved. UMI 300 N. Zeeb Rd. Ann Arbor, MI 48106 COMRADES, FRIENDS AND COMPANIONS: UTOPIAN PROJECTIONS AND SOCIAL ACTION IN GERMAN LITERATURE FOR YOUNG PEOPLE 1926-1934 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By Luke Springman, B.A., M.A. -

Leonard Nelson — Bibliographie Der Sekundärliteratur
LEONARD NELSON — BIBLIOGRAPHIE DER SEKUNDÄRLITERATUR Jörg Schroth Aktualisierte Version der in Diskurstheorie und Sokratisches Gespräch, hrsg. von Dieter Krohn, Barbara Neißer und Nora Walter, Frankfurt am Main 1996, S. 183–248 veröffentlichten Bibliographie Stand: 20.02.05 Die Richtigkeit der bibliographischen Angaben der mit einem Asteriskus versehenen Titel ist nicht überprüft worden. Mit dieser Bibliographie wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Für Literaturhinweise danke ich Jos Kessels, Tadeusz Kononowicz, Rainer Loska, Gisela Raupach-Strey und Nora Walter. Besonderen Dank schulde ich Peter Schroth für die Be- schaffung von Literatur aus den USA. I. Aufsatzbände II. Biographie, Geschichte der politischen und pädagogischen Tätigkeit und Wirkung, Vorworte, Einleitungen, Lexikonartikel, Allgemeindarstellungen III. Theoretische Philosophie IV. Praktische Philosophie V. Sokratisches Gespräch VI. Rezensionen zu Nelson VII. Rezensionen zur Sekundärliteratur VIII. Erwähnungen 1 I. AUFSATZBÄNDE 1983 [1] Horster, Detlef/Krohn, Dieter (Hrsg.) (1983): Vernunft, Ethik, Politik. Gustav Heckmann zum 85. Geburtstag, Hannover (358 S.) 1994 [2] Kleinknecht, Reinhard/Neißer, Barbara (Hrsg.) (1994): Leonard Nelson in der Diskussion, Frankfurt a. M. (184 S.) (= „Sokratisches Philosophieren“ – Schriftenreihe der Philosophisch-Politischen Akademie, hrsg. von Silvia Knappe, Dieter Krohn, Nora Walter, Band 1). Rezensionen: [744], [767] 1996 [3] Knappe, Silvia/Krohn, Dieter/Walter, Nora (Hrsg.) (1996): Vernunftbegriff und Menschenbild bei Leonard Nelson, Frankfurt a. M. (151 S.) (= „Sokra- tisches Philosophieren“ – Schriftenreihe der Philosophisch-Politischen Akademie Band 2) 1974 [4] Knigge, Friedrich (Hrsg.) (1974): Beiträge zur Friedensforschung im Werk Leo- nard Nelsons. Vier von der Philosophisch-Politischen Akademie Kassel preisgekrönte Arbeiten, Hamburg (VI + 194 S.) (= Beiheift 1 zur Zeit- schrift Ratio) Rezension: [755] 1989 [5] Krohn, Dieter/Horster, Detlef/Heinen-Tenrich, Jürgen (Hrsg.) (1989): Das Sokra- tische Gespräch – Ein Symposion, Hamburg (171 S.). -

The Influence of German National Socialism and Italian Fascism on the Nasjonal Samling, 1933–1936
fascism 8 (2019) 36-60 brill.com/fasc Norwegian Fascism in a Transnational Perspective: The Influence of German National Socialism and Italian Fascism on the Nasjonal Samling, 1933–1936 Martin Kristoffer Hamre Humboldt University of Berlin and King’s College London [email protected] Abstract Following the transnational turn within fascist studies, this paper examines the role German National Socialism and Italian Fascism played in the transformation of the Norwegian fascist party Nasjonal Samling in the years 1933–1936. It takes the rivalry of the two role models as the initial point and focusses on the reception of Italy and Germany in the party press of the Nasjonal Samling. The main topics of research are therefore the role of corporatism, the involvement in the organization caur and the increasing importance of anti-Semitism. One main argument is that both indirect and direct German influence on the Nasjonal Samling in autumn 1935 led to a radi- calization of the party and the endorsement of anti-Semitic attitudes. However, the Nasjonal Samling under leader Vidkun Quisling never prioritized Italo-German rivalry as such. Instead, it perceived itself as an independent national movement in the com- mon battle of a European-wide phenomenon against its arch-enemies: liberalism and communism. Keywords Norway – Germany – Italy – Fascism – National Socialism – transnational fascism – Nasjonal Samling – Vidkun Quisling © Martin Kristoffer Hamre, 2019 | doi:10.1163/22116257-00801003 This is an open access article distributed under the terms of the prevailing cc-by-nc license at the time of publication. Downloaded from Brill.com09/28/2021 09:35:40AM via free access <UN> Norwegian Fascism in a Transnational Perspective 37 In October 19331 – five months after the foundation of the party Nasjonal Sam- ling [NS; National Unity]2 – Norwegian merchant Johan Wilhelm Klüver sent a letter from Tientsin in China addressed to the NS headquarters in Oslo. -

Kaakinen Dissertation Final
MINDING THE GAP: READING HISTORY WITH JOSEPH CONRAD, PETER WEISS, AND W. G. SEBALD A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Kaisa Riitta Kaakinen August 2013 © 2013 Kaisa Riitta Kaakinen MINDING THE GAP: READING HISTORY WITH JOSEPH CONRAD, PETER WEISS, AND W. G. SEBALD Kaisa Riitta Kaakinen, Ph. D. Cornell University 2013 At the beginning of the twenty-first century the discipline of comparative literature faces the challenge of responding to expanding transnational readerships. Increasingly heterogeneous reading contexts not only highlight the need to extend comparative analysis to include formerly marginalized texts; they also challenge traditional analytical categories informing comparative literature as a discipline. This dissertation proposes that the notion of the implied reader, central to reader-response criticism based on hermeneutic conventions, has to be rethought in order to account for readers who cannot engage with a given text in an unimpeded relationship of dialogue; this is especially the case when literary texts revolve around histories of violence. Through an analysis of literary works by three European emigré writers, Joseph Conrad (1857-1924), Peter Weiss (1916-1982), and W. G. Sebald (1944-2001), this study highlights postimperial, postgenocidal and post-Cold War reading positions that challenge the traditional hermeneutic sense of a textual horizon of understanding. The study further argues that comparative analysis of situated reading needs to go beyond constructivist notions of reading, which make it difficult to grasp relationships between literature and history. This analysis proposes instead that historical pressures in the twentieth century require comparative literature to address not only implied but also various unimplied and unwelcome reading positions that engage twentieth-century history in displaced yet material ways that manifest in literary form. -

How to Find Treasure Troves ALMS Conference, Amsterdam, August 1-3, 2012
Thirty Years of Collecting Our History – Or: How to Find Treasure Troves ALMS Conference, Amsterdam, August 1-3, 2012 Ralf Dose, Magnus Hirschfeld Society, Berlin When founded in 1982/83, the Magnus Hirschfeld Society’s aim was to preserve the heritage of the sexual scientist Magnus Hirschfeld (1868-1935) for posterity, and to do research on his work. At that time, this was connected with the aim of the GL(BT) movement, which was to claim a history of its own. When looking more closely into the matter of the work and achievements of Dr. Hirschfeld, we soon noticed that the focus on GL(BT) history was far too narrow to capture the importance of Hirschfeld both for sexual science and for cultural history. 1 My paper explores some of the steps we took in finding the material remnants of Hirschfeld’s cultural heritage over some thirty years of research and collecting. It should be read together with the corresponding paper by Don McLeod on “Serendipity and the Papers of Magnus Hirschfeld: The Case of Ernst Maass,” where he gives a lot of detail about one of our joint searches. And, please, keep in mind that my English is not as good as my German. Thus, the German version of this paper sometimes is more specific than this one. 2 Preface When we started to look for Hirschfeld’s heritage, it was a common belief that hardly anything of Hirschfeld’s personal belongings or items from his Institute for Sexual Science would have survived. Manfred Herzer compiled a preliminary short list of single Hirschfeld letters which survived in various archives, libraries, and private collections. -

Willi Münzenberg's 'Last Empire': Die Zukunft And
Bernhard H. Bayerlein Willi Münzenberg’s ‘Last Empire’: Die Zukunft and the ‘Franco-German Union’, Paris, 1938 – 1940. New Visions of Anti-Fascism and the Transnational Networks of the Anti-Hitler Resistance1 Abstract The weekly Die Zukunft is among the most ambitious Franco-German media projects and collective organisers with European repercussions during the final crisis of the inter-war period from the Munich Agreement in September 1938 until May 1940 and the German occupation of France during the Second World War. The reading of the political-cultural journal as a unique, last ‘anti-fascist intermediate empire’ before the outbreak of the war and the efforts made by its editor, Willi Münzenberg, to unite the transnational anti-Hitler oppositionist networks contributes to an innovative perspective on the history of the German-speaking political emigration and German-French relations. New insights require major adjustments in the history of European strategies and the anti-Stalinist shift expressed by Die Zukunft after the conclusion of the Stalin-Hitler Pact contributes to a deeper understanding of the crisis of the political exile and the first stages of World War 1 This article is grounded in research conducted at the Institute for Social Movements Bochum, with support for two years from the Fritz-Thyssen-Stiftung. Within the scope of this project, which aims at a monograph about the Zukunft, different areas of research will be linked trans- disciplinarily, including historical media research and exile and resistance research, research on transnational political network building, on social movements, political ideas and cultural transfer. For more details refer to the presentation on the institute’s website at http://isb.rub. -

Chapter 4 'Now, Back to Our Virchow': German Medical and Political
21-4-2020 ‘Now, back to our Virchow’: German Medical and Political Traditions in Post-war Berlin - The Perils of Peace - NCBI Bookshelf NCBI Bookshelf. A service of the National Library of Medicine, National Institutes of Health. Reinisch J. The Perils of Peace: The Public Health Crisis in Occupied Germany. Oxford (UK): OUP Oxford; 2013 Jun 6. Chapter 4 ‘Now, back to our Virchow’:1 German Medical and Political Traditions in Post-war Berlin In these current dark times there are still some rays of light for the German people—in spite of all errors and crimes which have been perpetrated in their name—they are the rays of hope which arise from the unquenchable spring of their intellectual and spiritual past.2 As they arrived in Germany, the Allies were forced to rely on the cooperation of the German medical authorities. While Chapter 3 looked at German émigrés, this chapter focuses on those German doctors and health officers who never left the country, the large majority in the profession. How did they reflect on the events of the previous decade? How did they present their careers and relate to their émigré compatriots, some of whom were now returning to Germany, and the occupiers? This chapter focuses on Berlin, which became both the seat of the quadripartite Allied Control Council (ACC) and the capital of the Soviet zone. Most historians have now abandoned the once-popular idea of a ‘Zero Hour’ (Stunde Null) and a radical transformation of German society after the end of the war. This chapter, too, shows that the break after 1945 was not nearly as radical as many earlier studies claimed. -

Publication PDF3 MB
28.9.–8.10.2016 The Aes- thetics of Res - istance Peter Weiss 100 When Peter Weiss wrote “The Aesthetics of Resistance”, he was looking back into the 1930s/’40s, at a Berlin of the antifascist underground, at the Spanish Civil War, and at a decade of Euro - pean exile. It was a consideration of the 20th century – a novel combining art theory and worldview against the backdrop of the historical conflict between fascism and communism. Weiss por - trays an emancipation process that is also highly central for ques - tions of offering resistance today: the possibility of political par - ticipation by individuals. In addition there will be a theory forum, a reading of the novel "The Aesthetics of Resistance", a film programme in cooperation with the Arsenal – Institute for Film and Video Art and an exhibi - tion by Altındere at the n.b.k. Funded by the German Federal Cultural Foundation. Media partner: RBB Kulturradio. Contents “When is it right to stop fighting?” Guillermo Calderón 4 “It is easier for gasoline to cross the EU border than it is for refugees!” Doris Akrap in an interview with Oliver Frlji 6 “How to Change Ourselves Every Day”ć Aenne Quiñones in an interview with Nicoleta Esinencu 11 “Double Consciousness / Double Shooting” Rabih Mroué 14 “We would be out on the streets, at the place where a storm is more than thunderous applause” Marco Layera 18 “(To be) Continued Reflections on the Aesthetics of Resistance” Hans-Thies Lehmann 20 “What Does Resistance Mean Today?” Bini Adamczak 26 Bibliography 33 Festival programme 34 Tickets 35 Imprint 36 Additional text material in the German version of this newspaper at HAU or online! 3 “When is it right to stop considered heroes; the faces of those who wage a war of self-defense and aggression In the course of many years of committed mil - died fighting the dominance of military rule against fascism. -

Von Hodann Zu Amendt: Vorstellungen Von Sexueller „Liberalisierung“, Kindlicher Sexualität Und Geschlechterverhältnissen in Der Sexualerziehung Um 1900 Und Um 1968
Von Hodann zu Amendt: Vorstellungen von sexueller „Liberalisierung“, kindlicher Sexualität und Geschlechterverhältnissen in der Sexualerziehung um 1900 und um 1968 Dieser Beitrag untersucht Kontinuitäten und Brüche in den Vorstellungen von Geschlechterverhältnissen und kindlicher Sexualität sowie in den gesellschaftlichen Haltungen zu Sexualmoral und Sexualverhalten von Jugendlichen am Beispiel der Diskurse üBer Sexualität und Sexualaufklärung von Jugendlichen um 1900 und um 1968. Dabei geht es mir insBesondere darum, den Begriff der „sexuellen LiBeralisierung“ einer Kritik zu unterziehen, die zeigen soll, dass er, wenn üBerhaupt, nur einen äußerst Begrenzten Erklärungswert Besitzt und mehr verschleiert als zur Analyse Beiträgt. Ich werde mich zunächst mit dem im Verständnis der Zeitgenossen „progressiven“ Aufklärungsdiskurs um 1900 (hier verstanden im weiteren Sinne als die Periode von der Jahrhundertwende Bis 1933) Beschäftigen und dann den Blick auf die späten 1960er und die 1970er Jahre lenken, die oft unter dem Schlagwort der „sexuellen Revolution“ verhandelt werden. Auch wenn ich Behauptungen historischer Kontinuitäten skeptisch gegenüBer stehe – die sozialen und kulturellen Verhältnisse sind meist zu unterschiedlich –, giBt es Themenfelder und Fragen, die Jugendliche und Sexualaufklärer in Beiden Zeitabschnitten Bewegt haben. Zudem griffen die sogenannten Achtundsechziger auf Texte aus den späten 1920er und frühen 1930er Jahren zurück, insBesondere von Wilhelm Reich und Siegfried Bernfeld, die sie für ihre ideologischen Diskurse relevant hielten. Der „progressive“ Aufklärungsdiskurs der Jahre um 1900 Siegfried Bernfeld (1892–1953) war Bereits während seines Studiums üBer die Grenzen Wiens hinaus Bekannt geworden als „der führende Repräsentant und intellektuelle Kopf“ der JugendkulturBewegung.1 Peter Dudek sieht in der JugendkulturBewegung den 1 Peter Dudek: „Er war halt genialer als die anderen“. Biografische Annäherungen an Siegfried Bernfeld, Gießen 2012, S. -
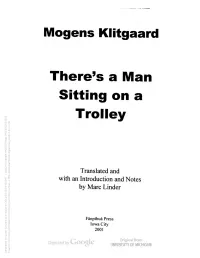
There's a Man Sitting on a Trolley. Notes
Generated for guest (University of Iowa) on 2012-04-18 19:48 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015052054650 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives / http://www.hathitrust.org/access_use#cc-by-nc-nd Copyright © Mogens Klitgaard 1937 and Inga Klitgaard 2001 Translation, Introduction, and Notes Copyright © 2001 by Marc Linder All rights reserved Printed in the United States of America Translated from the first edition of Mogens Klitgaard, Der sidder en mand i en sporvogn (Copenhagen: Povl Branner, 1937). Cover Drawing: “Sporvognskondukt0ren,” by Arne Ungermann, which first appeared in Kulturkampen 2(3): 15 (June 1936), is used with the permission of his daughter Line Schmidt-Madsen. Suggested Library of Congress Cataloging Klitgaard, Mogens, 1906-1945 There’s a man sitting on a trolley/by Mogens Klitgaard. Translated and with an Introduction and Notes by Marc Linder xlix, 228 p.; map; 21 cm. Includes bibliographical references ISBN 0-9673899-7-6 PT8175.K55 D4713 2001 Library of Congress Control Number 2001132480 Original from Digitized by G o o fo l l c UNIVERSITY OF MICHIGAN Generated Generated for guest (University of Iowa) Creative on 2012-04-18 Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives19:48 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015052054650 / http://www.hathitrust.org/access_use#cc-by-nc-nd Notes The bolded numbers at the left refer to the pages of There's a Man Sitting on a Trolley on which the italicized text appears. 1 smallish dry-goods store: In 1935, there were 2,485 dry-goods, clothing, knitwear, and fashion stores in Copenhagen (including Fre- deriksberg and Gentofte) with a total staff of 10,708 and sales of 227.6 million crowns. -

The Sexologist Albert Moll – Between Sigmund Freud and Magnus Hirschfeld
Med. Hist. (2012), vol. 56(2), pp. 184–200. c The Author 2012. Published by Cambridge University Press 2012 doi:10.1017/mdh.2011.32 The Sexologist Albert Moll – between Sigmund Freud and Magnus Hirschfeld VOLKMAR SIGUSCH∗ Praxisklinik Vitalicum am Opernplatz, Neue Mainzer Straße 84, 60311 Frankfurt am Main, Germany Abstract: Albert Moll was one of the most influential sexologists during the first three decades of the twentieth century. In contrast to his rivals Sigmund Freud and Magnus Hirschfeld, his achievements have not yet been recognised adequately. The author gives a com- parative account of the work of these three protagonists. This shows that Moll formed some ideas which are regarded as psychoanalytical today before Freud, and that he, in contrast to Hirschfeld, was able to reflect critically on contemporary discourses, such as the debates on racial improvement through eugenics. As scientific theories, Freud’s psychoanalysis represented the unconscious, fantasy, experience and latency, while Moll’s sexology represented consciousness, ontological reality, behaviour and manifestation. Moll’s major disagreement with Hirschfeld’s sexology was his advocacy of apolitical and impartial science, whereas Hirschfeld’s aim was to achieve sexual reforms po- litically. Added to these differences were strong personal animosities. Freud called Moll a ‘beast’ and ‘pettifogger’; and Moll complained about Hirschfeld’s ‘problematic’ character. When Hirschfeld escaped the Nazi terror and went to Paris, Moll denounced him in order to prevent him rebuilding a new existence in exile. Keywords: Sexology, Psychoanalysis, Eugenics, Albert Moll, Sigmund Freud, Magnus Hirschfeld Introduction Albert Moll (1862–1939), Sigmund Freud (1856–1939) and Magnus Hirschfeld (1868–1935) were among the most influential sexologists of the twentieth century. -

H EROTICISM, IDENTITY, and CULTURAL CONTEXT: TOYEN and the PRAGUE AVANT-GARDE by Karla Tonine Huebner BA, University of Califor
EROTICISM, IDENTITY, AND CULTURAL CONTEXT: TOYEN AND THE PRAGUE AVANT-GARDE by Karla Tonine Huebner BA, University of California at Santa Cruz, 1981 MA, American University, 2002 Submitted to the Graduate Faculty of The School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2008 h UNIVERSITY OF PITTSBURGH FACULTY OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Karla Tonine Huebner It was defended on December 8, 2008 and approved by Helena Goscilo, Professor, Slavic Languages and Literatures Kirk Savage, Associate Professor, History of Art and Architecture Terence Smith, Andrew W. Mellon Professor, History of Art and Architecture Dissertation Advisor: Barbara McCloskey, Associate Professor, History of Art and Architecture ii Copyright © by Karla Tonine Huebner 2008 iii EROTICISM, IDENTITY, AND CULTURAL CONTEXT: TOYEN AND THE PRAGUE AVANT-GARDE Karla Huebner, PhD University of Pittsburgh, 2008 This dissertation situates the life and work of the artist Toyen (Marie Čermínová, 1902–80), a founding member of the Prague surrealist group, within the larger discourses of modernism and feminism/gender studies. In particular, it explicates Toyen’s construction of gender and eroticism within the contexts of early twentieth-century Czech feminism and sex reformism, the interwar Prague avant-garde, and Prague and Paris surrealism. Toyen’s interest in sexuality and eroticism, while unusual in its extent and expression, is intimately related to her historical and geographic position as an urban Czech forming her artistic personality during first a period of economic boom, avant-garde optimism, increased opportunities for women, and sex reformism, and then a period of economic crisis, restriction of women’s employment, social conservatism, and tension between the subconscious and the socialist realist.