Faustin Linyekula / Studios Kabako
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Entretien Avec Faustin Linyekula
entretien avec Faustin Linyekula De quelle façon votre parcours singulier et vos créations sont liés à des souvenirs personnels et à l’histoire de votre pays, l’ex-Zaïre, aujourd’hui appelé RDC, République Démocratique du Congo ? Faustin Linyekula : Jusqu’en 1995, et ma rencontre à Nairobi avec Opiyo Okach, mime et danseur, avec lequel j’ai fondé la compagnie Gàara, je me présentais plutôt comme comédien, j’écrivais aussi de petites choses. Tout a commencé à Kisangani, entre 1988 et 1989, avec des amis, dont Vumi, aujourd’hui en prison, et qui m’a donné le désir d’écrire en me faisant lire ses poèmes. Nous étions dans la même classe et nous plaisantions sur le fait qu’il était mon parrain littéraire. Comme beaucoup d’adolescents qui veulent se rebeller, nous nous étions trouvés et formions un groupe d’amis, en partie réunis par l’enseignement et en réaction contre notre professeur de français qui ne jurait que par la poésie de la négritude. C’était selon lui l’aboutissement de toute démarche littéraire, tandis que pour nous, la négritude était dépassée. Nous cherchions ailleurs. Et ce refus nous a ouvert les yeux. Nous avons découvert d’autres écrivains africains plus critiques, notamment envers cette fameuse négritude. Ce qui faisait notre joie, c’était de lire et citer des phrases comme celle de l’écrivain nigérian Wole Soyinka : “Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore”. Nous rêvions ainsi de changer la littérature et le théâtre africains. Pas moins ! En lisant des poèmes lors des fêtes à l’école, en écoutant la radio. -

Gregory Maqoma Cion: Requiem of Ravel's Bolero
Gregory Maqoma Cion: Requiem of Ravel’s Bolero Start Time: 7.45pm Duration: 1 hour 10 mins/no interval Age guidance: 12+ Welcome Welcome to the Barbican and this year’s Dance Umbrella. As we celebrate our long- standing partnership, we are thrilled to bring this stirring performance of Cion: Requiem of Ravel’s Bolero to London. We’re delighted to welcome back dancer and choreographer Gregory Maqoma both to the Barbican and to Dance Umbrella, along with his stunning company Vuyani Dance Theatre and soaring choir. Hot on the heels of Tree, the hit show Maqoma recently choreographed for this year’s Manchester International Festival, he now embodies a professional mourner, inspired by stories written by fellow South African, Zakes Mda. Responding to recent political events both in his own country and around the world, this absorbing production is a thought- provoking lamentation on life and loss. Thank you for joining us this evening. Toni Racklin, Head of Theatre and Dance, Barbican Emma Gladstone, Artistic Director, Dance Umbrella Director’s note Gregory Maqoma The world has changed and we are constantly confronted by the scourge of violence against humans. I can’t help wondering how much the idea of a post-human era has infiltrated our very definition of humanity. Therefore this show’s message of death and its dire consequences must be communicated through a lament in order to tackle a universe where the age-old phenomena of greed, power and religion result in unnatural deaths. Toloki, the professional mourner, weaves through this virtual landscape of dissolution, bringing about catharsis. -

Presence of the Colonial Past Afrika Auf Europas Büh N E N a Reader on the Focus of the Theaterformen Festival Braunschweig 2010
presenCE of the colonial past afrika auf europas bÜh n e n a reader on the focus of the Theaterformen Festival Braunschweig 2010 supported by Content Editorial 04 I. ARCHIVE OF A POSSIBLE FUTURTE | Film series Archive of a possible future – notes on a film series | Nanna Heidenreich 06 Programme 08 II. Theatre productions Missie 10 Introduction 11 Ivo Kuyl interviews David van Reybrouck 12 Excerpt from Missie by David van Reybrouck 15 Exhibit A: Deutsch-Südwestafrika 16 Introduction 17 Performers’ quotes 18 The past that never ends Interview with Brett Bailey and Paul Grootboom | Frankfurter Rundschau 20 Influx Controls I: I wanna be wanna be Influx Controls II: On the 12th night of never I will not be held black 23 Introduction 24 Africa’s spirit was trampled down | Braunschweiger Zeitung 26 Performance Wonder | Kultiversum.de 26 Miss Soweto and the god of David Beckham | Nachtkritik.de 27 With all things Equal | excerpt from Influx Controls I: I wanna be wanna be 28 Pinkie’s Prayer | excerpt from Influx Controls II: On the 12th night of never I will not be held black 29 Pour en finir avec Bérénice 30 Introduction 31 The tragedy stays | Braunschweiger Zeitung 32 My Only True Country is my Body | David van Reybrouck about Faustin Linyekula 33 The Studios Kabako | Deutschlandfunksendung 36 III. THE PRESENCE OF THE ELSEWHERE IN THE NOW | thematic weekend Introduction 43 The complete programme of the thematic weekend 43 Decolonizing Germany | opening lecture by Kien Nghi Ha 47 Selected projects Baggage | Otobong Nkanga 57 Reconstructing Damon Albarn -
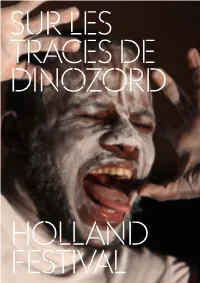
Sur-Les-Traces-De-Dinozord-Programme.Pdf
SUR LES TRACES DE DINOZORD HOLLAND FESTIVAL SUR LES TRACES DE DINOZORD Faustin Linyekula, Studios Kabako thanks to production partner patron this performance has been made possible by CONTENT Info & context Credits Profile Faustin Linyekula Notes About the artist Friends Holland Festival 2019 Join us Colophon INFO CONTEXT date & time introduction Tue 4 June, 8.30 pm by Kiza Magendane Wed 5 June, 8.30 pm 7.45 pm venue meet the artist Internationaal Theater Amsterdam, with Faustin Linyekula Grote Zaal Wed 5 June, after the performance moderator Kiza Magendane running time 1 hour 25 minutes Landloos no interval Sat 15 June, 5 pm, Frascati 3 language The Welcome Table – Édouard Glissant: French with Dutch and English One World in Relation surtitles Sun 16 June, 11 pm, Het Ketelhuis CREDITS direction Faustin Linyekula with Hlengiwe Lushaba (singer) Jean Kumbonyeki, Yves Mwamba, Faustin Linyekula, Michel Kiyombo (dancers), Papy Maurice Mbwiti, Antoine Vumilia Muhindo (actors) text Richard Kabako, Antoine Vumilia Muhindo music Wolfgang Amadeus Mozart (Requiem, fragmenten), Charles Lwanga Choir of Kisangani, Joachim Montessuis (Nierica), Arvo Pärt (Pari Intervallo, Redeuntes in mi, Trivium, Annum per Annum), Jimi Hendrix (Voodoo Child) music Arvo Pärt published / licensed by © Universal Edition, Vienna / Albersen Verhuur B.V., The Hague production Studios Kabako, Virginie Dupray coproduction KVS Theater, Brussels with support from DRAC Ile-de-France / French Ministry world premiere 13 December 2012 KVS, Brussels website Studios Kabako PROFILE FAUSTIN LINYEKULA Faustin Linyekula (born in 1974) calls himself a storyteller. That might seem strange for a man billed since the start of the cen- tury mainly as a dancer and choreographer at an impressive list of festivals and venues in cities such as Avignon, Brussels, Johannesburg, Lisbon and New York. -

Faustin Linyekula/ Studios Kabako
Faustin Linyekula/ Studios Kabako Le Festival des mensonges 20 21 22 23 SALLE DE CHAMPFLEURY K 22 h K durée estimée 2 h et puis la soirée se poursuit restauration possible pendant et après le spectacle proposée par l’association Karibu Afrika direction artistique Faustin Linyekula avec Papy Ebotani, Djodjo Kazadi, Faustin Linyekula, Marie-Louise Bibish Mumbu et les musiciens José Père Elanga (voix et guitare), Pati Basima (bassiste), Bampika Mwanza dit “Champion” (batteur), Teba Vangu dit “Bidjana” (voix), Kapay Mwenie dit “Flam” (guitare solo) avec les paroles de Lumumba, Kasa-Vubu, Mobutu, Tshombe, Kabila... les textes de Marie-Louise Bibish Mumbu Mes Obsessions : j'y pense et puis je crie ! les dessins de Papa Mfumu'eto 1er administration Virginie Dupray, assistée de Jean-Louis Mwandika restauration congolaise et bar Association Karibu Afrika, Avignon spectacle créé, première étape, au Festival de Liège les 1er et 2 février 2005 production Studios Kabako en coproduction avec le Centre chorégraphique national de Caen – Basse - Normandie dans le cadre de l’Accueil-studio – ministère de la Culture et de la Communication, le KVS Theater (Bruxelles), le Parc de la Villette (Paris) dans le cadre des Résidences d’artistes 2006 avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie, de la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture et de la Communication, de CULTURESFRANCE dans le cadre du programme Afrique en créations, du Centre national de la danse (Pantin) et de la Halle de la Gombe - Centre culturel français de Kinshasa les -

Faustin Linyekula
MORE MORE MORE ... FUTURE We deserve more than the vanishing shadows of delusions We deserve more than headlines and media compassion More than the false happiness that blinds our minds More than assistance, we deserve justice More than money, we deserve dignity More than a glorious past, we long for a future MORE MORE MORE...FUTURE Choreographer and director Faustin Linyekula creates intricate and powerful dance/theater/performance works which refl ect on the political, social and cultural history and present day struggles of his home country. Through personal stories, communal activity and beautifully crafted choreography, his works subvert the dominant images of contemporary Congo with their resourcefulness and hope. With more more more...future he takes inspiration from the driving force of ndombolo; bastard daughter of rumba, traditional rhythms, church fanfares and Sex Machine funk, this Congolese pop delivers unstoppable energy. Ndombolo musicians praise their own power, beautiful women, designer clothes and luxury cars -- a fantasy life drawn from soap operas and American music videos -- as if everything is granted in a country where in fact you have to start over again every day. In more more more...future ndombolo expresses not the cheap, thin dreams of money and fame, but the diffi culties, dead ends, and mistakes of previous generations. Linyekula’s choreography embraces creative destruction and stakes a claim to his own no-future society, saying “If it’s impossible for us to send to hell a future that we never had, if it’s diffi cult to go on ruining our pile of ruins, let’s try to dream, the feet firmly kept on the ground, and just imagine more future.” In this raucous and provocative performance three dancers, including Linyekula, twist and rage to the seething poems of Antoine Vumilia Muhindo, a political prisoner in Kinshasa and childhood friend of Linyekula’s, set in song by music director Flamme Kapaya, an exceptional guitarist and a major star in the Congo. -

Tales of Home, Life, and Death: Panaibra Gabriel Canda and Faustin Linyekula
Tales of Home, Life, and Death: Panaibra Gabriel Canda and Faustin Linyekula joan frosch, phd center for world arts, university of florida Essay commissioned by The Africa Contemporary Arts Consortium Look Back/Dance Forward: Tales of Home | Congo/Mozambique is curated by MAPP International Productions in partnership with The Africa Contemporary Arts Consortium. History is not past. The lost lives of Michael Brown, Trayvon Martin, Steven Sotloff, and the thousands of unnamed who have succumbed to the Ebola virus this year to date, provide hard evidence. Historic (mis)constructions of personhood deployed to justify colonial conquest, perpetrate genocide, and subjugate millions as “slaves,” haunt us in 2014. For the life or death of our shared humanity, we must ask: “Who is (not) human?” Whose life is the one to be valued, respected, if not, exceptionalized, and… whose life may be abused, lost, if not extinguished and remains unnamed? What combination of attributes—race, class, ethnicity, gender, religious affiliation, ability, sexual orientation, nationality, language, or age—confers the status of the human, “who manifests a subjectivity—that is, a consciousness like our own—that would allow us to consider each of them, taken individually, as another self” (an alter ego)? 1 In their intimate works for Tales of Home , Panaibra Gabriel (Mozambique), creator of Time and Spaces: The Marrabenta Solos, and Faustin Linyekula (Democratic Republic of Congo), creator of Le Cargo , have telescoped their immensely complex histories to the scale of the person. The artists seem to say: ”Come, look through my lens—you will recognize what was previously unseen, unnamed, or unknown to you. -
CONGO Faustin Linyekula
Faustin Linyekula // CONGO (Kisangani | Lyon) „Den Kongo, den gibt es nicht. Da ist nur ein Strom und ein großer Wald.“ Der Kongo musste erst erfunden werden – so Éric Vuillard in seiner gleichnamigen Erzählung. Der belgische König Leopold II. will eine Kolonie für sich allein, einen Staat als private Aktiengesellschaft. Nach der Berliner Kongokonferenz 1884 machen sich seine Gouverneure, Kommissare und Vollstrecker an die Arbeit. Der international gefeierte kongolesische Choreograf und Regisseur Faustin Linyekula hat die Erzählung KONGO für sein Stück bearbeitet. Er mischt Worte, Bewegungen und Lieder aus dem Äquatorialwald. In der Theaterarbeit tritt Linyekula als Tänzer auf der Bühne gemeinsam mit dem Schauspieler Kamono Maonda und der Sängerin Pasco Losanganya in einem holzschnittartigen Setting aus Licht und Schatten auf. Die dunkle und wunderschöne Reise gipfelt in der Frage: Wie kann man angesichts der Gräuel der Vergangenheit sprechen, tanzen oder auch nur auf den Beinen bleiben? Der Tänzer und Choreograf Faustin Linyekula lebt und arbeitet in Kisangani, im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo, ehemals Zaire, ehemals Belgisch Kongo, ehemals Kongo-Freistaat. Nach seinem Literatur- und Theaterstudium in Kisangani zog Linyekula nach Nairobi, wo er 1997 Kenias erste zeitgenössische Tanzkompanie mitbegründete. Nach seiner Rückkehr in den Kongo gründete er in Kinshasa 2001 die Studios Kabako, die sowohl Trainingsprogramme für Tanz und Theater anbieten, als auch Recherchen und Produktions- prozesse unterstützen. Seit 2007 befinden sich die Studios in Kisangani und wurden um die Felder Musik, Film und Video erweitert. Zudem arbeiten sie mit den Communities des Lubungs District an Bildungs- Nachhaltigkeits- und Umweltprojekten. Faustin Linyekulas Theaterarbeiten touren weltweit. Der 1968 in Lyon, Frankreich, geborene Éric Vuillard ist ein französischer Autor und Film- regisseur. -

The-Head-The-Load-Programme-En.Pdf
THE HEAD & THE LOAD HOLLAND FESTIVAL 1 THE HEAD & THE LOAD William Kentridge, Philip Miller, Thuthuka Sibisi, Gregory Maqoma thanks to production partner patron this performance has been made possible by co-commissioners with support from this performance is part of the HF Young selection YOUNG 2 Y CONTENT Info & context 4 Credits 5 About the work 9 Historical context 12 Profile Kentridge 15 About the artists 19 Friends 21 Holland Festival 2019 22 Join us 26 Colophon 29 3 INFO CONTEXT date & time introduction Wed 29 May 2019, 8.30 pm by Margriet van der Waal Thu 30 May 2019, 3 pm Thu 30 May, 2.15 pm, 7.45 pm Thu 30 May 2019, 8.30 pm Fri 31 May, 7.45 pm Fri 31 May 2019, 8.30 pm meet the artist venue with William Kentridge Theater Amsterdam Thu 30 May, after the performance moderator Margriet van der Waal running time 1 hour 25 minutes Johannesburg: City of 1000 Faces no interval Fri 31 June, 3 pm language William Kentridge & Faustin Linyekula Sotho, Zulu, Mandinka, Swahili, Sun 2 June, 3.30 pm French, German, Italian, English no surtitles The Welcome Table – Négritude Mon 3 June, 9 pm 4 CREDITS concept and director created and performed by William Kentridge actors Mncedisi Shabangu, Hamilton Dlamini, composer Nhlanhla Mahlangu, Luc De Wit Philip Miller featured vocalists and performers co-composer, music director Joanna Dudley, Nhlanhla Mahlangu, Ann Thuthuka Sibisi Masina, Bham Ntabeni, Sipho Seroto, N`Faly Kouyate (kora), Mario Gotoh (viola, projection design The Knights), Tlale Makhene (percussion), Catherine Meyburgh Vincenzo Pasquariello -

Leaving Ruins Explorations of Present Pasts by Sammy Baloji, Freddy Tsimba, and Steve Bandoma
Leaving Ruins Explorations of Present Pasts by Sammy Baloji, Freddy Tsimba, and Steve Bandoma Bogumil Jewsiewicki translated from the French by Allen F. Roberts If art is where the greatest ruins are, shattered history.” In his famous phrasing, “Break a vase, and Our art is in those ruins we became the love that reassembles the fragments is stronger than that love (Walcott 1962:13)1 which took its symmetry for granted when it was whole. The glue that fits the pieces is the sealing of its original shape.” In place of eference to the poetic work of Derek Walcott the ruins and heroes designated by the gaze of history, he contin- helps explain the particular attention of three ues, “I see cabbage palms moving their fronds at sunrise, [and] I Congolese artists directed to material and moral think they are reciting Perse…. At least islands not written about ruins that bear witness to traumatic experience. but writing themselves!” (Walcoltt 1998:78).3 The voice of the Walcott (1992) inscribes violence at the heart poet “Perse,” having preceded Walcott to the Nobel Prize in Lit- of Antillean heritage: “Decimation from the erature, “make[s] out of these foresters and fishermen heraldic Arawak downwards is the blasted root of Antillean history.” Since men!” (Walcott 1987:217). It is the artist, then, who reveals to the Rthe Atlantic and East African slave trades and perhaps before, world the experience and patrimony ignored by history: “The violence and its management have been at the heart of collective past is the sculpture and the present the beads of dew or rain on memories of societies of the present-day Democratic Republic the forehead of the past…. -

Look Back, Dance Forward Press Kit with Artist Biographies
Look Back,Dance Forward: Tales of Home | Congo / Mozambique Panaibra Gabriel Canda (Mozambique) A two-evening program with works by Faustin Linyekula (Democratic Republic of Congo) Look Back,Dance Forward: Tales of Home | Congo / Mozambique A two-evening program with works by Faustin Linyekula (Democratic Republic of Congo) and Panaibra Gabriel Canda (Mozambique) photo: Arthur Fink photo: Agathe Poupeney My name is Panaibra Gabriel Canda. The son of Gabriel Canda, a Marrabante singer and guitar player born in Inhambana- immigrated to Lourenco Marques, today Maputo; my mother was a dress maker, and protestant, together they had four kids… - Panaibra Gabriel Canda, Time and Spaces: The Marrabenta Solos I am Kabako, my name is Kabako, again Kabako, always Kabako… - Faustin Linyekula, Le Cargo So begins each work in Tales of Home: Congo/ Linyekula and Canda are internationally recognized Mozambique—a two-evening program of dance- for their work and each play vital roles in their theater featuring extraordinary contemporary artists communities. In their respective countries, they from the African continent. Faustin Linyekula will direct their own dance companies, creating artistic perform Le Cargo; Canda will perform Time & projects and public programs as Artist-Citizens who Spaces: The Marrabenta Solos. In both full length address relevant issues affecting a broad cross- works, the artists grapple with the complex histories section of society. of their countries by re-igniting memories of and/ or experiences with their fathers. They present, in MAPP International will create opportunities for very different ways, intimate and personal points of impactful community engagement including dance view on colonialized Africa, on their home countries, workshops and master classes, artistic exchanges on family and national histories, and on our global and public dialogues about art and citizenship. -

Gregory Maqoma and Vuyani Dance Theatre
i 13th JOMBA! Contemporary Dance Experience 31 August – 11 September 2011 VENUES The Festival sincerely acknowledges the support of funders and partners Elizabeth Sneddon Theatre (Tel: 031 – 260 2296) University of KwaZulu-Natal Principal Funder Howard College Campus Tickets: R45 (Students/Scholars/Pensioners: R30) Book at Computicket (or at venue one hour before) Tel: 083 915 8000 JOMBA! CITY 2 September @ 7pm Outside the Durban City Hall (Durban inner city cultural precinct) Tickets: R50 available at the gates only YOUTH FRINGE - Entrance Free! Dorothy Nyembe Hall Cato Manor/Umkhumbane Tel: 082 875 6065 WORKSHOP VENUE Dance Studio (Movement Room 2) University of KwaZulu-Natal Howard College Campus FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Centre for Creative Arts University of KwaZulu-Natal Tel: 031 – 260 2506/1816 E-mail: [email protected] www.cca.ukzn.ac.za 1 Introduction he University of KwaZulu-Natal’s Centre for Creative Arts and its celebrated annual contemporary often seen as an improvisation and ‘battle’ dance form, to the theatre stage. Carefully constructed solo dance platform, JOMBA!, invites you to explore this year’s 11 day festival spanning two weeks. works ask the audience to revel at two dancers whose bodies ooze strength, power and control. This year’s festival has dance off erings which encompass the very best of local and international It is also our great privilege to welcome fellow African dance maker Faustin Linyekula from the dancers and dance companies. Democratic Republic of the Congo. Faustin’s work takes a critical look at post-independence in Africa TNurturing local dance sees this year’s JOMBA! New Works programme off ering grants to both Mlu and embraces the anarchy and chaos of making art in a time of struggle and trauma.