De La Versatilité (4) Le Luth Arabe Dans Les Genres Musicaux Du Corridor Malais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TASTE of SOUTH EAST ASIA by Chef Devagi Sanmugam
TASTE OF SOUTH EAST ASIA by Chef Devagi Sanmugam COURSE CONTENT WORKSHOP 1 – CHINESE CUISINE (19th September 2013) Introduction to Chinese cuisine eating habits and food culture Ingredients commonly used in Chinese cooking Art of using wok and cooking with a wok Featured Recipes Spring Rolls Salt Baked Chicken Sweet and Sour Prawns with Pineapple Stir Fried Mixed Vegetables Steamed Fish Hakka Noodles WORKSHOP 2 – THAI AND VIETNAMESE CUISINE (20th September 2013) Introduction to Thai and Vietnamese cuisine eating habits and food culture Ingredients commonly used in Thai and Vietnamese cooking Making of curry pastes and dips Featured Recipes Vietnamese Beef Noodles Green curry chicken Caramelized Poached Fish Mango Salad Pineapple Rice WORKSHOP 3 – INDIAN AND SRI LANKAN CUISINE (21st September 2013) Introduction to Indian cuisine eating habits and food culture Ingredients commonly used in Indian cooking Art of using and blending spices, medicinal values and storage Featured Recipes Cauliflower Pakoras Peshawari Pilau Tandoori Chicken Prawns Jalfrezi Mixed Fruits Raita WORKSHOP 4 – JAPANESE, KOREAN AND FILIPINO CUISINE (22nd September) Brief introduction to Japanese, Korean and Filipino cuisine eating habits and food culture Ingredients commonly used in above cooking Featured Recipes Chicken Yakitori Bulgogi Chicken Adobo in coconut milk Teriyaki Salmon Korean Ginseng Soup WORKSHOP 5 – MALAYSIAN, INDONESIAN AND BALINESE (23rd September) Introduction to Malaysian, Indonesian and Balinese cuisine eating habits and food culture Ingredients commonly used in above cooking Herbs and spices used in above cuisine Featured Recipes Sate Lembu Nasi Kunyit Lamb Rendang Sambal Udang Eurasian Cabbage Roll WORKSHOP 6 – STREET FOODS OF ASIA (24th September 2013) Introduction to Streets foods of Asia eating habits and food culture Ingredients commonly used and eating habits Featured Recipes Chicken Rice (Singapore) Potato Bonda (India) Garlic Chicken Wings (Thailand) Roti John (Malaysia) Fresh Spring Rolls (Vietnam) . -

African Studies Association 59Th Annual Meeting
AFRICAN STUDIES ASSOCIATION 59TH ANNUAL MEETING IMAGINING AFRICA AT THE CENTER: BRIDGING SCHOLARSHIP, POLICY, AND REPRESENTATION IN AFRICAN STUDIES December 1 - 3, 2016 Marriott Wardman Park Hotel, Washington, D.C. PROGRAM COMMITTEE CHAIRS: Benjamin N. Lawrance, Rochester Institute of Technology William G. Moseley, Macalester College LOCAL ARRANGEMENTS COMMITTEE CHAIRS: Eve Ferguson, Library of Congress Alem Hailu, Howard University Carl LeVan, American University 1 ASA OFFICERS President: Dorothy Hodgson, Rutgers University Vice President: Anne Pitcher, University of Michigan Past President: Toyin Falola, University of Texas-Austin Treasurer: Kathleen Sheldon, University of California, Los Angeles BOARD OF DIRECTORS Aderonke Adesola Adesanya, James Madison University Ousseina Alidou, Rutgers University Souleymane Bachir Diagne, Columbia University Brenda Chalfin, University of Florida Mary Jane Deeb, Library of Congress Peter Lewis, Johns Hopkins University Peter Little, Emory University Timothy Longman, Boston University Jennifer Yanco, Boston University ASA SECRETARIAT Suzanne Baazet, Executive Director Kathryn Salucka, Program Manager Renée DeLancey, Program Manager Mark Fiala, Financial Manager Sonja Madison, Executive Assistant EDITORS OF ASA PUBLICATIONS African Studies Review: Elliot Fratkin, Smith College Sean Redding, Amherst College John Lemly, Mount Holyoke College Richard Waller, Bucknell University Kenneth Harrow, Michigan State University Cajetan Iheka, University of Alabama History in Africa: Jan Jansen, Institute of Cultural -

Teater ‘Uraong Ulu WARGA MOTAC Hatinya Luke Lagih’ Oleh Kumpulan Kesenian Uraong Ulu (Keulu) Telah I Memenangi Tempat Ketiga Dalam Festival Teater Malaysia 2006
3 FESTIVAL OF ASEAN CULTURAL EXPRESSIONS Festival Kesenian 2015 Orang Asli dan Peribumi Antarabangsa 2015 JKKN MENERAJUI HARI SUKAN NEGARA Teater ‘Uraong Ulu WARGA MOTAC Hatinya Luke Lagih’ Oleh Kumpulan Kesenian Uraong Ulu (Keulu) Telah i Memenangi Tempat Ketiga Dalam Festival Teater Malaysia 2006. Sudut Berita JKKN SEKILAS TINTA EDITOR YBhg. Datuk Norliza Rofli Ketua Pengarah YBrs. En. Mohamad Razy Mohd Nor Timbalan Ketua Pengarah (Sektor Dasar dan Perancangan) YBrs. Tn. Hj. Mesran Mohd Yusop Timbalan Ketua Pengarah (Sektor Kebudayaan dan Kesenian) Editor Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia. Mohd Zin Mohd Sahid Penolong Editor Seni Budaya Malaysia semakin mengalami ketirisan. Membina masyarakat Zuriah Mohamad yang berbudaya dan berkeperibadian tinggi adalah menjadi tanggungjawab SIDANG EDITORIAL setiap rakyat Malaysia kerana setiap kita adalah pemimpin diperingkat sidang redaksi Penulis masing-masing. Peristiwa-peristiwa negatif yang pernah berlaku akibat • Mohd Zin Mohd Sahid kebiadaban segelintir rakyat yang tidak bertanggungjawab, seharusnya • Zuriah Mohamad • Muhammad Haqkam Hariri dijadikan iktibar agar tidak berulang dan menjadi gejala yang memusnahkan • Ismarizal Zulamran bangsa Malaysia. Kebiadaban tersebut seharusnya dibendung supaya ia • Muhammad Faizal Ruslee tidak menjadi gejala kepada masyarakat keseluruhannya. Hanya dengan • Siti Anisah Abdul Rahman • Fauziah Ahmad disiplin, kesedaran dan keimanan yang jitu pada setiap insan sahaja yang akan dapat mengatasinya. Pereka Grafik/Kreatif Bafti Hera Abu Bakar Sama-samalah kita menjadikan iktibar dan pengajaran bahawa salah Jurufoto Zaman Sulieman satu sebab kejatuhan kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1511 ialah ‘angkara sikitul yang menjual maklumat kepada portugis’ ketika itu. Jika SIDANG REDAKSI kita sama-sama berpegang teguh kepada rukun negara dan disiplin • Unit Komunikasi Korporat diri, InshaAllah seni budaya Malaysia akan terus relevan selaras dengan • Bahagian Khidmat Pengurusan ungkapan ‘Tidak akan Melayu hilang di dunia’. -

Cuisine of the Islamic World Helena Hallenberg & Irmeli Perho
Cuisine of the Islamic World Helena Hallenberg & Irmeli Perho Original title: Ruokakulttuuri islamin maissa Translation: Owen F. Witesman The translation was kindly subvented by Finnish Literature Exchange FILI. Gaudeamus Helsinki University Press 2010 454 pages, hardbound ISBN 9789524951654 2 Table of Contents Introduction 9 .............................................................................The taste of home 10 ......................................................... Cuisine of the Islamic World 12 .....................................................................Objective of the book 14 .................................................................................... Terms used 15 ...................................................... Quran quotations and Hadiths 16 ................................................. Transliteration and pronunciation 19 ..............................................Cultural selection criterion for foods 27 ............................................................The roots of Islamic cuisine 27 ....................................................................... Arabia before Islam 33 ..................................................................................Bread baking 33 ...........................................................The birth and roots of Islam 35 ..............................Which aroma would the Prophet prefer today? 37 ......................................... Perceptions of impurity and cleanliness 39 ............................................... Islamic -

M. Cohen on the Origin of the Komedie Stamboelpopular Culture, Colonial Society, and the Parsi Theatre Movement
M. Cohen On the origin of the Komedie StamboelPopular culture, colonial society, and the Parsi theatre movement In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157 (2001), no: 2, Leiden, 313-357 This PDF-file was downloaded from http://www.kitlv-journals.nl Downloaded from Brill.com10/10/2021 12:19:15AM via free access MATTHEW ISAAC COHEN On the Origin of the Komedie Stamboel Popular Culture, Colonial Society, and the Parsi Theatre Movement Introduction . The Komedie Stamboel, also known as the Malay Opera, occupies a prom- inent place in Indonesia's cultural history.1 lts emergence in 1891 has been characterized as a 'landmark' in the development of modern popular theatre (Teeuw 1979:207). The theatre later contributed greatly to the birth of Indo- nesian contemporary theatre and film2 and played a formative role in mod- ern political discourse and representation (see Anderson 1996:36-7). The Komedie Stamboel has been celebrated as one of the most significant 'artistic achievements' of the Eurasian population of colonial Java (see Van der Veur 1968a), but also damned for its deleterious influence on Java's classical and 1 This article was written while a postdoctoral research fellow at the International Institute for Asian Studies (DAS). It was presented in part as lectures at KAS and the Fifth International Humanities Symposium, Gadjah Mada University, in 1998.1 would like to thank all the particip- ants in the research seminar, 'Popular theatres of Indonesia', Department of Southeast Asian and Oceanic Languages and Cultures, Leiden University, where I developed some of the ideas pre- sented here, as well as Kathryn Hansen, Rakesh Solomon, Catherine Diamond, Surapone Virulrak, Hanne de Bruin, and two anonymous BKI reviewers for their comments. -

Food Discourse: the Communicative Gateway Toward Understanding Formerly Colonized Representation in Parts Unknown
Illinois State University ISU ReD: Research and eData Theses and Dissertations 3-30-2018 Food Discourse: The Communicative Gateway Toward Understanding Formerly Colonized Representation in Parts Unknown Mitch Combs Illinois State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://ir.library.illinoisstate.edu/etd Part of the Communication Technology and New Media Commons Recommended Citation Combs, Mitch, "Food Discourse: The Communicative Gateway Toward Understanding Formerly Colonized Representation in Parts Unknown" (2018). Theses and Dissertations. 850. https://ir.library.illinoisstate.edu/etd/850 This Thesis is brought to you for free and open access by ISU ReD: Research and eData. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of ISU ReD: Research and eData. For more information, please contact [email protected]. FOOD DISCOURSE: THE COMMUNICATIVE GATEWAY TOWARD UNDERSTANDING FORMERLY COLONIZED REPRESENTATION IN PARTS UNKNOWN Mitch Combs 102 Pages CNN’s television series, Anthony Bourdain: Parts Unknown, merges food and travel genres to communicate representations of local, indigenous, and other formerly colonized cultures. This thesis will present the significance of Parts Unknown through a review of literature that concerns postcolonial theory and food discourse to which critical insights emerge and explain how indigenous cultures are represented within Western “foodie” television. These insights will then guide a postcolonial investigation of the food rhetoric -

Mek Mulung Di Pentas Dunia Pentas Di Mulung Mek
ISSN 2180 - 009 X Bil 1/2015 NASKHAH PERCUMA Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia Lafaz syukur seawal bicara yang dapat diungkapkan atas penerbitan buletin JKKN Bil 1/2015 yang kini dikenali sebagai “Citra Seni Budaya”. Penjenamaan semula buletin ini adalah bertitik tolak daripada hasrat dan usaha JKKN untuk melaksanakan transformasi bagi memastikan setiap program dan aktiviti yang dilaksanakan memberi impak positif kepada masyarakat di samping pulangan kepada peningkatan ekonomi negara. Merujuk kepada Kamus Dewan Edisi Ke-4, Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan “Citra” membawa maksud ‘gambaran’ atau ‘imej peribadi seseorang’. Oleh itu, “Citra Seni Budaya” adalah refleksi kepada usaha murni JKKN yang dilaksanakan secara berterusan untuk memartabatkan seni dan budaya. Ia akan menjadi wadah perkongsian ilmu serta maklumat mengenai seni dan budaya yang boleh dimanfaatkan sebagai salah satu sumber rujukan sampingan. Semoga usaha kecil ini boleh membantu merealisasikan hasrat JKKN bagi menyebarluaskan maklumat berkaitan seni budaya yang hakikatnya berada bersama kita saban hari. Salmiyah Ahmad CORETAN EDITOR CORETAN Editor JABATAN SIDANG KEBUDAYAAN DAN EDITORIAL KESENIAN NEGARA YBhg. Datuk Norliza Rofli • Muhammad Faizal Ruslee Ketua Pengarah • Siti Anisah Abdul Rahman • Fauziah Ahmad YBrs. En. Mohamad Razy Mohd Nor Timbalan Ketua Pengarah Pereka Grafik/Kreatif (Sektor Dasar dan Perancangan) Bafti Hera Abu Bakar YBrs. Tn. Hj. Mesran Mohd Yusop Jurufoto Timbalan Ketua Pengarah Zaman Sulieman (Sektor Kebudayaan dan Kesenian) SIDANG REDAKSI YBrs. -

Nde Tozo Boya ? » Si Vous N’Êtes Pas Au Parfum De « Nde Tozo Boya », C’Est Que Vous Avez Manqué Un Épisode De La Tendance Aujourd’Hui
HEBDOMADAIRE RÉGIONAL DINFORMATIONS DU GROUPE ADIAC DU BASSIN DU CONGO CCongo R - République démocratique duC Congo A - Angola B- Burundi -C Cameroun - CCentrafrique - Gabon G - Guinée G équatoriale - Ouga Onda - Rwanda R - Tchad T - Sao S Tomé-et-Principe TP N° 092 VENDREDI 16 AU JEUDI 22 OCTOBRE 2020 XAF CDF RWF SOCIÉTÉ Vous avez dit : « Nde tozo boya ? » Si vous n’êtes pas au parfum de « Nde Tozo Boya », c’est que vous avez manqué un épisode de la tendance aujourd’hui. On s’en amuse, on s’en agace, on la met en mu- sique, bref il est dicile d’y échapper. Entre actualités, diérents challenges, cris du cœur et solidarité, les réseaux sociaux sont inondés de ce slogan que l’on pourrait traduire ici et en quelque sorte par « Ce que nous n’approuvons pas ». Quand la mu- sique s’en mêle, trois singles faisant référence directe à « Nde tozo boya » viennent de voir le jour en un temps record. PAGE 8 EXPOSITION « Puisqu’il faut vivre » dénonce les bavures liées au port du masque Les tableaux « Puisqu’il faut vivre » font partie de la série « Utopicus » de la présente ex- position à l’Institut français du Congo de l’artiste Jordy Kissy Moussa. Les deux œuvres mettent en exergue l’eroi suscité par le nonrespect du port du masque plus que la contamination à la covid-19. A travers l’œuvre, l’artiste congolais souhaite éduquer la population qui doit se montrer responsable et interpeller la police à se montrer rigoureuse et raisonnable sans abuser de son pouvoir. -

2018 Near East and North Africa Regional Overview of Food Security
2 018 Near East and North Africa REGIONAL OVERVIEW OF FOOD SECURITY AND NUTRITION RURAL TRANSFORMATION-KEY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE NEAR EAST AND NORTH AFRICA COVER PHOTOGRAPH A Farmer cultivating crops. ©FAO/Franco Mattioli 2 018 REGIONAL OVERVIEW OF FOOD SECURITY AND NUTRITION RURAL TRANSFORMATION-KEY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE NEAR EAST AND NORTH AFRICA Food and Agriculture Organization of the United Nations Cairo, 2019 RECOMMENDED CITATION: FAO. 2019. Rural transformation-key for sustainable development in the near east and North Africa. Overview of Food Security and Nutrition 2018. Cairo. 80 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. ISBN 978-92-5-131348-0 © FAO, 2019 Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-Noncommercial -Share Alike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/ 3.0/igo/legalcode/legalcode). Under the terms of this licence, this work may be copied, redistributed and adapted for non-commercial purposes, provided that the work is appropriately cited. -

Mapping the History of Malaysian Theatre: an Interview with Ghulam-Sarwar Yousof
ASIATIC, VOLUME 4, NUMBER 2, DECEMBER 2010 Mapping the History of Malaysian Theatre: An Interview with Ghulam-Sarwar Yousof Madiha Ramlan & M.A. Quayum1 International Islamic University Malaysia It seems that a rich variety of traditional theatre forms existed and perhaps continues to exist in Malaysia. Could you provide some elucidation on this? If you are looking for any kind of history or tradition of theatre in Malaysia you won’t get it, because of its relative antiquity and the lack of records. Indirect sources such as hikayat literature fail to mention anything. Hikayat Raja-Raja Pasai mentions Javanese wayang kulit, and Hikayat Patani mentions various music and dance forms, most of which cannot be precisely identified, but there is no mention of theatre. The reason is clear enough. The hikayat generally focuses on events in royal court, while most traditional theatre developed as folk art, with what is known as popular theatre coming in at the end of the 19th century. There has never been any court tradition of theatre in the Malay sultanates. In approaching traditional theatre, my own way has been to first look at the proto- theatre or elementary forms before going on to the more advanced ones. This is a scheme I worked out for traditional Southeast Asian theatre. Could you elaborate on this? Almost all theatre activity in Southeast Asia fits into four categories as follows: Proto-Theatre, Puppet Theatre, Dance Theatre and Opera. In the case of the Philippines, one could identify a separate category for Christian theatre forms. Such forms don’t exist in the rest of the region. -
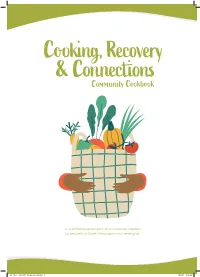
Community Cookbook
Cooking, Recovery & Connections Community Cookbook A community-led project and cookbook created by residents of North Melbourne and Flemington. LIT1057_coHealth_Cookbook FA.indd 1 18/5/21 3:48 pm The Cooking Recovery and Connections project has been led by a team of cohealth Health Concierges across North Melbourne and Flemington, February to May 2021. In July 2020 residents were subjected to an enforced ‘hard lockdown’, which removed residents’ autonomy – even around cultural practices and food choices. This project is owned and led by Contents public housing residents to support COVID-19 recovery, it is a community- driven response to support connection and wellbeing, produced by and Okra – Bamya 5 for residents of the nine towers in North Melbourne and Flemington. Prepared by Hajira Soliman Shakshuka 7 Prepared by Mohamed Musa Red Cabbage 9 Acknowledgement Prepared by Emebet Antonyo Himbasha – Eritrean Sweet Bread 11 cohealth acknowledges the ancestors and Prepared by Kedija Ibrahim Traditional Custodians of the land on which Homemade Falafel 13 our offices stand and pays respect to Elders Prepared by Aisha Suliman past and present. This project and community Roasted Pumpkin Soup 15 cookbook was led and produced by residents Prepared by Halima Ahmed on Wurundjeri and Boon Wurrung lands. We Fatteh of Lentils 17 acknowledge the Stolen Generations and Prepared by Jameia Mohamed the historical and ongoing impact of Project team: Community Artwork 19 colonisation on Aboriginal and Torres Furdus Suliman Strait Islander peoples. Nagat Abdalla Sudanese Baklava 21 Prepared by Sara Zakaria We also recognise the resilience, strength Abdiwass Ismail Somali Oat and Meat Soup – Shurbad 23 and pride of Aboriginal and Torres Strait Baeda Abdikadir Prepared by Kelli Willis Islander communities. -

Lesson 2 the People of Madagascar
LUTHERAN HOUR MINISTRIES online mission trip Curriculum LESSON 2 THE PEOPLE OF MADAGASCAR 660 MASON RIDGE CENTER DRIVE, SAINT LOUIS, MO 63141 | LHM.ORG 0117 LHM – MADAGASCAR Lesson 2 – The People of Madagascar Population On the map, Madagascar is very close to the eastern edge of Africa. This closeness would lead people to conclude that the inhabitants of Madagascar are predominately African. This is not true. The native inhabitants of Madagascar are the Malagasy (pronounced mah-lah-GAH-shee), who originated in Malaysia and Indonesia and reached Madagascar about 1,500 years ago. The language, customs, and physical appearance of today’s Malagasy reflect their Asian ancestry. Nearly 22.5 million people live in modern Madagascar. The annual growth rate of three percent combined with an average life expectancy of only sixty- four years gives Madagascar a young population. About sixty percent of the Malagasy people are less than twenty-five years old. Thirty-five percent of the adult population is classified as illiterate. More than ninety-five percent of the population is of Malagasy origin. The other five percent is made up of French, Comorians, Indo-Pakistanis, and Chinese peoples. The Malagasy are divided into 20 distinct ethnic groups, each of which occupies a certain area of the island. These groups originally started as loosely organized clans. Each clan remained apart from each other clan, marrying only within its clan. The clans developed into separate ethnic groups. Today there is an increased amount of intermarriage between the clans blurring the lines of distinction. All groups consider themselves as equally Malagasy.