Sortie-La-Brigue-06
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guide Touristique
Village de charme et d'histoire l La Turbie Turbie La 1 INTRODUCTION 3-5 ACCES 6-7 PREPAREZ VOTRE SEJOUR 9-11 LA TURBIE SUR LE WEB 11 QUATRE FAÇONS DE DECOUVRIR NOTRE VILLAGE, A VOUS DE CHOISIR ! 13-15 HISTOIRE 16-19 PATRIMOINE 20 - 27 LE TROPHÉE D'AUGUSTE 28 - 31 PAYSAGES 32 - 35 LA TURBIE SUR LES ROUTES TOURISTIQUES 36 LA TURBIE EN FAMILLE 37 - 41 RANDONNEES 42 - 43 FESTIVITES ET TRADITIONS 44 - 47 SERVICES ET INFORMATIONS PRATIQUES 48 Publication et rédaction : fond personnel de Michèle Régie Publicitaire : Toutes vos informations Mairie de La Turbie Bertola-Vanco. Média Plus Communication sur notre site internet Merci à Michèle Bertola-Vanco, Z.I. Secteur C7 www.ville-la-turbie.fr Mentions légales : André Franco et Jean Cunégondo Allée des Informaticiens - B.P. 75 Textes : Mairie de La Turbie pour leur aide précieuse. 06709 St-Laurent du Var - Cedex 2 maire Tél. : 04 92 271 389 Village de charme et d'histoire La Turbie est jumelée Crédits photos : Tirage : 10 000 exemplaires Fax : 04 92 273 214 l depuis 2004 A vol d’oiseau - Pierre Behar Site Web : www.mediapluscom.fr avec la commune de Nadège Berro Ville de La Turbie, Impression : Sarre (Val d’Aoste, Italie). Monte-Carlo Golf Club, Orgaya, Imprimerie spéciale de la société Maquettiste : N.A (art’like créa) Plus d’informations sur : Ange Borria, Fotolia®, Microsoft®, Média Plus Communication Dépôt légal : 2014 Turbie La www.comune.sarre.ao.it Som 1 « La Turbie, merveilleux balcon suspendu au-dessus des pittoresques découpures des caps et d’une vaste étendue de mer bleuissante ». -
Nice La Grave De Contes
300 Nice La Grave de Contes Lundi à Vendredi Nice Vauban 05.30 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 Drap - Place Cauvin 05.50 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20 Nice Vauban La Grave de Contes 06.10 06.40 07.40 08.40 09.40 10.40 Saint-Jean d’Angely Tende Gendarmerie Nice Vauban 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 16.00 Pont V. Auriol Drap - Place Cauvin 11.20 12.35 13.20 14.20 15.20 16.20 Cité PLM La Grave de Contes 11.40 12.55 13.40 14.40 15.40 16.40 Ancien Octroi Les Ecoles Nice Nice Vauban 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.20 Parc à Fourrages Drap - Place Cauvin - 16.50 17.20 17.50 18.20 18.40 Lycée de Drap - - - 18.10 - - Lavoir La Grave de Contes 16.40 17.10 17.40 18.20 18.40 - La Chaumière Sclos de Contes - - - - - 19.05 Bon Voyage Coaraze Village 17.00 - - - - - Riba Roussa Pont de l’Ariane Nice Vauban 19.00 20.00 L’Oli La Nuit Drap - Place Cauvin 19.20 20.20 Trinité La La Grave de Contes 19.40 20.40 Sainte-Anne Route de Laghet La Trinité Samedi Pont de la Roma Nice Vauban 05.30 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 Les Chênes Verts Drap - Place Cauvin 05.50 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 La Grave de Contes 06.10 07.40 08.40 09.40 10.40 11.40 Le Vallon Place Cauvin Drap Nice Vauban 12.15 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Carlin Drap - Place Cauvin 12.35 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 Pont de Cantaron Pont de Chemin de Fer La Grave de Contes 12.55 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 Lycée Sclos de Contes 13.10 de Drap Les Vernes Nice Vauban 18.00 19.00 20.00 Plan du Blavet Drap - Place Cauvin 18.20 19.20 20.20 Pont de Peille La Grave de Contes 18.40 19.40 20.40 La Condamine -

Dossier Départemental Sur Les RISQUES MAJEURS Dans Les
Cet ouvrage a été réalisé par : la Direction de la Défense et de la Sécurité de la Préfecture des Alpes-Maritimes Dossier Départemental Avec l’active participation de : sur les RISQUES MAJEURS dans les Alpes-Maritimes 06 06 Direction Régionale de l'Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 2007 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur Direction Départementale de l'Équipement des Alpes-Maritimes Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Alpes-Maritimes Office National des Forêts - Service départemental de Restauration des Terrains en Montagne des Alpes-Maritimes Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes ALPES-MARITIMES Que soient également remerciés : Le Cyprès, la Délégation Régionale d’EDF PACA, Météo France, le BRGM et tous ceux qui ont répondu à nos sollicitations. DANS LES DANS RISQUES MAJEURS DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES DÉPARTEMENTAL DOSSIER > Préface > Sommaire général Le RISQUE NATUREL ou TECHNOLOGIQUE MAJEUR ............................. 3 Les ENJEUX en PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR et la SITUATION dans les ALPES-MARITIMES ............................. 13 Le RISQUE NATUREL dans les ALPES-MARITIMES ............................. 19 > Mouvement de terrain ........................................... 20 > Inondation ....................................................... 27 > Feu de forêt ...................................................... 35 > Sismique ......................................................... 42 > Avalanche -
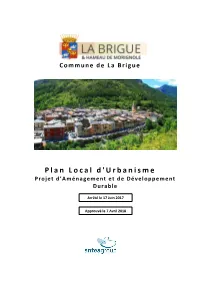
Plan Local D'urbanisme P�Ojet D’A���Age�E�T Et De D�Veloppe�E�T Durable
Commune de La Brigue Plan Local d'Urbanisme Pojet d’Aageet et de Dveloppeet Durable Arrêté le 17 Juin 2017 Approuvé le 7 Avril 2018 ________________________ Antea group _______________________ Commune de La Brigue Pla Loal d’Uaise – Pojet d’Aéageet et de Développeet Duale PLU approuvé le 7 Avril 2018 SOMMAIRE Préambule .................................................................................................................... 1 1. Axer prioritairement le développement du territoire en valorisant les transports collectifs ....................................................................................................................... 2 1.1. Le tai, poit fot de l’ogaisatio des dplaeets .............................................. 2 1.2. Maintenir une offre de transport locale ..................................................................... 2 1.3. Maîtise l’volutio du tafi poids louds su la RD 6204 .......................................... 2 2. Préserver l’idetité forte d’u village de otage itégré à l’eviroeet ....... 3 2.1. Maintenir les grands équilibres entre espaces naturels, forestiers, agricoles et artificialisés ......................................................................................................................... 3 2.1.1. Préserver le site Natura 2000 du Maguaeis et de l’ua de Tede à Saoge ....................... 3 2.1.2. Pseve l’itgit des espaes de iodivesit et favoise le aitie de la Trame Verte et Bleue ................................................................................................................................................ -

Recherches Régionales N°112
RECHERCHES REGIONALES --- Alpes-Maritimes et Contrées limitrophes SOMMAIRE 31e année 1990 – N°3 Les représentants du bien et du mal dans les Juillet - septembre fresques et peintures murales des Alpes- Maritimes aux XVe et XVIe siècles par Catherine ACHIARDI P . 2 112 Le lycée de garçons de Nice : enseignants et enseignes (1909-1929) par Franck LEFEUVRE p. 41 LES REPRESENTATIONS DU BIEN ET DU MAL DANS LES FRESQUES ET PEINTURES MURALES DES ALPES-MARITIMES AUX XVe ET XVIe SIECLES par Catherine ACCHIARDI Mémoire de D.E.A effectué sous la direction de M. Derlange à l'U.E.R Lettres et Sciences Humaines de Nice en 1987-1988. 2 Religion de l'un, du tout, le christianisme est cependant vécu par le fidèle, comme une longue et unique alternative, qui dure toute une vie, entre le Salut et la Perdition. L'art, instrument de propagande, expression de la spiritualité et de la dévotion chrétiennes, se fait catéchèse et prière. Mystique et raffinée dans les retables, d'une inspiration plus populaire dans les fresques et peintures murales, la figuration de la lutte entre le Bien et le Mal, du péché et de la vertu, témoigne à la fois de la spiritualité religieuse mais aussi de la sociologie d'une époque. Dans une imagerie pleine de superstitions et de candeur, d'angoisse et de confiance, les Bons et les Méchants sont classés et représentés avec un mélange d'atroce et de jovial. Aussi, en plein XVe siècle, les murs foisonnent d'images de fin du monde. La Renaissance n'est pas seulement un siècle d'humanisme et de lumières ; elle perpétue et concrétise les peurs du Moyen-âge. -

Le Grand Tour Alpi Maritime-Mercantour
Page 1 L’itinéraire présenté est mythique. Avec près de 360 kilomètres, le Grand Tour Alpi Marittime-Mercantour emmène le cycliste sur les traces du Tour de France et de son homologue italien, le Giro. Exigeant par sa longueur, ce parcours l’est aussi par son altitude. En effet, une grande partie de l’itinéraire se déroule au dessus de 2000 mètres avec un point culminant, à 2802 m, au col de la Bonnette, la plus haute route goudronnée d’Europe. Exceptionnelle par sa diversité d’altitude et de paysages, cette itinérance vous conduit des garrigues méditerranéennes aux forêts de mélèzes et « déserts » d’altitude du cœur du Parc national du Mercantour. Panoramas à 360°, névés éternels, ambiance et chaleur des villages de montagne, le Grand Tour Alpi Marittime- Mercantour vous invite de Juin à Septembre à un plein d’oxygène, de soleil et d’émotions. Page 2 CIRCUITDU GRANDALPI TOUR MARITTIME MERCANTOUR Page 3 Étape 1 : Saint-Martin-Vésubie – Valberg Vallées de la Vésubie, de la Tinée et du Cians 58,6 kilomètres 2 cols au programme Le Col Saint-Martin 1500 m Le Col de la Couillole 1678m Le fil de l’étape Saint-Sauveur-sur-Tinée : Km 29,1 Passé cette section, se dresse le village de Saint-Martin-Vésubie : Km 0 Saint-Sauveur-sur-Tinée. A sa sortie, il faut Dans Saint-Martin, prendre la RM94 en direction de prendre à gauche la RM30 en direction de la Madone des Fenestres. Au premier lacet, Roubion/Valberg. C’est alors le début de continuer tout droit pendant 1,5km, puis prendre à l’ascension du Col de la Couillole, et il ne s’agit gauche la RM89 sur 100 mètres avant de grimper pas de le prendre à la légère. -

Série a Lois Et Actes Du Pouvoir Central Sous La Direction De Marion Duvigneau, Conservateur En Chef Du Patrimoine
Archives municipales de Nice Série A Lois et actes du pouvoir central sous la direction de Marion Duvigneau, conservateur en chef du patrimoine Nice, 2015 Introduction Lois et actes du pouvoir central. Cotes extrêmes A 1-8 Date de l'unité documentaire 1792-1860 Nombre d'unités de niveau bas 8 Métrage linéaire 0,63 ml Organisme responsable de l'accès intellectuel Service des Archives de Nice Côte d'Azur Origine Ville de Nice Catégorie du producteur Collectivité territoriale Modalités d'entrée Versements, abonnements Informations sur l'évaluation Fonds clos, sauf à retrouver quelques pièces éparses en cours de reclassement d'autres fonds des Archives municipales Statut juridique Archives publiques Communicabilité Consultation librement autorisée en salle de lecture du service des Archives de Nice Côte d'Azur Conditions d'utilisation Reproduction librement autorisée Langue des unités documentaires français, italien Lieu Nice (Alpes-Maritimes, France) Rédacteur de la description Rétroconversion électronique par Christine Célier, adjoint administratif, sous la direction de Marion Duvigneau, conservateur en chef du patrimoine, 2015 Informations sur la description Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de la norme ISAD(G) : norme générale et internationale de description archivistique (seconde édition) et de la DTD EAD 2002 (deuxième version). L'indexation a été réalisée d'après la note d'information DITN/RES/2007/008 relative à la normalisation des descripteurs et le Thésaurus pour la description et l'indexation des archives locales anciennes, modernes et contemporaines. Date de création description Mercredi 9 septembre 2015 Date de mise à jour description Lundi 5 octobre 2015 Corps de l'inventaire Période révolutionnaire. -

Sectorisation Mouvement 2019
DSDEN des Alpes-Maritimes Sectorisation du département des Alpes-Maritimes Division du personnel enseignant 1er degré Mouvement 2019 1- Les zones infra-départementales Zone infra-départementale 1 Zone infra-départementale 2 Zone infra-départementale 3 Zone infra-départementale 4 Zone infra-départementale 5 Zone infra-départementale 6 Antibes Andon Aspremont Berre-les-Alpes Beaulieu-sur-Mer Ascros Biot Auribeau-sur-Siagne Bonson Blausasc Beausoleil Belvédère Cagnes-sur-Mer Briançonnet Bouyon Bendejun Breil-sur-Roya Beuil Cannes Cabris Carros Coaraze Cap-d'Ail Clans Châteauneuf-Grasse Caille Castagniers Cantaron Castellar Daluis La Colle-sur-Loup Caussols Colomars Châteauneuf-Villevieille Fontan Entraunes Le Bar-sur-Loup Cipières Èze Contes Gorbio Guillaumes Le Cannet Coursegoules Falicon Drap La Brigue Isola Le Rouret Escragnolles Gattières La Trinité Menton La Bollène-Vésubie Mandelieu-la-Napoule Gourdon Gilette La Turbie Moulinet La Penne Mouans-Sartoux Grasse La Gaude L'Escarène Roquebrune-Cap-Martin La Tour Mougins Gréolières La Roquette-sur-Var Levens Sainte-Agnès Lantosque Opio La Roquette-sur-Siagne Le Broc Lucéram Saint-Jean-Cap-Ferrat Malaussène Roquefort-les-Pins Le Tignet Nice Peille Saorge Péone Saint-Paul- de -Vence Pégomas Saint-Blaise Peillon Sospel Pierrefeu Théoule-sur-Mer Peymeinade Saint-Jeannet Saint-André-de-la-Roche Tende Puget-Théniers Tourrettes-sur-Loup Saint-Auban Saint-Laurent-du-Var Tourrette-Levens Roquebillière Valbonne Saint-Cézaire-sur-Siagne Saint-Martin-du-Var Roquesteron Vallauris Saint-Vallier-de-Thiey -

D Nice > Breil Sur Roya > Cuneo D
SNCF service clientèle 05A Retrouvez tous les horaires actualisés sur www.ter-sncf.com/paca Train ayant une correspondance pour Breil en gare de Ventimiglia Nice > Breil sur Roya > Cuneo Service Relations Clients SNCF - 62 973 ARRAS cedex 9 Briançon ATTENTION ! N'oubliez pas sauf sam sauf sam sauf sam sauf sam sauf sam sauf sam sauf sam train des merveilles : sauf dim dim dim et tous les tous les tous les tous les tous les dim et tous les tous les dim dim et tous les tous les dim et tous les tous les tous les tous les tous les tous les tous les dim et tous les tous les tous les dim et tous les dim et tous les tous les tous les de vous reporter jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours Ce train touristique circulant toute l’année vous permet aux renvois fériés fériés fériés fériés fériés fériés fériés Un service de Transport à la DemandeEmbrun est proposé à droite de découvrir les richesses culturelles, sportives et gastronomiques de la vallée du Paillon et de la Roya- par le Conseil Général des Alpes-Maritimes au Og Og départ des gares de Drap-Cantaron, L’Escarène, O O g g g O g O g g O g g O g g O g O g O g g g O g g g g O Bévéra. A certaines dates, il vous propose tout au long de Touët-de-l’Escarène, Sospel,Gap Breil, Fontan-Saorge, Nice ville 06.30 07.16 07.21 07.46 08.05 09.05 09.46 09.53 10.46 12.05 12.36 12.46 14.46 15.46 16.05 16.46 17.04 17.30 17.55 18.35 18.46 19.20 Nice ville son parcours les commentaires de guides conférenciers Saint-Dalmas-de-Tende, La Brigue, Tende et Nice St Roch 06.34 - 07.26 - 08.09 09.09 - 09.57 - 12.09 12.40 - - - 16.09 - 17.08 17.34 17.59 18.39 - 19.24 Nice St Roch pour accompagner votre voyage. -

Keolis Awarded a Contract to Operate the Public Transport Network of the French Riviera Urban Community
PRESS RELEASE Paris, 14 June 2019 Keolis awarded a contract to operate the public transport network of the French Riviera Urban Community • On 29 April 2019, the French Riviera Urban Community selected Keolis to operate and maintain its public transport network called Zest. • This new six-year public service delegation contract starts on 8 July 2019 and is expected to generate a total revenue of €60 million. • Keolis’ missions are to reinforce the transport network offer across the 15 cities and villages of the community1 and modernise the network by rolling out new digital services, including Wi-Fi access in all buses. • Keolis has committed to increasing passenger numbers by 17% and boosting revenue by 24% across the whole network between now and 2025. Following the tender process, the French Riviera Urban Community Council (75,000 inhabitants) selected Keolis to manage and operate its public transport network (regular and extracurricular bus lines, on-demand transport, and soon, an electric shuttle service). This public service delegation contract is a major issue for the French Riviera Urban Community which is seeking to modernise and revive its public transport network and in doing so contribute to the agglomeration and wider region’s appeal. Expanded public transport coverage From 8 July on, Keolis Menton Riviera - Keolis’ new subsidiary’s name – will start operating the network, including transport for extracurricular activities. Transport coverage will be improved across all the cities and villages of the French Riviera Urban Community. In Autumn 2019, an electric shuttle service will be introduced in Menton as part of a one-year experiment. -

Alpes Maritimes – 6 Nights from the Alps to the Mediterranean
Telephone: +44 (0) 1722 322 652 Email: [email protected] Alpes Maritimes – 6 nights From the Alps to the Mediterranean https://www.onfootholidays.co.uk/routes/alpes-maritimes/alpes-maritimes-6-nights/ Route Summary At a glance The 6-night (5 days walking) version of the Alpes Maritimes route misses out one night in Sospel and the "Sospel circuit" walking day. How much walking? Full days: 12-16km per day, 4-6 hrs walking Using shortening options: 7-16km per day, 3-6 hrs walking Max. Grade: page 1/8 After a spectacular railway journey from Nice, reach the medieval village of La Brigue offering the chance to walk fascinating winding alleyways and old town houses. Explore the villages perchés high over the Roya valley and the town of Saorge, which climbs steeply up the valley side. Visit the ancient towns of Breil and Sospel and stay in the astonishing mountain-top village of Ste. Agnès, with views across to the Mediterranean. Finally arrive in Menton itself, Belle Epoque faded splendour now being restored to its former glory, and a stroll down the promenade before dining well in one of its restaurants. This route can be walked as a medium-hard walk or, using shortening options, as a medium graded one, and the route is well signed. Route Highlights ● The “villages perchés” of the Roya valley ● Dramatic alpine scenery ● The flora of the Gorge de Bévéra ● Painted chapels and Renaissance altarpieces ● Chamois, ibex, moufflons, boars, birds of prey ● The Belle Epoque charms of Menton ● Saorge, its winding alleys and underground passages We Recommend An extra night at La Brigue (to walk to Tende or to Notre Dame des Fontaines, or in summer to make an expedition to the Vallée des Merveilles), and extra nights in Menton by the sea front, just to relax.. -

Cartographie Des Zones Inondables Département Des Alpes-Maritimes
Cartographie des zones inondables Département des Alpes-Maritimes Cartographie Hydrogéomorphologique AE 04 10 27 FEVRIER 2006 Cartographie des zones inondables par la méthode hydrogéomorphologique Département des Alpes-Maritimes Maître d'ouvrage :DIREN PACA Auteur : SIEE , Pôle Risques naturels Chef de projet : L. Mathieu Participants : V. Durin, N Sautel ,M. Boisard, Date 06/2005 N° d'affaire : AE 04 10 27 Pièces composant l’étude : - 1 document contenant le rapport d’étude et l’atlas - 1 notice de la base de données numériques géographiques - 1 CD-Rom Résumé de l’étude : L’étude présente pour les principaux cours d’eau du département une cartographie informative des zones inondables définies d’après une analyse hydrogéomorphologique. Zone géographique : Rivières et torrents de la Tinée, la Roya et la Levensa, la Bevera, le Paillon de L’Escarenne, le Vallon de Laghet, la Cagne, la Brague, le Mardaric et la Miagne,la Frayère, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Contrôle qualité interne Rapport : Rédigé par L. Mathieu et V Durin. Cartographie hydrogéomorphologique : Effectuée par L. Mathieu. Numérisation et SIG: Réalisé par M. Boisard TABLE DES MATIERES INTRODUCTION................................................................................................................................................................................................. 1 Contexte de l’étude................................................................................................................................1 Méthodologie retenue