Recherches Régionales N°112
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guide Touristique
Village de charme et d'histoire l La Turbie Turbie La 1 INTRODUCTION 3-5 ACCES 6-7 PREPAREZ VOTRE SEJOUR 9-11 LA TURBIE SUR LE WEB 11 QUATRE FAÇONS DE DECOUVRIR NOTRE VILLAGE, A VOUS DE CHOISIR ! 13-15 HISTOIRE 16-19 PATRIMOINE 20 - 27 LE TROPHÉE D'AUGUSTE 28 - 31 PAYSAGES 32 - 35 LA TURBIE SUR LES ROUTES TOURISTIQUES 36 LA TURBIE EN FAMILLE 37 - 41 RANDONNEES 42 - 43 FESTIVITES ET TRADITIONS 44 - 47 SERVICES ET INFORMATIONS PRATIQUES 48 Publication et rédaction : fond personnel de Michèle Régie Publicitaire : Toutes vos informations Mairie de La Turbie Bertola-Vanco. Média Plus Communication sur notre site internet Merci à Michèle Bertola-Vanco, Z.I. Secteur C7 www.ville-la-turbie.fr Mentions légales : André Franco et Jean Cunégondo Allée des Informaticiens - B.P. 75 Textes : Mairie de La Turbie pour leur aide précieuse. 06709 St-Laurent du Var - Cedex 2 maire Tél. : 04 92 271 389 Village de charme et d'histoire La Turbie est jumelée Crédits photos : Tirage : 10 000 exemplaires Fax : 04 92 273 214 l depuis 2004 A vol d’oiseau - Pierre Behar Site Web : www.mediapluscom.fr avec la commune de Nadège Berro Ville de La Turbie, Impression : Sarre (Val d’Aoste, Italie). Monte-Carlo Golf Club, Orgaya, Imprimerie spéciale de la société Maquettiste : N.A (art’like créa) Plus d’informations sur : Ange Borria, Fotolia®, Microsoft®, Média Plus Communication Dépôt légal : 2014 Turbie La www.comune.sarre.ao.it Som 1 « La Turbie, merveilleux balcon suspendu au-dessus des pittoresques découpures des caps et d’une vaste étendue de mer bleuissante ». -

Terre De Randonnées Pages 2 À 10
ENTREPRISE RICHEZ OLIVIER Rénovation - Isolation Couverture - Charpente Zinguerie Le mensuel gratuit du moyen et haut pays niçois 04 93 76 17 42 / 06 10 04 15 10 [email protected] Septembre 2017-N° 19 / Tél : 06 74 68 71 12 / 06 22 90 40 50 — [email protected] www.couverture-charpente-levens.fr Terre de randonnées pages 2 à 10 Vos pages villages portrait Ça se passe près Chantal Bagnato de chez vous p. 11 à 44 une femme de tête p. 47 focus sport L'École de Danse des Deux Deux Levensois s'entraînent Vallées prépare la rentrée p. 46 pour le triathlon de Nice p. 48 LE DOSSIER L’automne, le meilleur moment pour randonner De tranquilles chemins muletiers casse-croûte, l’eau, peut-être du moyen pays qui musardent même éviter quelques patous dans la forêt. Qui traversent soupçonneux qui ne vous lais- les genêts et les cistes, les pâ- seront pas approcher de leur turages, les pins et les mélèzes. troupeau... Des sentiers balisés, autrefois Mais quelle récompense ! utilisés par les colporteurs et les troupeaux pour franchir les En profiter vallées et les cols. Et au bout de Les plus entraînés se lanceront l’effort, après avoir patiemment dans la Grande Traversée du mis un pied devant l’autre, la Mercantour, qui demande seize récompense avec les grands jours pour relier Estenc à Men- espaces du haut Var, les lacs ton, en faisant étape dans neuf de montagne qui étincellent au refuges. Mais attention : ce soleil, les cimes qui se poussent sentier est du niveau du GR 20 du col jusqu’aux 3 143 mètres (Ph. -

Un Bistrot Pour Voir Du Pays
MAGAZINE Auberge du Moulin à Roubion Un bistrot pour voir du pays L'Auberge du Moulin, c'est le principal commerce de Roubion. Un Bistrot de pays qui vous fait voyager dans le Comté de Nice, entre produits locaux et cuisine traditionnelle. Blotti contre les falaises, à 1 300 m halte pour tout visiteur du cru. d'altitude, Roubion fait partie de Manuel Pin y est installé depuis ces jolis villages perchés où se 2011, en compagnie de son épouse mêlent l'ambiance du proche ar- Marie-France. De retour dans le rière-pays niçois et celle de la mon- village de son enfance, il a rénové tagne. On y vient pour sa petite l'ensemble du bâtiment communal station des Buisses, dédiée au ski pour en faire bien davantage qu'un en hiver et au VTT à la belle saison, restaurant. "Nous avons une acti- pour son circuit de portes peintes, vité d'épicerie", explique-t-il. "Nous pour son site d'escalade et sa via vendons des produits laitiers, des ferrata ou encore pour ses itinérai- fruits et légumes, des œufs...". Un res de randonnée, comme le fa- plus indéniable pour les Roubion- meux parcours vers le hameau pas- nais qui ne disposent, bien sûr, toral de Vignols, qui domine les d'aucun autre commerce de ce type. flots tumultueux de la Vionène. Et qui peuvent trouver à l'auberge Pour atteindre ce lieu chargé d'his- de quoi répondre aux besoins du toire, porte d'entrée du Parc natio- quotidien : cosmétiques, articles nal du Mercantour, il faut quitter la ménagers.. -
Nice La Grave De Contes
300 Nice La Grave de Contes Lundi à Vendredi Nice Vauban 05.30 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 Drap - Place Cauvin 05.50 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20 Nice Vauban La Grave de Contes 06.10 06.40 07.40 08.40 09.40 10.40 Saint-Jean d’Angely Tende Gendarmerie Nice Vauban 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 16.00 Pont V. Auriol Drap - Place Cauvin 11.20 12.35 13.20 14.20 15.20 16.20 Cité PLM La Grave de Contes 11.40 12.55 13.40 14.40 15.40 16.40 Ancien Octroi Les Ecoles Nice Nice Vauban 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.20 Parc à Fourrages Drap - Place Cauvin - 16.50 17.20 17.50 18.20 18.40 Lycée de Drap - - - 18.10 - - Lavoir La Grave de Contes 16.40 17.10 17.40 18.20 18.40 - La Chaumière Sclos de Contes - - - - - 19.05 Bon Voyage Coaraze Village 17.00 - - - - - Riba Roussa Pont de l’Ariane Nice Vauban 19.00 20.00 L’Oli La Nuit Drap - Place Cauvin 19.20 20.20 Trinité La La Grave de Contes 19.40 20.40 Sainte-Anne Route de Laghet La Trinité Samedi Pont de la Roma Nice Vauban 05.30 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 Les Chênes Verts Drap - Place Cauvin 05.50 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 La Grave de Contes 06.10 07.40 08.40 09.40 10.40 11.40 Le Vallon Place Cauvin Drap Nice Vauban 12.15 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Carlin Drap - Place Cauvin 12.35 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 Pont de Cantaron Pont de Chemin de Fer La Grave de Contes 12.55 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 Lycée Sclos de Contes 13.10 de Drap Les Vernes Nice Vauban 18.00 19.00 20.00 Plan du Blavet Drap - Place Cauvin 18.20 19.20 20.20 Pont de Peille La Grave de Contes 18.40 19.40 20.40 La Condamine -
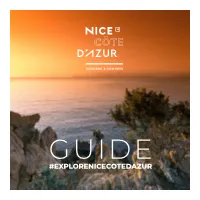
La Bollène-Vésubie
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR GUIDE #EXPLORENICECOTEDAZUR 1 aint-Dalmas- le-elvage aint-Etienne-de-inée LA MÉTROPOLE aint-auveur-sur-inée Isola Italie NICE CÔTE D’AZUR aldeblore Roubion e territoire de la Métropole Nice Côte aint-Martin-ésubie d’Azur puise dans sa géographie et son Roure histoire, une identité particulière et partagée entre littoral, collines, vallées Rimplas Belvédère L enanson et montagnes. Des rives de la Méditerranée Ilonse aux sommets du Mercantour, il offre une Roquebilière Clans La Bollène- Marie ésubie incomparable qualité de vie et propose : gastronomie, casinos, spectacles, loisirs, Alpes La our- Bairols sur-inée Lantosque festivals, sports… de Haute Il suffit de lever les yeux pour apprécier le bleu Provence ournefort du ciel et la luminosité qui ont fasciné les artistes Utelle tels que Matisse, Chagall, Dufy et tant d’autres, Monaco qui ont laissé un patrimoine culturel d’exception. Bonson Duranus Gilette Des stations balnéaires animées… aux criques Levens La Roquette-sur-ar aint-Blaise préservées, des champs qui embaument le thym aint-Martin-du-ar Le Broc Castagniers et le romarin… aux charmants villages perchés, Alpes Carros ourrette-Levens des sentiers de randonnée…aux majestueuses Gattières Aspremont Maritimes aint-eannet Colomars cimes enneigées, c’est un paradis propice à tous Falicon aint-André-de-la-Roche les plaisirs. ence La rinité Eze Nice Cap d’Ail Mer Ajoutez-y 300 jours d’ensoleillement par an, La Gaude Var illefranche-sur-Mer Méditerranée un aéroport international, un prestigieux parc aint-Laurent-du-ar Beaulieu-sur-Mer hôtelier, il est facile de comprendre pourquoi aint-ean-Cap-Ferrat il est devenu mythique et légendaire, célèbre Cagnes-sur-Mer dans le monde entier. -

Dossier Départemental Sur Les RISQUES MAJEURS Dans Les
Cet ouvrage a été réalisé par : la Direction de la Défense et de la Sécurité de la Préfecture des Alpes-Maritimes Dossier Départemental Avec l’active participation de : sur les RISQUES MAJEURS dans les Alpes-Maritimes 06 06 Direction Régionale de l'Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 2007 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur Direction Départementale de l'Équipement des Alpes-Maritimes Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Alpes-Maritimes Office National des Forêts - Service départemental de Restauration des Terrains en Montagne des Alpes-Maritimes Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes ALPES-MARITIMES Que soient également remerciés : Le Cyprès, la Délégation Régionale d’EDF PACA, Météo France, le BRGM et tous ceux qui ont répondu à nos sollicitations. DANS LES DANS RISQUES MAJEURS DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES DÉPARTEMENTAL DOSSIER > Préface > Sommaire général Le RISQUE NATUREL ou TECHNOLOGIQUE MAJEUR ............................. 3 Les ENJEUX en PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR et la SITUATION dans les ALPES-MARITIMES ............................. 13 Le RISQUE NATUREL dans les ALPES-MARITIMES ............................. 19 > Mouvement de terrain ........................................... 20 > Inondation ....................................................... 27 > Feu de forêt ...................................................... 35 > Sismique ......................................................... 42 > Avalanche -

06001 Grasse 06002 Grasse 06003
Préfecture des Alpes-Maritimes Direction des élections et de la légalité COORDONNEES DES MAIRIES DES ALPES MARITIMES ET MAIRES Bureau des élections code Arrondis- Communes N° Téléphone N° fax Adresse 1 Adresse 2 Email Maire INSEE -sement Aiglun 06001 GRASSE 04 93 05 85 35 04 93 05 64 92 9 place de la Mairie 06910 AIGLUN [email protected] Mme MORALES Mario Amirat 06002 GRASSE 04 93 05 80 55 04 93 05 68 54 21 rue Mairie 06910 AMIRAT [email protected] M. CONIL Jean-Louis Andon 06003 GRASSE 04 93 60 45 40 04 93 60 74 23 23 place Victorien Bonhomme 06750 ANDON [email protected] Mme OLIVIER Michèle Antibes 06004 GRASSE 04 92 90 50 00 04 92 90 50 01 Cours Masséna - BP 2205 06606 ANTIBES [email protected] M. LEONETTI Jean Ascros 06005 NICE 04 93 05 84 21 04 93 05 68 24 Le Village 06260 ASCROS [email protected] M. GIOBERGIA Vincent Aspremont 06006 NICE 04 93 08 00 01 04 93 08 34 73 21 avenue Caravadossi 06790 ASPREMONT [email protected] M. FERRETTI Alexandre Auribeau-sur-Siagne 06007 GRASSE 04 92 60 20 20 04 93 60 93 07 Montée de la Mairie 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE [email protected] M. VARRONE Jacques Auvare 06008 NICE 04 93 05 14 29 04 93 05 14 29 Le Village 06260 AUVARE [email protected] Mme DROGOUL Bernadette Bairols 06009 NICE 04 93 02 90 46 04 93 02 90 46 Le Village 06420 BAIROLS [email protected] M. -

QUOI DE NEUF ? N°4 Bulletin D’Information À Destination Des Correspondants Du Réseau Loup
QUOI DE NEUF ? N°4 Bulletin d’information à destination des correspondants du réseau loup Rappel … de rappelS - les excréments et les poils doivent être collectés avec des gants (ou tout au moins en évitant de les toucher à mains nues) en particulier pour éviter les contaminations Dommages et présence du loup sur l’arc alpin dommageables à des analyses génétiques. - les excréments doivent être conservés au congélateur en évitant au maximum décongélation / recongélation. Par 256 des 354 constats établis au 31/10/99 ont fait l’objet d’un contre, les poils doivent être conservés dans des enveloppes classement en suspicion loup ou gros canidé indéterminé à température ambiante (contre 237 sur les 337 établis au 31/10/98). Ces constats ont - tout prélèvement doit être identifier correctement en regroupé 1164 victimes (dont 246 liées à 2 dérochements notant sur le sac ou l’enveloppe : département, date, massifs, 1 dans les Hautes Alpes, 1 en Savoie) contre 1006 en commune, récolteur, lieu-dit et n° d’ordre ; tout 1998. prélèvement non identifié est perdu et non utilisable Le nombre de constats (classés en suspicion loup ou gros - une fiche doit être remplie pour chaque indice. Une copie canidé indéterminé) : est transmise à l’animateur du réseau (ne surtout pas mettre - a diminué dans les Alpes Maritimes (146 contre 165) malgré les fiches au congélateur avec les excréments…) et une une légère extension des dommages vers le Haut Var ; autre à la DDAF. - a augmenté dans les Alpes de Haute Provence (23 contre 8) où - à chaque fiche indice et à chaque constat doit être joint les dommages sont localisés surtout dans les Monges et aussi une carte de localisation, sur laquelle le lieu exact est en Ubaye. -

Tempête Alex - Etat Des Routes Au 09/12/2020 a 14H30
TEMPÊTE ALEX - ETAT DES ROUTES AU 09/12/2020 A 14H30 ± 0 2.5 5 10 km Légende 10 9 ! C o l dd ee la L o m bb a rdd ee ! 11 ! T ous usage rs 21 12 ! 8 ! 5 ! 20 ! 7 4 6 ! ! 44 ! ! ! 3 Ac c ès re stre int (se c ours e t sous c ond itions) ! 19 ! !13 !43 2 !14 ! ! 18 161!7 !42 ! 40Isola 1 Route fe rm ée à la c irc ulation 41 ! ! ! 39 ! P 38 ! !37 !36 !35 34 ! 33 ! 32 R ! RM89 Route d u Boréon M Coup ée à l’inte rse c tion ave c la RM2565 2 2 31 0 ! Passage à gué m is e n se rvic e au p ont Maïssa 5 q ui p e rm e t d e d e sse rvir e nviron 190 c hale ts !9 30 ! sur 2km s d e la RM89 e nc ore e xistante . Le Boréon 8 Au-d e là, la route e st d étruite ; ! 7 29 ! ! réalisation d ’une p iste d 'ac c ès jusq u'au lac d u Boréon, 6 !5 ! ac c e ssib le e n 4x4 e t rése rvée se rvic e s e t travaux 4 28 ! ! (inac c e ssib le d ès le s p re m ière s c hute s d e ne ige ). RM89 !3 27 La Madone de Fenestre C o l dd ee ! 12 la C o u illo le 2 ! la C o u illo le ! 11 10 ! 26 9 ! ! 8 ! 1 ! ! 7 37 RM94 ! 16 ! ! Roubion 6 ! ! 7 5 Roure 25 ! 14 P 6 ! 15 ! ! 12 ! 4 ! 10 38 ! 11 ! ! 36 ! 5 40 ! ! P ! 3 8 4 3 2 ! 13 9! ! ! ! RM171 : Route d e la Gord olasq ue ! ! 1 ! 12 R 24 1 ! M3 ! ! 0 ! Ouve rte se lon le s m od alités suivante s: P 41 2 ! 35 ! Valdeblore ! 11 43 - Rétréc isse m e nts d e c haussée ! ! 44 R 23 51 ! 42 ! ! ! Saint Martin 45 !34 49 ! M Saint Sauveur P ! P - Lim itation d e tonnage à 3,5t ! 3 53 !50 ! Vésubie 10 1 ! 48 1 ! ! 47 !46 sur Tinée 22 Rimplas 54 ! ! ! 33 R ! M 55 2 ! !3 2 9 RM2565 ! ! 21 P 5 ! 6 32 ! !56 5 8 ! P P 31 Berthemont 20 -

1 N° 2012-0000069 LETTRE CIRCULAIRE
LETTRE CIRCULAIRE n° 2012-0000069 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.023.0 Montreuil, le 25/05/2012 04/06/2012 DIRECTION DE LA OBJET REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET Modification du champ d’application du versement transport (art. L. DU SERVICE 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales). GESTION DES COMPTES / GESTION DES OUTILS ET BASES DOCUMENTAIRES Texte à annoter : Lettre circulaire n° 2012-026 du 06/03/2012 Affaire suivie par : MR/PM - Création d’un Etablissement Public de Coopération intercommunal (EPCI) dénommé METROPOLE NICE COTE D’AZUR - Suppression de l’identifiant n° 9300609 au 31 déc embre 2011 et création de l’identifiant n° 9300618 au 1 er janvier 2012 - A compter du 1 er janvier 2012, le versement transport est instauré : - au taux de 2 % pour 24 communes, - un lissage du taux sur 5 ans pour les 22 autres communes (identifiants nos 9300616 et 9300617) - Attribution du numéro identifiant 9300618 - Coordonnées postales, comptables et bancaires Par un décret du 17 octobre 2011, le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’Immigration a décrété la création de METROPOLE NICE COTE D’AZUR par fusion de la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur avec la Communauté de Communes de la Tinée, la Communauté de Communes des stations du Mercantour et la Communauté de Communes de Vésubie-Mercantour, par intégration au périmètre du nouvel ensemble de la commune de la Tour. Par un arrêté du 7 novembre 2011, la Préfecture des Alpes-Maritimes a approuvé la création de METROPOLE NICE COTE -
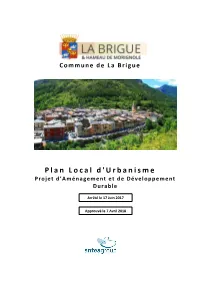
Plan Local D'urbanisme P�Ojet D’A���Age�E�T Et De D�Veloppe�E�T Durable
Commune de La Brigue Plan Local d'Urbanisme Pojet d’Aageet et de Dveloppeet Durable Arrêté le 17 Juin 2017 Approuvé le 7 Avril 2018 ________________________ Antea group _______________________ Commune de La Brigue Pla Loal d’Uaise – Pojet d’Aéageet et de Développeet Duale PLU approuvé le 7 Avril 2018 SOMMAIRE Préambule .................................................................................................................... 1 1. Axer prioritairement le développement du territoire en valorisant les transports collectifs ....................................................................................................................... 2 1.1. Le tai, poit fot de l’ogaisatio des dplaeets .............................................. 2 1.2. Maintenir une offre de transport locale ..................................................................... 2 1.3. Maîtise l’volutio du tafi poids louds su la RD 6204 .......................................... 2 2. Préserver l’idetité forte d’u village de otage itégré à l’eviroeet ....... 3 2.1. Maintenir les grands équilibres entre espaces naturels, forestiers, agricoles et artificialisés ......................................................................................................................... 3 2.1.1. Préserver le site Natura 2000 du Maguaeis et de l’ua de Tede à Saoge ....................... 3 2.1.2. Pseve l’itgit des espaes de iodivesit et favoise le aitie de la Trame Verte et Bleue ................................................................................................................................................ -

DH De Roubion 2007
2ème Manche Régionale Côte d'Azur ROUBION 2007 13-mai-07 Classement Scratch Clt Nom et prénom Club Catégorie Manche 1 Manche 2 Temps Ecart 1 LEROY Quentin FREJUS ROC D'AZUR SEN 2:43.42 2:41.82 2:41.82 2 MARINI Richard US CAGNES NORCO SUNTOUR SEN 2:46.06 2:43.74 2:43.74 1.92 3 SERGENT Lilian MERCANTOUR VTT MA1 2:49.64 2:51.30 2:49.64 7.82 4 GALLEAN Mathieu PEILLE VTT JUN 2:53.27 2:52.44 2:52.44 10.62 5 BORSARELLI Julien UC MONACO JUN 2:54.06 2:53.74 2:53.74 11.92 6 MUSETTI Geoffrey MONACO JUN 2:55.45 2:54.02 2:54.02 12.20 7 DELENTE Arnaud CALVISSON EGOBIKE CALVISSON EGJUN 2:54.09 2:54.95 2:54.09 12.27 8 ROVIGO Paul TRIAL SPIRIT SEN 2:59.55 2:54.92 2:54.92 13.10 9 BIERSTEKER Andres LES BOUDRAGUES JUN 2:55.66 2:55.32 2:55.32 13.50 10 BOSCH Etienne UC MONACO KONA GRASSROOTS SENST 2:55.58 2:58.73 2:55.58 13.76 11 BRANCA Andre NL CORSE SEN 2:58.67 2:57.23 2:57.23 15.41 12 LEENAERT Benoit ASM CICLYSME SAINT MAXIME MA1 2:57.62 2:57.62 15.80 13 LUC Adrien VTT LUBERON CAD 2:57.74 3:23.34 2:57.74 15.92 14 MARTIN Cedric PEILLE VTT JUN 2:59.39 2:58.35 2:58.35 16.53 15 BLANC David ASPTT DRAGUIGNAN MA1 2:58.43 3:06.48 2:58.43 16.61 16 BERTETTO Jonathan PEILLE VTT SEN 2:58.94 2:59.26 2:58.94 17.12 17 RACAUD Arthur US CAGNES CAD 3:00.16 2:59.27 2:59.27 17.45 18 CHAUVIN Robin VTT RANDO 04 COMMENCAL SENST 3:02.93 3:00.38 3:00.38 18.56 19 SORBIER Patrick CS LES PORTES DU MERCANTOUR MA1 3:00.66 3:01.48 3:00.66 18.84 20 FINOTTO Cedric NL SEN 3:00.73 3:02.14 3:00.73 18.91 21 FIGUIERE Loic AVC SISTERON CAD 3:00.84 3:02.04 3:00.84 19.02 22 REIG Damien UC MONACO