Les Lactaires En Franche-Comte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mycodiversity Studies in Selected Ecosystems of Greece: 5
Uploaded — May 2011 [Link page — MYCOTAXON 115: 535] Expert reviewers: Giuseppe Venturella, Solomon P. Wasser Mycodiversity studies in selected ecosystems of Greece: 5. Basidiomycetes associated with woods dominated by Castanea sativa (Nafpactia Mts., central Greece) ELIAS POLEMIS1, DIMITRIS M. DIMOU1,3, LEONIDAS POUNTZAS4, DIMITRIS TZANOUDAKIS2 & GEORGIOS I. ZERVAKIS1* 1 [email protected], [email protected] Agricultural University of Athens, Lab. of General & Agricultural Microbiology Iera Odos 75, 11855 Athens, Greece 2 University of Patras, Dept. of Biology, Panepistimioupoli, 26500 Rion, Greece 3 Koritsas 10, 15343 Agia Paraskevi, Greece 4 Technological Educational Institute of Mesologgi, 30200 Mesologgi, Greece Abstract — Very scarce literature data are available on the macrofungi associated with sweet chestnut trees (Castanea sativa, Fagaceae). We report here the results of an inventory of basidiomycetes, which was undertaken in the region of Nafpactia Mts., central Greece. The investigated area, with woods dominated by C. sativa, was examined for the first time in respect to its mycodiversity. One hundred and four species belonging in 54 genera were recorded. Fifteen species (Conocybe pseudocrispa, Entoloma nitens, Lactarius glaucescens, Lichenomphalia velutina, Parasola schroeteri, Pholiotina coprophila, Russula alutacea, R. azurea, R. pseudoaeruginea, R. pungens, R. vitellina, Sarcodon glaucopus, Tomentella badia, T. fibrosa and Tubulicrinis sororius) are reported for the first time from Greece. In addition, 33 species constitute new habitats/hosts/substrates records. Key words — biodiversity, macromycete, Mediterranean, mushroom Introduction Castanea sativa Mill., Fagaceae (sweet chestnut) generally prefers north- facing slopes where the rainfall is greater than 600 mm, on moderately acid soils (pH 4.5–6.5) with a light texture. It covers ca. -
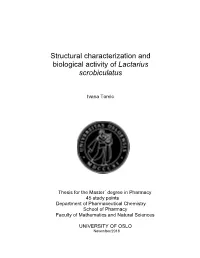
Structural Characterization and Biological Activity of Lactarius Scrobiculatus
Structural characterization and biological activity of Lactarius scrobiculatus Ivana Tomic Thesis for the Master´ degree in Pharmacy 45 study points Department of Pharmaceutical Chemistry School of Pharmacy Faculty of Mathematics and Natural Sciences UNIVERSITY OF OSLO November/2018 II Structural characterization and biological activity of Lactarius scrobiculatus Thesis for Master´ degree in Pharmacy Department for Pharmaceutical chemistry School of Pharmacy Faculty of Mathematics and Natural Sciences University in Oslo Ivana Tomic November 2018 Supervisor: Anne Berit Samuelsen III © Author 2018 Structural characterization and biological activity of Lactarius scrobiculatus Ivana Tomic http://www.duo.uio.no/ Print: Reprosentralen, Universitetet i Oslo IV Acknowledgments The present thesis was carried out at the Departement of Pharmaceutical Chemistry, University of Oslo (UiO), for the Master´s degree in Pharmacy at the University of Oslo. The other institute include Norwegian Centre of Molecular Medicine, where I have performed activity assay. First and foremost, I would like to thank to my supervisor Anne Berit Samuelsen for hers support and guidance throughout my work and useful comments during the writing. Further, I also want to thank Hoai Thi Nguyen and Cristian Winther Wold for help with carrying out GC and GC-MS analysis. Also, I am very thankful to Karl Malterud for help with NMR analysis. Special thanks to Suthajini Yogarajah for her patience and lab support. I would also like to thank to Kari Inngjerdingen for good and helpful Forskningforberedende kurs. My gratitude goes also to Prebens Morth group at NMCC, special to Julia Weikum and Bojana Sredic, who were always kind and helpful. Finally, I would like to express my fabulous thanks to my wonderful parents, my husband and my four sons for their great patience, sacrifice, moral support and encouragement during my master thesis. -

The Genus Coprinus and Allies
BRITISH MYCOLOGICAL SOCIETY FUNGAL EDUCATION & OUTREACH— [email protected] The genus Coprinus and allies Most of the species previously in the genus Coprinus and commonly known as Inkcaps were transferred into three new genera in 2001 on the basis of their DNA: Coprinopsis, Coprinellus and Parasola, leaving just three British species in Coprinus in the strict sense. The name Inkcap comes from the characteristic habit of most of these species of dissolving into a puddle of black liquid when mature - or ‘deliquescing’. In the past this liquid was indeed used for ink. Many Coprinus comatus species are very short-lived – some fruit bodies survive less than a day – Photo credit: Nick White and they occur in moist conditions throughout the year in a range of different habitats according to species including soil, wood, vegetation, roots and dung. Caps are thin-fleshed, usually white when young and often appear coated in fine white powder or fibrils called ‘veil’; they range in size from minute (less than 0.5cm) to more than 5cm across. Gills start out pale but soon turn black with the deliquescing spores. Stems are white and in some species very tall in relation to cap size. One species, Coprinopsis atramentaria, has a seriously unpleasant effect if eaten a few hours either side of consuming alcohol, acting like the drug ‘Antabuse’ used to treat alcoholics. Coprinopsis lagopus Photo credit: Penny Cullington Unless otherwise stated, text kindly provided by Penny Cullington and members of the BMS Fungus recording groups BRITISH MYCOLOGICAL SOCIETY FUNGAL EDUCATION & OUTREACH— [email protected] The genus Agaricus This genus contains not only our commercially grown shop mushroom (Agaricus bisporus) but also about 40 other species in the UK including the very tasty Agaricus campestris (Field Mushroom) and several others renowned for their excellent flavour. -

A Reference Genome of the European Beech (Fagus Sylvatica L.)
A reference genome of the European Beech (Fagus sylvatica L.) Bagdevi Mishra1,2, Deepak K. Gupta1,2, Markus Pfenninger1,3, Thomas Hickler1,4, Ewald Langer4, Bora Nam1,2, Juraj Paule6, Rahul Sharma1, Bartosz Ulaszewski7, Joanna Warmbier7, Jaroslaw Burczyk7, Marco Thines1,2 1 Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F), Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt am Main, Germany 2 Goethe University, Department for Biological Sciences, Institute of Ecology, Evolution and Diversity, Max-von-Laue-Str. 9, D-60438 Frankfurt am Main, Germany 3 Johannes Gutenberg Universität, Fachbereich Biologie, Institut für Organismische und Molekulare Evolutionsbiologie (iOME), , Gresemundweg 2, 55128 Mainz 4 Goethe University, Department for Geology, Institute of Geography, Max-von-Laue-Str. 23, D-60438 Frankfurt am Main, Germany 5 University of Kassel, FB 10, Department of Ecology, Heinrich-Plett-Str. 40, D-34132 Kassel, Germany 6 Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Frankfurt, Department of Botany and Molecular Evolution, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt am Main, Germany 7 Kazimierz Wielki University, Department of Genetics, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland Author for correspondence – Marco Thines ([email protected]). ORCID: 0000-0001-7740-6875 Downloaded from https://academic.oup.com/gigascience/advance-article-abstract/doi/10.1093/gigascience/giy063/5017772 by guest on 11 June 2018 Abstract Background: The European Beech is arguably the most important climax broad-leaved tree species in Central Europe, widely planted for its valuable wood. Here we report the 542 Mb draft genome sequence of an up to 300-year-old individual (Bhaga) from an undisturbed stand in the Kellerwald- Edersee National Park in central Germany. -

Fungal Genomes Tell a Story of Ecological Adaptations
Folia Biologica et Oecologica 10: 9–17 (2014) Acta Universitatis Lodziensis Fungal genomes tell a story of ecological adaptations ANNA MUSZEWSKA Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Pawinskiego 5A, 02-106 Warsaw, Poland E-mail: [email protected] ABSTRACT One genome enables a fungus to have various lifestyles and strategies depending on environmental conditions and in the presence of specific counterparts. The nature of their interactions with other living and abiotic elements is a consequence of their osmotrophism. The ability to degrade complex compounds and especially plant biomass makes them a key component of the global carbon circulation cycle. Since the first fungal genomic sequence was published in 1996 mycology has benefited from the technolgical progress. The available data create an unprecedented opportunity to perform massive comparative studies with complex study design variants targeted at all cellular processes. KEY WORDS: fungal genomics, osmotroph, pathogenic fungi, mycorrhiza, symbiotic fungi, HGT Fungal ecology is a consequence of osmotrophy Fungi play a pivotal role both in encountered as leaf endosymbionts industry and human health (Fisher et al. (Spatafora et al. 2007). Since fungi are 2012). They are involved in biomass involved in complex relationships with degradation, plant and animal infections, other organisms, their ecological fermentation and chemical industry etc. repertoire is reflected in their genomes. They can be present in the form of The nature of their interactions with other resting spores, motile spores, amebae (in organisms and environment is defined by Cryptomycota, Blastocladiomycota, their osmotrophic lifestyle. Nutrient Chytrydiomycota), hyphae or fruiting acquisition and communication with bodies. The same fungal species symbionts and hosts are mediated by depending on environmental conditions secreted molecules. -

A Preliminary Checklist of Arizona Macrofungi
A PRELIMINARY CHECKLIST OF ARIZONA MACROFUNGI Scott T. Bates School of Life Sciences Arizona State University PO Box 874601 Tempe, AZ 85287-4601 ABSTRACT A checklist of 1290 species of nonlichenized ascomycetaceous, basidiomycetaceous, and zygomycetaceous macrofungi is presented for the state of Arizona. The checklist was compiled from records of Arizona fungi in scientific publications or herbarium databases. Additional records were obtained from a physical search of herbarium specimens in the University of Arizona’s Robert L. Gilbertson Mycological Herbarium and of the author’s personal herbarium. This publication represents the first comprehensive checklist of macrofungi for Arizona. In all probability, the checklist is far from complete as new species await discovery and some of the species listed are in need of taxonomic revision. The data presented here serve as a baseline for future studies related to fungal biodiversity in Arizona and can contribute to state or national inventories of biota. INTRODUCTION Arizona is a state noted for the diversity of its biotic communities (Brown 1994). Boreal forests found at high altitudes, the ‘Sky Islands’ prevalent in the southern parts of the state, and ponderosa pine (Pinus ponderosa P.& C. Lawson) forests that are widespread in Arizona, all provide rich habitats that sustain numerous species of macrofungi. Even xeric biomes, such as desertscrub and semidesert- grasslands, support a unique mycota, which include rare species such as Itajahya galericulata A. Møller (Long & Stouffer 1943b, Fig. 2c). Although checklists for some groups of fungi present in the state have been published previously (e.g., Gilbertson & Budington 1970, Gilbertson et al. 1974, Gilbertson & Bigelow 1998, Fogel & States 2002), this checklist represents the first comprehensive listing of all macrofungi in the kingdom Eumycota (Fungi) that are known from Arizona. -

<I>Lactarius Fumosibrunneus</I>
ISSN (print) 0093-4666 © 2010. Mycotaxon, Ltd. ISSN (online) 2154-8889 MYCOTAXON doi: 10.5248/114.333 Volume 114, pp. 333–342 October–December 2010 Lactarius fumosibrunneus in a relict Fagus grandifolia var. mexicana population in a Mexican montane cloud forest Victor M. Bandala* & Leticia Montoya [email protected]; [email protected] Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología, A.C. P.O. Box 63, Xalapa, Veracruz 91000, Mexico Abstract — Lactarius fumosibrunneus, a species considered in the literature contaxic with L. fumosus, is interpreted here as an independent taxon due to the differences in the structure of pileipellis and presence of cystidia. Recognition of L. fumosibrunneus is supported by morphological comparison with original collections, Mexican samples, and type specimens of related taxa. Collections of L. fumosibrunneus were found in the Mexican montane cloud forest of Central Veracruz (east coast of Mexico) where it appears to be ectomycorrhizal partner of the tree Fagus grandifolia var. mexicana. Key words — ectomycorrhizal fungi, Fagaceae, neotropical fungi, Russulaceae, taxonomy Introduction Lactarius fumosibrunneus A.H. Sm. & Hesler is an American member of subgenus Plinthogalus (Burl.) Hesler & A.H. Sm. described by Smith & Hesler (1962) from Michigan, U.S.A. Based on the macroscopical resemblance of L. fumosibrunneus with L. fumosus Peck, Hesler & Smith (1979) considered it as conspecific. During a regular monitoring of the Mexican montane cloud forest in Veracruz (east coast of Mexico) by the authors (Montoya et al. 2010), some populations of a taxon macroscopically close to the aforementioned species were observed. After a comparative study of collections of these populations with specimens from U.S.A. -
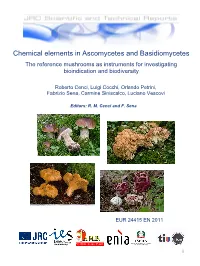
Chemical Elements in Ascomycetes and Basidiomycetes
Chemical elements in Ascomycetes and Basidiomycetes The reference mushrooms as instruments for investigating bioindication and biodiversity Roberto Cenci, Luigi Cocchi, Orlando Petrini, Fabrizio Sena, Carmine Siniscalco, Luciano Vescovi Editors: R. M. Cenci and F. Sena EUR 24415 EN 2011 1 The mission of the JRC-IES is to provide scientific-technical support to the European Union’s policies for the protection and sustainable development of the European and global environment. European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Via E.Fermi, 2749 I-21027 Ispra (VA) Italy Legal Notice Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of this publication. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server http://europa.eu/ JRC Catalogue number: LB-NA-24415-EN-C Editors: R. M. Cenci and F. Sena JRC65050 EUR 24415 EN ISBN 978-92-79-20395-4 ISSN 1018-5593 doi:10.2788/22228 Luxembourg: Publications Office of the European Union Translation: Dr. Luca Umidi © European Union, 2011 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Printed in Italy 2 Attached to this document is a CD containing: • A PDF copy of this document • Information regarding the soil and mushroom sampling site locations • Analytical data (ca, 300,000) on total samples of soils and mushrooms analysed (ca, 10,000) • The descriptive statistics for all genera and species analysed • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in mushrooms • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in soils 3 Contact information: Address: Roberto M. -

Angiocarpous Representatives of the Russulaceae in Tropical South East Asia
Persoonia 32, 2014: 13–24 www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj RESEARCH ARTICLE http://dx.doi.org/10.3767/003158514X679119 Tales of the unexpected: angiocarpous representatives of the Russulaceae in tropical South East Asia A. Verbeken1, D. Stubbe1,2, K. van de Putte1, U. Eberhardt³, J. Nuytinck1,4 Key words Abstract Six new sequestrate Lactarius species are described from tropical forests in South East Asia. Extensive macro- and microscopical descriptions and illustrations of the main anatomical features are provided. Similarities Arcangeliella with other sequestrate Russulales and their phylogenetic relationships are discussed. The placement of the species gasteroid fungi within Lactarius and its subgenera is confirmed by a molecular phylogeny based on ITS, LSU and rpb2 markers. hypogeous fungi A species key of the new taxa, including five other known angiocarpous species from South East Asia reported to Lactarius exude milk, is given. The diversity of angiocarpous fungi in tropical areas is considered underestimated and driving Martellia evolutionary forces towards gasteromycetization are probably more diverse than generally assumed. The discovery morphology of a large diversity of angiocarpous milkcaps on a rather local tropical scale was unexpected, and especially the phylogeny fact that in Sri Lanka more angiocarpous than agaricoid Lactarius species are known now. Zelleromyces Article info Received: 2 February 2013; Accepted: 18 June 2013; Published: 20 January 2014. INTRODUCTION sulales species (Gymnomyces lactifer B.C. Zhang & Y.N. Yu and Martellia ramispina B.C. Zhang & Y.N. Yu) and Tao et al. Sequestrate and angiocarpous basidiomata have developed in (1993) described Martellia nanjingensis B. Liu & K. Tao and several groups of Agaricomycetes. -

Insecticidal Properties of Lactarius Fuliginosus and Lactarius Fumosus
6470 Emomol. expo appl. 57: 23-28, 1990. © 1990 Kluwer Academic Publishers. Primed ill Belgium. 23 f'm'l::m~ bf U. 8. Dept. 0 4.~..cu..!tt.'U-e fOiJi u~ Insecticidal properties of Lactarius fuliginosus and Lactarius fumosus Patrick F. Dowd & Orson K. Miller I Northern Regional Research Center, A.R.S., U.S.D.A., Peoria, IL 61604, U.S.A.; 1 Department of Biology, Virginia Polytechnic Institute & State University, Blacksburg, VA 24061, U.S.A. Accepted: !Vlay I, 1990 Key words: Heliothis zea, Oncopeltlls fasciatus, chemotaxonomy, chromenes Abstract Acetone and ether: acetone extracts of the mushrooms Lactarius fuliginosus (Fr. ex Fr.) Fr., L. fumosus fumosus Peck and L.fumosus.fumosoides (Smith and Hesler) Smith and Hesler were toxic to the corn earworm, Heliothis zea (L.), while water extracts were inactive. Ether: acetone extracts of L. fuliginosus and L. fumosus fumosus were toxic to the large milkweed bug, Oncopeltusfasciatus (L.), and in some cases caused precocious development. Profiles of compounds separated chromatographically and visualized with chromene reagents, literature reports ofchromenes from L. fuliginosus, and known insecticidal/anti hormone effects of chromenes suggest that chromenes may be responsible for the activity of some of the extracts. Introduction exuding a milky fluid and/or color change reactions (Ramsbottom, 1954), which could be a The ability of higher plants to produce secondary warning reaction. Several species of Lactarius metabolites that serve a defensive role is well contain sesquiterpene lactones that deter insects recognized (Whittaker & Feeny, 1971). Ana from feeding (Nawrot et al., 1986). Other species, logously, the secondary metabolites produced by such as the European Lactariusfuliginosus (Fr. -

Bulletin De La Société Mycologique Et Botanique De La Région Chambérienne
Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne n° 16 2011 ISSN 1635-429X SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE ET BOTANIQUE DE LA RÉGION CHAMBÉRIENNE Association à but non lucratif créée en 1961, membre de la Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie reconnue d'utilité publique. OBJECTIFS : Faire progresser les connaissances et la protection en mycologie et en botanique. ACTIVITÉS : Sorties sur le terrain : une vingtaine par an, en semaine et le week-end. Réunions de détermination et de formation mycologique et botanique tous les lundis à 20 heures au siège social à la maison des associations de Chambéry. Loupes binoculaires, microscopes et bibliothèque sont à la disposition des adhérents. Plusieurs soirées conférences sont organisées au cours de l'année. SIÈGE SOCIAL : Maison des associations Boîte U 10 rue Saint-François-de-Sales 73000 CHAMBÉRY Site Internet : http://smbrc.fr BUREAU : Président d'honneur : Madame le maire de Chambéry. Président : Maurice Durand. Vice-présidents : Thierry Delahaye, André Dudoret, Gérard Mouton. Secrétaires : Christophe Chillet, Régine Revel. Trésoriers : Véronique Le Bris, Claude Choudin. COTISATION : Le montant annuel est fixé en assemblée générale (24 euros en 2011). ÉDITORIAL 1961-2011, pour le cinquantenaire de notre association, il semblait évident de parler des grandes figures qui ont marqué notre association, mais rapidement il apparait que le choix est impossible. 2011, c’est aussi l’année du bénévolat et du volontariat. Alors, tout devient évident : ce cinquantenaire nous le devons à tous les bénévoles qui ont œuvré successivement au sein de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne. Je voudrais souligner et remercier le travail accompli par nos prédécesseurs, qu’ils soient membres du bureau, du conseil d’administration, ou adhérents bénévoles, chacun a su apporter sa pierre à notre édifice. -

Inventaire Des Espèces De BASIDIOMYCOTA Du Gard Au 15 Février 2015, Après Consultation De 8 Publications Périodiques Et 22 Ouvrages De Mycologie*
Inventaire des espèces de BASIDIOMYCOTA du Gard au 15 février 2015, après consultation de 8 publications périodiques et 22 ouvrages de Mycologie* Cette liste permet de voir rapidement toutes les espèces de Basidiomycota signalées dans le Gard NB 1) Si les noms relevés dans les différentes publications apparaissent deux ou plusieurs fois de façon identique, on n’indiquera qu’une seule appellation de genre et d’espèce dans « Noms des genres et d’espèces actuels ». NB 2) Si, pour un nom de Genre et d’espèce actuel, les noms relevés dans les différentes publications ne sont pas identiques, on conservera les deux appellations et on caractérisera cette similitude en identifiant les cellules de la première colonne d’une même couleur. NB 3) Pour connaitre les bulletins, revues, ouvrages de mycologie d’où proviennent ces noms de genres et d’espèces ainsi que les lieux où ces espèces ont été récoltées, consulter « Répartition des espèces par arrondissement » et « Répartition des espèces par commune ». NB 4) Les noms de Genres et d’espèces écrits en vert sont tirés du Site « Species fungorum » ; écrits en bleu, ils proviennent du Site « Index Fungorum » ; écrits en noir, ils ne proviennent ni de l’un ni de l’autre. *Voir la liste des publications périodiques et ouvrages de mycologie consultés A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z BASIDIOMYCOTA (222 Genres, 971 espèces ou variétés) Noms de Genres et d’espèces actuels Noms utilisés dans les publications et (Commentaires) Abortiporus (Meruliaceae – Polyporales – Agaricomycetes) Abortiporus biennis (Bull.) Singer (1944) Doedalea biennis Bull.