Lieu De L'histoire, Histoire Du Lieu Ou Comment Fabriquer Un Lieu Saint Bouddhique Tibétain
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Call of the Siren: Bod, Baútisos, Baîtai, and Related Names (Studies in Historical Geography II)
The Call of the Siren: Bod, Baútisos, Baîtai, and Related Names (Studies in Historical Geography II) Bettina Zeisler (Universität Tübingen) 1. Introduction eographical or ethnical names, like ethnical identities, are like slippery fishes: one can hardly catch them, even less, pin them G down for ever. The ‘Germans’, for example, are called so only by English speakers. The name may have belonged to a tribe in Bel- gium, but was then applied by the Romans to various tribes of North- ern Europe.1 As a tribal or linguistic label, ‘German (ic)’ also applies to the English or to the Dutch, the latter bearing in English the same des- ignation that the Germans claim for themselves: ‘deutsch’. This by the way, may have meant nothing but ‘being part of the people’.2 The French call them ‘Allemands’, just because one of the many Germanic – and in that case, German – tribes, the Allemannen, settled in their neighbourhood. The French, on the other hand, are called so, because a Germanic and, in that case again, German tribe, the ‘Franken’ (origi- nally meaning the ‘avid’, ‘audacious’, later the ‘free’ people) moved into France, and became the ruling elite.3 The situation is similar or even worse in other parts of the world. Personal names may become ethnic names, as in the case of the Tuyu- hun. 4 Names of neighbouring tribes might be projected onto their overlords, as in the case of the Ḥaža, who were conquered by the Tuyuhun, the latter then being called Ḥaža by the Tibetans. Ethnic names may become geographical names, but then, place names may travel along with ethnic groups. -

Tibet: Why It Is Important to China? a Geographic Perspective by Paul Kaliszewski Cranbrook Kingswood Boys Middle School
Unit Plan Tibet: Why it is Important to China? A Geographic Perspective By Paul Kaliszewski Cranbrook Kingswood Boys Middle School Introduction The following five day unit plan focuses on the importance of the Plateau of Tibet, generally, and the Tibetan Autonomous Republic (TAR), specifically, to the People’s Republic of China from a geographical perspective. While there has been much recent scholarship on Tibet at the university level, Tibet remains an area either largely ignored in K-12 curricula or, if covered, is presented in a very romantic, biased (usually, anti-Chinese) manner. The purpose of this unit is to demonstrate the importance of the TAR to China in geo-political terms in order to better understand China’s stance on this often highly contentious area. The unit will comprise five, 45 minute class periods, designed for use in grades 6 or 7. However, at the teacher’s discretion, the lesson could be modified for any secondary (6-12) curriculum. Standards are based on the State of Michigan’s Proposed Social Studies Content Expectations for Grade 6. Objective: To use skills of geographic inquiry and analysis to answer important questions about relationships between people, their cultures, and their environment, in their community and within the larger world context. Day 1 Activities: Hand out KWLQ chart (see attached) and conduct a KWLQ activity, asking students to list in column 1 as many facts as they can about what they know about the physical and human geography of Tibet and the Tibetan Plateau. Review with students, creating a master list that will be saved. -

Educating the Heart
Approaching Tibetan Studies About Tibet Geography of Tibet Geographical Tibet Names: Bod (Tibetan name) Historical Tibet (refers to the larger, pre-1959 Tibet, see heavy black line marked on Tibet: A Political Map) Tibet Autonomous Region or Political Tibet (refers to the portion of Tibet named by People’s Republic of China in 1965, see bolded broken line on Tibet: A Political Map) Khawachen (literary Tibetan name meaning “Abode of Snows”) Xizang (the historical Chinese name for meaning “Western Treasure House”) Land of Snows (Western term) Capital: Lhasa Provinces: U-Tsang (Central & Southern Tibet) Kham (Eastern Tibet) Amdo (Northeastern Tibet) Since the Chinese occupation of Tibet, most of the Tibetan Provinces of Amdo and Kham have been absorbed into the Chinese provinces of Qinghai, Sichuan, and Yunnan Main Towns: Llasa, Shigatse, Gyantse, Chamdo Area: 2,200,000 Sq. kilometers/850,000 sq. miles Elevation: Average 12-15,000 feet Tibet is located on a large plateau called the Tibetan Plateau. Borders: India, Nepal, Bhutan, Burma (south) China (west, north, east) Major Mountains Himalaya (range to south & west) and Ranges Kunlun (range to north) Chomolungma (Mt. Everest) 29,028 ft. Highest peak in the world Kailas (sacred mountain in western Tibet to Buddhists, Hindus & Jains) The Tibetan Plateau is surrounded by some of the world’s highest mountain ranges. Major Rivers: Ma Chu (Huzng He/Yellow Dri Chu (Yangtze) Za Chu (Mekong) Ngul Chu (Salween) Tsangpo (Bramaputra) Ganges Sutlej Indus Almost all of the major rivers in Asia have their source in Tibet. Therefore, the ecology of Tibet directly impacts the ecology of East, Southeast and South Asia. -

Challenging Central Tibet's Dominance
! CHALLENGING CENTRAL TIBET’S DOMINANCE OF HISTORY: THE OCEANIC BOOK, A 19TH-CENTURY POLITICO-RELIGIOUS GEOGRAPHIC HISTORY GRAY TUTTLE This article considers how the northeastern part of the Tibetan plateau, called A mdo (now in Qinghai, Gansu, and northern Sichuan) came to be seen as part of Tibet, focusing mainly on a mid-nineteenth-century text but also examining pre-modern sources.1 Explicitly geographic texts dealing in detail with most of the territory of what we now consider Tibet only date from the eighteenth century.2 These relatively late geographic sources share a distinctively early modern conception of a plateau-wide Tibetan region, and are quite different from earlier histories of ‘Tibet,’ which tended to pay little attention to most of eastern Tibet. But rather than merely focusing on such texts, I have expanded my focus to include all historical works that are dominated by any suggestion of ‘cartographic’ narratives. By this I mean texts that focus on broad regions of Tibet and especially how particular regions are politically and religiously controlled. This is what Julia Thomas has called “the 1 I want to thank the late Gene Smith, Dan Martin, Kurtis Schaeffer and Jann Ronis for all their bibliographic work on Tibetan histories, on which I have relied in this present study. For an introduction to Gene Smith’s work see www.tbrc.org and Gene Smith 2001 Among Tibetan Texts: History and Literature of the Himalayan Plateau. Kurtis R. Schaeffer (ed.) Boston: Wisdom Publications. For Dan Martin, see his 1997 Tibetan Histories: A Bibliography of Tibetan-Language Historical Works. -

The Life and Scholarship of the Eighteenth- Century Amdo Scholar Sum Pa Mkhan Po Ye Shes Dpal ’Byor (1704-1788)
Renaissance Man From Amdo: the Life and Scholarship of the Eighteenth- Century Amdo Scholar Sum Pa Mkhan Po Ye Shes Dpal ’Byor (1704-1788) The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:40050150 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Renaissance Man From Amdo: The Life and Scholarship of the Eighteenth-Century Amdo Scholar Sum pa Mkhan po Ye shes dpal ’byor (1704-1788) ! A dissertation presented by Hanung Kim to The Department of East Asian Languages and Civilizations in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History and East Asian Languages Harvard University Cambridge, Massachusetts April, 2018 © 2018 – Hanung Kim All rights reserved. ! Leonard W. J. van der Kuijp Hanung Kim Renaissance Man From Amdo: The Life and Scholarship of the Eighteenth- Century Amdo Scholar Sum pa Mkhan po Ye shes dpal ’byor (1704-1788) Abstract! This dissertation examines the new cultural developments in eighteenth-century northeastern Tibet, also known as Amdo, by looking into the life story of a preeminent monk- scholar, Sum pa Mkhan po Ye shes dpal ’byor (1708-1788). In the first part, this study corroborates what has only been sensed by previous scholarship, that is, the rising importance of Amdo in Tibetan cultural history. -

Four Years' Journeyings Through Great Tibet, by One of the Trans-Himalayan Explorers of the Survey of India Author(S): J
Four Years' Journeyings Through Great Tibet, by One of the Trans-Himalayan Explorers of the Survey of India Author(s): J. T. Walker Source: Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, New Monthly Series, Vol. 7, No. 2 (Feb., 1885), pp. 65-92 Published by: Wiley on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1800295 . Accessed: 16/06/2014 02:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) and Wiley are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.202 on Mon, 16 Jun 2014 02:33:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions PROCEEDINGS OF THE ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY AND MONTHLY RECOED OF GEOGEAPHY. Four Years9 Joumeyings through Great Tibet, by one of the Trans- Himalayan Explorers of the Survey of India. By General J. T. Walker, c.b., f.r.s., late Surveyor-General of India. -

Bulletin of Tibetology Seeks to Serv3 the Specialist As Well As the General Reader with an Interest in This Field of Study
Bulletin of VOL. II No. 1.. 4 March 1965 NAMGYAL INSTITUTE OF TlBETOLOGY GANGTOK. SIKKIM --The Bulletin of Tibetology seeks to serV3 the specialist as well as the general reader with an interest in this field of study. The motif portraying the Stupa on the mountains suggests the dimensions of th9 field- EDITORS GYALMO HOPE NAMGYAL T. SHERAB GYAlTSHEN NIRMAl C. SINHA Bullet;n Vol. II No. 1. '1' ... " 4 MARCH 1965 NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOlOGY GANGTOK. SIKKIM "".... --' 'fJ~a::f·~·"'9C::·filll·"l~z:.· a;~' ~q'~' G~G ...:> , st published 4 March, 1965 Reprinted 1 Saptember, 1991 Printed at Impression Gangtok Published by The Director Namgyal Institute of Tibetology Gangtok CONTENTS Page HOW OLD WAS SRONG BRTSAN SGAMPO 6 H. E. RICHARDSON PRINCIPLES .oF BUDDHIST TANTRISM 9 LAMA ANAGARIKA GOVINDA THE TIBETAN TRADITION OF GEOGR PHY 17 TURR~LL V. WYLIE . UTTARAKURU' 2'7 BUDDHA PRAKASH NOTES &. TOPICS 36 NIRMAL C. SINHA CONTRIBUTORS IN THIS ISSUE: HUGH eDWARD RICHARDSON Held diplomatic assignments in lhasa (1936.40 & 1946-50) and Chungking (1942-44); reputed for linguistic abilities. knows several Asian languages. speaks lhasa cockney and reads . classical Tibetan with native intonation, conversed with the poet Tagore in Bengali; was (1961-62) Visiting Professor in Tibetan languaQe and history at University of Washington. Seattle, USA; reCipient of the Gold Medal of the Royal Central Asian Society, UK; lelding authority on history of Tibet, ancient as well as modern, LAMA ANAGARIKA GOVINDA An Indian national of European (German) descent and Buddhist (Mahayana) faith; began asa student of humanities in Western discipline ) Friebury. -

Sino-Tibetan Relations 1990-2000: the Internationalisation of the Tibetan Issue
Sino-Tibetan Relations 1990-2000: the Internationalisation of the Tibetan Issue Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie der Philipps-Universität Marburg vorgelegt von Tsetan Dolkar aus Dharamsala, Indien 29 Februar 2008 Erstgutachter: Prof. Dr. Dirk Berg-Schlosser Zweitgutachter: Prof. Dr. Wilfried von Bredow Sino-Tibetan Relations 1990-2000: the Internationalisation of the Tibetan Issue Submitted by Tsetan Dolkar Political Science Department, Philipps University First Advisor: Professor Dr. Dirk Berg-Schlosser Second Advisor: Professor Dr. Wilfried von Bredow A dissertation submitted to the Faculty of the Social Sciences and Philosophy of Philipps University in partial fulfillment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Political Science Philipps University, Marburg 29 February 2008 TABLE OF CONTENTS Acknowledgement vi Maps viii List of Abbreviations xi PART I A GLIMPSE INTO TIBET’S PAST Chapter 1 Tibet: A Brief Historical Background 1 1.1.1 Introduction 1 1.1.2 Brief Historical Background 4 1.1.2.1 Tibetan Kings (624-842 AD) and Tang China (618-756 AD) 4 1.1.2.2 The Buddhist Revolution in Tibet (842-1247) and the Song Dynasty (960-1126) 8 1.1.2.3 The Sakya Lamas of Tibet (1244-1358) and the Mongol Empire (1207-1368) 10 1.1.2.4 The Post-Sakya Tibet (1337-1565) and the Ming China (1368-1644) 11 1.1.2.5 The Gelugpa’s Rule (1642-1950) and the Manchu Empire (1662-1912) 13 1.1.2.6 Tibet in the Twentieth Century 19 -
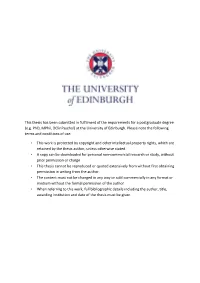
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. A MINORITY WITHIN A MINORITY Being Bonpo in the Tibetan Community in Exile YU-SHAN LIU PhD in Social Anthropology The University of Edinburgh 2012 Signed Declaration I hereby declare that this thesis has been composed entirely by me, the candidate, Yu-Shan Liu. Unless otherwise stated or indicated, the work is all my own, and has not been submitted for any other degree or professional qualification. Signed Abstract This thesis presents a study of the Bonpo in Dolanji, a Tibetan refugee settlement in North India. The Bonpo are a distinctive religious minority within the Tibetan refugee population. In the 1950s, Chinese Communist forces occupied Tibet and, in 1959, the fourteenth Dalai Lama fled Tibet into exile in India. In 1960, the Tibetan Government-in-Exile was established in Dharamsala, and emphasised a ‘shared’ Buddhist heritage as being central to the Tibetan national identity. -

TIBET 2OOO Environment and Development Issues
TIBET 2OOO Environment and Development Issues Environment and Development Desk, DIIR Central Tibetan Administration Gangchen Kyishong Dharamsala, HP, India 2000 Published by the Environment and Development Desk, DIIR Central Tibetan Administration Gangchen Kyishong, Dharamsala, 176215 District Kangra, HP, India [email protected] website: www.tibet.net April 2000 Copyright 2000 Environment and Development Desk, DIIR ISBN 81-86230-29-7 Tibet 2000: Environment and Development Issues Project Team Project Director and Principal Researcher Tsultrim Palden Dekhang Researchers Tashi Choedon Bidhartsang Khedup Waiser Judy Duncan Nick Schofield Lorne Stockman Laura Ziemer Editorial Consultant Jane Perkins Production Tsering Yangkey Dekyi Tsondue Cartographer Dr. Kunchok Tsundue Acknowledgements The Environment and Development Desk, DIIR would like to thank the following individuals and organisations for their contributions and support: Anusha Fernando, Nicholas Schofield, Judy Duncan, Lorne Stockman, Laura Ziemer, Kunchok Tsundue, Susan Mizrahi, Gabriel Lafitte, Peter Raine, Catherine Moore, John Ackerly, Lodi G. Gyari, Tempa Tsering, Bhuchung K. Tsering, Tseten Samdrup, Chris Rapaport, Leslie Dickout, Karin Tang, Markus Strumpel, Jordhen Chazotsang, Pema Dorjee, Rachel Fleming, Department of Security, Planning Council and Tibetan Reception Centre of CTA, Library of Tibetan Works and Archives, ICT, ICLT, TIN, TYC and the staff of DIIR. Our special thanks to Milarepa Fund for funding the research for this report. For further information on Tibet and its environment, please visit our official website: www.tibet.net DEDICATION Dedicated to His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet whose concern for the future of this planet and message of non-violence continues to inspire us all. PREFACE WHY SAVE TIBET’S ENVIRONMENT? TIBET, popularly known as the “Roof of the World”, existed for over 2,000 years as a sovereign nation, with its three administrative regions, Kham, Amdo and U-Tsang, spanning 2.5 million sq. -

Propagation of the Deformation and Growth of the Tibetan-Himalayan
Earth-Science Reviews 143 (2015) 36–61 Contents lists available at ScienceDirect Earth-Science Reviews journal homepage: www.elsevier.com/locate/earscirev Propagation of the deformation and growth of the Tibetan–Himalayan orogen: A review Yalin Li a,⁎, Chengshan Wang a, Jingen Dai a,GanqingXub, Yunling Hou a,XiaohanLia a State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China b Department of Earth and Ocean Science, University of Waikato, Hamilton 2001, New Zealand article info abstract Article history: Long-standing problems in the geological evolution of the Tibetan–Himalayan orogen include where the Received 22 January 2014 India–Asia convergence was accommodated and how the plateau grew. To clarify these problems, we review Accepted 13 January 2015 the deformations and their role in the plateau's growth. Our results show that ~1630 km of shortening occurred Available online 22 January 2015 across the Tibetan–Himalayan orogen since ~55 Ma, with more than ~1400 km accommodated by large-scale thrust belts. These thrust belts display an outward expansion from central Tibet and couple with the surficial Keywords: fi – Tibetan plateau uplift. The development of the Tibetan plateau involved three signi cant steps: Primitive plateau (~90 55 Ma), – – Fold–thrust belt Proto-plateau (~55 40 Ma), and Neoteric plateau (~40 0 Ma). Several processes have collaborated to produce Extension the Proto-plateau, including the pre-existing Primitive plateau, the India–Asia collision, and subductions of Crustal shortening Greater India and Songpan–Ganzi beneath the Lhasa–Qiangtang terrane. Since ~40 Ma, the Proto-plateau, Uplift which was dominated by a topographic gradient, lower crustal flow and continuous India–Asia convergence, Cenozoic experienced three periods of rapid outward growth (~40–23, ~23–10, and ~10–0 Ma) in general. -
UCLA Electronic Theses and Dissertations
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Belonging and Ethnicity in China’s West: Urbanizing Minorities in Xining City on the Eastern Tibetan Plateau Permalink https://escholarship.org/uc/item/1xm3s8ps Author Grant, Andrew Publication Date 2016 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Belonging and Ethnicity in China’s West: Urbanizing Minorities in Xining City on the Eastern Tibetan Plateau A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Geography by Andrew Nicholas Grant 2016 © Copyright by Andrew Nicholas Grant 2016 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Belonging and Ethnicity in China’s West: Urbanizing Minorities in Xining City on the Eastern Tibetan Plateau by Andrew Nicholas Grant Doctor of Philosophy in Geography University of California, Los Angeles, 2016 Professor John A. Agnew, Chair China’s twenty-first century economic rise has had a powerful impact on the lives of Tibetans and other ethnic minorities living in its Western Region, the administrative region composed of China’s Inner Asian border provinces. Urbanization in this region is reshaping the lives and livelihoods of erstwhile farmers and pastoralists moving to urban environments. The state hopes to decrease ethnic tension through economic development and the enrollment of all frontier peoples into the national consumer economy. In light of this situation, this dissertation asks: are Tibetans’ lives and livelihoods changing for better or for worse? Focusing on one exemplary city in this region, I argue that despite increased material prosperity, ethnic differences have been exacerbated as perceptions about unequal access to work and ethnic discrimination have proliferated.