Analyse De La Traduction D'un Texte Multimodal : La Bande Dessinée
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1 Indigenous Litter-Ature 2 Drinking on the Pre-Mises: the K'ulta “Poem” 3 Language, Poetry, Money
Notes 1 Indigenous Litter-ature 1 . E r n e s t o W i l h e l m d e M o e s b a c h , Voz de Arauco: Explicación de los nombres indí- genas de Chile , 3rd ed. ( Santiago: Imprenta San Francisco, 1960). 2. Rodolfo Lenz, Diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de len- guas indígenas americanas (Santiago: Universidad de Chile, 1910). 3 . L u d o v i c o B e r t o n i o , [ 1 6 1 2 ] Vocabulario de la lengua aymara (La Paz: Radio San Gabriel, 1993). 4 . R . S á n c h e z a n d M . M a s s o n e , Cultura Aconcagua (Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y DIBAM, 1995). 5 . F e r n a n d o M o n t e s , La máscara de piedra (La Paz: Armonía, 1999). 2 Drinking on the Pre-mises: The K’ulta “Poem” 1. Thomas Abercrombie, “Pathways of Memory in a Colonized Cosmos: Poetics of the Drink and Historical Consciousness in K’ulta,” in Borrachera y memoria , ed. Thierry Saignes (La Paz: Hisbol/Instituto Francés de Estudios Andinos, 1983), 139–85. 2 . L u d o v i c o B e r t o n i o , [ 1 6 1 2 ] Vocabulario de la lengua aymara (La Paz: Radio San Gabriel, 1993). 3 . M a n u e l d e L u c c a , Diccionario práctico aymara- castellano, castellano-aymara (La Paz- Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1987). -

Creating Culture Through Food, a Study of Traditional Argentine Foods
Unit Title: Creating Culture through Food: A Study of Traditional Argentine Foods Author: Kyra Brogden George Watts Magnet Montessori, Durham, NC Subject Area: Writing and Language, Social Studies Topic: Food and culture Grade Level: 1st, 2nd, 3rd (Lower Elementary) Time Frame: 4 days of 45-minute lessons on Argentine food, nutrition and culture Cooking: 3 days of cooking and 1 day to put together the cookbook *The cooking lessons will require more time and resources. Also the cookbook may require going through a rough draft and final copy that can occur after the lessons themselves are completed. That can be done at the teachers’ discretion. Brief Summary: This unit will focus on helping students understand the role of nutrition and food in defining a culture by studying Argentine nutrition and food. The first four lessons will focus on comparing nutritional guidelines, evaluating food, and a discussion about meal times in both the United States and Argentina. The students will then embark on a series of three lessons that each focus on a traditional Argentine food. The students will cook the food, create a nutritional analysis, learn about the history of that food, and then write food reviews. The students will ultimately make a cookbook with the recipes, pictures, nutritional analysis, and their own food review. Established Goals are taken from the Common Core Standards for Grade 2: Research to Build and Present Knowledge 7. Participate in shared research and writing projects (e.g. read a number of books on a single topic to produce a report; record science observations) 8. -

Argentines' Perceptions of the World Order, Foreign Policy and Global Issues Engdownload
NATIONAL SURVEY / ARGENTINES’ PERCEPTIONS OF THE WORLD ORDER, FOREIGN POLICY AND GLOBAL ISSUES (Round 6) PRESS CONTACTS: Alejandro CATTERBERG / President, Poliarquía Consultores Benjamin N. GEDAN / Director, Argentina Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars SUGGESTED CITATION ARGENTINA PULSE #6. Poliarquía-Wilson Center Survey, April 2020. “Argentines’ Perceptions of the World Order, Foreign Policy and Global Issues.” ABOUT ARGENTINA PULSE ArgentinaPulse is a joint undertaking of Poliarquía Consultores and the Argentina Project at the Wilson Center. The aim of ArgentinaPulse is to produce, scientifically and systematically, analysis and public opinion data on Argentines’ perceptions of the world order, international relations and global issues. Poliarquía Consultores provides ArgentinaPulse with the technical capacity to produce high-quality social science research, while the Wilson Center contributes its expertise studying international affairs. ABOUT POLIARQUIA CONSULTORES Poliarquía Consultores is Argentina’s leading firm in providing strategic information to interpret the country’s sociopolitical context. The company works in accordance with the highest ethical and professional standards to ensure accuracy in its analyses and to guarantee innovation in developing creative solutions. Using the latest social research techniques, Poliarquía Consultores systematically produces public opinion studies, market research and sociopolitical analyses at the local, regional and national levels. ABOUT THE WILSON CENTER’S ARGENTINA PROJECT The Argentina Project aspires to be the premiere institution for policy relevant research on the political and economic reforms underway in Argentina. This ambitious project takes advantage of renewed significant interest in Argentina in the public and private sectors in the United States, and provides a forum for non-partisan discussions about Argentina’s challenges, opportunities and growing regional and global engagement. -

Argentina-Report-World
CultureGramsTM World Edition 2015 Argentina (Argentine Republic) Before the Spanish began to colonize Argentina in the 1500s, BACKGROUND the area was populated by indigenous groups, some of whom belonged to the Incan Empire. However, most groups were Land and Climate nomadic or autonomous. Colonization began slowly, but in Argentina is the-eighth largest country in the world; it is the 1700s the Spanish became well established and somewhat smaller than India and about four times as big as indigenous peoples became increasingly marginalized. The the U.S. state of Texas. Its name comes from the Latin word British tried to capture Buenos Aires in 1806 but were argentum, which means “silver.” Laced with rivers, Argentina defeated. The British attempt to conquer the land, coupled is a large plain rising from the Atlantic Ocean, in the east, to with friction with Spain, led to calls for independence. At the the towering Andes Mountains, in the west, along the Chilean time, the colony included Paraguay and Uruguay as well as border. The Chaco region in the northeast is dry, except Argentina. during the summer rainy season. Las Pampas, the central Independence plains, are famous for wheat and cattle production. Patagonia, A revolution erupted in 1810 and lasted six years before to the south, consists of lakes and rolling hills and is known independence was finally declared. Those favoring a centrist for its sheep. The nation has a varied landscape, containing government based in Buenos Aires then fought with those such wonders as the Iguazú Falls (1.5 times higher than who favored a federal form of government. -

Ruin, Resistance and Renewal in a Qom Community of Northern Argentina
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2015 Fighting With Wine: Ruin, Resistance and Renewal in a Qom Community of Northern Argentina Christopher A. Golias University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Indigenous Studies Commons, Latin American Languages and Societies Commons, Latin American Studies Commons, and the Social and Cultural Anthropology Commons Recommended Citation Golias, Christopher A., "Fighting With Wine: Ruin, Resistance and Renewal in a Qom Community of Northern Argentina" (2015). Publicly Accessible Penn Dissertations. 1741. https://repository.upenn.edu/edissertations/1741 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/1741 For more information, please contact [email protected]. Fighting With Wine: Ruin, Resistance and Renewal in a Qom Community of Northern Argentina Abstract This study examines public binge drinking among the Qom (Toba) ex-foragers of Formosa, northern Argentina. Based upon 15 months of ethnographic fieldwork in a peri-urban Qom barrio (Lot 84), this analysis relates binge drinking to Qom ethnohistory, community life, and interactions with the Argentine state. The public, performative nature of Qom binge drinking is explored; intoxication is shown to convey in sometimes violent public spectacle the pathos of their socioeconomic marginality, reinforce non- indigenous Argentines’ entrenched perceptions of violent “Indians”, and paradoxically provide the Qom with vehicle for continued colonial resistance. Many Qom view drinking problems as rooted in Lot 84’s close proximity to the city (Formosa) relative to more rural Qom villages. Thus they reference a continuum of health that runs from urban, non-indigenous spaces to the rural bush country where foods—including home-brewed alcohol—are healthful rather than harmful. -

AN ARGENTINE PERSPECTIVE a Discussion with Practitioners and Academics Orfalea Center for Global & International Studies University of California, Santa Barbara
THE ROLE OF RELIGION IN GLOBAL CIVIL SOCIETY: AN ARGENTINE PERSPECTIVE A Discussion with Practitioners and Academics Orfalea Center for Global & International Studies University of California, Santa Barbara at Universidad del Cema Buenos Aires, Argentina August, 2009 Sponsored by the Henry R. Luce Initiative on Religion and International Affairs LIST OF PARTICIPANTS: Mercedes Carluccio Fernando López-Alves Project Director, Global Democracy Professor of Sociology, UCSB and Special Carlos Escudé Advisor, CEIEG Director, Centro de Estudios Internacionales y Leonor Slavsky de Educacion para la Globalizacion (CEIEG) Senior researcher, National Institute of Universidad del Cema (UCEMA) Anthropology, National Culture Secretariat Victor Faessel Program Director, Orfalea Center for Global & An Opportunistic Collaboration International Studies, UCSB Kurt Frieder The purpose of this Buenos Aires workshop was outlined by Mark Juergensmeyer, Director of the Founder and Director, Fundacion Huesped Orfalea Center for Global and International Studies Rebeca González Esteves at UC Santa Barbara, who said that he hoped it Graduate Student, UCEMA would provide insights into the variety of ways in which religion and global civil society relate in the Giles Gunn Latin American context. The workshop was part of a Chair , Global & International Studies Program four-year project on Religion in Global Civil Society University of California, Santa Barbara organized by the Orfalea Center and funded by the Henry Luce Foundation, a project that will create Beatriz -
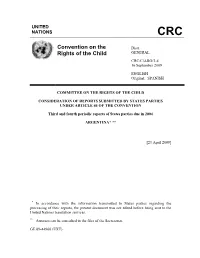
Convention on the Rights of the Child During the Period Under Review
UNITED NATIONS CRC Convention on the Distr. Rights of the Child GENERAL CRC/C/ARG/3-4 16 September 2009 ENGLISH Original: SPANISH COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 44 OF THE CONVENTION Third and fourth periodic reports of States parties due in 2004 ARGENTINA* ** [23 April 2008] * In accordance with the information transmitted to States parties regarding the processing of their reports, the present document was not edited before being sent to the United Nations translation services. ** Annexes can be consulted in the files of the Secretariat. GE.09-44960 (EXT) CRC/C/ARG/3-4 Page 2 CONTENTS Paragraphs Page I. PRESENTATION 1-7 4 II. INTRODUCTION 8-16 5 III. GENERAL ASPECTS 17-36 6 A. Demographic aspects 18-26 6 B. Economic and social conditions 27-36 7 IV. FOLLOW-UP TO THE PRINCIPAL AREAS OF CONCERN AND RECOMMENDATIONS CONCERNING ARGENTINA’S SECOND PERIODIC REPORT 37-991 12 A. General measures of implementation (arts. 4, 42 and 44 of the Convention) 37-235 12 B. Definition of the child (art. 1 of the Convention) 236-242 46 C. General principles (arts. 2, 3, 6 and 12 of the Convention) 243-359 47 D. Civil rights and freedoms (arts. 7, 8, 13 to 17 and 37 (a) of the Convention) 360-397 66 E. Family environment and alternative care (arts. 5, 18, paras. 1 and 2; arts. 9 to 11, 19 to 21, 25, 27 and 39 of the Convention) 398-459 73 F. Basic health and welfare (arts. -

Religiously Disaffiliated, Religiously Indifferent, Or Believers Without Religion? Morphology of the Unaffiliated in Argentina
religions Article Religiously Disaffiliated, Religiously Indifferent, or Believers without Religion? Morphology of the Unaffiliated in Argentina Juan Cruz Esquivel 1,2 1 National Council of Scientific and Technical Research (CONICET), Buenos Aires C1083 ACA, Argentina; [email protected] 2 University of Buenos Aires, Buenos Aires C1053 CABA, Argentina Abstract: This article aims to characterize the socioeconomic and demographic profile of the popula- tion without religious affiliation in Argentina as well as their beliefs, practices, and attitudes toward a range of issues related to public and private life. This is a social conglomerate that has grown exponentially in the region and worldwide, but it has been little explored by the social sciences of religion in Latin America. The research was based on the Second National Survey on Religious Beliefs and Attitudes in Argentina, which was carried out in 2019. The study universe was made up of the population of the Argentine Republic aged 18 years or more, living in localities or urban agglomerations with at least 5000 inhabitants. A total of 2421 cases were selected through a multistage sampling. The analysis of the data reveals that it would be inaccurate to say that the religiously unaffiliated do not convey religious beliefs. Almost three out of 10 (most of those who responded do not belong to any religion but neither defined themselves as agnostics or atheists) believe in God and in Jesus Christ. Given that they are the most numerous sub-group and with the highest growth rate within the religiously unaffiliated, it would be unwise to consider this fringe of the Argentine Citation: Esquivel, Juan Cruz. -

Though Many Have White Skin, Their Veins Flow of Black Blood: Afro-Argentine Culture and History During the Twentieth Century in Buenos Aires, Argentina Erika D
McNair Scholars Journal Volume 7 | Issue 1 Article 8 2003 Though Many Have White Skin, their Veins Flow of Black Blood: Afro-Argentine Culture and History during the Twentieth Century in Buenos Aires, Argentina Erika D. Edwards Grand Valley State University Follow this and additional works at: http://scholarworks.gvsu.edu/mcnair Recommended Citation Edwards, Erika D. (2003) "Though Many Have White Skin, their Veins Flow of Black Blood: Afro-Argentine Culture and History during the Twentieth Century in Buenos Aires, Argentina," McNair Scholars Journal: Vol. 7: Iss. 1, Article 8. Available at: http://scholarworks.gvsu.edu/mcnair/vol7/iss1/8 Copyright © 2003 by the authors. McNair Scholars Journal is reproduced electronically by ScholarWorks@GVSU. http://scholarworks.gvsu.edu/ mcnair?utm_source=scholarworks.gvsu.edu%2Fmcnair%2Fvol7%2Fiss1%2F8&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages Though Many Have White Skin, their Veins Flow of Black Blood: Afro-Argentine Culture and History during the Twentieth Century in Buenos Aires, Argentina Abstract Introduction Although the Afro-Argentine population One of the first things I noticed while continued to decline during the twentieth studying in Buenos Aires, Argentina, was century, the people played an integral role that there were few, if any, blacks among in shaping Argentina’s culture through their the city’s inhabitants. I lived there for six contributions in the field of dance, months and people always assumed that literature, and religion. Unfortunately, their I was Brazilian because of their popular vibrant culture and history are often belief that Afro-Argentines no longer ignored and overlooked because of exist. However, this is a lie: Afro- Argentina’s subtle efforts to whiten its Argentines do indeed exist. -

Of Southern Europe? Anti-Neoliberal Populisms In
Instituto de Ciencia Política A ‘LATINAMERICANIZATION’ OF SOUTHERN EUROPE? ANTI-NEOLIBERAL POPULISMS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE por Enrico Padoan Tesis presentada al Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado académico de Doctor Profesores Guías: Pierre Ostiguy, Manuela Caiani Comisión Informante: Carla Alberti; Juan Pablo Luna; Julia Lynch; Kenneth Roberts Junio 2018 Santiago de Chile, Chile ©2018, Enrico Padoan Ninguna parte de esta tesis puede reproducirse o transmitirse bajo ninguna forma o por ningún medio o procedimiento, sin permiso por escrito del autor. ACKNOWLEDGMENTS [Please, let me use, in this opening section, different languages (my poor English, my slightly better Spanish, and my hopefully decent Italian). I just want to speak to different people through the language (the ‘code’) that we are used to employ to talk to each other. I am aware that perhaps this is not a proper decision, and I apologize for that. I just want to thank all of you as clearly as possible]. Scorrendo i ringraziamenti di diverse tesi di dottorato, magari poi divenute libri, ho letto svariate volte la frase ‘this was not a solitary enterprise’. Questa tesi, al contrario, è davvero frutto di una solitary enterprise. Ovviamente, non nel senso che quanto scritto in queste pagine sia esclusivamente farina del mio sacco, quando invece (e lo specificherò fra non molto) è frutto di un lunghissimo processo di confronto e di dibattito con moltissimi docenti, colleghi ed amici, i quali mi hanno aiutato a migliorarne il contenuto (ovviamente, valga il caveat “gli errori e le mancanze sono miei”). -

Lo Afro De La Identidad Argentina: Blackness and Mestizaje in Argentina
LO AFRO DE LA IDENTIDAD ARGENTINA: BLACKNESS AND MESTIZAJE IN ARGENTINA By David C. Weaver Thesis Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in Latin American Studies May, 2017 Nashville, Tennessee Approved: Nicolette Kostiw, Ph.D. Edward Fischer, Ph.D. TABLE OF CONTENTS Page Abstract ...........................................................................................................................................1 Introduction .....................................................................................................................................2 Review of Literature .......................................................................................................................5 PART I: Historical and Cultural Context of Race in Argentina .....................................................9 PART II: “Disappearance” in Plain Sight: The Moment of Erasure and the Afro-Argentine .......24 PART III: Contemporary Concepts of Blackness and Multiculturalism in Argentina .................39 Conclusion ....................................................................................................................................47 References .....................................................................................................................................49 Appendix: Archival sources and translations ...............................................................................52 ii ABSTRACT: -

Calls for the Release of Jailed Activist Go Unheeded in Argentina Andrã©S Gaudãn
University of New Mexico UNM Digital Repository NotiSur Latin America Digital Beat (LADB) 1-13-2017 Calls for the Release of Jailed Activist Go Unheeded in Argentina Andrés GaudÃn Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/notisur Recommended Citation GaudÃn, Andrés. "Calls for the Release of Jailed Activist Go Unheeded in Argentina." (2017). https://digitalrepository.unm.edu/ notisur/14484 This Article is brought to you for free and open access by the Latin America Digital Beat (LADB) at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in NotiSur by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. LADB Article Id: 80182 ISSN: 1060-4189 Calls for the Release of Jailed Activist Go Unheeded in Argentina by Andrés Gaudín Category/Department: Argentina Published: 2017-01-13 A year after the jailing of social activist and indigenous leader Milagro Sala, the government of Argentina, under President Mauricio Macri, finds itself in an uncomfortable position as human rights groups the world over express their dismay over the situation. In addition to leading the Organización Barrial Túpac Amaru, a neighborhood association active in the northwestern province of Jujuy, Sala also serves as a deputy for PARLASUR, the legislative body of the Mercado Común del Sur (MERCOSUR) trade bloc (NotiSur, May 20, 2016). She has been locked up since Jan. 16, 2016, due to a confusing series of allegations with which the pro-Macri governor of the province, Gerardo Morales, has sought to remove her from the political stage. While the Macri administration endorses the maneuvers made against Sala, a wide range of groups, including the Organization of American States (OAS), demand that the indigenous activist of Qulla descent be freed.