Dynamiques Environnementales, 37
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

O Planeamento Na Assomada: Proposta De Parâmetros
Sandra Maria Moniz Tavares O Planeamento na Assomada: Proposta de Parâmetros Urbanísticos Para a Construção da Qualidade no Ambiente do Território Urbano em Cabo Verde, Assomada – Santa Catarina como Caso de Estudo. Orientador: Professor Doutor José Diogo Da Silva Mateus Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Departamento de Urbanismo. Lisboa, Junho de 2012 Sandra Maria Moniz Tavares O Planeamento na Assomada: Proposta de Parâmetros Urbanísticos Para a Construção da Qualidade no Ambiente do Território Urbano em Cabo Verde, Assomada – Santa Catarina como Caso de Estudo. Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Mestre, no curso de Mestrado em Urbanismo, conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Orientador: Professor Doutor José Diogo Da Silva Mateus Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Lisboa, Junho de 2012 Dedicatória Dedico este trabalho aos meus familiares, em especial aos meus pais, avó, esposo, filhos e irmãos pela estima, pelo carinho e pelo amor souberam acolher e acompanhar a minha decisão em enfrentar aos novos desafios pela busca de conhecimentos e novas oportunidades que a vida me exigiu. Por isso não posso deixar de, com muito apreço manifestar a profunda gratidão. 3 AGRADECIMENTOS O Planeamento na Assomada: Propostas de Parâmetros Urbanísticos para a Construção da Qualidade no Ambiente do Território, é o resultado de uma investigação intensa, baseada: nos trabalhos de terreno, inquéritos, recolha bibliográfica, análises dos ortofotomapas existentes e de outros documentos em Assomada - Santa Catarina, ilha de Santiago Cabo Verde. A proposta de um quadro paramétrico e do esboço de cartogramas que protege, valorize e recupere o ambiente no território, não teria sido possível, sem a colaboração de um conjunto de entidades e pessoas que doutamente contribuíram para a sua concretização. -

Sandra Maria Moniz Tavares
Departamento de Geociência HIGROGEOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS NO CONCELHO DE SANTA CATARINA Licenciatura em Geologia – Ramo Cientifico Sandra Maria Moniz Tavares INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO Praia, Setembro 2006 Sandra Maria Moniz Tavares TEMA: HIGROGEOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS NO CONCELHO DE SANTA CATARINA Trabalho Científico apresentado ao ISE para obtenção do Grau de Licenciatura em Geologia-Ramo Científico sob a Orientação do Eng.º Arrigo Querido, em Setembro de 2006. Praia, Setembro 2006 DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS TRABALHO CIENTÍFICO APRESENTADO AO ISE PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIATURA EM GEOLOGIA-RAMO CIENTÍFICO ELABORADO POR, SANDRA MARIA MONIZ TAVARES, APROVADO PELOS MEMBROS DO JURI, FOI HOMOLOGADO PELO CONCELHO CIENTÍFICO PEDAGÓGICO, COMO REQUISITO PARCIAL À OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIATURA EM GEOLOGIA – RAMO CIENTÍFICO. O JURI, _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Praia, aos _____/_____/_____ DEDICATÓRIA Este trabalho é dedicado aos meus dois filhos, Sander Carlos Tavares Almeida e Alexander Tavares Almeida, ao meu marido Carlos António Mascarenhas Almeida e aos meus Pais. AGRADECIMENTOS Após um longo percurso desse trabalho gostaria de agradecer todos àqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para o sucesso desse trabalho. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pela saúde, força e coragem para enfrentar as dificuldades deparadas ao longo da realização do trabalho. Gostaria de agradecer todos àqueles que contribuíram para que o mesmo atingisse a esse patamar. - Ao meu orientador, Eng. Arrigo Querido, um agradecimento especial, tanto na orientação como nos documentos facultados e correcção científica deste trabalho. - Ao Chefe do Departamento de Geociências Dr. Alberto da Mota Gomes um obrigado pela sugestão que me deu na escolha do Tema e do orientador; - Aos funcionários do INGRH, em especial o Dr. -
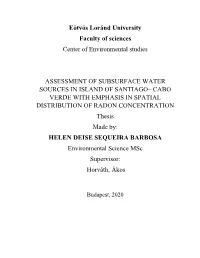
Cabo Verde with Emphasis in Spatial Distribution of Radon Concen
Eötvös Loránd University Faculty of sciences Center of Environmental studies ASSESSMENT OF SUBSURFACE WATER SOURCES IN ISLAND OF SANTIAGO– CABO VERDE WITH EMPHASIS IN SPATIAL DISTRIBUTION OF RADON CONCENTRATION Thesis Made by: HELEN DEISE SEQUEIRA BARBOSA Environmental Science MSc Supervisor: Horváth, Ákos Budapest, 2020 TABLE OF CONTENTS ABBREVIATIONS ............................................................................................................... 3 1. ABSTRACT ................................................................................................................... 4 2. INTRODUCTION ......................................................................................................... 5 2.1. Aim ........................................................................................................................... 7 2.2. Hypothesis ................................................................................................................ 7 3. LITERATURE REVIEW ............................................................................................. 8 3.1. Sources of natural radioactive radiation ................................................................... 8 3.1.1. General properties of radon. .......................................................................... 9 3.1.2. Radon in Cape Verde ..................................................................................... 9 3.2. Natural Conditions at the Island of Santiago ......................................................... 10 -
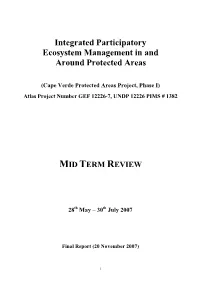
Integrated Participatory Ecosystem Management in and Around Protected Areas
Integrated Participatory Ecosystem Management in and Around Protected Areas (Cape Verde Protected Areas Project, Phase I) Atlas Project Number GEF 12226-7, UNDP 12226 PIMS # 1382 MID TERM REVIEW 28th May – 30th July 2007 Final Report (20 November 2007) 1 Acknowledgements The two authors of the report – Dr Nigel Varty (International Consultant) and Sonia Elsy Merino (National Consultant) - would like to thank the UNJO in Cape Verde for organising the MTE mission (5-28 June 2007), and providing administrative, logistical (transport, office facilities, etc) and other support to the MTE team. The authors would like to thank especially José Levy, Eunice Gomez, and the Resident Representative, Patricia de Mowbray, for their help and support. The UNDP-GEF Regional Coordination Unit in Dakar also provided support to the evaluation mission and the team would like to thank the UNDP-GEF Regional Technical Advisor, Fabiana Issler, for her input, particularly in arranging for completion of the review of the draft report. The evaluation team also wishes to express its gratitude to the Director of DGA, Ivone Lopes, and the whole of the project team for their time and enjoyable visits to Serra da Malagueta and Monte Gordo, particularly to the Project Coordinator, Maria Teresa Vera Cruz, the two Project Site Coordinators, José Luís Elba Martins (Serra da Malagueta) and Lazaro António Sá (Monte Gordo), and to the project’s Chief Technical Advisor, Abdelkader Bensada. The International Consultant would like to thank José Levy and Jeanne Gouba at the UNJO and Fabiana Issler of UNDP-GEF for very constructive comments on the draft MTE report, which helped to substantially strengthen and balance the final version. -

Cabo Verde): Análise E Proposta Para O Seu Desenvolvimento Sustentado
O sistema de pastoreio transumante no planalto do Tarrafal de Santiago (Cabo Verde): análise e proposta para o seu desenvolvimento sustentado. LEININE JÚNIOR DA VEIGA TAVARES Dissertação apresentada à Escola Superior Agrária de Bragança para obtenção do Grau de Mestre em Gestão de Recursos Florestais Orientado: Professora Doutora Marina Maria Meca Ferreira de Castro Co-Orientador: Professor Doutor José Manuel Correia dos Santos Ferreira de Castro Bragança Novembro, 2017 DEDICATÓRIA À minha família iv AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a minha família, por me possibilitar e triunfar mais uma etapa da minha vida. Os meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas e instituições que de uma forma ou outra mostraram apreço e consideração por esta investigação. Agradeço a todos os meus professores do Mestrado em Gestão de Recursos Florestais pelos ensinamentos, acompanhamento e disponibilidade demonstrada. Aos meus amigos e colegas em Cabo Verde pelo apoio demonstrado na facilitação dos dados e documentos. Aos meus colegas de curso e amigos, pela amizade e apoio dado ao longo destes anos, um grande obrigado pelos momentos que passamos juntos. Os meus agradecimentos á Delegação do Ministério do Desenvolvimento Rural do Tarrafal (MDR), DGASP ao Instituto Nacional de Estatística (INE) e à Camara Municipal do Tarrafal (CMT). Aos meus orientadores a Professora Doutora Marina Castro e o Professor Doutor José Castro, um especial agradecimento pela orientação e os ensinamentos. Finalmente, uma enorme palavra de apreço e gratidão a todos os pastores que contribuíram de forma decisiva para a concretização deste trabalho e dedico este passo na minha vida académica de aprendizagem á minha família. -

Problemas De Recursos Hídricos Em Ilhas Exemplo Da Ilha De Santiago
6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa PROBLEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS EM ILHAS EXEMPLO DA ILHA DE SANTIAGO CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DA RIBEIRA GRANDE DA CIDADE VELHA CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DA RIBEIRA SECA Alberto da Mota GOMESi Professor Associado do Instituto Superior de Educação António Filipe Lobo de Pinaii Professor Convidado do Instituto Superior de Educação ENQUADRAMENTO DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE Origem e Localização As ilhas de Cabo Verde elevam-se de um soco submarino, em forma de ferradura, situado a uma profundidade da ordem de 3.000 metros. Deste soco emergem três pedestais bem distintos1. A Norte, compreendendo as ilhas de St° Antão, S. Vicente, St.ª Luzia e S. Nicolau e os ilhéus Boi, Pássaros, Branco e Raso. A Leste e a Sul, com as ilhas do Sal, Boa Vista, Maio e Santiago e os ilhéus Rabo de Junco, Curral de Dadó, Fragata, Chano, Baluarte e de Santa Maria. A Oeste, compreendendo as ilhas do Fogo e da Brava e os ilhéus Grande, Luís Carneiro e de Cima (Fig. 1 - Mapa de Cabo Verde e distribuição das ilhas nos três pedestais). A formação das ilhas teria sido iniciada por uma actividade vulcânica submarina central, mais tarde completada por uma rede físsural manifestada nos afloramentos. A maior parte das ilhas é dominada por emissões de escoadas lávicas e de materiais piroclásticos (escórias, bagacinas ou "lapilli" e cinzas) subaéreos, predominantemente basálticas. O Arquipélago de Cabo Verde fica localizado na margem Oriental do Atlântico Norte, a cerca de 450 Km da Costa Ocidental da África e a cerca de 1.400 Km a SSW das Canárias, limitado pelos paralelos 17° 13' (Ponta Cais dos Fortes, Ilha de St° Antão) e 14º 48' (Ponta de Nho Martinho, Ilha Brava), de latitude Norte e pelos meridianos de 22° 42' (ilhéu Baluarte, Ilha da Boa Vista) e 25° 22' (Ponta Chã de Mangrado, Ilha de St° Antão) de longitude Oeste de Greenwich. -

Nº 10 «Bo» Da República De Cabo Verde — 6 De Março De 2006
I SÉRIE — Nº 10 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 6 DE MARÇO DE 2006 291 Decreto-Lei nº 25/2006 conservação de estradas bem como actualizar a classificação das estradas e definir os níveis de serviço das de 6 de Março vias públicas rodoviárias; Não obstante ter sido o Decreto-Lei nº54/2004, de 27 de Após consulta aos Municípios de Cabo Verde através da Dezembro sobre a comercialização, a informação e o controle Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde; da qualidade dos produtos destinados a alimentação de lactentes, objecto de regulamentação através do Decreto No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do Regulamentar nº1/2005, de 17 de Janeiro, em consequência artigo 203 da Constituição, o Governo decreta o seguinte: da não implementação na prática dos preceitos definidos neste último diploma, corre-se o risco de um ruptura de Artigo 1º stocks dos produtos lácteos, destinados a crianças menores Objecto de vinte e quatro meses. O presente diploma tem por objecto, fundamental, a Tornando-se necessário reafirmar, por um lado, a valia classificação administrativa e gestão das vias rodoviárias e o dever da observância rigorosa dos preceituados, de Cabo Verde, bem como a definição dos níveis de serviço naqueles dois mencionados diplomas e, por outro lado, a das mesmas. conveniência em se estar ciente das reais dificuldades sentidas pelos operadores em dar cabal cumprimento ao CAPÍTULO I que neles se preceitua, importa que se encontre uma solução normativa satisfatória para a situação em apreço. Classificação Administrativa das Estradas O que terá que passar, inevitavelmente, pela prorrogação Artigo 2º do prazo para o inicio da vigência do mencionado Decreto- Lei n.º 54/2004. -

Planeamento De Equipamentos Educativos Em Cabo Verde
TESE DE DOUTORAMENTO Planeamento de equipamentos educativos em Cabo Verde Tese submetida à Universidade de Coimbra como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Engenharia Civil, na especialidade em Urbanismo, Ordenamento do Território e Transportes. Autor Osvaldo Rui Monteiro dos Reis Borges Orientador António Pais Antunes Coimbra, 30 de Dezembro de 2011 Financiamento da investigação Este trabalho de investigação foi financiado pela “Fundação para Ciência e Tecnologia” (FCT) do Ministério da Ciência e do Ensino Superior de Portugal no âmbito do “Concurso para atribuição de bolsas de investigação para licenciados, mestres e doutorados nacionais dos PALOP e Timor” através da ref.ª SFRH/DB/15347/2005. i À memória da minha mãe, Georgete da Luz Monteiro dos Reis Borges ii Agradecimentos A elaboração deste trabalho científico contou com apoio e colaboração de muitas pessoas que, de forma directa ou indirecta, com maior ou menor intensidade, contribuíram para a sua concretização. Também várias instituições portuguesas e cabo-verdianas merecem destaque, pois que o seu apoio logístico e financeiro tornou possível o desenvolvimento desta tese. A todas presto meu tributo, através de sinceros e profundos votos de agradecimento. Entretanto, quero ainda, muito especialmente, deixar uma palavra de gratidão e de louvor pela prestimosa colaboração aos que mais directamente estiveram ligados à realização deste trabalho: ao Prof. Doutor António Pais Antunes, que desde a primeira hora aceitou ser o orientador desta investigação -

Contribuição Para Evolução Do Abastecimento De Água Em Zonas Rurais Da Ilha De Santiago, Cabo Verde
Contribuição para Evolução do Abastecimento de Água em Zonas Rurais da Ilha de Santiago, Cabo Verde Dórise Marilene Silva Lima Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia do Ambiente Júri Presidente: Professora Doutora Maria Joana Castelo Branco de Assis Teixeira Neiva Correia Orientador: Professor Doutor José Manuel de Saldanha Gonçalvos Matos Vogal: Professor Doutor António Jorge Silva Guerreiro Monteiro Outubro 2013 AGRADECIMENTOS A realização desta dissertação só foi possível graças à colaboração e apoio de diversas pessoas às quais quero prestar os meus sinceros agradecimentos. Em primeiro lugar agradeço ao Professor Doutor José Saldanha Matos, meu Orientador de dissertação de Mestrado, pela oportunidade de realizar este trabalho, pelo empenho, rigor e, paciência que sempre demonstrou e por todos os conhecimentos que transmitiu. A toda a minha família por todo o apoio que sempre me têm dado. E em especial a minha mãe Armanda e ao meu mano Erickson, que sempre me apoiaram, em todos os momentos, bons e maus, ajudando a ultrapassar os maus e a tornando ainda mais especial os bons. A minha amiga Maria Gomes, pela sua dedicação e esforço de forma a conseguir o contato do gabinete técnico da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos. A Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, pela atenção, disponibilidade para tirar as minhas dúvidas e fornecer-me informação do Concelho, sobre a temática. Aos meus colegas e amigos, que estiveram sempre ao meu lado, em todos os momentos, tanto de alegria como de nervosismo, e até mesmo nos momentos de mau-humor, tendo sempre uma palavra de apoio ou simplesmente contribuindo para momentos de distracção e diversão. -

167 Bean Germplasm Collection in The
167 BEAN GERMPLASM COLLECTION IN THE CAPE VERDE ISLANDS, W. AFRICA V. Marcarían and R. Buhrow - Plant Sciences Department University of Arizona, Tucson, Arizona 85721 N. Silva, Instituto Nacional de Investigacao Agraria/ C. P., 84 Praia, Cape Verde The Cape Verde Archipeligo is located in the Atlantic Ocean approximately 375 miles west of coastal West Africa within an area between 14° 30' and 17° 30' north latitude and 22° 30' and 25° 30' west longitude. Cape Verde is considered an extension of the Sahelian arid region although evaporation rates are more oceanic than found on the continent. Annual rainfall ranges from 50 mm to 1000 mm depending on location on the island, elevation, island mass and orientation to the prevailing northeast tradewinds. Because of its location in relation to the intertropical conversion fronts that bring rain. Cape Verde will always be prone to drought. Beans are important components of the high risk corn/bean farming systems and provide a major portion of dietary protein to over 80% of the rural population of which over 39% have female headed households. Short and medium-term goals for bean improvement include creation and distribution of synthetic populations selected from local land-races and improved germplasm. In order to preserve genetic diversity in these extremely fragile, agro-ecosystems, there will be no large scale introduction of improved cultivars. Objectives of the University of Arizona Food Crop Research Project and the INIA collection effort were to provide additional material for increases, distribution, research and breeding purposes and to identify areas of high diversity and specialized adaptation. -

Infraestructuras De Cabo Verde
Serie: guías de inversión Fecha de realización: julio 2004 Páginas: 26 @ www.africainfomarket.org INFRAESTRUCTURAS DE CABO VERDE 1. Infraestructuras de transporte 1.1. Aeropuertos 1.2. Puertos 1.3. Carreteras 2. Infraestructuras de Comunicaciones y NTIC 3. Infraestructuras energéticas 3.1. Energía 3.2. Agua 4. Infraestructuras industriales 4.1. Zonas industriales 4.2. Zonas francas 5. Estructura bancaria 5.1. Evolución del sistema bancario 5.2. Bancos comerciales 5.3. Control bancario y regulación www.africainfomarket.org pág. 1 Resumen ¾ En los últimos años se ha observado un desarrollo significativo en las infraestructuras aeroportuarias de Cabo Verde, donde destacan tres aeropuertos (Amílcar Cabral - Sal, Praia y São Pedro) y seis aeródromos (Rabil, São Filipe, Preguiça, Maio y Ponta do Sol). El Gobierno mantiene una política de inversiones constantes en este sector, al ser considerado como parte fundamental del desarrollo turístico del país. ¾ El Archipiélago de Cabo Verde dispone de una amplia red de puertos en todas sus islas, si bien el acceso marítimo al país se realiza por medio de Porto Grande y el Puerto de Praia. Los restantes recintos portuarios presentan un menor grado de desarrollo y son utilizados como puntos de transbordo de personas y mercancías entre las diferentes islas. ¾ Cabo Verde dispone de una extensa red de carreteras, por lo general, estrechas, sinuosas y pavimentadas con adoquines. El Banco Mundial financiará con 25 millones de dólares para ampliar y reparar la red viaria del país. A partir de este año, un Instituto de Carreteras se encargará de la gestión y manutención de carreteras del archipiélago. -

Conselho De Ministros ___Decreto
Publicado: I SÉRIE- Nº 23 – B.O. DA REPÚBLICA DE CABO VERDE – 6 DE JULHO DE 1999 Conselho de Ministros No uso da faculdade conferida pela _____________ alínea b) do artigo 217º da Constituição, o Governo decreta o Decreto-Regulamentar seguinte: nº 7/99 De 6 de Julho Artigo 1º (Aprovação) A evolução tecnológica e o aumento considerável do "tráfego postal em È aprovado o Código Postal, que vem Cabo Verde fizeram nascer novas e em anexo ao presente diploma do qual frequentes exigências no que tange à faz parte integrante. qualidade e natureza dos serviços postais, à constância da sua prestação Artigo 2º e ao processo de execução dos (Estrutura) mesmos. 1. O Código Postal é constituído Novas e modernas necessidades e por um campo numérico e um campo conveniência predominam no domínio nominal. do tráfego postal e da prestação dos 2. O campo numérico do Código serviços postais de cabo Verde. Postal é constituído por quatro algarismo que identificam o destino É premente a implementação de uma da encomenda ou da correspondência estrutura organizativa de distribuição e com o seguinte significado: postal e a introdução nos serviços dos Correios dos mecanismos necessários a) O primeiro algarismo e adequados e dos processos de identifica a Ilha; tecnologias modernas aconselháveis a b) O segundo algarismo uma inevitável evolução. identifica o Conselho; c) O terceiro algarismo identifica A introdução do Código Postal e a a Estação Postal; consequente instalação do d) O quarto algarismo identifica a equipamento apropriado ao tratamento classe postal. automática de correspondência e encomenda serão factores decisivos 3.