Triple Agent
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

My Adventures As an Undercover Agent In
True stories of undercover agents Undercover Operations and espionage. The Spy Wore Red: My Adventures as an Undercover Agent in World War II by Aline, Countess of Romanones Chronicles the true story of Aline Griffith, a beautiful young woman who was working as a model for Hattie Carnegie in New York when she was recruited for World War II espionage work in Spain. BIOG ALINE Under and Alone: The True Story of the Undercover Agent Who Infilttrated America’s Most Violent Outlaw Motorcycle Gang by William Queen A veteran ATF agent describes his remarkably successful two-and-a-half-year stint as an un- dercover agent with the Mongols, a violent outlaw motorcycle gang, a time during which he not only became a full member, but also rose to the position of treasurer, documenting their violent crimes and offering profiles of individual gang members. 364.106 Q The Company We Keep: A Husband-and-Wife True-Life Spy Story by Robert Baer A CIA operative and his CIA sharpshooter wife describe how they unexpectedly fell in love during a mission and the complicated challenges they faced in their shared effort to return to civilian life. 327.127 B The Dangerous Otto Katz: The Many Lives of a Soviet Spy by Jonathan Miles This biography of the spy who became the inspiration for Casablanca’s Victor Laszlo de- scribes his involvement in the Spanish Civil War, Stalin’s secret meetings, Trotsky’s murder and the lives of Hollywood celebrities as he sought fame, fortune and glory. BIOG KATZ Priceless: How I Went Undercover to rescue the World’s Stolen Treasures by Robert K. -
Children and Teens' Department
July 2011 Tuesday, July 5, 7 p.m. Thursday, July 14, 7 p.m. Saturday, July 23, 3 p.m. Tyler Cowen July5 11 14 John A. Farrell Sandra Beasley July 11 23July 11 The Great Stagnation Clarence Darrow Don’t Kill The Birthday Girl (Dutton, $12.95) (Doubleday, $32.50) (Crown, $23) For all the excitement of smartphones and social media, are the A journalist, biographer of Tip O’Neill and now senior This memoir from the award-winning poet chronicles new intellectual technologies as innovative and productive as writer for The Center for Public Integrity, Farrell draws on Beasley’s life-long allergies to—just about everything. A partial list those of the past? In this concise, thought-provoking look at unpublished documents to examine the darker side of the great of what she must avoid includes dairy, soy, beef, shrimp, cucumbers, recent economic history, the George Mason University profes- defense attorney. Famous for his role in the Scopes “Monkey and mustard. Thriving despite the constant threats, Beasley tells her sor and blogger argues that the pace of change has stalled. He Trial” and his advocacy on behalf of workers and blacks, Darrow story with wit and humor, examines the science of allergies, and compares today’s technological advances to those that fueled the also faced charges of bribing a jury; meanwhile, his personal life offers advice to fellow sufferers. Industrial Revolution, and finds that we have failed to keep pace in producing new was riddled with misjudgments concerning women and money. wealth, jobs, and overall productivity. Sunday, July 24, 5 p.m. -

Spring 2011 Films at the National Gallery of Art Feature Eric Rohmer
Office of Press and Public Information Fourth Street and Constitution Av enue NW Washington, DC Phone: 202-842-6353 Fax: 202-789-3044 www.nga.gov/press Release Date: March 29, 2011 Spring 2011 Films at the National Gallery of Art Feature Eric Rohmer, Nam June Paik, Igor Stravinsky, Kevin Jerome Everson, plus New Documentaries, Exhibition Films, and More Film still f rom Son of Babylon (Mohamed Al-Daradji, 2010, 35 mm, Arabic/Kurdish with subtitles, 92 minutes) to be shown at the National Gallery of Art on Thursday , May 12, 6:30 p.m. Image courtesy of Mohamed Al-Daradji The spring film season begins in April with the series Richard Dindo: Artists, Writers, and Rebels, from the renowned Swiss director's works focusing on infamous cultural icons. One of Dindo's documentaries features painter and sculptor Paul Gauguin in conjunction with the Gauguin: Maker of Myth exhibition, on view at the Gallery from February 27 through June 5, 2011. In celebration of the exhibition In the Tower: Nam June Paik (March 12–October 2, 2011), the Gallery will present All For All: Collaborative Channeling, a program highlighting three videos that Nam June Paik made in collaboration with other artists: Guadalcanal Requiem, You Can't Lick Stamps in China, and Allan ‘n' Allen's Complaint. Washington premieres include Lost Bohemia, a film about a spectrum of artists, musicians, dancers, and actors who once resided in the now-demolished Carnegie Studio Towers, and Son of Babylon by Iraqi filmmaker Mohamed Al-Daradji. The Gallery presents a number of film series this season, including A Season of Rohmer, a retrospective of works by recently deceased new wave director Eric Rohmer. -

A Critical Comparative Reading of Nationalism in Pramoedya A
DOI: 10.9744/kata.17.1.1-8 ISSN 1411-2639 (Print), ISSN 2302-6294 (Online) OPEN ACCESS http://kata.petra.ac.id A Critical Comparative Reading of Nationalism in Pramoedya A. Toer and Ngugi wa Thiong’o Sunardi, D. Faculty of Language and Arts, University of Ma Chung Malang, INDONESIA Email: [email protected] ABSTRACT This article tries to explore how the conception, birth, and development of novel can become a tool to shed lights to our understanding of the conception, birth, and development of nationalism. The discussion departs from a powerful finding by Edward Said that prominent exiles he happened to know and befriend with had deliberately chosen to be novelists. According to Said, the choice to write novels was fueled by intense feeling of homelessness, which in turn took shape in dream of an imaginary homeland. Novel as a genre is in perpetual search for epic; and since that epic is elusive, what novel can offer is an imagined form. It is in this shared feeling, the same desire to imagine a perfect home, the constant fabrication of narratives of the epic past, the invention of quasi-sacred texts alongside with the heroes and enemies, the dynamics of including and excluding of people that novel and nationalism inform each other. As reader, we turn to postcolonial Kenyan Thiong‟o‟s A Grain of Wheat and Indonesian Toer‟s This Earth of Mankind. By commenting on the main characters of these novels we make intellectual exploration into the idea of nationalism. The results are two tentative conclusions regarding the relationship between novel and nationalism, i.e. -
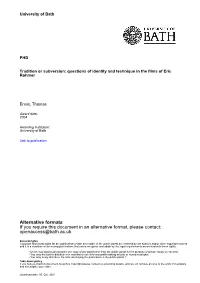
Thesis Rests with Its Author
University of Bath PHD Tradition or subversion: questions of identity and technique in the films of Eric Rohmer Ennis, Thomas Award date: 2004 Awarding institution: University of Bath Link to publication Alternative formats If you require this document in an alternative format, please contact: [email protected] General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 05. Oct. 2021 UNIVERSITY OF BATH LIBRARY AUTHOR: THOMAS ENNIS YEAR: 2004 TITLE: TRADITION OR SUBVERSION: QUESTIONS OF IDENTITY AND TECHNIQUE IN THE FILMS OF ERIC ROHMER Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis rests with its author. A copy of this thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and they must not copy it or use material from it except as permitted by law or with the consent of the author. -

Éric Rohmer, La Poétique Du Hasard Jacques Kermabon
Document généré le 23 sept. 2021 05:38 24 images Hommage Éric Rohmer, la poétique du hasard Jacques Kermabon Enfances de cinéma Numéro 147, juin–juillet 2010 URI : https://id.erudit.org/iderudit/62790ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) 24/30 I/S ISSN 0707-9389 (imprimé) 1923-5097 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Kermabon, J. (2010). Hommage : Éric Rohmer, la poétique du hasard. 24 images, (147), 6–9. Tous droits réservés © 24/30 I/S, 2010 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ hommage Éric Rohmer la poétique du hasard par Jacques Kermabon Éric rohmer, mort le 11 janvier dernier, fut de tous les rÉalisateurs de la nouvelle vague celui dont la constance du parcours impressionne le plus. après l’échec public de son premier long métrage, Le signe du lion, il fonda avec Barbet schroeder les films du losange, société de production qui lui garantit une totale indépendance. cet héritier d’andré Bazin a traversé la deuxième moitié du XXe siècle sans jamais dévier des convictions à la fois esthétiques, économiques et morales qui l’animaient. -

Join Us. 100% Sirena Quality Taste 100% Pole & Line
melbourne february 8–22 march 1–15 playing with cinémathèque marcello contradiction: the indomitable MELBOURNE CINÉMATHÈQUE 2017 SCREENINGS mastroianni, isabelle huppert Wednesdays from 7pm at ACMI Federation Square, Melbourne screenings 20th-century February 8 February 15 February 22 March 1 March 8 March 15 7:00pm 7:00pm 7:00pm 7:00pm 7:00pm 7:00pm Presented by the Melbourne Cinémathèque man WHITE NIGHTS DIVORCE ITALIAN STYLE A SPECIAL DAY LOULOU THE LACEMAKER EVERY MAN FOR HIMSELF and the Australian Centre for the Moving Image. Luchino Visconti (1957) Pietro Germi (1961) Ettore Scola (1977) Maurice Pialat (1980) Claude Goretta (1977) Jean-Luc Godard (1980) Curated by the Melbourne Cinémathèque. 97 mins Unclassified 15+ 105 mins Unclassified 15+* 106 mins M 101 mins M 107 mins M 87 mins Unclassified 18+ Supported by Screen Australia and Film Victoria. Across a five-decade career, Marcello Visconti’s neo-realist influences are The New York Times hailed Germi Scola’s sepia-toned masterwork “For an actress there is no greater gift This work of fearless, self-exculpating Ostensibly a love story, but also a Hailed as his “second first film” after MINI MEMBERSHIP Mastroianni (1924–1996) maintained combined with a dreamlike visual as a master of farce for this tale remains one of the few Italian films than having a camera in front of you.” semi-autobiography is one of Pialat’s character study focusing on behaviour a series of collaborative video works Admission to 3 consecutive nights: a position as one of European cinema’s poetry in this poignant tale of longing of an elegant Sicilian nobleman to truly reckon with pre-World War Isabelle Huppert (1953–) is one of the most painful and revealing films. -
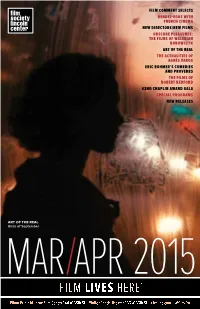
The Films of Walerian Borowczyk (Apr 2 – 9) 10 Kahn, Jean-Paul Civeyrac, Quentin Dupieux, and More
FILM COMMENT SELECTS RENDEZ-VOUS WITH FRENCH CINEMA NEW DIRECTORS/NEW FILMS OBSCURE PLEASURES: THE FILMS OF WALERIAN BOROWCZYK ART OF THE REAL THE ACTUALITIES OF AGNÈS VARDA ERIC ROHMER'S COMEDIES AND PROVERBS THE FILMS OF ROBERT REDFORD 42ND CHAPLIN AWARD GALA SPECIAL PROGRAMS NEW RELEASES ART OF THE REAL Birds of September MAR/APR 2015SM FILM LIVES HERE Elinor Bunin Munroe Film Center 144 W 65th St | Walter Reade Theater 165 W 65th St | filmlinc.com | @filmlinc HERE STARTS PROGRAMMING SPOTLIGHT TABLE OF CONTENTS RENDEZ-VOUS WITH FRENCH CINEMA Festivals & Series 2 Film Comment Selects (Through Mar 5) 2 PROVOKES PROVOKES We have an exciting lineup… Once again, the festival will introduce audiences to new tal- ent—Thomas Cailley (Love at First Fight), Thomas Lilti (Hippocrates), Lucie Borleteau (Fidelio, Rendez-Vous with French Cinema (Mar 6 – 15) 3 Alice’s Odyssey)—and several seasoned directors will return to introduce their latest oeuvres: New Directors/New Films (Mar 18 – 29) 7 Benoît Jacquot, who is opening the festivities, André Téchiné, Christophe Honoré, Cédric Obscure Pleasures: The Films of Walerian Borowczyk (Apr 2 – 9) 10 HERE FILM Kahn, Jean-Paul Civeyrac, Quentin Dupieux, and more. Get ready for an amazing 10 days of exhilarating French cinema! Art of the Real (Apr 10 – 26) 13 –Florence Almozini, Senior Programmer Eric Rohmer's Comedies and Proverbs (Apr 17 – 30) 17 The Films of Robert Redford (Apr 24 – 27) 18 HERE FILM 42nd Chaplin Award Gala honoring Robert Redford (Apr 27) 19 INSPIRES NEW DIRECTORS/NEW FILMS Special Programs 20 The wonderful thing about a festival like New Directors/New Films is that, by definition, it New Releases 22 renews itself every year. -

Les Jeux De La Liberté Et Du Hasard Dans Les Films D'éric Rohmer
Document généré le 27 sept. 2021 10:29 Séquences La revue de cinéma Les Jeux de la liberté et du hasard dans les films d’Éric Rohmer Maurice Elia Numéro 130, août 1987 URI : https://id.erudit.org/iderudit/50705ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) La revue Séquences Inc. ISSN 0037-2412 (imprimé) 1923-5100 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Elia, M. (1987). Les Jeux de la liberté et du hasard dans les films d’Éric Rohmer. Séquences, (130), 32–35. Tous droits réservés © La revue Séquences Inc., 1987 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ ETUDE JEUX DE LA LIBERTE ET DU HASARD DANS LES FILMS D'ÉRIC ROHMER Maurice Elia FILMOGRAPHIE Réalisations cinéma courts métrages 1950 : Journal d'un « Le personnage central de mes films est, scélérat avant tout, complaisant envers lui-même. 1951 : Présentation ou Il est constamment dupe (...) Charlotte et de sa propre philosophie son steak et sa complaisance est toujours 1954 : Bérénice dénoncée par ses partenaires. » 1956 : La Sonate à Éric Rohmer, Cinéma 71, no 153, février 1971. -
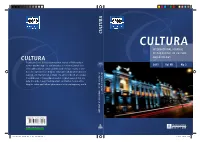
Creative Society: Concepts and Problems
CULTURA CULTURA INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY OF CULTURE CULTURA AND AXIOLOGY Founded in 2004, Cultura. International Journal of Philosophy of 2015 Culture and Axiology is a semiannual peer-reviewed journal devo- 2 2015 Vol XII No 2 ted to philosophy of culture and the study of value. It aims to pro- mote the exploration of different values and cultural phenomena in regional and international contexts. The editorial board encourages the submission of manuscripts based on original research that are judged to make a novel and important contribution to understan- ding the values and cultural phenomena in the contempo rary world. CULTURE AND AXIOLOGY CULTURE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ISBN 978-3-631-66790-3 www.peterlang.com CULTURA 2015_266790_VOL_12_No2_GR_A5Br.indd 1 27.10.15 KW 44 19:44 CULTURA CULTURA INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY OF CULTURE CULTURA AND AXIOLOGY Founded in 2004, Cultura. International Journal of Philosophy of 2015 Culture and Axiology is a semiannual peer-reviewed journal devo- 2 2015 Vol XII No 2 ted to philosophy of culture and the study of value. It aims to pro- mote the exploration of different values and cultural phenomena in regional and international contexts. The editorial board encourages the submission of manuscripts based on original research that are judged to make a novel and important contribution to understan- ding the values and cultural phenomena in the contempo rary world. CULTURE AND AXIOLOGY CULTURE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL www.peterlang.com CULTURA 2015_266790_VOL_12_No2_GR_A5Br.indd 1 27.10.15 KW 44 19:44 CULTURA INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY OF CULTURE AND AXIOLOGY Cultura. -

Rétrospective Intégrale
RÉTROSPECTIVE INTÉGRALE Éric LE LOUXOR 16.01.19 > 5.02.19 Rohmer LES COPIES DE CETTE RÉTROSPECTIVE ONT ÉTÉ RESTAURÉES EN 2K AVEC L’AIDE DU CNC Photo © Rosette • Imprimerie Gestion Graphic 01 39 95 41 26 SEMAINE DU 16.01 > 22.01 SEMAINE DU 23.01 > 29.01 SEMAINE DU 30.01 > 3.02 MERCREDI 16 JANVIER MERCREDI 23 JANVIER MERCREDI 30 JANVIER • 11:00 MA NUIT CHEZ MAUD • 11:15 QUATRE AVENTURES DE REINETTE ET MIRABELLE • 11:15 LA CARRIÈRE DE SUZANNE /LA BOULANGÈRE DE MONCEAU • 13:15 LA MARQUISE D’O • 13:30 PAULINE À LA PLAGE • 13:30 LA COLLECTIONNEUSE • 15:30 LE SIGNE DU LION • 15:30 LE BEAU MARIAGE • 15:30 LES RENDEZ-VOUS DE PARIS • 17:30 PARIS VU PAR • 17:20 LE GENOU DE CLAIRE • 17:30 LE GENOU DE CLAIRE • 19:30 LE GENOU DE CLAIRE ☛ En présence de BÉATRICE ROMAND • 19:30 L’ARBRE, LE MAIRE ET LA MÉDIATHÈQUE • 19:40 L’AMOUR L’APRÈS-MIDI • 21:30 LES RENDEZ-VOUS DE PARIS • 21:40 L’AMI DE MON AMIE • 21:30 LE RAYON VERT JEUDI 31 JANVIER • 11:15 PAULINE À LA PLAGE • 11:20 LA CARRIÈRE DE SUZANNE / LA BOULANGÈRE DE MONCEAU • 11:50 TRIPLE AGENT • 13:30 PERCEVAL LE GALLOIS • 13:30 LES RENDEZ-VOUS DE PARIS • 14:00 PARIS VU PAR • 16:15 L’AMI DE MON AMIE • 15:30 TRIPLE AGENT • 15:45 PERCEVAL LE GALLOIS • 18:10 L’ANGLAISE ET LE DUC • 17:40 PARIS VU PAR • 18:15 LE SIGNE DU LION • 20:30 LA FEMME DE L’AVIATEUR ☛ En présence de MARIE RIVIÈRE • 19:45 LA COLLECTIONNEUSE • 20:15 CONTE D’HIVER ☛ En présence de ROSETTE ☛ En présence de BARBET SCHROEDER (sous réserve) VENDREDI 1er FÉVRIER • 11:15 CONTE D’AUTOMNE • 11:15 LA COLLECTIONNEUSE • 11:15 LE SIGNE DU LION • 13:30 -
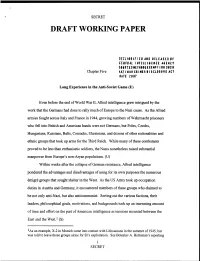
Draft Working Paper
SECRET DRAFT WORKING PAPER DEN. ASCU I EN AID RELEASED BY CENTIAL INTELLIGENCE AGENCY SEINECESNEINIIISEXENPT INN 3111 Chapter Five OA/ 1 WAR CRIMES., SCLOSU At ACT DATE 2007 Long Experience in the Anti-Soviet Game (U) Even before the end of World War II, Allied intelligence grew intrigued by the work that the Germans had done to rally much of Europe to the Nazi cause. As the Allied armies fought across Italy and France in 1944, growing numbers of Wehrmacht prisoners who fell into British and American hands were not Germans, but Poles, Czechs, Hungarians, Russians, Baits, Cossacks, Ukrainians, and dozens of other nationalities and ethnic groups that took up arms for the Third Reich. While many of these combatants proved to be less than enthusiastic soldiers, the Nazis nonetheless raised substantial manpower from Europes non-Aryan populations. (U) Within weeks after the collapse of German resistance, Allied intelligence pondered the advantages and disadvantages of using for its own purposes the numerous émigré groups that sought shelter in the West. As the US Army took up occupation duties in Austria and Germany, it encountered members of these groups who claimed to be not only anti-Nazi, but also anticommunist. Sorting out the various factions, their leaders, philosophical goals, motivations, and backgrounds took up an increasing amount of time and effort on the part of American intelligence as tensions mounted between the East and the West. 1 (S) 'As an example, X-2 in Munich came into contact with Lithuanians in the summer of 1945, but was told to leave those groups alone for SI's exploitation.