Montagnac. 6000 Ans D'histoire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Quatre À Roubieu
PIRE à QUATORZIÈME...................................... ... pages 319 à 340 TOPONYMIE ~ EL'HERAULT Dictionnaire Topographique et Etymologique par Frank R. HAMLIN avec la collaboration de l'abbé André Cabrol tudes érault ises ÉDITIONS DU BEFFROI ÉTUDES HÉRAULTAISES 2000 3]9 QUIST tudes éraultoises Mas de QUATRE, f. (St-André-de-Sangonis). Vrai Honor... QUINQUARTZ, 1203 (c. Valmagne, nU 660), semblablement, d'après le plan cadastral, habitation 1205 iibid.. nv661), loc. non ident. près de Font Mars formée par la réunion de quatre maisons contiguës. (M èze), ÉtYITI. obscure. o Les QUATRE CANAUX, h. (Palavas). D'après le croisement du Canal du Midi et du cours canalisé du Le Mas de QUINTAL, ruines (Soubès). Prob. n. de Lez. 0 Les QUATRE CANTONS (Villeneuve-l ès famille ; pourrait également indiquer la redevance au Maguelonne) : tènement des Quatre Cantons, 1774 seigneur du cinquième de la récolte (suivant Nègre, (compoix, ap. °FD. IV. 45). Sens précis inconnu. 0 Les NLT, p. 74) ; sans rapport direct avec le mot fr. quintal. QUATRE CARRIÈRES (Agde ' Vendémian). Occ. Combe de QUINTANEL (Rouet - Ferrières-les quatre carrièras « quatre chemins », indication d'un Verreries). N. de famille. carrefour. 0 Les QUATRE CHEMINS, maison (Poussan). Les QUATRE CHEMINS (Capestang; La QUINTERIE (Clermont-l'Hérault). Terres dont Causse-de-la-Selle; Mèze ; Vic-la-Gardiole). Indication on donnait le cinquième des fruits au propriétaire. d'un carrefour. 0 Les QUATRE PILAS, f. (Murviel-lès Les QUINT:ES, maison (Taussac-la-Billière). Adj. fém. Montpellier) : les quatre Pilas, 1770-2 (Cassini). Occ. occ. quinta «cinquième» ; allusion inconnue. quatre pia/as, prob. au sens de « quatre auges ». -
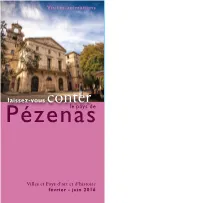
Mise En Page 1
Visites-animations laissez-vous conter Pézenasle pays de Villes et Pays d’art et d’histoire février - juin 2016 1 SOMMAIRE FÉVRIER - MARS Février - Mars La pierre Visites guidées • Visites guidées 3 • Visites à thème 3 dans tous ses états Pézenas, • Visites des villages 4-6 le centre historique Samedi 13 février à 15h Avril - Mai L’année 2016 sera celle de Jeudi 18 février à 15h • Visites guidées 7 la pierre; visites, escapades, confé- Pézenas, Ville de foires dès le • Visites à thème 7 rences, expositions vous en feront XIIIe siècle fut aussi la ville de • Escapades découvrir de multiples aspects: résidence des Montmorency du patrimoine 8-9 la géologie du territoire, les gouverneurs du Languedoc, puis • Mois anciennes carrières, l’utilisation du du Prince de Conti, cousin de de l’Architecture 9 calcaire et du basalte dans la Louis XIV, protecteur de Molière. construction, de la structure aux Découvrez, en compagnie d’un Expositions décors sculptés. guide conférencier, ce passé • Temporaires 10 prestigieux dans le secteur • Permanentes 11 Pierre et chaux sont indissocia- sauvegardé. bles, vous admirerez au cours des Tarif: 6€, tarif réduit: 5€ Les visages de pierre Musées 10-11 visites proposées la finesse des départ minimum 5 personnes. Regards sur les mascarons décors en trompe l’œil, imitant , Office de Tourisme Jeudi 25 février à 15h Conférences 12 parfois les pierres de taille, qui de Pézenas-Val d’Hérault Partez à la découverte des remar- se développent avec l’architecture quables mascarons du XVIIIe siècle Renaissance viticole aux abords des centres qui ornent les façades des hôtels d’un four à chaux 12 historiques. -

Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-De-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias JM Agglo 2:Mise En Page 1 22/09/09 16:36 Page 3
JM Agglo 2:Mise en page 1 22/09/09 16:36 Page 2 Numéro 2 • Octobre 2009 Octobre 2 • Numéro Transport : de nouveaux services Cadre de vie : une priorité Un territoire au naturel Viticulture : terroirs d’exception Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [ Lézignan-la-Cèbe [ Montagnac Nézignan-l’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias JM Agglo 2:Mise en page 1 22/09/09 16:36 Page 3 agir dans l’agglo [ Portiragnes : du très haut débit pour le parc d'activités économiques du Puech P. 4 [ Contrat d'agglomération Etat-Région: une nouvelle implusion pour nos chantiers P. 5 [ Habitat : la réfection des façades subventionnée P. 6 [ Patrimoine : la voûte du dôme du château Laurens livre ses secrets P. 7 P4 [ Qualité de vie : les gagnants du concours des maisons fleuries 2009 P. 8 [ Aménagement durable : une gestion raisonnée des ressources P. 9 [ Transport : une offre enrichie et des bus neufs P. 10 P11 zoom sur l’agglo e Terroirs et AOC d'exception r i [ Des appellations à la carte P. 13 a [ L’âge d’or gravé dans la pierre P. 14 m Vivre dans l’agglo m P15 [ Nizas : un terroir reconnu P. 15 o [ Nézignan-l'Evêque : un blason restauré P. 16 s [ Bessan : un âne et ses légendes P. 17 [ Vias : la Maison du Patrimoine P. 17 [ Florensac et Castelnau-de-Guers : de nouveaux sites internet P. 18 [ Caux : une saison réussie P. 19 sortir dans l’agglo [ Cap d'Agde : 10ème salon nautique P. -

Liste Des Zones Infra-Departementales Pour Les Partipants Obligatoires
LISTE DES ZONES INFRA-DEPARTEMENTALES POUR LES PARTIPANTS OBLIGATOIRES 4 zones infra-départementales sont offertes : 4 MUG sont offerts : Zone A, B, C et D 1-DIR. 2 à 7 classes 2-ASH 3-REMPLACEMENT 4- ENSEIGNEMENT ZONE A ZONE B AGEL PORTIRAGNES ABEILHAN LE POUJOL-SUR-ORB AIGNE PREMIAN AGDE LE PRADAL AIGUES-VIVES PUIMISSON ALIGNAN-DU-VENT LES AIRES AZILLANET PUISSERGUIER AUMES LEZIGNAN-LA-CEBE BASSAN QUARANTE AUTIGNAC LUNAS BELARGA RIOLS AVENE MAGALAS BEZIERS SAUVIAN BEDARIEUX MARGON BOUJAN-SUR-LIBRON SERIGNAN BERLOU MARSEILLAN CAPESTANG SIRAN BESSAN MONTAGNAC CAZOULS-LES-BEZIERS ST-ETIENNE-D'ALBAGNAN CABREROLLES MONTBLANC CERS ST-PONS-DE-THOMIERES CAMPAGNAN MURVIEL-LES-BEZIERS CESSERAS ST-THIBERY CAMPLONG NEFFIES COLOMBIERS THEZAN-LES-BEZIERS CASTANET-LE-HAUT NEZIGNAN-L'EVEQUE CORNEILHAN VALRAS-PLAGE CASTELNAU-DE-GUERS NIZAS COURNIOU VENDRES CAUSSES-ET-VEYRAN PEZENAS CREISSAN VILLENEUVE-LES-BEZIERS CAUX PINET CRUZY CAZEDARNES POMEROLS FELINES-MINERVOIS CAZOULS-D'HERAULT POUZOLLES FERRALS-LES-MONTAGNES CEBAZAN PUISSALICON FRAISSE-SUR-AGOUT CEILHES-ET-ROCOZELS ROQUEBRUN LA CAUNETTE CESSENON-SUR-ORB ROUJAN LA LIVINIERE COLOMBIERES-SUR-ORB SERVIAN LA SALVETAT-SUR-AGOUT COULOBRES ST-CHINIAN LESPIGNAN ESPONDEILHAN ST-GENIES-DE-FONTEDIT LIEURAN-LES-BEZIERS FAUGERES ST-GENIES-DE-VARENSAL LIGNAN-SUR-ORB FLORENSAC ST-GERVAIS-SUR-MARE MARAUSSAN GABIAN ST-NAZAIRE-DE-LADAREZ MAUREILHAN GRAISSESSAC ST-PARGOIRE MONTADY HEREPIAN ST-PONS-DE-MAUCHIENS NISSAN-LEZ-ENSERUNE JONCELS TOURBES OLARGUES LA TOUR-SUR-ORB VALROS OLONZAC LAMALOU-LES-BAINS VIAS PAILHES -

Mise En Page 1
Sommaire Les JEP 2017, c'est frais! La jeunesse au cœur Soirées Expositions de cette 34e édition d’ouverture des “journées Aumes . 19 européennes Agde . 4 Agde . 19 du patrimoine” Pézenas . 5 Bessan . 19 Castelnau-de-Guers . 19 Animations Pézenas . 20 Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public jeunesse et Pomérols . 21 et sa sensibilisation au patrimoine, à l'histoire de la nation patrimoine Saint-Thibéry . 21 et à l'histoire de l'art, ou encore aux métiers du patrimoine. Vias . 21 Agde . 6 S'adresser aux jeunes générations, c'est une occasion de Bessan . 7 Ouvertures des sites saluer le travail des associations et des réseaux engagés Castelnau-de-Guers . 7 dans l'éducation artistique et culturelle, des réseaux des Florensac . 7 Agde . 22 Villes et Pays d'art et d'histoire, et de bien d'autres encore Pézenas . 8-11 Caux . 22 qui valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse. Portiragnes . 11 Lézignan-la-Cèbe . 22 Rallye Archéo . 12 Montagnac . 23 Le thème de la jeunesse fait souffler un vent de fraîcheur Pézenas . 23,24 et de créativité sur la médiation du patrimoine. Autres animations Pomérols . 25 Portiragnes . 25 Dans chaque commune, on s'est appliqué à transmettre Agde . 13 Saint-Thibéry . 25 le savoir-faire, la connaissance et le talent pour vous Pézenas . 13 Tourbes . 25 proposer un programme riche et vivant qui s’adresse avec humour à toutes les générations dans un langage résolu- Visites guidées ment moderne. Calendrier . 26-30 Agde . 14 Venez vivre notre patrimoine à pied, en voiture, ou en ba- Aumes . -

C98 Official Journal
Official Journal C 98 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 25 March 2020 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RECOMMENDATIONS European Central Bank 2020/C 98/01 Recommendation of the European Central Bank of 19 March 2020 to the Council of the European Union on the external auditors of Latvijas Banka (ECB/2020/14) . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 2 2020/C 98/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9710 — Bertelsmann/Penguin Random House) (1) . 3 2020/C 98/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 4 2020/C 98/05 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9683 — Colony Capital/PSP/Etix) (1) . 5 2020/C 98/06 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9424 — NVIDIA/Mellanox) (1) . 6 2020/C 98/07 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9758 — Toyota Financial Services Corporation/Mitsui & Co/KINTO Brasil) (1) . 7 2020/C 98/08 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9724 — Generali/UIR/Zaragoza) (1) . 8 EN (1) Text with EEA relevance. IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/09 Euro exchange rates — 24 March 2020 . 9 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY European Commission 2020/C 98/10 Notice of the impending expiry of certain anti-dumping measures . -

Modification Versement Transport Herault
PARIS, le 13/02/2004 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES ANNULE ET REMPLACE LA LETTRE CIRCULAIRE N°2004-008 DU 23/01/2004 LETTRE CIRCULAIRE N° 2004-055 OBJET : Modification du champ d'application du Versement Transport (art L .2333-64 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales). - Création de la Communauté d'Agglomération HERAULT MEDITERRANEE. - A compter du 1er janvier 2004, le versement transport est applicable au taux de 0,60%. - Coordonnées bancaires de la Communauté d'Agglomération HERAULT MEDITERRANEE. NB / Sur le tableau ci-joint la Banque de France est celle de BEZIERS et non d'AGDE Par arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2002, la Communauté d'Agglomération HERAULT MEDITERRANEE a été créée entre les communes de : ADISSAN, AGDE, AUMES, BESSAN, CASTELNAU-DE-GUERS, CAUX, CAZOULS D'HERAULT, FLORENSAC, LEZIGNAN-LA-CEBE, MONTAGNAC, NEZIGNAN L'EVEQUE, NIZAS, PEZENAS, PINET, POMEROLS, PORTIRAGNES, SAINT PONS-DE-MAUCHIENS, SAINT THIBERY et VIAS. Par délibération du 26 septembre 2003, la Communauté d'Agglomération HERAULT MEDITERRANEE a décidé de fixer à compter du 1er janvier 2004, le versement transport au taux de 0,60% sur toutes les communes comprises dans son périmètre de transport urbain. 1 Le numéro d'identifiant attribué à cette nouvelle Autorité Organisatrice de Transport est le n°9303407. La Communauté d'Agglomération HERAULT MEDITERRANEE possède des coordonnées bancaires. La taxe versement transport est donc à verser sur le compte de la Communauté d'Agglomération ouvert auprès de la Banque de France et géré par la Trésorerie d'AGDE. Les informations relatives au champ d'application, au recouvrement et reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint. -

Parcours Du Mois De Juin 2021
PARCOURS DU MOIS DE JUIN 2021 Mardi 1 juin : 75km Balaruc- Poussan- Villeveyrac- St Pargoire- Campagnan- Paulhan- Adissan Nizas- St jean de Bébian- Pézenas- Aumes- Montagnac- Abbaye- Loupian Bouzigues- Balaruc Jeudi 3 juin : 88km Balaruc- Poussan- Villeveyrac- Vendémian- St Bauzile de la Sylve- Gignac Aniane- La boissière- Mas de Belaure- La taillade- Cournonterral- Poussan Balaruc Dimanche 6 juin : 90km Balaruc- Bouzigues- Loupian- Mèze- Grand grange- Pinet- Pomerols Florensac- Castelnau de guers- Pézenas- Lézignan- Adissan- Aspiran- Canet Le pouget- Vendémian- Villeveyrac- Poussan- Balaruc Mardi 8 juin : 80 km Balaruc- Poussan- Villeveyrac- Abbaye- Montagnac- Aumes- Pézenas- Conas Nézignan l'évèque- St Thibery- Le pont Romain- St louis- Pomerols- Pinet Grand grange- Mèze- Bouzigues- Balaruc Jeudi 10 juin : 85 km Balaruc- Poussan- Gigean- Montbazin- Cournonterral- Pignan- St Georges Bel air- Montarnaud- La boissière- Mas d'Alhem- Aumelas- Vendémian Villeveyrac- Poussan- Balaruc Dimanche 13 juin : 89km Balaruc- Poussan- Cournonterral- La peyssine- Murviel- Montarnaud Vailhauquès- Saugras- Murles- Grabels- Bel air- St Georges- Pignan Cournonterral- Poussan- Balaruc Mardi 15 juin : 82km Balaruc- Poussan- Villeveyrac- Abbaye- St Pons- St Pargoire- St Marcel Plaissan- Le pouget- Aumelas- St Paul et valmalle- Murviel- La peyssine Cournonterral- Poussan- Balaruc Jeudi 17 juin: 89km Balaruc- Lafarge- La peyrade- Frontignan- Vic- Mireval- Villeneuve- La prison Saussan- Lavérune- St Georges- Bel air- Vailhauquès- Montarnaud- Murviel La peyssine- -

JM Agglo 13 8Oct Mise En Page 1 19/10/2012 09:47 Page 2
JM Agglo 13 8oct_Mise en page 1 19/10/2012 09:47 Page 1 Numéro 13 • Octobre 2012 Octobre 13 • Numéro Une rentrée vitaminée Opération “un fruit pour la récré” à Pinet Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [ Lézignan-la-Cèbe [ Montagnac Nézignan-l’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thibéry [ Vias JM Agglo 13 8oct_Mise en page 1 19/10/2012 09:47 Page 2 4 Agir dans l’agglo [ Agriculture durable P. 4 [ Habitat : vieillesse et handicap P. 6 [ Economie : “la Capucière” à Bessan P. 9 11 Zoom sur l’agglo Une Agglo de services [ L’annuaire détachable des services P. 11 15 Vivre dans l’agglo [ Pinet : la fête du vin ressuscitée P. 15 [ Pomérols : la vidéo projection pour 2013 P. 16 [ Montagnac : le projet Lavagnac relancé P. 18 20 Sortir dans l’agglo [ La saison culturelle d’Agde P. 20 [ L’histoire du théâtre P. 21 [ Agenda P. 22 Dans l’Objectif Concours Maisons Fleuries 2012 316 participants ont concouru cette année à la 10ème édition des “Maisons fleuries” organisée par l’Agglo. La commune de Bessan a accueilli en juin dernier la manifestation de remise de prix. Le 1er prix dans la catégorie “jardin” a été attribué à Gilbert ARNAL d’ Aumes et le 1er Prix dans la catégorie “balcon/terrasse” a été décerné à MarieFrance VIALALLORCA de Pinet. Les gagnants des 1ers prix par commune : Adissan Roger RODIERE Agde Antoinette VENEZIA Aumes Gilbert ARNAL Bessan Nadine CAMPAGNE CastelnaudeGuers Monique PENARRUBIA Caux Louise CARASCO Florensac Henri PUJOL Montagnac Yolande JAUNE Nézignanl’Evêque Charly LELE Pézenas Christian MULLIGAN Pinet MarieFrance VIALALLORCA Pomérols Elianne FERNANDEZ SaintThibéry JeanMichel DAUMAS Vias Josette MIERZWINSKY. -

Arrondissements De Béziers
Arrondissement de Béziers COMMUNES ABEILHAN CRUZY PORTIRAGNES ADISSAN DIO-ET-VALQUIERES LE POUJOL-SUR-ORB AGDE ESPONDEILHAN POUZOLLES AGEL FAUGERES LE PRADAL AIGNE FELINES-MINERVOIS PRADES-SUR-VERNAZOBRE AIGUES-VIVES FERRALS-LES-MONTAGNES PREMIAN LES AIRES FERRIERES-POUSSAROU PUIMISSON ALIGNAN-DU-VENT FLORENSAC PUISSALICON ASSIGNAN FOS PUISSERGUIER AUMES FOUZILHON QUARANTE AUTIGNAC FRAISSE-SUR-AGOUT RIEUSSEC AVENE GABIAN RIOLS AZILLANET GRAISSESSAC ROQUEBRUN BABEAU-BOULDOUX HEREPIAN ROQUESSELS BASSAN JONCELS ROSIS BEAUFORT LAMALOU-LES-BAINS ROUJAN BEDARIEUX LAURENS SAINT-CHINIAN BERLOU LESPIGNAN SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN BESSAN LEZIGNAN-LA-CEBE SAINT-ETIENNE-D'ESTRECHOUX BEZIERS LIEURAN-LES-BEZIERS SAINT-GENIES-DE-VARENSAL BOISSET LIGNAN-SUR-ORB SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT BOUJAN-SUR-LIBRON LA LIVINIERE SAINT-GERVAIS-SUR-MARE LE BOUSQUET-D'ORB LUNAS SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS BRENAS MAGALAS SAINT-JULIEN-D'OLARGUES CABREROLLES MARAUSSAN SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON CAMBON-ET-SALVERGUES MARGON SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ CAMPLONG MAUREILHAN SAINT-PONS-DE-THOMIERES CAPESTANG MINERVE SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS CARLENCAS-ET-LEVAS MONS-LA-TRIVALLE SAINT-THIBERY CASSAGNOLES MONTADY SAINT-VINCENT-D'OLARGUES CASTANET-LE-HAUT MONTAGNAC LA SALVETAT-SUR-AGOUT CASTELNAU-DE-GUERS MONTBLANC SAUVIAN LA CAUNETTE MONTELS SERIGNAN CAUSSES-ET-VEYRAN MONTESQUIEU SERVIAN CAUSSINIOJOULS MONTOULIERS SIRAN CAUX MURVIEL-LES-BEZIERS LE SOULIE CAZEDARNES NEFFIES TAUSSAC-LA-BILLIERE CAZOULS-D' HERAULT NEZIGNAN-L'EVEQUE THEZAN-LES-BEZIERS CAZOULS-LES-BEZIERS NISSAN-LEZ-ENSERUNE TOURBES CEBAZAN NIZAS LA TOUR-SUR-ORB CEILHES-ET-ROCOZELS OLARGUES VAILHAN CERS OLONZAC-EN-MINERVOIS VALRAS-PLAGE CESSENON-SUR-ORB OUPIA VALROS CESSERAS PAILHES VELIEUX COLOMBIERE-SUR-ORB PARDAILHAN VENDRES COLOMBIERS PEZENAS VERRERIES-DE-MOUSSANS COMBES PEZENES-LES-MINES VIAS CORNEILHAN PIERRERUE VIEUSSAN COULOBRES PINET VILLEMAGNE-L'ARGENTIERE COURNIOU POILHES VILLENEUVE-LES-BEZIERS CREISSAN POMEROLS VILLESPASSANS (au 1er janvier 2017). -

CAHIER DES CHARGES DE L'appellation D'origine CONTRÔLÉE « Languedoc »
Procédure nationale d'opposition suite à l’avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boisons alcoolisées, et des eaux-de-vie des 21 octobre et 16 décembre 2010 CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « Languedoc » AVERTISSEMENT Cette modification du cahier des charges ne saurait préjuger de la rédaction finale qui sera retenue après instruction par le comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’INAO, sur la base notamment des résultats de la procédure nationale d’opposition. Les oppositions éventuelles qui seront formulées dans le cadre de la présente procédure ne peuvent porter que sur les éléments modifiés du cahier des charges : - Les modifications apparaissent dans le corps du texte en caractères gras. - Les dispositions proposées à la suppression apparaissent en caractères barrés XXX. Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc. » 1/62 Version n° 2 du 20/12/2010 Procédure nationale d'opposition suite à l’avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boisons alcoolisées, et des eaux-de-vie des 21 octobre et 16 décembre 2010 CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE « LANGUEDOC » CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc », initialement reconnue par le décret du 24 décembre 1985 sous le nom de « Coteaux du Languedoc », les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires 1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. -

Atlas Départemental Des Zones Inondables De L'hérault
NOTE DE PRESENTATION DE L’ATLAS DEPARTEMENTAL DES ZONES INONDABLES DE L’HERAULT 1) LES ATLAS DE ZONES INONDABLES : UNE DEMARCHE NATIONALE D’INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS PREVISIBLES Une démarche nationale appliquée localement Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, mais également en Europe. En France, le risque inondation concerne une commune sur trois à des degrés divers. La responsabilité de l’Etat en matière de prévention des risques d’inondation repose en priorité sur l’information des populations, la maîtrise de l’urbanisation dans les zones inondables et la préservation des zones naturelles d’expansion de crues. La constitution à l’échelle des bassins hydrographiques d’un document de référence sur les phénomènes d’inondation contribue à développer la conscience du risque chez les populations exposées. De par ses caractéristiques naturelles de climat et de relief, la région méditerranéenne se trouve fortement soumise au risque inondation avec des crues fréquentes et répétitives. Conscients de ce danger, les services de l’Etat ont lancé de nombreuses études pour acquérir une connaissance plus précise des zones exposées. Les Atlas de Zones Inondables (AZI) constituent les documents de référence voués à la connaissance des zones inondables. Ils doivent permettre de guider les collectivités territoriales dans leurs réflexions sur le développement et l’aménagement du territoire, en favorisant l’intégration du risque d’inondation dans les documents d’urbanisme tels que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les cartes communales. La DIREN a conduit avec la DDE34, un programme d’élaboration des atlas des zones inondables couvrant la quasi totalité des bassins versants du département de l’Hérault.