GSJ: Volume 9, Issue 2, February 2021, Online: ISSN 2320-9186
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

En Téléchargeant Ce Document, Vous Souscrivez Aux Conditions D’Utilisation Du Fonds Gregory-Piché
En téléchargeant ce document, vous souscrivez aux conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché. Les fichiers disponibles au Fonds Gregory-Piché ont été numérisés à partir de documents imprimés et de microfiches dont la qualité d’impression et l’état de conservation sont très variables. Les fichiers sont fournis à l’état brut et aucune garantie quant à la validité ou la complétude des informations qu’ils contiennent n’est offerte. En diffusant gratuitement ces documents, dont la grande majorité sont quasi introuvables dans une forme autre que le format numérique suggéré ici, le Fonds Gregory-Piché souhaite rendre service à la communauté des scientifiques intéressés aux questions démographiques des pays de la Francophonie, principalement des pays africains et ce, en évitant, autant que possible, de porter préjudice aux droits patrimoniaux des auteurs. Nous recommandons fortement aux usagers de citer adéquatement les ouvrages diffusés via le fonds documentaire numérique Gregory- Piché, en rendant crédit, en tout premier lieu, aux auteurs des documents. Pour référencer ce document, veuillez simplement utiliser la notice bibliographique standard du document original. Les opinions exprimées par les auteurs n’engagent que ceux-ci et ne représentent pas nécessairement les opinions de l’ODSEF. La liste des pays, ainsi que les intitulés retenus pour chacun d'eux, n'implique l'expression d'aucune opinion de la part de l’ODSEF quant au statut de ces pays et territoires ni quant à leurs frontières. Ce fichier a été produit par l’équipe des projets numériques de la Bibliothèque de l’Université Laval. Le contenu des documents, l’organisation du mode de diffusion et les conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché peuvent être modifiés sans préavis. -

Monographie Des Communes Des Départements De L'atlantique Et Du Li
Spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin : Monographie des communes des départements de l’Atlantique et du Littoral Note synthèse sur l’actualisation du diagnostic et la priorisation des cibles des communes Monographie départementale _ Mission de spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin _ 2019 1 Une initiative de : Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement Durable (DGCS-ODD) Avec l’appui financier de : Programme d’appui à la Décentralisation et Projet d’Appui aux Stratégies de Développement au Développement Communal (PDDC / GIZ) (PASD / PNUD) Fonds des Nations unies pour l'enfance Fonds des Nations unies pour la population (UNICEF) (UNFPA) Et l’appui technique du Cabinet Cosinus Conseils Monographie départementale _ Mission de spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin _ 2019 2 Tables des matières LISTE DES CARTES ..................................................................................................................................................... 4 SIGLES ET ABREVIATIONS ......................................................................................................................................... 5 1.1. BREF APERÇU SUR LES DEPARTEMENTS DE L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL ................................................ 7 1.1.1. INFORMATIONS SUR LE DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE ........................................................................................ 7 1.1.1.1. Présentation du Département de l’Atlantique ...................................................................................... -

Sdac Finale Lokossa
REPUBLIQUE DU BENIN *-*-*-*-* MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L’ADMINISTRATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (MDGLAAT) *-*-*-*-**-*-*-*-* DEPARTEMENT DU MONO *-*-*-*-* COMMUNE DE LOKOSSA Schéma Directeur d’Aménagement Communal (SDAC) de Lokossa VERSION FINALE Appui technique et financier : PDDC/GiZ Réalisé par le cabinet Alpha et Oméga Consultants 08 BP1132 tri postal ; Tél. 21 31 60 46 03BP703 ; Tél. : (+229) 21 35 32 50 COTONOU Décembre 2011 1 Sommaire 1 Rappel de la synthèse du diagnostic et de la problématique d’aménagement et de développement ....................................................................................................................................... 5 1.1 Synthèse générale du diagnostic de la commune de Lokossa ................................................ 5 1.1.1 Situation de la commune de Lokossa .............................................................................. 5 1.1.2 Brève description du milieu physique et naturel de la commune de Lokossa ................ 7 1.1.3 Brève description du milieu humain ............................................................................... 9 1.1.4 Caractéristiques économiques de la commune ............................................................ 10 1.1.5 Les niveaux d’équipement et de service ....................................................................... 11 1.2 Etat de l’aménagement du territoire de la commune de Lokossa ........................................ 15 1.2.1 Accessibilité de la commune ........................................................................................ -

Part 1: Chapter 2
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21958 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Aalders Grool, Marjolijn Cornelia Title: Verbal art of the Fon (Benin) Issue Date: 2013-10-16 2. Collecting the corpus This chapter describes the fieldwork during my stay in Benin. I will first describe the social context during the fieldwork and the political situation at the time. I will enter into the planning of the project and the preparations for the recording. The chapter continues with the actual collection of the corpus. Finally,I will describe the transcription and translation. 2.1. The social and political context of the fieldwork The preparations and the recording of the corpus took place in 1975 and 1976. This section describes the traditional context in the rural communities in Benin at that time and the changes that the Marxist-Leninist revolution brought about. The traditional context In 1976, the economy of the rural areas in the south of Benin depended on the growing of crops of starchy staples like maize, peanuts, and plantain. Yam, cassava, and millet were brought in from the north of the country. People in the south grew all kinds of vegetables as well. Small husbandry was a common practice. People lived in dwellings where a number of families lived together. A village consisted of a number of larger and smaller compounds. The supply of electricity was exceptional, but oil lamps were common. The chief of the village officially represented the central government, but in daily life, he shared his power with the priests and the diviners. -

Migrations Historiques Et Peuplement Dans Les Régions Lagunaires Du Bénin Méridional
Migrations historiques et peuplement dans les régions lagunaires du Bénin méridional Jean PLlYA La grande originalité des paysages géographiques du Bénin méridional tient à la présence, tout le long du littoral sur plus de 120 kilomètres et sur une profondeur de plus de 40 kilomètres à l'intérieur des terres. de lagunes en relation avec la mer ou de lacs aux eaux plus ou moins douces selon le mouvement des crues des fleuves intérieurs ou côtiers. La côte est bordée par un cordon de sables récents qui isole un réseau de lagu nes séparées par des cordons anciens ou insérés dans les plateaux argilo-sableaux du Continental terminal. A l'intérieur. on trouve successivement de l'ouest à l'est, les plateaux de Corné et de Bopa. entre le fleuve Mono qui sépare le Togo et le Bénin méridional et le lac Ahémé , puis le plateau d'Allada, entre le même lac et l'ensemble fluvial Ouémé-sô et enfin, au-delà, le plateau de Sakété. Un premier réseau de lagunes côtières s'étend sur 65 km environ, de la fron tière togolaise au village de Togbin, à moins de 10 km de Cotonou. Il se subdivise en lagune de Grand-Popo et lagune de Ouidah, de part et d'autre du chenal de l'Aho qui apporte au lac Ahémé ou évacue vers l'Océan les eaux maritimes ou les eaux douces et les sédiments du Mono. Le deuxième réseau, alimenté par les eaux du plus long fleuve du Bénin, l'Ouémé, part de la lagune de Cotonou, s'épanouit dans le lac Nokoué qui communique avec la lagune de Porto-Novo une trentaine de km plus à l'est et avec la lagune de Lagos un peu plus loin. -

Universidade Federal De Uberlândia Instituto De Ciências Humanas Do Pontal Programa De Pós Graduação Em Geografia Do Pontal
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DO PONTAL PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO PONTAL MOHAMED MOUDJABATOU MOUSSA MICROFINANCIAMENTO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CUNICULTURA EM ALLADA, BENIN, E O COMBATE À POBREZA NA BUSCA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL Ituiutaba 2019 MOHAMED MOUDJABATOU MOUSSA MICROFINANCIAMENTO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CUNICULTURA EM ALLADA, BENIN, E O COMBATE À POBREZA NA BUSCA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Geografia Do Instituto de Ciências Humanas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, como exigência parcial para obtenção do Título de Mestre em Geografia. Linha de Pesquisa: Produção do espaço rural e urbano. Orientador Prof. Dr. Anderson Pereira Portuguez Ituiutaba 2019 ATA DE DEFESA Programa de Pós- Geografia do Pontal Graduação em: Defesa de: Mestrado PPGEP Data: 29 de Abril de 2019 Hora de início: 14:00hs Hora de 16:10hs encerramento: Matrícula 21712GEO013 do Discente: Nome do Mohamed Moudjabatou Moussa Discente: Título do MICROFINANCIAMENTO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO Trabalho: DO DESENVOLVIMENTO DA CUNILCULTURA EM ALLADA, BENIM, E O COMBATE À POBREZA NA BUSCA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL Área de Produção do espaço e as dinâmicas ambientais concentração : Linha Produção do espaço rural e urbano de pesquis a: Projeto de Pesquisa de Dinâmicas territoriais e produção do espaço vinculação: Reuniu-se no Auditório II, Campus Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, a Banca Examinadora, designada pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal, assim composta: Professores Doutores: ( Dr. Alessandro Gomes Enoque-Instituto de Ciências Humanas – Universidade Federal de Uberlândia); ( Dra. -
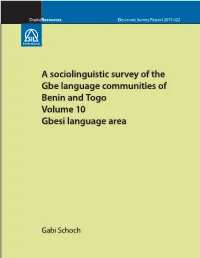
A Sociolinguistic Survey of the Gbe Language Communities of Benin and Togo Volume 10 Gbesi Language Area
DigitalResources Electronic Survey Report 2011-022 ® A sociolinguistic survey of the Gbe language communities of Benin and Togo Volume 10 Gbesi language area Gabi Schoch A sociolinguistic survey of the Gbe language communities of Benin and Togo Volume 10 Gbesi language area Gabi Schoch SIL International® 2011 SIL Electronic Survey Report 2011-022, March 2011 Copyright © 2011 Gabi Schoch and SIL International® All rights reserved A SOCIOLINGUISTIC SURVEY OF THE GBE LANGUAGE COMMUNITIES OF BENIN AND TOGO Series editor: Angela Kluge Gbe language family overview (by Angela Kluge) Volume 1: Kpési language area (by Evelin I. K. Durieux-Boon, Jude A. Durieux, Deborah H. Hatfield, and Bonnie J. Henson) Volume 2: Ayizo language area (by Deborah H. Hatfield and Michael M. McHenry) Volume 3: Kotafon language area (by Deborah H. Hatfield, Bonnie J. Henson, and Michael M. McHenry) Volume 4: Xwela language area (by Bonnie J. Henson, Eric C. Johnson, Angela Kluge) Volume 5: Xwla language area (by Bonnie J. Henson and Angela Kluge) Volume 6: Ci language area (by Bonnie J. Henson) Volume 7: Defi language area (by Eric C. Johnson) Volume 8: Saxwe, Daxe and Se language area (by Eric C. Johnson) Volume 9: Tofin language area (by Gabi Schoch) Volume 10: Gbesi language area (by Gabi Schoch) ii Contents Abstract 1. Introduction 2. Background 2.1. Language name and classification 2.2. Language area 2.3. Population 2.4. History of migration 2.5. Presence of other ethnic groups 2.6. Regional language use 2.7. Non-formal education 2.8. Religious situation 3. Previous linguistic research 4. -

Ananas Comosus) (L.) MERR Dans La Commune D’Allada Au
REPUBLIQUE DU BENIN Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université d’Abomey-Calavi Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi Centre Autonome de Perfectionnement Filière : Sciences Agricoles Option : Production Végétale Rapport de fin de formation pour l’obtention du diplôme de la Licence Professionnelle. Thème : Amélioration de la production de la culture d’ananas (Ananas comosus) (L.) MERR dans la Commune d’Allada au Bénin Présenté et soutenu par : MIKO GOHOUN Faustin Maître de stage Superviseur Dr Alphonse AGBAKA Ir. DJIHOU Zanitas Enseignant Chercheur à En service à la L’EPAC/ UAC Direction Générale Maître Assistant des CARDER Universités (CAMES) Atlantique-Littoral Année : 2012-2013 5ème Promotion THEME : PRODUCTION DE LA CULTURE D’ANANAS DANS LA COMMUNE D’ALLADA : CAS DES VARIETES PAIN DE SUCRE ET CAYENNE LISSE (ANANAS COMOSUS) CERTIFICATION Je soussigné Docteur Alphonse AGBAKA, enseignant chercheur (EPAC/UAC) certifie que le présent rapport a été intégralement rédigé et corrigé sous ma direction en collaboration avec Ingénieur Zanitas DJIHOU en service à la direction Générale CARDER Atlantique-Littoral par monsieur Faustin G. MIKO Etudiant en fin de formation à l’EPAC. En foi de quoi, la présente certification lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Abomey-Calavi, le……………………….2017 Dr Alphonse AGBAKA Enseignant Chercheur à l’EPAC/ UAC Maître Assistant des Universités (CAMES) Présenté et soutenu par MIKO GOHOUN Faustin i THEME : PRODUCTION DE LA CULTURE D’ANANAS DANS LA COMMUNE D’ALLADA : CAS DES VARIETES PAIN DE SUCRE ET CAYENNE LISSE (ANANAS COMOSUS) DEDICACE Je dédie ce travail à : Mon père MIKO G. -

Commune D'allada Projet D'amelioration De La
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN ooo Fraternité – Justice – Travail –––0o0––– PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE L’ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION °°°°°°°°°° PROJET MULTISECTORIEL DE L’ALIMENTATION, DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION (PMASN) -------o------- COMMUNE D’ALLADA PROJET D’AMELIORATION DE LA SITUATION NUTRITIONNELLE, DES PRATIQUES D’ALIMENTATION, D’HYGIENE ET DE SANTE DANS LA COMMUNE D’ALLADA Proposé par : Avril 2017 1 Sigles et abréviations CPS: Centre de Promotion Social EMICoV: Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages OCB Organisation Communautaire de Base ONG: Organisation Non Gouvernementale PANAR: Programme National de d’Alimentation et de Nutrition Axé sur les Résultats PDC: Plan de Développement Communal PMASN: Projet Multisectoriel de l’Alimentation, de la Sante, et de la Nutrition PSDAN: Plan Stratégique de Développement de l’Alimentation et de la Nutrition PTA: Programme de Travail Annuel RGPH: Recensement Général de la Population et des Habitats SCDA: Secteur Communal de Développement Agricole SFD: Service de financement Décentralisé SP CAN: Secrétariat Permanent du Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition CNA : Centre Nutritionnel Ambulatoire CNT : Centre Nutritionnel Thérapeutique 2 LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES LISTE DES TABLEAUX Tableau I : Répartition de la population par arrondissement. Tableau II : Répartition de la population de la Commune d’Allada par tranche d’âge Tableau III : Résultats attendus du projet Tableau IV : Cadre logique Tableau V : Rôle des différents acteurs et parties prenantes dans l’action et les raisons pour leur choix Tableau VI : Attitudes des parties prenantes vis à vis du projet Tableau VII : Rôle des acteurs dans le dispositif de suivi/évaluation Tableau VIII : Cahier de charge en fonction du profil/poste LISTE DES FIGURES Figure 1 : Carte des villages de la commune d’Allada Figure 2 : Organigramme du projet Figure 3 : Partenariat et rôles des acteurs 3 Table des matières 1. -
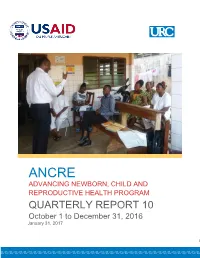
Quarterly Report 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ANCRE 34 ADVANCING NEWBORN, CHILD AND 35 REPRODUCTIVE HEALTH PROGRAM 36 37 QUARTERLY REPORT 10 38 October 1 to December 31, 2016 39 January 31, 2017 1 ANCRE Advancing Newborn, Child and Reproductive Health Program Quarterly Report No. 10 October 1 to December 31, 2016 Distribution: Athanase Hounnankan, United States Agency for International Development (USAID)/Benin Agreement Officer Representative Michelle Kouletio, United States Agency for International Development (USAID)/Benin Agreement Alternate Officer Representative Souleymane Kanon, ANCRE Chief of Party ANCRE Subcontractors: Results 4 Development and Dimagi File This report was prepared by the USAID/Benin Advancing Newborn, Child and Reproductive Health (ANCRE) program ANCRE is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID)/Benin in Cooperative Agreement No. AID-680-A-14- 00001. The program is managed by University Research Co., LLC (URC), in collaboration with Dimagi, Inc. and the Results for Development Institute (R4D). DISCLAIMER: The points of view expressed by the author in this publication do not necessarily reflect those of th United States Agency for International Development of the United States government. ANCRE - Quarterly Report No. 10 // October 1 to December 31, 2016 TABLE OF CONTENTS ACRONYMS ........................................................................................................................................... -

Villages Et Quartiers De Ville (Cartes De Districts)
REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE UNITE D'ANALYSE ET DE MINISTERE DU PLAN ET DE LA STATISTIQUE FORMATION DEMOGRAPHIQUES INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE LA POPULATION de L'ATLANTIQUE Villages et Quartiers de Ville (Cartes de Districts) Novembre 1988 REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE UNITE D'ANALYSE ET DE MINISTERE DU PLAN ET DE LA STATISTIQUE FORMATION DEMOGRAPHIQUES INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION (MARS 1979) LA POPULATION de L'ATLANTIQUE Villages et Quartiers de Ville (Cartes de Districts) Novembre 1988 DIm D)':"/) A T l B R B S Papa PRESENTATION GEOGRAPHIQUE i à iv II. LISTE DES TABLEAUX NOMBRE DE MENAGES ET LEUR POPULATION SELON LES DISTRICTS, LES COMMUNES ET LES VILLAGES POUR LA PROVINCE DE L'ATLANTIQUE Papa TABLEAU 1. District rural d'Abomey-Calavi 1 TABLEAU 2. District rural d'Allada 4 TABLEAU 3. District urbain de Cotonou l 7 TABLEAU 4. District urbain de Cotonou 2 8 TABLEAU 5. District urbain de Cotonou 3 9 TABLEAU 6. District urbain de Cotonou 4 10 TABLEAU 7. District urbain de Cotonou 5 11 TABLEAU 8. District urbain de Cotonou 6 12 TABLEAU 9. District rural de Kpomassè 13 TABLEAU 10. District rural de Ouidah 16 TABLEAU 11. District rural lacustre de So-Ava 18 TABLEAU 12. District rural de Torro 20 TABLEAU IJ. District rural de Torri-BossUo 22 "- \~ TABLEAU 14. District rural de Zè 24 III. -

Republique Du Benin
REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME AGENCE BENINOISE POUR L'ENVIRONNEMENT PLAN D'AMENAGEMENT DU SITE RAMSAR 1018 Etude réalisée par Comlan HESSOU avec la collaboration de Cossi Jean HOUNDAGBA Toussaint VODOUNOU Février 2004 2 Table des matières Liste des cartes Carte n° 1 : Carte n°1 : Carte hydro-climatique du Bénin …………………………………..………………16 Carte n° 2 : Carte n°2 : Localisation des sites RAMSAR du sud Bénin ………………………………… 23 Carte n° 3 : Occupation du sol et habitats de faune dans les lagunes anciennes …………………………...45 Carte n° 4 : Occupation du sol et habitats de faune dans la basse vallée de l’Ouémé et mer côtière ……..48 Carte n°5 : Occupation du sol et habitat de faune dans la moyenne vallée de l’Ouémé …………………...52 Carte n° 6 : Occupation du sol et habitats de faune dans les marécages d’Adjarra ……………………….53 Carte n° 7 : Carte d’aménagement du site ………………………………………………..70 Liste des tableaux Tableau n°1 : Poids démographique et spatial des départements du Bénin en 2002 ............................................. 18 Tableau n°2 : Répartition par sous-site des zones humides du Site 1018 ............................................................. 25 Sous-site ................................................................................................................................................................ 25 Tableau n° 3 : Répartition mensuelle du débit moyen et des apports annuels de l’Ouémé inférieur à la station de Bonou (entre 1948 et 1984). .........................................................................................................................