Evaluation Du Master Energie Nucléaire De L'université Paris-Sud
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ABIES Journal January 2021
ABIES Journal January 2021 Table of contents Edito: Tips and tricks from PhD students p.2 The word of a doctoral candidate (Florian) p.2 Challenge “creation d’entreprise” p.4 Next trainings and events (in English) p.5 Prochaines formations (en français) p.6 Job offers p.6 1 TIPS AND TRICKS FROM PHD STUDENTS Notion: a productivity support tool As a PhD student, chances are that you use several applications/tools that help you capture, sort, and organize your ideas (Todoist? Evernote? Word? PDF? ...). The use of these different tools can lead to a disordered accumulation of documents, scattered in multiple places. The information is fragmented and difficult to find. It is in this context that Notion.so can help you. What is it? Simply, it's a PC and mobile application that can change the way you organize yourself by gathering the tools you need in one place. To take notes during meetings, make to-do lists, create spreadsheets, manage your planning and projects (personal and professional) ... All this is possible on Notion.so. Discover this application by visiting: www.notion.so The Pomodoro method Have you ever tried to do several things at once, writing an email while listening to a conversation on the phone for example? If so, have you been fully present, focused, and efficient on these various tasks? It is a safe bet that the answer is no. In order to avoid this scattering, the Pomodoro method can be a good solution. This method of time and goals management proposes to divide one's work into small tasks and to use a timer to perform a specific task during a given time interval, and then to take a short break. -

ENSTA Paristech – UPM/ETSIT Presentation of Double- Moving Forward Degree
ENSTA ParisTech – UPM/ETSIT Presentation of Double- Moving Forward Degree Titre présentation History 1741 Origins Founded by Henry-Louis Duhamel du Monceau, , originally: the School of Henry-Louis Duhamel Construction Engineers of Royal Vessels du Monceau (1700-1782) . General The school became Presentation The National School of Maritime Engineering FIELDS OF EXPERTISE - Mechanical Engineering and Transportation History - Energy Origins of ENSTA - Complex Systems Engineering Merger with 3 other « Grandes Ecoles » 1970 General Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées Presentation Extension of the spectrum of specialities L'École Nationale L'École Nationale L'École des Ingénieurs Supérieure des Poudres, Supérieure de Hydrographes fondée en 1775. l'Armement, de la Marine, fondée en 1936, fondée en 1814. ENSTA École Nationale Supérieure de Techniques Avancées 32 boulevard Victor, Paris 15ème. Logo in 1970 History ENSTA ParisTech was born 1991 General Founding member of « ParisTech » Presentation ParisTech : 10 « Grandes Ecoles » (Graduate School of Engineering) AgroParis Tech Chimie ParisTech Institut d'Optique Graduate School 2006 École des Ponts ParisTech Mines ParisTech ESPCI ParisTech ENSTA becomes ENSTA ParisTech ENSAE ParisTech Télécom ParisTech ENSTA ParisTech Arts et Métiers ParisTech History ENSTA ParisTech in the Université Paris-Saclay 2012 General Presentation Arrival on Paris-Saclay campus On Ecole polytechnique campus Ici un texte en complément de la page. Un chiffre, une info clé… Partnerships and networks Et encore -

Tuitions Fees, Cvec & Fees
TUITIONS FEES, CVEC & FEES NORMAL PRICE FOR PRICE FOR CSC SCHOLARS PRICE FOR CSC SCHOLARS WITHIN A DOUBLE DEGREE (DD) NON-EUROPEAN STUDENTS (INDIVIDUAL APPLICANTS) AND/OR COMING FROM A PARTNER UNIVERSITY NB: Full cost of a "Diplôme d'ingénieur*" per year = 17 000€ (on average) List of partner Tuition fees CVEC** Tuition fees CVEC Tuition fees CVEC universities (DD and others) 1st year in France 4 290 € 92 € 4 290 € 92 € 1 765 € 92 € DD Tongji, all partner GRO ARIS ECH A P T universities of ParisTech 2nd year in France 4 290 € 92 € 4 290 € 92 € 4 290 € 92 € ARTS ET MÉTIERS 1st year in France 3 370 € 92 € 3 370 € 92 € 3 370 € 92 € SCIENCES ET TECHNOLOGIES 2nd year in France 3 370 € 92 € 3 370 € 92 € 3 370 € 92 € 1st year in France 3 570 € 92 € 1 785 € 92 € 0 € 92 € CHIMIE PARISTECH - PSL 2nd year in France 3 570 € 92 € 1 785 € 92 € 0 € 92 € 6300 € (tuition) + 3150 € (tuition) + 3150 € (tuition) + 92 € 92 € 92 € DD Tongi, XJTU 975€ (fees) 975 € (fees) 975€ (fees) 1st year in France 0 € (tuition) + DD SEU, Tsinghua n/a n/a n/a n/a 92 € ECOLE DES PONTS 975 € (fees) University 6300 € (tuition) + 3150 € (tuition) + 3150 € (tuition) + DD Tongi University, PARISTECH 92 € 92 € 92 € 975 € (fees) 975 € (fees) 975 € (fees) XJTU 2nd year in France n/a n/a n/a n/a 0 tuition + 975€ fees 92 € DD SEU, Tsinghua 1st year in France 850 € 92 € 150 € 92 € 0 € 92 € ESPCI PARIS - PSL 2nd year in France 850 € 92 € 150 € 92 € 0 € 92 € 1st year in France 5 000 € 92 € 2 900 € 92 € 2 900 € 92 € DD HUST INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL 2nd year in France 5 000 € 92 -

PC* Du Lycée Michelet, Année 2018-2019 Résultats Des Écrits, Résultats Oraux
PC* du lycée Michelet, année 2018-2019 Résultats des écrits, Résultats oraux légende : Banque X-ENS Banque mines-ponts Banque Centrale Supelec Banque CCP Banque E3A ex PCSI2 Polytechnique : X Centrale-Supélec : P Centrale Lille : Li Orientation moyenne ex PCSI1 ENS Paris : U Centrale Lyon : L Centrale Marseille : M Ban Centrale- PC* Mines ponts Chimie physique que Mines-Ponts CCP Physique extérieurs ENS Lyon : L Centrale Nantes : N UTT : U ; (Arts&M : A) Supelec TPE- EIVP Mines-Télécom X- ASS5/2 ENS Saclay : C SuypOptique : O ENSEA : E ; (ESTP : Es) Toutes les autres ENS écoles du « Top 13 » de L’Étudiant OUE FRE ESPCI : E barre : 12,38 Barre : 359 Navale : Na ; (EPF : Ep) écoles L Proposition SCEI au 29/8/2019 décision NILL S1 S2 admissibilités moyenne total admissibilités moyenne admissibilités admissibilités moyenne ESTACA présentées classement moyenne E+O moyenne E+O classement moyenne E+O OTAmin H VALeSTE 14 15,4 X-L-C-E Admissible 15,17 455 Admissible P-N-L-O-Li-M-E 13,44 ? 353 14,39 13,44 ENS Paris-Saclay X-ENS OUI DEFINITIF GNEANTugue OINEsLAE 12,7 14,1 Non Admissible Admissible 13,99 419,75 Admissible P-N-L-O-Li-M 14,33 Admissible Admissible 14,41 321 14,55 13,16 119 15,81 CENTRALE LYON Centrale OUI DEFINITIF YSR Jul H es- 12,4 13 Non Admissible Non Admissible 11,27 338 Non Admissible M-E 11,22 Admissible Admissible 13,09 10,85 790 13,72 Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique CCINP-P OUI DEFINITIF BREélèn eDE 12,7 12,3 Non Admissible Admissible 12,41 372,25 Admissible M-E-Es 11,25 Admissible Admissible 12,88 1164 10,35 -

Diversity at Paristech: a Value to Be Celebrated
October 2020 THE NEWSLETTER N°8 #Connect #Innovate #Share FEATURED Diversity at ParisTech: A value to be celebrated CHRISTIAN LERMINIAUX President of ParisTech EDITORIAL Despite the ongoing health crisis, the new academic year has got off to a good start across the ParisTech schools. The schools and their staff have worked tremendously hard to ensure that students have access to high-quality teaching in a safe environment. Blended learning has been introduced, with students alternating between face-to-face classes and online sessions as necessary in order to limit numbers on the campuses. International students too have taken up their places – a sign Arts et Métiers © that the ParisTech schools continue to enjoy a solid reputation on the The ParisTech schools prepare origin), disability diversity and world stage. The grandes écoles LAURENT CHAMPANEY Director general of Arts et Métiers young people for their future gender and sexuality diversity. entrance examinations went ahead Institute of Technology and President careers. It is vital that students as planned, and we were pleased of the Diversity Commission receive training in diversity We’ve done a lot to make all to see that candidates were management so that once they these kinds of diversity a reality, in as motivated as ever in spite graduate, they are able to promote particular with regard to recruitment. of the unprecedented crisis A year ago you were appointed and manage diversity in their To increase cultural diversity, we are all facing. President of the ParisTech Diversity -
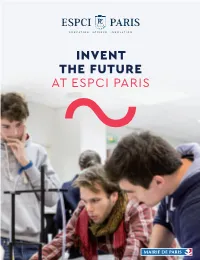
Invent the Future at ESPCI Paris Welcome to an Outstanding Environment for Science
INVENT THE FUTURE AT ESPCI PARIS WELCOME TO AN OUTSTANDING ENVIRONMENT FOR SCIENCE. ESPCI PARIS, AN ENGINEERING SCHOOL RUN BY THE CITY OF PARIS, HAS TRAINED 90 INNOVATION ENGINEERS READY TO INVENT THE FUTURE AND MEET THE CHALLENGES OF TOMORROW EVERY YEAR SINCE 1882. 90 STUDENT-ENGINEERS PER GRADUATING CLASS 1 PTA ENT APPLICATION SUBMITTED CHOOSE EACH WEEK ESPCI 6 NOBEL PARIS ! PRIZES JEAN-FRANÇOIS JOANNY Choose science and research by 1 Director of ESPCI Paris SCIENTIFIC ARTICLE joining an outstanding scientific community made up of more than PUBLISHED EACH DAY 530 researchers and professor-researchers on a campus that includes 9 joint research units. We encourage you to choose an education founded in excellence and ND the freedom that comes with it. You will walk in the footsteps of 6 Nobel 2 Prizes winning alums. You will be trained by the best minds in physics, BEST ENGINEERING chemistry and biology. With more than one professor-researcher for every SCHOOL, IN THE student-engineer, ESPCI has the highest student-teacher ratio of all engi- SHANGHAI RANKING neering schools in France. ESPCI Paris’ unique pedagogical approach is based on interdisciplinary studies and a close relationship between teaching and research. Here, you have everything you need to fully concentrate on your passion for 9 science and prove yourself among the world’s best. To study at ESPCI JOINT Paris is to study in the heart of Paris, in the Latin Quarter, on a campus RESEARCH UNITS that will be entirely renovated in the years to come. By choosing ESPCI Paris, you will become one of 90 students in the 135th graduating class who will go on to discover and invent the science of tomorrow—and maybe even create their own start-up. -

CONICYT Ranking Por Disciplina > Sub-Área OECD (Académicas) Comisión Nacional De Investigación 1
CONICYT Ranking por Disciplina > Sub-área OECD (Académicas) Comisión Nacional de Investigación 1. Ciencias Naturales > 1.6 Ciencias Biológicas Científica y Tecnológica PAÍS INSTITUCIÓN RANKING PUNTAJE USA Harvard University 1 5,000 USA Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2 5,000 UNITED KINGDOM University of Oxford 3 5,000 USA Stanford University 4 5,000 UNITED KINGDOM University of Cambridge 5 5,000 USA Johns Hopkins University 6 5,000 USA University of California San Francisco 7 5,000 USA University of Washington Seattle 8 5,000 UNITED KINGDOM University College London 9 5,000 USA Cornell University 10 5,000 CANADA University of Toronto 11 5,000 USA University of Pennsylvania 12 5,000 USA University of California San Diego 13 5,000 DENMARK University of Copenhagen 14 5,000 USA University of Michigan 15 5,000 USA University of California Berkeley 16 5,000 USA University of California Los Angeles 17 5,000 USA Duke University 18 5,000 USA University of California Davis 19 5,000 UNITED KINGDOM Imperial College London 20 5,000 USA Columbia University 21 5,000 USA Yale University 22 5,000 USA University of Minnesota Twin Cities 23 5,000 FRANCE Universite Paris Saclay (ComUE) 24 5,000 USA University of North Carolina Chapel Hill 25 5,000 AUSTRALIA University of Queensland 26 5,000 AUSTRALIA University of Melbourne 27 5,000 USA Washington University (WUSTL) 28 5,000 NETHERLANDS Utrecht University 29 5,000 USA University of Wisconsin Madison 30 5,000 FRANCE Sorbonne Universite 31 5,000 SWEDEN Karolinska Institutet 32 5,000 USA University -

August 2021 Ccci
AUGUST 2021 CCCI 1 PUC-Rio has currently more than 300 student exchange agreements and offers several double degree programs. Besides student exchange cooperation, the university maintains academic partnership with many universities around the world in order to promote joint research, promotion of scientific events, conferences and seminars, orientation and co-orientation of dissertations and theses for Master and/or Doctoral degrees, participation in examining boards and commissions, staff mobility and whatever other activity of an academic character. This list may change due to the establishment of new agreements or the end of partnerships. Students interested in Student Exchange Programs should contact the Central Coordination for International Cooperation (CCCI) for further information. 2 INDEX Student Exchange - Bilateral Agreements..…………………………….04 Africa.........................................................................................................................04 America ....................................................................................................................05 Asia...........................................................................................................................12 Europe......................................................................................................................15 Oceania.....................................................................................................................29 Student Exchange - Double Degree Agreements……….…………..30 -
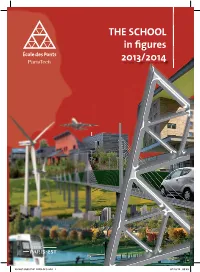
201407-0385Web Pap Anglais 0
THE SCHOOL 2013/2014 201407-0385 PaP ANGLAIS.indd 1 07/10/14 09:45 Degrees in engineering – 75 École nationale des ponts et chaussées professors, 3 assistant professors and 82 lecturers Year 1: Consolidation of scienti c knowledge and induction seminars Immersion placement: the course begins with 4 weeks of Masters programmes experience work in a company Scienti c internship: the whole class spends 3 months (April -July) in public or private research centres, 61% of them abroad “Science and Technology” Masters programme: – Mechanics of Materials and structures (MMS) with UPEM Year 2 choice of a faculty department: – Materials Science for Sustainable Construction (SMCD) Civil and structural engineering with UPEM Planning, environment, transport Mechanical engineering and materials science – Mechanics of Soils, Rocks and Structures in their Industrial engineering Environment (MSROE) with UPEM, UPMC and École Centrale Economics, management, nance Paris Applied mathematics and computer science – Built Heritage Materials in the Environment (MAPE) Year 2 internship: with UPEC and Paris Diderot - Paris 7 Between Years 2 and 3, 80% of the class attend a one-year internship, 30% of them abroad – Nuclear Energy “speciality in dismantling and waste The other students complete a short summer internship management” with ParisTech, Université Paris Sud and (2 months), 20% abroad École Centrale Paris, INSTN Gif, ESE SUPELEC and the support Year 3: End of Course Project (PFE): of several industrial rms: EDF, Areva, GDF SUEZ (ParisTech For at least 4 months, students apply the skills acquired in their Masters) programme to a scienti c or technical problem, at a company – Numerical Analysis and Partial Di erential Equations or research facility. -

Paris Sciences & Lettres (PSL) Makes Impressive Debut in 'World' Rankings
Paris Sciences & Lettres (PSL) makes impressive debut in ‘World’ rankings Submitted by: BlueSky Public Relations Ltd Tuesday, 20 June 2017 Paris Sciences & Lettres (PSL) has marked its first appearance in the Times Higher Education World Reputation Rankings with the highest ranking of any French institution and listed the eighth best in Europe. Overall it was 38th, placing it among the world’s top 50 universities. This first international ranking is an impressive feat for PSL, coming only seven years after its foundation as a collegiate of research and higher education institutions in the Paris area, and three national research organisations. The rankings achievement is a strong reflection of its progress since the results are based on peer recognition. An extensive global opinion survey of leading academics stretching across 137 countries assessed the excellence of research and teaching. The survey was conducted between January and March this year and received a total of 10,566 responses. PSL’s ranking shows that by consolidating institutions within a large university it has been possible to rise to heights that no French institution could have hoped to reach on its own. For example, the École normale supérieure ranked individually in the 61 to 70 bracket, and now, as a member institution of PSL, finds itself among the top 40. “France has been a relative underperformer in this list in recent years, but PSL’s success reveals the collective prestige of many of the leading institutions in Paris”, affirmed Phil Baty, publisher of the Times Higher Education Ranking. Marc Mézard, President of PSL, added: “This Times Higher Education ranking shows clear recognition of the progress achieved in developing PSL. -

FRAMEWORK AGREEMENT Between Paris Lnstitute of Science and Technology and Instituto Politécnico Nacional from México
.,,, ,_ ,~ FRAMEWORK AGREEMENT Between Paris lnstitute of Science and Technology and Instituto Politécnico Nacional from México The following Graduate Schools: AgroParisTech (lnstitut des sciences et industries du vivant et de l'environnement) Arts et Métiers ParisTech (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) Chimie ParisTech (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris) Ecole des Ponts ParisTech (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) Ecole Polytechniq ue ENSAE ParisTech (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administratíon Économique) ENSTA ParisTech (Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées) ESPCI ParisTech (Ecole Supérieure de Physique et de Chímie lndustrielles de la Ville de Paris) HEC Paris {Ecole des Hautes Etudes Commerciales) lnstitut d'Optique Graduate School MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) Telecom ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications) Of the Paris lnstitute of Science and Technology, hereunder designated as ParisTech, 12 rue Edouard Manet 75013 Paris- France, represented by its President, Mr. Jean-Philippe Vanot, and Instituto Politécnico Nacional from Mexico, hereunder designated as IPN, Edificio de la Dirección General, Avenida Luis Enrique Erro s/n, Unidad Profesional "Adolfo López Matees", Colonia Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Distrito Federal, C.P. 07738, represented by its General Director, Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez. Express that they have common fields of interest in education and research and therefore -

Master in Energy
MASTER IN ENERGY The PSL master’s degree in Energy provides discovery of the world of energy and its environmental and economic issues. It covers all areas of expertise necessary to the transformation of the energy sector: materials, components, energy systems… Hosted by Chimie ParisTech, MINES ParisTech and ESPCI Paris, this master degree procures methodologies to assess an energy system and measure the impact of technological innovations. It also covers proficiency in systems for the conversion and storage of energy and the methods, tools and criteria according to which decisions are taken. MAIN ASSETS RESEARCH — Core knowledge in the energy sector. The master’s degree in Energy is training for and — Specialization via a choice of 2 modules from 4 through research. It is based on the research topics modules offered: energy efficiency, decarbonization existing within Université PSL in the field of energy. of fuels, renewable energies / networks / storage, It is based on a balance between experimental, digital sustainable energies and materials. and theoretical approaches, perfectly matched with — Multidisciplinary training: thermodynamics, elec- the research activities and R&D of research organiza- trochemistry, electricity, materials, digital analysis, tions and large industrial groups. statistics… — International exposure: the Master’s 2nd year is taught in English. French language classes are avai- lable to international students. OPPORTUNITIES — Training in innovation through research: internships This program is recommended for students who of at least 8 months are required during the 2 years wish to prepare themselves for a career in acade- of the program, to be performed in various research, mic research or in centers of industrial research and academic and industrial groups.