Notices Fillols.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mining, Memory and the Mountain: Iron Mining on the Canigou Massif (Pyrenees-Orientales, France)’ Journal of the Mining Heritage Trust of Ireland, 16, Pp
This document is with a copy of the following article published by the Mining Heritage Trust of Ireland. It is provided for non-commercial research and educational use. The Mining Heritage Trust of Ireland formally ceased its existence in 2019 but has provided a continuing website of resources with free access for those interested in the activities of the organisation in its various formats from 1996-2019, and in Irish mining heritage in a broader sense. Jenkins Carter, S., Claughton, P. (2018) ‘Mining, Memory and the Mountain: Iron Mining on the Canigou Massif (Pyrenees-Orientales, France)’ Journal of the Mining Heritage Trust of Ireland, 16, pp. 21-32 Copyright of this article remains with the Mining Heritage Trust of Ireland whose archives, intellectual assets and library have been transferred to the Natural History Division of the National Museum of Ireland. Please contact [email protected] for any enquiries relating to the MHTI. This cover page must be included as an integral part of any copies of this document. Please visit www.mhti.com for more information. MINING, MEMORY AND THE MOUNTAIN: IRON MINING ON THE CANIGOU MASSIF (PYRÉNÉES-ORIENTALES, FRANCE) by Sharon Jenkins Carter and Peter Claughton Sharon Jenkins Carter, University of Wales, Trinity St David's; Corresponding author: Peter Claughton, University of Exeter, Email: [email protected] Preface: At the NAMHO conference in Dublin in 2016, Sharon Jenkins Carter took us through her work exploring how the heritage of iron mining defines the identity and culture of the local popu- lation of the communities of the Canigou in the department of Pyrénées-Orientales (France). -
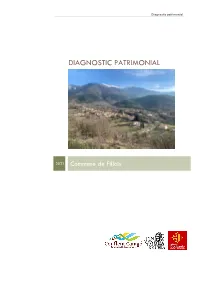
Diagnostic Fillols.Pdf
Diagnostic patrimonial DIAGNOSTIC PATRIMONIAL 2021 Commune de Fillols Diagnostic patrimonial Textes : Léonie Deshayes Photographies : Léonie Deshayes, Syndicat Mixte Canigó Grand Site, Michel Prats Avril 2021 Diagnostic patrimonial SOMMAIRE PREAMBULE ................................................................................. 4 HISTORIQUE ................................................................................. 7 Fillols de la Protohistoire au 13e siècle ................................................................... 7 Fillols du 14e siècle au 17e siècle ...........................................................................11 Fillols du 18e siècle à nos jours ...............................................................................13 LE CADRE NATUREL ................................................................... 18 Caractéristiques paysagères et hydrauliques .....................................................18 Patrimoine vernaculaire et agropastoralisme ......................................................25 Matériaux de construction........................................................................................27 FORME URBAINE ....................................................................... 30 Implantation du bâti..................................................................................................30 Typologies de l’habitat traditionnel ......................................................................35 Patrimoine industriel : les mines de fer de Fillols .................................................39 -

Les Ambullas Corneilla-De-Conflent
(05) La Redoute -2h50- altitude 813 m Randonnée N°4 Magnifique panorama sur les massifs environnants, la partie aval de la vallée de la Têt. Il est souvent possible Bonne conduite d’y apercevoir la mer. en montagne Revenir sur ses pas jusqu’au col et prendre à droite le chemin (direction Corneilla-de-Conflent) qui redescend Respectez la faune et la flore. doucement pour rejoindre la piste Ria - Sirach - Restez sur les sentiers balisés. Les Ambullas Corneilla-de-Conflent. Rapportez vos déchets. Passage près de la citerne « font de la perdiu ». Respectez la reglementation Prendre à droite (direction Corneilla-de-Conflent) affichée. et suivre la piste. Vous devez être bien équipé: Durée : 4h30 - 5h00 (hors arrêts) 12,6 km La piste, parfois coupée après une période de pluie, peut chaussures de montagne, eau. être contournée par la droite. Laissez les clotures et barrières Environ 500m après le poteau directionnel « Ambulla », dans la position trouvée. Balisage : prendre à droite le sentier (arbuste tourmenté) qui monte Restez silencieux et discret. Jaune (Promenade et Randonnée) vers la bergerie romane. Renseignez-vous sur les conditions A l’intersection, tourner à gauche (direction météorologiques. Corneilla-de-Conflent). Le retour se fait par le même chemin Ne pas faire de feu. Dénivelé : 240 m que l’aller. Cumulé : 470 m Arrivée Eglise Sainte Marie - Corneilla de Conflent -4h30- Difficulté : Moyenne Période : Printemps, Automne et Hiver. En été, éviter les fortes chaleurs. Chapeau et eau (en quantité suffisante) sont absolument nécessaires. Infos pratiques Secours. 112 ou 15 Météo. 08 99 71 02 66 Office de Tourisme Devenez ‘photo-reporter’ en tagant vos plus belles de Vernet-les-Bains photos de randos #vernetlesbains sur instagram 2 rue de la chapelle Tel. -

Département Des Pyrénées-Orientales Découpage
CC Agly Fenouillèdes CC Roussillon Conflent Fitou Département des Pyrénées-Orientales Opoul-Perillos Découpage des arrondissements Vingrau CC Salanque Méditerranée Périmètre des intercommunalités Salses le Château er Prugnanes 1 janvier 2017 Caudiès de Saint-Paul Fenouillèdes de Fenouillet Maury Tautavel Le St Espira de Hippolyte St Barcarès Lesquerde Rasiguères l’Agly Laurent St Martin Cases de la CC Conflent – Canigó Fenouillet Fosse de Fenouillet St Arnac Latour de Pène Rivesaltes Claira Salanque Estagel Le Lansac Planèzes de Vira Vivier Felluns France CC Capcir Haut Conflent Ansignan Baixas Torreilles Prats Calce CU Perpignan Méditerranée Pézilla Peyrestortes de Cassagnes Montner Pia Sournia de Trilla Caramany Rabouillet Conflent VillelongueSte Marie Bompas de la Sal. Bélesta Corneilla St Villeneuve la Mer Trévillach la Sournia Montalba Pézilla la Estève le Rivière la Rivière Perpignan Canet en Campoussy Château NéfiachMillas Rivière Baho Tarerach St Roussillon Ille sur Têt Feliu St Le Soler Cabestany Mosset Feliu Molitg d’Amont Arboussols Corbère d’Avall Toulouges les Bains St Nazaire Rodès les Puyvalador Eus Canohès Saleilles St Michel Cabanes Fontrabiouse Urbanya Thuir Villeneuve Campôme Vinça Bouleternère de Corbère de la Théza Alénya Réal Catllar Marquixanes Llotes Ponteilla Pollestres Camélas Raho Corneilla St Nohèdes Ria- Espira Rigarda Llupia Formiguères Conat Prades del Vercol Cyprien CC Sud Roussillon Sansa Sirach Los de Casefabre Conflent Ste Colombe Masos Joch Bages Latour Castelnou Trouillas Montescot Villefranche Codalet -

Les Infos De Catllar
LES INFOS DE CATLLAR DECEMBRE 2014 - N° 13 Edito - Le mot du Maire. Catllanaises, Catllanais, Les différents investissements présentés lors de nos précédents bulletins, financés sans emprunts, sont aujourd’hui achevés. Pas de projet d’envergure pour l’année 2015. La baisse de la dotation globale de fonc- tionnement (DGF) et des subventions ampute nos recettes et affecte notre budget. Un effort est donc demandé aux collectivités locales, obligeant à des choix budgétaires difficiles pour réduire les dépenses. L’année à venir sera essentiellement consacrée à l’amélioration de l’éclairage public, la signalétique, l’enfouissement des réseaux de communication…, ainsi qu’à la protection et la qualité de l’environnement (passages piétons, travaux d’entretien des berges de la Castellane et du Routès…). De nombreuses études se feront en partenariat avec la Communauté de Communes, le Parc Naturel Régional (PNR), et les syndicats impliqués. Mais la priorité des priorités sera donnée à la reprise de nos documents d’urbanisme. Une atten- tion toute particulière sera portée à l’entretien de nos réseaux d’assainissement. Dès janvier 2015, trois re- gards d’eaux usées seront remplacés rue de la Têt, afin de supprimer les nombreuses infiltrations d’eaux pa- rasitaires et réduire les dépenses de fonctionnement de notre régie. Je me fais l’interprète des élus et du personnel communal pour souhaiter la bienvenue aux nou- veaux arrivants, un joyeux Noël et une excellente année 2015 à l’ensemble de la population. Votre Maire, Josette PUJOL LES VŒUX DU MAIRE Vous êtes cordialement invités à partager la galette des rois à la Salle Polyvalente, le samedi 17 janvier 2015 à 17h. -

Fr-Web-Jbk-Cadastre Corneilla De Conflent.Pdf
1 CORNEILLA-DE-CONFLENT (nom correct: CORNELLÀ DE CONFLENT) Région historique du Conflent Cadastre corrigé le 31 mai 2016 à la mairie. Maire: Patrice ARRO. Commission municipale: Patrice ARRO, maire, Nicole RESTAYNT. Commande de la Communauté de Communes du Conflent-Canigó. Responsable à la DGI de Perpignan: Patrick MOUREY, ingénieur du cadastre. Expert: Joan BECAT, Études Catalanes, Université de Perpignan. Recueil préliminaire des noms de la commune le 17 juillet 2000, avec Robert FAJAL, maire, Ramon GUAL, Joan BECAT. L’Institut Géographique National (IGN, Paris) a corrigé la toponymie de Corneilla-de-Conflent sur son portail internet GEOPORTAIL et sur sa carte au 1:25.000 Massif du Canigou nº2349 ET. Note: Vous trouverez l’ensemble des toponymes de Corneilla- de-Conflent avec leur graphie catalane correcte dans l’Atles toponímic de Catalunya Nord - Atlas toponymique de Catalogne Nord, éd. Terra Nostra, Prades, 2015, 2 volumes, 970p. TOPONYMES ET NOM SUR LE NOM SUR LE NOM SUR GEOPORTAIL FEUILLES CADASTRE ANTÉRIEUR CADASTRE ACTUEL (portail cartographique CADASTRALES CORRIGÉ de l’IGN) Noms de sections cadastrales A1 Bach de la Trencade Bac de la Trencada Bac de la Trencada Cadastre de Corneilla-de-Conflent - Maire Patrice Arro - Correction 2016 - Joan Becat 2 B1/B2 Badebany Badabany Badabany A5 Bosch del Priou Bosc del Prior Bosc del Prior A1/A3 Ambouilla en Bullà En Bullà B4 Lo Bourgué el Burguer - A5 Los Cabanils els Cabanils els Cabanils A2 Chemin de Corneilla el Camí de Cornellà Camí de Cornellà B4 Camp del Pla Camp del Pla - B3 Camp -

Vallée De Mantet (Identifiant National : 910030159)
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030159 Vallée de Mantet (Identifiant national : 910030159) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 66085128) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, Groupe Ornithologique du Roussillon, Soldanelle, .- 910030159, Vallée de Mantet. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030159.pdf Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon Rédacteur(s) :Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, Groupe Ornithologique du Roussillon, Soldanelle Centroïde calculé : 595625°-1725008° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 16/06/2008 Date actuelle d'avis CSRPN : 16/06/2008 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Département Des Pyrénées-Orientales ______
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DIRECTION DE L'ESPACE RURAL ET DE LA FORÊT INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL _________ DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES _______ RÉSULTATS DU TROISIÈME INVENTAIRE FORESTIER (1989-1990) Année d’édition : 1994 La reproduction partielle ou totale des données publiées dans la présente brochure est autorisée, sous réserve d’en indiquer la source TABLE DES MATIÈRES ____ 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 1.1 - Aperçu historique et géographique 7 1.2 - Démographie 8 1.3 - Aspects économiques 8 1.3.1 - Agriculture 8 1.3.2 - Industrie 9 1.3.3 - Bâtiment, génie civil et agricole 9 1.3.4 - Secteur tertiaire 9 1.4 - Relief, climat et hydrographie 9 1.4.1 - Relief 9 1.4.2 - Climat 10 1.4.3 - Hydrographie 11 2 - PRÉSENTATION DES FORÊTS DU DÉPARTEMENT 13 2.0 - Définitions 13 2.1 - Données générales 13 2.2 - Régions forestières 16 2.2.1 - Corbières méridionales 16 2.2.1.1 - Situation - relief 16 2.2.1.2 - Géologie - pédologie 16 2.2.1.3 - Climat 16 2.2.1.4 - Paysage et végétation forestière 16 2.2.2 - Fenouillèdes 17 2.2.2.1 - Situation - relief 17 2.2.2.2 - Géologie - pédologie 17 2.2.2.3 - Climat 18 2.2.2.4 - Paysage et végétation forestière 18 2.2.3 - Bordure orientale du pays de Sault 19 2.2.3.1 - Situation - relief 19 2.2.3.2 - Géologie - pédologie 19 2.2.3.3 - Climat 19 2.2.3.4 - Paysage et végétation forestière 20 2.2.4 - Plaine du Roussillon 20 2.2.4.1 - Situation - relief 20 2.2.4.2 - Géologie - pédologie 21 2.2.4.3 - Climat 21 2.2.4.4 - Paysage et végétation forestière 22 -

Les Ram Des Pyrénées-Orientales
LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DANS LES PYRENEES-ORIENTALES • Agly - Fenouillèdes et Estagel • Bompas Communes couvertes : Ansignan, Caramany, Caudies, Esta- Place David Vidal - 66430 Bompas - 04 68 34 76 38 gel, Fenouillet, Feilluns, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Les- [email protected] querde, Le Vivier, Maury, Pézilla-de-Conflent, Planèzes, Prats-de- Sournia, Prugnanes, Rabouillet, Rasiguères, St-Arnac, St-Martin • Cabestany de Fenouillet, St-Paul de Fenouillet, Trilla, Vira Espace Enfance - 16 av. Célestin Freinet - 66330 Cabestany 04 68 50 91 61 - [email protected] les Rue de la Fou - 66220 Saint-Paul de Fenouillet • Canet-en-Roussillon Ram 06 38 49 19 35 - [email protected] Rue des salins - 66140 Canet-en-Roussillon Relais assistants maternels • Albères - Côte Vermeille 04 68 86 71 71 - [email protected] Communes couvertes : Argelès-sur-Mer, Bages, Elne, Ortaffa, Palau del Vidre, Sorède, St-André, Laroque-des-Albères, Mon- • Canohes tesquieu-des-Albères, St-Génis-des-Fontaines, Villelongue-dels- 3 rue Romain Escudier - 66680 Canohes des Pyrénées-Orientales 04 68 21 06 07 - [email protected] Monts, Banyuls-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Cerbère 3 allée Ferdinand Buisson - 66700 Argelès-sur-Mer • Perpignan Nord 04 68 55 58 90 - 06 85 20 28 73 25 bis rue Samuel de Champlain - 66000 Perpignan [email protected] 04 68 52 30 38 - [email protected] La Caf coordonne le réseau des • Perpignan Sud Relais assistants maternels • Aspres Communes couvertes : Banyuls-des-Aspres, -

9782746989535.Pdf
MUSCAT DE RIVESALTES – Photos : Marc Gaillet. All right reserved – 05/2015 MUSCAT DE RIVESALTES All the natural freshness from the grape in this fruity aperitif. Serve chilled any time of the year. vinsduroussillon.com Contents Banyuls-sur-Mer – Knowing More Banyuls de la Marenda ......................65 About Perpignan Bélesta – Belestar ..............................69 & North Catalonia Canet-en-Roussillon – Canet de Rosello ................................70 Céret ...................................................78 Record Sheet ........................................4 Collioure – Cotlliure ...........................80 Not to be missed ..................................4 Elne – Elna ..........................................85 Nature ...................................................8 Font-Romeu .......................................88 History ................................................12 In the surroundings ..................................92 Heritage & Traditions ........................13 Ille-sur-Têt – Illa ..................................94 Gastronomy .......................................15 In the surroundings ..................................96 Sports & Leisure .................................20 Le Barcarès – El Barcares ...................98 Festivals & Events ..............................23 In the surroundings ............................... 101 Le Boulou – El Volo ..........................102 In the surroundings ............................... 106 Perpignan Maury – Mauri ..................................107 -

Répartition Communale Du Potentiel Radon Géogénique Des Pyrénées-Orientales ¯
Répartition communale du potentiel radon géogénique des Pyrénées-Orientales ¯ Opoul-Périllos Vingrau Salses-le-Château Prugnanes Saint-Paul-de-Fenouillet Maury Caudiès-de-Fenouillèdes Tautavel Le Barcarès Saint-Hippolyte Espira-de-l'Agly Lesquerde Saint-Laurent-de-la-Salanque FosseSaint-Martin-de-Fenouillet Cases-de-Pène Fenouillet Rivesaltes Saint-Arnac RasiguèresPlanèzes Latour-de-France Lansac Estagel Vira Le Vivier Felluns Ansignan Claira Torreilles Calce Peyrestortes Prats-de-Sournia Cassagnes Baixas Pia Montner Pézilla-de-ConflentTrilla Caramany Rabouillet Bompas Sainte-Marie Bélesta Villelongue-de-la-Salanque Sournia Saint-Estève Trévillach Corneilla-la-Rivière Pézilla-la-Rivière Baho Montalba-le-Château Millas Villeneuve-la-Rivière Campoussy Néfiach Perpignan Tarerach Mosset Canet-en-Roussillon Ille-sur-Têt Saint-Féliu-d'Amont Le Soler Cabestany Saint-Féliu-d'Avall Toulouges Molitg-les-Bains Arboussols Corbère-les-Cabanes Saint-Nazaire Puyvalador Eus Rodès Saleilles Corbère Canohès Urbanya BouleternèreSaint-Michel-de-Llotes Fontrabiouse Réal Campôme Catllar Vinça Villeneuve-de-la-Raho Marquixanes Thuir Pollestres Théza Alénya Ponteilla Nohèdes Camélas Rigarda Llupia Formiguères Sansa Espira-de-Conflent Corneilla-del-Vercol Saint-Cyprien Conat Masos Joch Casefabre Ria-Sirach Prades CastelnouSainte-Colombe-de-la-Commanderie Montescot Bages Finestret Trouillas Latour-Bas-Elne Codalet Terrats Elne Olette Villefranche-de-Conflent Caixas Railleu Glorianes Villemolaque Boule-d'Amont Angles Matemale Jujols Clara Montauriol Fourques Saint-Jean-Lasseille -

Partie3-Annexes Orientations
4. '2&80(176*5$3+,48(6 PDPFCI 2016 ± PARTIE IV : Documents Graphiques 140 Département des Pyrénées-Orientales Massifs forestiers et aléa feu de forêt échelle : 1 / 300 000° - Date : octobre 2015 - Sources: BD carto® ©IGN, DDTM 66, alea dép. - Auteur : ONF Pôle DFCI 11 / 66 Corbières Fenouillèdes Plaine Roussillon Capcir Conflent Aspres Cerdagne Albères Vallespir Limite de Massif Aléa feu de forêt Très faible Faible Modéré Elevé 05 10 20 Kilomètres Très élevé Département des Pyrénées-Orientales Les massifs forestiers 1:300 000 Sources : INSEE, RGP 2010 et BD TOPO®, ©IGN ONF DFCI - 14/09/2015 Limites Communales Massifs forestiers Opoul-Périllos Albères Vingrau Aspres Salses-le-Château Prugnanes Saint-Paul-de-Fenouillet Maury Capcir Caudiès-de-Fenouillèdes Tautavel Barcarès Saint-Hippolyte Cerdagne Lesquerde Espira-de-l'Agly Saint-Laurent-de-la-Salanque Fosse Cases-de-Pène Fenouillet Saint-Martin Planèzes Rivesaltes Saint-Arnac Rasiguères Conflent Latour-de-France Vivier Lansac Estagel Vira Claira Felluns Ansignan Torreilles Corbières Calce Peyrestortes Pia Prats-de-Sournia Cassagnes Baixas Trilla Montner Pézilla-de-Conflent Caramany Rabouillet Fenouillèdes Bompas Sainte-Marie Bélesta Villelongue-de-la-Salanque Sournia Corneilla-la-Rivière Saint-Estève Trévillach Plaine Roussillon Pézilla-la-Rivière Baho Montalba-le-Château Néfiach Millas Campoussy Villeneuve-la-Rivière Perpignan Tarerach Canet en Roussillon Vallespir Mosset Saint-Féliu-d'Amont Ille-sur-Têt Soler Cabestany Saint-Féliu-d'Avall Toulouges Molitg-les-Bains Arboussols Rodès