Monographie De La Commune De Delouze
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
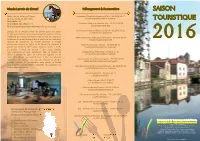
Depliant ST 11 CORRIGE V3.Indd
Musée Lorrain du Cheval Hébergement & Restaurati on SAISON Dates : du 1er juillet au 31 août, Chambres d’Hôtes des Bords de la Tour – 03 29 89 63 57 sauf les mardis, de 14h à 18h 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU TOURISTIQUE Tarif adulte : 3€ Tarif enfants (12 -18ans) : 2 € Chambres d’Hôtes de Vouthon-Bas – 03 29 89 74 00 Tarif groupe (10 personnes minimum) : 2€ par personne 55130 VOUTHON-BAS Chambres d’Hôtes La Maison du Canal – 03 29 46 41 52 Chaque été, le Musée Lorrain du Cheval ouvre ses portes 55130 HOUDELAINCOURT et off re aux visiteurs une occasion unique de parcourir la tour médiévale de Gondrecourt tout en découvrant les collecti ons Hôtel Restaurant L’Auberge du Père Louis – 03 29 89 64 14 du Musée. La rareté, la diversité et la qualité de ces collecti ons 55130 HOUDELAINCOURT 2016 raviront les passionnés du monde équestre, à l’image du harnais complet de liti ère et du harnais de traîneau à Hôtel Restaurant Le Central – 03 29 89 63 42 grelots du début du 18ème siècle. Simples curieux ? Sorti e 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU en famille ? Sorti e de groupe ? Des visites guidées sont organisées et vous plongeront dans le monde du Restaurant Au Peti t Resto – 03 29 46 47 92 cheval à travers les âges. Le musée est organisé en six 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU salles thémati ques qui traitent tour à tour des diverses uti lisati ons des chevaux au cours de l’histoire et de leur Aire naturelle de la Ferme d’Orgeval – 03 29 89 77 88 encrage culturel. -

La Micro-Crèche
JUILLET 2019 #7 HORIZON L’ACTU DES PORTES DE MEUSE L’ÉTÉ SERA ANIMÉ ! TOURISME DÉVELOPPEMENT PORTRAIT À la découverte des Portes de Meuse ! ÉCONOMIQUE Gérard LARGUIER, peintre et voisin de PICASSO. p.4 De nouvelles entreprises s’installent. p.21 p.10 ÉDITO // SOMMAIRE COUP DE CŒUR p. 3 TOURISME p. 4 VIE ASSOCIATIVE p. 6 SPORT p. 8 L’HERBE N’EST PAS PLUS VERTE AILLEURS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE p. 10 Je l’avoue… Quand certains clament que l’herbe est plus verte ailleurs, je ne peux m’empêcher de les inciter à lever la tête et à regarder autour d’eux pour apprécier les nombreux atouts de notre territoire. La qualité de vie y est très appréciable, à p. 12 l’opposé des grands centres urbains et de leurs nuisances. Nos ACTEURS ÉCONOMIQUES enfants sont en sécurité dans nos écoles et dans nos villages. Nous avons accès à de nombreux services publics grâce aux Mairies et à la Communauté de Communes des Portes de Meuse. Nous possédons un patrimoine naturel et historique PETITE ENFANCE p. 16 exceptionnel. Nos forêts, nos cours d’eau, nos châteaux, le site intercommunal d’Écurey, notre histoire méritent d’être connus et reconnus. Nous en sommes convaincus. Et c’est bien pour cela que nous avons construit une véritable offre touristique IMMOBILIER p. 18 en partenariat avec l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud, ainsi qu’avec la Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne. Randonnées, chasse au trésor, expositions, visites, animations sportives et culturelles, vous trouverez durant l’été de nombreuses occasions de découvrir PATRIMOINE p. -

Répertoire Numerique Detaille De La Sous-Serie 2 Z
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MEUSE RÉPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE DE LA SOUS-SERIE 2 Z SOUS-PREFECTURE DE COMMERCY (1800-1940) par Yves KINOSSIAN conservateur stagiaire du patrimoine avec la participation d’Annie ÉTIENNE et de Monique HUSSENOT sous la direction de Jacques MOURIER directeur des Archives de la Meuse BAR-LE-DUC 1994, 1997 INTRODUCTION Historique C'est le décret-loi du 30 janvier 1790 qui crée le département du Barrois rebaptisé département de la Meuse un mois plus tard. Celui-ci est divisé en huit districts (Bar-le-Duc, Clermont-en-Argonne, Commercy, Etain, Gondrecourt-le-Château, Saint-Mihiel, Stenay puis Montmédy et Verdun) et soixante-dix-neuf cantons. Bar-le-Duc est choisi comme chef-lieu du département contre Verdun et devient la capitale administrative de la Meuse. La gestion des districts est confiée à un conseil de douze membres, un directoire de quatre membres et un procureur-syndic. Les cantons sont des circonscriptions électorales, sièges de justice de paix, mais dépourvues d'administration propre. La constitution de l'an III (22 août 1795) a supprimé les districts, laissant une structure département – canton – commune. L'idée du district est reprise et modifiée dans le cadre de la réforme de l'organisation administrative de l'an VIII : à la création de préfectures répond la fondation de districts agrandis, nommés initialement « arrondissements communaux ». Ce sont les ancêtres de nos arrondissements ; en l'an VIII on en compte 402 pour 5 105 cantons. D'anciens chefs-lieux de districts dépouillés de leurs prérogatives se mobilisent pour être désignés chefs-lieux d'arrondissement 1. -

The Uncensored Letters of a Canteen Girl
THE UNCENSORED LETTERS OF A CANTEEN GIRL NEW YORK HENRY HOLT AND COMPANY 1920 3i 570 ^1 Copyright, 1920 BY HENRY HOLT AND COMPANY TO PAT GATTS BRADY SNOW NEDDY BILL NICK HARRY JERRY and THE REST THIS BOOK is DEDICATED 436oo9 CONTENTS PAGE CHAPTER I BOURMONT Company A i CHAPTER II GONCOURT The Doughboys 59 CHAPTER III Rattentout The Front. .;.... 87 CHAPTER IV GONDRECOURT The Artillery 112 CHAPTER V Abainville The Engineers 132 CHAPTER VI Mauvages The Ordnance 167 CHAPTER Vn Verdun The French 214 CHAPTER VIII CONFLANS Pioneers, M. P.'s and Others 237 FOREWORD ToM. D. M. andM. H. M: My dears. These letters were all written for you; scratched down on odds and ends of writing paper, in a rare spare moment at the canteen; at night, at my billet, by candle-light; in the mornings, perched in front of Madame's fire-place with my toes tucked up on an orna- mental chaufrette foot-warmer. Why were they never sent? Simply because all letters mailed from France in those days, must of course pass under the eyes of the Censor. And as the Censor was likely to be a young man who sat opposite you at the mess-table, it meant that one mustn't say the things one could, and one couldn't say the things one would. So, after my first fortnight over there I decided to write my letters to you just as I would at home, putting down everything I saw and thought— and did, quite brazenly and shame- lessly, and then keep them, under lock and key if need be,—until I could give them to you in person. -

Tél.: (38) 63.80.01
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL B.P. 6009 - 45060 Orléans Cedex - Tél.: (38) 63.80.01 DIRECTION DEPARTEMENTALE de 1'EQUIPEMENT GROUPE d?ETUDE et de PROGRAMMATION Estimation des besoins en granuláis et recensement des gisements potentiels dans la Vallée de la Meuse entre PAGNY-SUR-MEUSE et DOMREMY-LA-PUCELLE J. RICOUR avec la collaboration de Cl. MAROTEL Service géologique régional LORRAINE Rue du Parc de Brabois - 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Tél. : (83) 51.43.51 79 SGN 587 LOR Vandoeuvre, le 26 novembre 1979 RESUME L'étude des ressources et des besoins en granuláis dans le Sud du département de la Meuse fait suite aux études antérieures réalisées en particulier pour le Groupement d'Etude et de Programmation de la DIRECTION DEPARTEMENTALE de 1'EQUIPEMENT. L'évaluation des besoins montre que ceux-ci sont en stagnation du fait de l'évolution de la démographie du secteur concerné. L'étude des ressources montrent que celles-ci sont en général de qualité moyenne à médiocre et sont susceptibles de couvrir la demande locale sous réserve que les exploitations plus importantes du secteur de PAGNY - VOID, au Nord, n'absorbent la demande du Sud du département. SOMMAIRE Pages Résumé 1 - Introduction.. 1 2 - Cadre géologique du secteur d'étude . 2 2.1. Aperçu géologique 2.2. Caractéristiques des matériaux rocheux et meubles 3 - Etude des besoins 8 3.1. Aperçu des besoins au niveau national 3.2. Définition des besoins au niveau local 4 - Etat des contraintes dans le secteur d'étude 13 4.1. Définition des contraintes 4.2. -
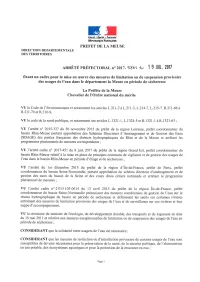
Arrêté Cadre Secheresse 2017
Page 1 Annexe 2 – Répartition des communes par zones d’alerte Zone d’alerte 1 : Aisne amont 55014 AUBREVILLE 55285 LAVOYE 55017 AUTRECOURT-SUR-AIRE 55116 LE CLAON 55023 AVOCOURT 55379 LE NEUFOUR 55032 BAUDREMONT 55253 LES ISLETTES 55033 BAULNY 55497 LES SOUHESMES-RAMPONT 55038 BEAULIEU-EN-ARGONNE 55254 LES TROIS-DOMAINES 55040 BEAUSITE 55289 LEVONCOURT 55044 BELRAIN 55290 LIGNIERES-SUR-AIRE 55065 BOUREUILLES 55295 LISLE-EN-BARROIS 55068 BRABANT-EN-ARGONNE 55301 LONGCHAMPS-SUR-AIRE 55081 BRIZEAUX 55343 MONTBLAINVILLE 55082 BROCOURT-EN-ARGONNE 55346 MONTFAUCON-D'ARGONNE 55103 CHARPENTRY 55380 NEUVILLE-EN-VERDUNOIS 55108 CHAUMONT-SUR-AIRE 55383 NEUVILLY-EN-ARGONNE 55113 CHEPPY 55384 NICEY-SUR-AIRE 55117 CLERMONT-EN-ARGONNE 55389 NUBECOURT 55128 COURCELLES-SUR-AIRE 55395 OSCHES 55129 COUROUVRE 55404 PIERREFITTE-SUR-AIRE 55518 COUSANCES-LES-TRICONVILLE 55409 PRETZ-EN-ARGONNE 55141 DAGONVILLE 55442 RAIVAL 55155 DOMBASLE-EN-ARGONNE 55416 RARECOURT 55174 EPINONVILLE 55419 RECICOURT 55175 ERIZE-LA-BRULEE 55446 RUMONT 55177 ERIZE-LA-PETITE 55453 SAINT-ANDRE-EN-BARROIS 55178 ERIZE-SAINT-DIZIER 55454 SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 55179 ERNEVILLE-AUX-BOIS 55000 SEIGNEULLES 55185 EVRES 55517 SEUIL-D'ARGONNE 55194 FOUCAUCOURT-SUR-THABAS 55498 SOUILLY 55199 FROIDOS 55525 VADELAINCOURT 55202 FUTEAU 55527 VARENNES-EN-ARGONNE 55208 GESNES-EN-ARGONNE 55532 VAUBECOURT 55210 GIMECOURT 55536 VAUQUOIS 55251 IPPECOURT 55549 VERY 55257 JOUY-EN-ARGONNE 55555 VILLE-DEVANT-BELRAIN 55260 JULVECOURT 55567 VILLE-SUR-COUSANCES 55266 LACHALADE 55570 VILLOTTE-SUR-AIRE 55282 LAVALLEE -
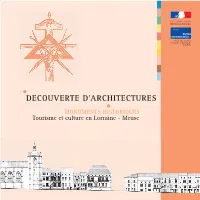
Decouverte D'architectures
DECOUVERTE D’ARCHITECTURES MONUMENTS HISTORIQUES Tourisme et culture en Lorraine - Meuse L’État, avec le concours des collectivités territoriales, protège et participe à la mise en valeur des monuments historiques. Il entend aussi promouvoir un environnement de qualité. Ces objectifs ne peuvent être atteints sans une politique de formation et de sensibilisation du public à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage. Ce guide est un document pédagogique. Il nous aidera à découvrir la qualité artistique, la valeur historique, la richesse constructive et technique des monuments historiques de la Meuse tout en nous familiarisant avec le langage de l’architecture. Il nous permettra de mieux faire connaître le patrimoine de la Meuse et contribuera au développement touristique et culturel du département. Sa publication a été rendue possible grâce à l’action du service départemental de l’architecture et du patrimoine, grâce au concours des collectivités territoriales et des professionnels du patrimoine : architectes et entreprises du bâtiment. Cette large participation confirme l’intérêt de tous pour notre patrimoine. Michel LAFON Préfet de la Meuse Ce guide, édité en 1994, avait été réalisé par le SDAP de la Meuse : Avec le concours des partenaires suivants : Préfecture de la Meuse • Conseil régional de Lorraine • Conseil général de la Meuse • Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC Lorraine • Archives départementales de la Meuse • Conservation des antiquités et objets d’art • Association les Amis du patrimoine Meusien • Des Villes et Communes de VERDUN, BAR LE DUC, COMMERCY, SAINT MIHIEL, VAUCOULEURS, MONTMEDY, CLERMONT EN ARGONNE, VIGNEULLES LES HATTONCHATEL, LIGNY EN BARROIS • Agence Alligator et ses collaborateurs. -

Les Randonnées Andonnées
de Bar-le-Duc Bar-le-Duc Incontournables et et du du Les Les Bar ro is is Randonnées L'a ge nd a a 2016 Beaulieu- dir. Ste-Menehould en-Argonne Clermont-en-Argonne Villers- 20 aux-Vents D Brabant- le-Roi D75 dir. Charleville- dir. Reims Mézières Sedan Châlons-en- Laimont D994 MEUSE dir. Châlons-en- Champagne D35 Champagne Verdun Reims Paris Metz Bar-le-Duc Gare Meuse TGV dir. Toul, Fains- N135 Nancy Bar-le-Duc Commercy -graphik.com • Impression : Imprimerie du Barrois Nancy Véel dir. Saint-Dizier Ligny-en-Barrois Maulan N4 Ligny-en-Barrois CHAMPAGNE dir. St-Dizier ARDENNE D169 Ménil- Delouze-Rosières D96 sur-Saulx Ornai Saul 6 n Conception : stephanie.georges@atelier x D960 Houdelaincourt Tél. : 03 29 79 11 13 • [email protected] • 13 11 79 29 03 : Tél. c • 55000 BAR-LE-DUC BAR-LE-DUC 55000 • c d’Ar Jeanne rue 7 : Sud Grand Meuse ourisme T de fice Of ou disponible à : : à disponible ou ! le obi m b we m ois.co .tourisme-barleducetbarr www ite s e notr r su : ct Conta sur geable téléchar détaillé ogramme Pr z-nous gne i jo Re Programme détaillé téléchargeable sur Rejoignez-nous Contact : sur notre site www.tourisme-barleducetbarrois.com web mobile ! ou disponible à : Office de Tourisme Meuse Grand Sud : 7 rue Jeanne d’Arc • 55000 BAR-LE-DUC Tél. : 03 29 79 11 13 • [email protected] t our Houdelainc 0 D96 x Conception :stephanie.georges@atelier n 6 Saul sur-Saulx Ornai 6 D9 Ménil- Delouze-Rosières D169 A RDENNE St-Dizier . -

1917, L'arrivée Des Américains
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 1917, l’arrivée des Américains à Gondrecourt-le-Château et en Val d’Ornois. PROGRAMME 2017 Au début de l’été 1917, la 1ère Division d’Infanterie américaine arrive à Gondrecourt-le-Château où le général Sibert implante son Quartier Général. En quelques mois, ce sont plus de 8 000 hommes qui s’installent dans de nombreux villages du Val d’Ornois. Les paysages et la vie quotidienne sont bouleversés : deux aérodromes se développent sur les hauteurs des villages d’Amanty et de Delouze ; une usine de fabrication de voies ferrées est bâtie à Abainville ; des hôpitaux sont installés à Gondrecourt-le-Château et Mauvages. Aux régiments d’infanterie se joignent des régiments d’artillerie, de cavalerie et du génie ; les casernements, camps d’entraînement se multiplient… Durant toute la seconde moitié de l’année 1917, les troupes américaines sont préparées par des instructeurs français, provenant notamment de bataillons de chasseurs alpins. Dès la fin de l’année 1917, les troupes américaines participent aux offensives alliées. En septembre 1918, elles sont massivement engagées dans la reprise du Saillant de Saint-Mihiel et en octobre de la même année, dans l’offensive Meuse-Argonne. 1917,2 Gondrecourt-le-Château, Rue Raymond Poincaré, soldats américains. 3 PARCOURS DE MÉMOIRE DU VAL D’ORNOIS ÉVÈNEMENTS Arrière-front La Grande Guerre, 1917, allemand Argonne Conférence Débat Champ exposition extérieure de bataille & l'arrivée des troupes Verdun Saillant de St-Mihiel Arrière-front américaines français Nos villages, Bar-le-Duc ©Auguste Goulden/SPCA/ECPAD - 20 Août 1917 – Gondrecourt-le-Château – Mise en place des masques à gaz Gondrecourt-le-Château ©Auguste Goulden/SPCA/ECPAD - 20 Août 1917 – Gondrecourt-le-Château – Mise en place des masques à gaz ©Auguste Goulden/SPCA/ECPAD - 20 Août 1917 – Gondrecourt-le-Château – Mise en place des masques à gaz Tréveray Histoire du village et patrimoine d'Infanterie US (DIUS), appelée Big Red One en référence à son insigne. -

Siren : 200066108)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC des Portes de Meuse (Siren : 200066108) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Montiers-sur-Saulx Arrondissement Bar-le-Duc Département Meuse Interdépartemental non Date de création Date de création 05/10/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Michel LOISY Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 1, rue de l'Abbaye - Ecurey Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 55290 MONTIERS SUR SAULX Téléphone Fax Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF oui Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 16 972 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 22,94 Périmètre Nombre total de communes membres : 51 Dept Commune (N° SIREN) Population 55 Abainville (215500018) 306 55 Amanty (215500059) 39 55 Ancerville (215500109) 2 781 55 Aulnois-en-Perthois (215500158) 515 55 Badonvilliers-Gérauvilliers (215500265) 140 55 Baudonvilliers (215500315) 384 55 Bazincourt-sur-Saulx (215500356) 153 55 Biencourt-sur-Orge (215500513) 127 55 Bonnet (215500596) 203 55 Brauvilliers (215500752) 176 55 Brillon-en-Barrois (215500794) 705 55 Bure (215500877) -

Radioactive Waste Repositories and Host Regions
Radioactive Waste Management www.nea.fr 2010 2010 Radioactive Waste Repositories and Host Regions: Envisaging the Future Together Radioactive Waste Repositories and Host This 7th Forum on Stakeholder Confidence (FSC) workshop focused on the territorial implementation of France’s high-level and long-lived intermediate-level waste management programme. Sessions addressed the French historical and legislative context, public information, reversibility, environmental monitoring and the issue of memory. Amongst the participants were representatives of local and regional governments, Regions: Envisaging the civil society organisations, universities, waste management agencies, institutional authorities and delegates from 13 countries. This report provides a synthesis of the workshop deliberations. Future Together Synthesis of the FSC National Workshop and Community Visit Bar-le-Duc, France 7-9 April 2009 OECD Nuclear Energy Agency ISBN 978-92-64-99128-6 Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles F-92130 Issy-les-Moulineaux, France Tel.: +33 (0)1 4524 1015 – Fax: +33 (0)1 4524 1110 -:HSTCQE=^^VW][: E-mail: [email protected] – Internet: www.nea.fr NUCLEARENERGYAGENCY Radioactive Waste Management ISBN 978-92-64-99128-6 Radioactive Waste Repositories and Host Regions: Envisaging the Future Together Synthesis of the FSC National Workshop and Community Visit Bar-le-Duc, France 7-9 April 2009 © OECD 2010 NEA No. 6925 NUCLEAR ENERGY AGENCY ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT The OECD is a unique forum where the governments of 30 democracies work together to address the economic, social and environmental challenges of globalisation. The OECD is also at the forefront of efforts to understand and to help governments respond to new developments and concerns, such as corporate governance, the information economy and the challenges of an ageing population. -

RAA N° 45 Du 24 Décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA MEUSE Recueil N°45 24 décembre 2015 SOMMAIRE PREFECTURE DE LA MEUSE DIRECTION DES SERVICES DU CABINET BUREAU DU CABINET SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE Arrêté n°2015 - 2584 du 10 décembre 2015 portant à connaissance la liste des admis à un examen du certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » ........................ 1765 Arrêté n° 2015 – CMRO 2675 en date du 21 décembre 2015 autorisant les usagers de la voie d'eau à traverser le tunnel de Mauvages en navigation libre en raison de l'indisponibilité des moyens de traction du tunnel de Mauvages Canal de la Marne au Rhin branche Ouest, entre le PK 86.618 et le PK 91.495 sur le territoire de la commune de Mauvages, du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016................................................................................. p 1766 DIRECTION DES USAGERS ET DES LIBERTES PUBLIQUES BUREAU DES USAGERS, DE LA REGLEMENTATION ET DES ELECTIONS Arrêté n° 2015 - 2655 du 18 décembre 2015 publiant la liste des journaux pouvant recevoir les annonces judiciaires et légales en 2016 .................................................................................... p 1767 1761 Arrêté n° 2015 – 2676 du 21 décembre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire S.A.R.L AMBULANCES TAXIS Alain Nicolas et fils carrefour de l’Europe 55 100 Haudainville .................................................................................................................... p 1769 Arrêté n° 2015 - 2689 du 23 décembre 2015 portant agrément d’un centre d’examens psychotechniques des conducteurs et des candidats au permis de conduire ........................... p 1769 BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT Décision du 15 décembre 2015 portant établissement de la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de la Meuse pour l’année 2016........