Centre De Stockage Cigéo (52-55)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sidérurgies Et Métallurgies Meusiennes Paul Naegel
Sidérurgies et métallurgies meusiennes Paul Naegel To cite this version: Paul Naegel. Sidérurgies et métallurgies meusiennes : Fin XVIIe - début XXe siècles. Journée d’études ”Les industries de la Lorraine du XVIIIe s. à nos jours.”, Mar 2011, UCKANGE (Moselle), France. halshs-00578474 HAL Id: halshs-00578474 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00578474 Submitted on 28 Mar 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Sidérurgies et métallurgies meusiennes (Fin XVIIe – début XXe siècles) 1 par Paul Naegel 2 Résumé : Vouloir présenter dans le cadre d’une communication en temps limité un sujet aussi vaste que celui des sidérurgies et métallurgies meusiennes entre 1790 et 1914 relève de l’impossible, sauf à mettre l’accent sur quelques particularités souvent méconnues. Le département de la Meuse, créé en 1790, a connu, dès lors, une unité administrative remplaçant la mosaïque de souverainetés existant sous l’Ancien Régime. La législation s’appliquant à l’industrie étant devenue, pour l’essentiel, uniforme et centralisée, des sources intéressantes sur les processus d’industrialisation sont disponibles aux Archives départementales de la Meuse. Nous présentons dans cette communication quelques résultats d’une thèse soutenue en 2006 et de publications ultérieures, en nous efforçant, au-delà des ressources géologiques et hydrographiques spécifiques qu’offrait le département de la Meuse au XIXe siècle, de contextualiser la sidérurgie et la métallurgie meusienne. -

La Micro-Crèche
JUILLET 2019 #7 HORIZON L’ACTU DES PORTES DE MEUSE L’ÉTÉ SERA ANIMÉ ! TOURISME DÉVELOPPEMENT PORTRAIT À la découverte des Portes de Meuse ! ÉCONOMIQUE Gérard LARGUIER, peintre et voisin de PICASSO. p.4 De nouvelles entreprises s’installent. p.21 p.10 ÉDITO // SOMMAIRE COUP DE CŒUR p. 3 TOURISME p. 4 VIE ASSOCIATIVE p. 6 SPORT p. 8 L’HERBE N’EST PAS PLUS VERTE AILLEURS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE p. 10 Je l’avoue… Quand certains clament que l’herbe est plus verte ailleurs, je ne peux m’empêcher de les inciter à lever la tête et à regarder autour d’eux pour apprécier les nombreux atouts de notre territoire. La qualité de vie y est très appréciable, à p. 12 l’opposé des grands centres urbains et de leurs nuisances. Nos ACTEURS ÉCONOMIQUES enfants sont en sécurité dans nos écoles et dans nos villages. Nous avons accès à de nombreux services publics grâce aux Mairies et à la Communauté de Communes des Portes de Meuse. Nous possédons un patrimoine naturel et historique PETITE ENFANCE p. 16 exceptionnel. Nos forêts, nos cours d’eau, nos châteaux, le site intercommunal d’Écurey, notre histoire méritent d’être connus et reconnus. Nous en sommes convaincus. Et c’est bien pour cela que nous avons construit une véritable offre touristique IMMOBILIER p. 18 en partenariat avec l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud, ainsi qu’avec la Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne. Randonnées, chasse au trésor, expositions, visites, animations sportives et culturelles, vous trouverez durant l’été de nombreuses occasions de découvrir PATRIMOINE p. -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 23 Mars 2014
ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 23 Mars 2014 Liste des candidatures par commune (scrutin plurinominal) Département 55 - MEUSE Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Abainville (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BONTANT Antoine Mme BOURGUIGNON Magali Mme CAREL Sylvie M. HERPIERRE Jean-Claude Mme LABAT Bérengère M. LEDUC Christian M. LHUILLIER Daniel M. MULLER Serge M. PRUDHOMME Christian Mme SOMMER Jessica Mme THIERY Céline Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Abaucourt-Hautecourt (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. ADAM Gérard M. CHANCELLE Didier M. CLAUSSIN Michel Mme DUBAUX Christine M. GARDIEN Gilles Mme GARDIEN Mélina Mme LAGARDE Noëlle M. MITTAUX Jean-Marie M. PALHIES Lionel M. ROLLINGER Philippe M. TEDESCO Richard M. TOLUSSO Luc Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aincreville (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 7 M. DUBAUX Christophe M. GARAND Jeremy M. GERARD Gregory M. HANNEQUIN Judicaël M. MAGISSON Jean-Marie M. MARTIN Fabien M. RAVENEL Guy Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Amanty (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 7 Mme AUER Marie-José M. BELLAMY Xavier M. BERTIN Jean-Michel M. BONTANT Joachim Mme DE KONING Véronique M. DIOTISALVI Jean-Luc Mme GROSS Anne-Sophie M. HUBER Stéphane M. PREY Alain M. RIGAUX Joël Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Ambly-sur-Meuse (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. -
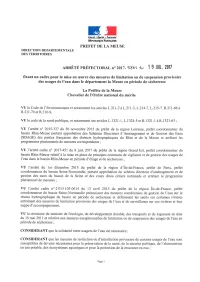
Arrêté Cadre Secheresse 2017
Page 1 Annexe 2 – Répartition des communes par zones d’alerte Zone d’alerte 1 : Aisne amont 55014 AUBREVILLE 55285 LAVOYE 55017 AUTRECOURT-SUR-AIRE 55116 LE CLAON 55023 AVOCOURT 55379 LE NEUFOUR 55032 BAUDREMONT 55253 LES ISLETTES 55033 BAULNY 55497 LES SOUHESMES-RAMPONT 55038 BEAULIEU-EN-ARGONNE 55254 LES TROIS-DOMAINES 55040 BEAUSITE 55289 LEVONCOURT 55044 BELRAIN 55290 LIGNIERES-SUR-AIRE 55065 BOUREUILLES 55295 LISLE-EN-BARROIS 55068 BRABANT-EN-ARGONNE 55301 LONGCHAMPS-SUR-AIRE 55081 BRIZEAUX 55343 MONTBLAINVILLE 55082 BROCOURT-EN-ARGONNE 55346 MONTFAUCON-D'ARGONNE 55103 CHARPENTRY 55380 NEUVILLE-EN-VERDUNOIS 55108 CHAUMONT-SUR-AIRE 55383 NEUVILLY-EN-ARGONNE 55113 CHEPPY 55384 NICEY-SUR-AIRE 55117 CLERMONT-EN-ARGONNE 55389 NUBECOURT 55128 COURCELLES-SUR-AIRE 55395 OSCHES 55129 COUROUVRE 55404 PIERREFITTE-SUR-AIRE 55518 COUSANCES-LES-TRICONVILLE 55409 PRETZ-EN-ARGONNE 55141 DAGONVILLE 55442 RAIVAL 55155 DOMBASLE-EN-ARGONNE 55416 RARECOURT 55174 EPINONVILLE 55419 RECICOURT 55175 ERIZE-LA-BRULEE 55446 RUMONT 55177 ERIZE-LA-PETITE 55453 SAINT-ANDRE-EN-BARROIS 55178 ERIZE-SAINT-DIZIER 55454 SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 55179 ERNEVILLE-AUX-BOIS 55000 SEIGNEULLES 55185 EVRES 55517 SEUIL-D'ARGONNE 55194 FOUCAUCOURT-SUR-THABAS 55498 SOUILLY 55199 FROIDOS 55525 VADELAINCOURT 55202 FUTEAU 55527 VARENNES-EN-ARGONNE 55208 GESNES-EN-ARGONNE 55532 VAUBECOURT 55210 GIMECOURT 55536 VAUQUOIS 55251 IPPECOURT 55549 VERY 55257 JOUY-EN-ARGONNE 55555 VILLE-DEVANT-BELRAIN 55260 JULVECOURT 55567 VILLE-SUR-COUSANCES 55266 LACHALADE 55570 VILLOTTE-SUR-AIRE 55282 LAVALLEE -

Conseil Départemental Du 23 Janvier 2020 Commission Permanente Du
N° 03 / 2020 Recueil des Actes Administratifs Conseil départemental du 23 janvier 2020 Commission Permanente du 23 janvier 2020 et Actes de l’Exécutif départemental 23 Département de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN - 55012 BAR-LE-DUC - Cedex Tél : 03 29 45 77 12 Fax : 03 29 45 77 89 Email : [email protected] - 24 - Sommaire EXTRAIT DES DELIBERATIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL SERVICE COLLEGES (12310) ......................................................................................................................................... 29 Réseau des collèges - Sectorisation ............................................................................................................... 29 COMMISSION PERMANENTE DIRECTION GENERALE DES SERVICES (10000) .................................................................................................................. 57 Adhésion à la Société Française d'Evaluation ............................................................................................. 57 Externalisation des gendarmeries - Convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes pour la passation et l'exécution conjointe d'une concession pour la gestion de certaines gendarmeries de la Meuse ............................................................................................................ 57 DIRECTION TERRITOIRES (13100) .................................................................................................................................... 58 Patrimoine - Programmation 2018 - Prorogation -

Communauté D'agglomération De Bar-Le-Duc Sud Meuse
Communauté d’agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse Portrait d’agglomération DATES CLÉS • 1er janvier 2013 : création de la nouvelle Communauté d’Agglomération regroupant 27 communes • 1er Janvier 2014 : extension de la Communauté d’Agglomération à 32 communes • 1er janvier 2015 : extension à 33 communes (séparation de Loisey-Culey en 2 communes) • Président : Bertrand Pancher depuis le 14 avril 2014 Nombre de Superficie Population communes (km²) CA de Bar-le-Duc 36 187 33 400 Ville Centre 15 950 1 23.62 SCoT 65 088 124 1 745 COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BAR-LE-DUC SUD MEUSE Les « compétences obligatoires » • En lien avec l’aménagement de l’espace : Aménagement numérique d’intérêt communautaire ; • Développement économique Numérisation du cadastre et Système d’Information • Aménagement de l’espace communautaire Géographique (SIG). • Equilibre social de l’habitat • En lien avec la protection de l’environnement : Hydraulique ; • Politique de la Ville Mise en valeur des paysages – Chemin de randonnées. • Accueil des gens du voyage • En lien avec l’attractivité du territoire communautaire : • Collecte et traitement des déchets des ménages Soutien à des manifestations ou évènements sportifs ou et déchets assimilés culturels d’intérêt communautaire, le cas échéant organisés par les communes membres ; Schéma communautaire de Les « compétences optionnelles » développement des enseignements artistiques ; Schéma communautaire de développement de la lecture publique ; • Assainissement des eaux usées Actions en faveur de la formation professionnelle et de • Eau l’enseignement supérieur ; Charte de coopération en matière • Protection et mise en valeur de l’environnement d’accueil scolaire et périscolaire ; Aménagement des places et du cadre de vie publiques ; Schéma d’harmonisation des cœurs de villages. -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code
Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Grand-Est Rethel Acy-Romance 08 08001 Grand-Est Nouzonville Aiglemont 08 08003 Grand-Est Rethel Aire 08 08004 Grand-Est Rethel Alincourt 08 08005 Grand-Est Rethel Alland'Huy-et-Sausseuil 08 08006 Grand-Est Vouziers Les Alleux 08 08007 Grand-Est Rethel Amagne 08 08008 Grand-Est Carignan Amblimont 08 08009 Grand-Est Rethel Ambly-Fleury 08 08010 Grand-Est Revin Anchamps 08 08011 Grand-Est Sedan Angecourt 08 08013 Grand-Est Rethel Annelles 08 08014 Grand-Est Hirson Antheny 08 08015 Grand-Est Hirson Aouste 08 08016 Grand-Est Sainte-Menehould Apremont 08 08017 Grand-Est Vouziers Ardeuil-et-Montfauxelles 08 08018 Grand-Est Vouziers Les Grandes-Armoises 08 08019 Grand-Est Vouziers Les Petites-Armoises 08 08020 Grand-Est Rethel Arnicourt 08 08021 Grand-Est Charleville-Mézières Arreux 08 08022 Grand-Est Sedan Artaise-le-Vivier 08 08023 Grand-Est Rethel Asfeld 08 08024 Grand-Est Vouziers Attigny 08 08025 Grand-Est Charleville-Mézières Aubigny-les-Pothées 08 08026 Grand-Est Rethel Auboncourt-Vauzelles 08 08027 Grand-Est Givet Aubrives 08 08028 Grand-Est Carignan Auflance 08 08029 Grand-Est Hirson Auge 08 08030 Grand-Est Vouziers Aure 08 08031 Grand-Est Reims Aussonce 08 08032 Grand-Est Vouziers Authe 08 08033 Grand-Est Sedan Autrecourt-et-Pourron 08 08034 Grand-Est Vouziers Autruche 08 08035 Grand-Est Vouziers Autry 08 08036 Grand-Est Hirson Auvillers-les-Forges 08 08037 Grand-Est Rethel Avançon 08 08038 Grand-Est Rethel Avaux 08 08039 Grand-Est Charleville-Mézières Les Ayvelles -

Communauté D'agglomération De Bar-Le-Duc Sud Meuse
Communauté d’agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse Portrait d’agglomération DATES CLÉS • 1er janvier 2013 : création de la nouvelle Communauté d’Agglomération regroupant 27 communes • 1er Janvier 2014 : extension de la Communauté d’Agglomération à 32 communes • 1er janvier 2015 : extension à 33 communes (séparation de Loisey-Culey en 2 communes) • Président : Bertrand Pancher depuis le 14 avril 2014 Nombre de Superficie Population communes (km²) CA de Bar-le-Duc 36 187 33 400 Ville Centre 15 950 1 23.62 SCoT 65 088 124 1 745 COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BAR-LE-DUC SUD MEUSE Les « compétences obligatoires » • En lien avec l’aménagement de l’espace : Aménagement numérique d’intérêt communautaire ; • Développement économique Numérisation du cadastre et Système d’Information • Aménagement de l’espace communautaire Géographique (SIG). • Equilibre social de l’habitat • En lien avec la protection de l’environnement : Hydraulique ; • Politique de la Ville Mise en valeur des paysages – Chemin de randonnées. • Accueil des gens du voyage • En lien avec l’attractivité du territoire communautaire : • Collecte et traitement des déchets des ménages Soutien à des manifestations ou évènements sportifs ou et déchets assimilés culturels d’intérêt communautaire, le cas échéant organisés par les communes membres ; Schéma communautaire de Les « compétences optionnelles » développement des enseignements artistiques ; Schéma communautaire de développement de la lecture publique ; • Assainissement des eaux usées Actions en faveur de la formation professionnelle et de • Eau l’enseignement supérieur ; Charte de coopération en matière • Protection et mise en valeur de l’environnement d’accueil scolaire et périscolaire ; Aménagement des places et du cadre de vie publiques ; Schéma d’harmonisation des cœurs de villages. -
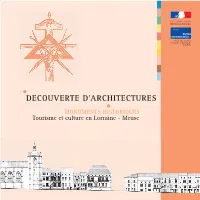
Decouverte D'architectures
DECOUVERTE D’ARCHITECTURES MONUMENTS HISTORIQUES Tourisme et culture en Lorraine - Meuse L’État, avec le concours des collectivités territoriales, protège et participe à la mise en valeur des monuments historiques. Il entend aussi promouvoir un environnement de qualité. Ces objectifs ne peuvent être atteints sans une politique de formation et de sensibilisation du public à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage. Ce guide est un document pédagogique. Il nous aidera à découvrir la qualité artistique, la valeur historique, la richesse constructive et technique des monuments historiques de la Meuse tout en nous familiarisant avec le langage de l’architecture. Il nous permettra de mieux faire connaître le patrimoine de la Meuse et contribuera au développement touristique et culturel du département. Sa publication a été rendue possible grâce à l’action du service départemental de l’architecture et du patrimoine, grâce au concours des collectivités territoriales et des professionnels du patrimoine : architectes et entreprises du bâtiment. Cette large participation confirme l’intérêt de tous pour notre patrimoine. Michel LAFON Préfet de la Meuse Ce guide, édité en 1994, avait été réalisé par le SDAP de la Meuse : Avec le concours des partenaires suivants : Préfecture de la Meuse • Conseil régional de Lorraine • Conseil général de la Meuse • Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC Lorraine • Archives départementales de la Meuse • Conservation des antiquités et objets d’art • Association les Amis du patrimoine Meusien • Des Villes et Communes de VERDUN, BAR LE DUC, COMMERCY, SAINT MIHIEL, VAUCOULEURS, MONTMEDY, CLERMONT EN ARGONNE, VIGNEULLES LES HATTONCHATEL, LIGNY EN BARROIS • Agence Alligator et ses collaborateurs. -

Les Randonnées Andonnées
de Bar-le-Duc Bar-le-Duc Incontournables et et du du Les Les Bar ro is is Randonnées L'a ge nd a a 2016 Beaulieu- dir. Ste-Menehould en-Argonne Clermont-en-Argonne Villers- 20 aux-Vents D Brabant- le-Roi D75 dir. Charleville- dir. Reims Mézières Sedan Châlons-en- Laimont D994 MEUSE dir. Châlons-en- Champagne D35 Champagne Verdun Reims Paris Metz Bar-le-Duc Gare Meuse TGV dir. Toul, Fains- N135 Nancy Bar-le-Duc Commercy -graphik.com • Impression : Imprimerie du Barrois Nancy Véel dir. Saint-Dizier Ligny-en-Barrois Maulan N4 Ligny-en-Barrois CHAMPAGNE dir. St-Dizier ARDENNE D169 Ménil- Delouze-Rosières D96 sur-Saulx Ornai Saul 6 n Conception : stephanie.georges@atelier x D960 Houdelaincourt Tél. : 03 29 79 11 13 • [email protected] • 13 11 79 29 03 : Tél. c • 55000 BAR-LE-DUC BAR-LE-DUC 55000 • c d’Ar Jeanne rue 7 : Sud Grand Meuse ourisme T de fice Of ou disponible à : : à disponible ou ! le obi m b we m ois.co .tourisme-barleducetbarr www ite s e notr r su : ct Conta sur geable téléchar détaillé ogramme Pr z-nous gne i jo Re Programme détaillé téléchargeable sur Rejoignez-nous Contact : sur notre site www.tourisme-barleducetbarrois.com web mobile ! ou disponible à : Office de Tourisme Meuse Grand Sud : 7 rue Jeanne d’Arc • 55000 BAR-LE-DUC Tél. : 03 29 79 11 13 • [email protected] t our Houdelainc 0 D96 x Conception :stephanie.georges@atelier n 6 Saul sur-Saulx Ornai 6 D9 Ménil- Delouze-Rosières D169 A RDENNE St-Dizier . -

1917, L'arrivée Des Américains
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 1917, l’arrivée des Américains à Gondrecourt-le-Château et en Val d’Ornois. PROGRAMME 2017 Au début de l’été 1917, la 1ère Division d’Infanterie américaine arrive à Gondrecourt-le-Château où le général Sibert implante son Quartier Général. En quelques mois, ce sont plus de 8 000 hommes qui s’installent dans de nombreux villages du Val d’Ornois. Les paysages et la vie quotidienne sont bouleversés : deux aérodromes se développent sur les hauteurs des villages d’Amanty et de Delouze ; une usine de fabrication de voies ferrées est bâtie à Abainville ; des hôpitaux sont installés à Gondrecourt-le-Château et Mauvages. Aux régiments d’infanterie se joignent des régiments d’artillerie, de cavalerie et du génie ; les casernements, camps d’entraînement se multiplient… Durant toute la seconde moitié de l’année 1917, les troupes américaines sont préparées par des instructeurs français, provenant notamment de bataillons de chasseurs alpins. Dès la fin de l’année 1917, les troupes américaines participent aux offensives alliées. En septembre 1918, elles sont massivement engagées dans la reprise du Saillant de Saint-Mihiel et en octobre de la même année, dans l’offensive Meuse-Argonne. 1917,2 Gondrecourt-le-Château, Rue Raymond Poincaré, soldats américains. 3 PARCOURS DE MÉMOIRE DU VAL D’ORNOIS ÉVÈNEMENTS Arrière-front La Grande Guerre, 1917, allemand Argonne Conférence Débat Champ exposition extérieure de bataille & l'arrivée des troupes Verdun Saillant de St-Mihiel Arrière-front américaines français Nos villages, Bar-le-Duc ©Auguste Goulden/SPCA/ECPAD - 20 Août 1917 – Gondrecourt-le-Château – Mise en place des masques à gaz Gondrecourt-le-Château ©Auguste Goulden/SPCA/ECPAD - 20 Août 1917 – Gondrecourt-le-Château – Mise en place des masques à gaz ©Auguste Goulden/SPCA/ECPAD - 20 Août 1917 – Gondrecourt-le-Château – Mise en place des masques à gaz Tréveray Histoire du village et patrimoine d'Infanterie US (DIUS), appelée Big Red One en référence à son insigne. -

Radioactive Waste Repositories and Host Regions
Radioactive Waste Management www.nea.fr 2010 2010 Radioactive Waste Repositories and Host Regions: Envisaging the Future Together Radioactive Waste Repositories and Host This 7th Forum on Stakeholder Confidence (FSC) workshop focused on the territorial implementation of France’s high-level and long-lived intermediate-level waste management programme. Sessions addressed the French historical and legislative context, public information, reversibility, environmental monitoring and the issue of memory. Amongst the participants were representatives of local and regional governments, Regions: Envisaging the civil society organisations, universities, waste management agencies, institutional authorities and delegates from 13 countries. This report provides a synthesis of the workshop deliberations. Future Together Synthesis of the FSC National Workshop and Community Visit Bar-le-Duc, France 7-9 April 2009 OECD Nuclear Energy Agency ISBN 978-92-64-99128-6 Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles F-92130 Issy-les-Moulineaux, France Tel.: +33 (0)1 4524 1015 – Fax: +33 (0)1 4524 1110 -:HSTCQE=^^VW][: E-mail: [email protected] – Internet: www.nea.fr NUCLEARENERGYAGENCY Radioactive Waste Management ISBN 978-92-64-99128-6 Radioactive Waste Repositories and Host Regions: Envisaging the Future Together Synthesis of the FSC National Workshop and Community Visit Bar-le-Duc, France 7-9 April 2009 © OECD 2010 NEA No. 6925 NUCLEAR ENERGY AGENCY ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT The OECD is a unique forum where the governments of 30 democracies work together to address the economic, social and environmental challenges of globalisation. The OECD is also at the forefront of efforts to understand and to help governments respond to new developments and concerns, such as corporate governance, the information economy and the challenges of an ageing population.