Étude De L'émergence D'une Conception
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Royal-Dutch-Shell-Fra-Oljemuseets-Årbok-2018.Pdf
Nor sk oljemuseum årbok 201 7 Årboken er Norsk Oljemuseums viktigste, årlige publikasjon. Den tar for seg et bredt spekter av aktuelle tema knyttet til petroleumsnæringen og museets virksomhet. Artiklene er skrevet både av museets egne ansatte og eksterne bidragsytere. Museets årsmelding og regnskap er også å finne i årboken. Norsk Oljemuseumoljemuseum Årbokårbok 20172018 Royal Dutch/Shell av Trude Meland hell har drevet sin verdensomspennende En gryende globalisering Svirksomhet i over 100 år og har bygget opp en Det hele startet i 1833 da Marcus Samuel sr. av verdens mest kjente merkevarer. Royal Dutch/ åpnet en liten forretning i Londons East End Shell som i dag er et multinasjonalt selskap med hvor han handlet med antikviteter, rariteter, hovedkontor i Haag og forretningsadresse i konkylier og dekorative skjell. Skjell og konkylier London, startet som en allianse i 1907. Da slo det var på moten i det viktorianske Storbritannia, og nederlandske Royal Dutch Petroleum Company forretningen var lukrativ.2 og britiske The «Shell» Transport and Trading Company seg sammen. Dette er historien om Den vokste til et blomstrende import- og hvordan Royal Dutch/Shell Group vokste seg eksportfirma, og Samuel organiserte en toveis til å bli et av verdens største foretak, men også handel mellom Storbritannia og det fjerne østen. om de to som startet det – den ene fra Londons Tekstiler og maskiner til å bygge opp en industri østkant, jødisk opprinnelse og ambisiøs. Den gikk fra Storbritannia, og i retur kom ris, kull, andre nederlender, med en hang for detaljer og silke, kobber og porselen. Antall handelspartnere tall. Mennene var Marcus Samuel jr. -

Britain, British Petroleum, Shell and the Remaking of the International Oil Industry, 1957-1979
Empires of Energy: Britain, British Petroleum, Shell and the Remaking of the International Oil Industry, 1957-1979 Author: Jonathan Robert Kuiken Persistent link: http://hdl.handle.net/2345/bc-ir:104079 This work is posted on eScholarship@BC, Boston College University Libraries. Boston College Electronic Thesis or Dissertation, 2013 Copyright is held by the author, with all rights reserved, unless otherwise noted. Boston College The Graduate School of Arts and Sciences Department of History EMPIRES OF ENERGY: BRITAIN, BRITISH PETROLEUM, SHELL AND THE REMAKING OF THE INTERNATIONAL OIL INDUSTRY, 1957-1979 [A dissertation by] JONATHAN R. KUIKEN submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy August, 2013 © copyright by JONATHAN ROBERT KUIKEN 2013 Empires of Energy: Britain, British Petroleum, Shell and the remaking of the international oil industry, 1957-1979 Jonathan R. Kuiken Dissertation Advisor - James E. Cronin Dissertation Abstract This dissertation examines British oil policy from the aftermath of the Suez Crisis in 1956-1957 until the Iranian Revolution and the electoral victory of Margaret Thatcher’s Conservative Party in 1979. It was a period marked by major transitions within Britain’s oil policy as well as broader changes within the international oil market. It argues that the story of Britain, and Britain’s two domestically-based oil companies, BP and Shell, offers a valuable case study in the development of competing ideas about the reorganization of the international oil industry in the wake of the rise of the Organization of Petroleum Exporting countries and the companies’ losing control over the production of oil. -

A History of Royal Dutch Shell Vol 1C
Royal Dutch Shell and the Nazis By John Donovan In the "Fortune Global 500 Ranking by Revenue 2010", Royal Dutch Shell Pic is ranked as the second largest company in the world, after Wal-Mart Stores. Many people know something about the oil giants' controversial track record in Nigeria. It includes decades long plunder and pollution, with involvement in espionage, corruption, torture, murder, and other human rights abuses. Some people are aware of Shell's unscrupulous dealings with despotic regimes in Iraq, Iran, and Libya. Shell deliberately disguised shipping movements of Iraqi and Iranian oil during UN sanctions. Very few people have any inkling of Shell's pivotal support for Hitler and the Nazi Party. Basically, Shell saved the Nazi Party when it was in danger of financial collapse and continued, for over a decade, to pump funds into the Nazi project. As a consequence, Shell was arguably indirectly responsible for over 30 million deaths in World War 2. I have already published a series of articles on this explosive subject, the most recent major article under the headline: "Royal Dutch Shell Nazi Secrets" The Dutch oil baron Sir Henri Deterding drove Shell's support for the Nazis. He was the dictatorial founder of Royal Dutch Shell publicly described as the "Napoleon of Petroleum" and "The Most Powerful Man in the World". Sir Henri was infatuated with Hitler and the Nazis. An official account of the history of the oil giant - "A History of Royal Dutch Shell" - authored by eminent historians associated with Utrecht University, provided invaluable information during my research. -

Oil and the War Danger This Discomfort
Page Nine THE DAILY WORKER, NEW YORK, SATURDAY. DECEMBER 3, 1927 THE DAILY WORKER , ON GUARD FOR MUSSOLINI By Fred Ellis Published by the DAILY WORKER PUBLISHING CO. Vr j Red Rays Sunday , Daily, Except ' 1 Orchard 1680 83 First Street, New York, N. Y. Phone, THAT little revolt in Ukraine is just Cable Address: "Daiwork” " what we said it was—a false SUBSCRIPTION RATES alarm. All the “reliable” capitalist By Mail (in New York only): By Mail (outside of New York). newspapers that have millions of dol- SB.OO per year $4.50 six months $6.00 per year $3.50 six months lars at their disposal to spend on $2.50 three months. $2.00 three months. high-priced correspondents and cable gave detail re- to toils, minute about the Address and mail out checks volt that had Ukraine up in THE DAILY 33 First Street, New York, N. Y. the WORKER. arms against the Soviet Union. Mos- Editor ROBERT MINOR cow denied that there was even a de- cent Ukraine, Assistant Editor WM. F. DUNNE brawl in the but with Litvinoff raising the devil with the under Entered as Becond-class mall at the post-office at New lork, N. T.. imperialist war mongers in Geneva of March 3,187 S. » the act something had to be done, so the capitalist correspondents pulled off a Senate No One Wants to Organize revolt in the Ukraine. A * * » of Refusal of the democratic senators to take advantage their | AFTER the Associated Press had ** the majority over the republicans and organize the senate with oemo- ( ! spread the story of fake re- | volt over the world, it began to in- fact that the crats in control of all the committees reveals the ! vestigate the authenticity of its re- ports. -

The One-Tier Board in the Changing and Converging World of Corporate Governance, Under the Supervision of Professor Dr
THE ONE-TIER BOARD IN THE CHANGING AND CONVERGING WORLD OF CORPORATE GOVERNANCE THE ONE-TIER BOARD IN THE CHANGING AND CONVERGING WORLD OF CORPORATE GOVERNANCE A comparative study of boards in the UK, the US and The Netherlands Willem J.L. Calkoen 2012 Kluwer – Deventer – The Netherlands This PhD thesis contained in this book was publicly defended by the author on 11 October 2011 at Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. Omslagontwerp: H2R Vormgeving & Communicatie ISBN 978-90-13-10437-0 NUR 827-715 E-book: 978-90-13-10438-7 © 2012, Kluwer Deventer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h tot en met 16m Auteurswet jo. het Besluit van 27 november 2001, Stb. 2002, 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Kluwer BV legt de gegevens van abonnees vast voor de uitvoering van de (abonnements)- overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. -

Hitler's Biggest Allies in World War II Were Ford, General Motors &
Cars & Nazis article Hitler’s biggest allies in World War II were Ford, General Motors & a special report by Clive Matthew-Wilson All content © The Dog & Lemon Guide 2010. All rights reserved N 1937, William E. Dodd, U.S. a tiny bunch of nutters raving on Mu- Ambassador to Germany, sent an nich street corners, Ford is believed to I urgent warning to the American have provided considerable amounts of government: finance to the fledgling party, enabling the Nazis to gain their stronghold on “A clique of U.S. industrialists is Germany. It is notable that even after hell-bent to bring a fascist state to sup- “A clique of U.S. the horrors of the Nazi era were exposed plant our democratic government and is following World War II, Ford never working closely with the fascist regimes industrialists denied financing Hitler. in Germany and Italy. ”1 is hell-bent By the mid-1930s General Motors Ford, General Motors and Standard to bring a was totally committed to large-scale Oil weren’t just the world’s leading auto- fascist state to war production in Germany, produc- motive suppliers, they were among the supplant our ing trucks, tanks & armoured cars. Its largest and wealthiest corporations on German subsidiary Adam-Opel manu- the planet. Greedy, ruthless and drunk democratic factured a host of effective military with Nazi ideology, they decided to help government equipment for the German military end democracy, first in Europe, then in throughout the war. And, while the America. and is working American Air Force used conventional closely with the piston engines, the German Air Force While their own country was at war fascist regimes was close to getting the world’s first with Germany, Ford, General Motors jet fighters, thanks almost entirely to and Standard Oil kept or expanded in Germany General Motors. -

Patents for Hitler
Copyright 1942 by Guenter Reimann PRINTED IN GREAT BRITAlN BY RICHARD CLAY AND COMPANY, LTD., BUNGAY, SUFFOLK. become partners in agreements with national states as some kind of 'private empire' or 'economic state'. They were an expression of the idea that economic power has attained peculi- arities which we otherwise used to connect only with the political state .... Economic states which are not restricted by national boundaries will try to repress the national state as an economic factor so that they have absolute power in their hands."! The Nazi economist, Dr. Fritz Werr,2 extensively quoted A. Marcus as his authority on "the economic state". He par- ticularly referred' to the great oil powers, the Standard Oil Company of New Jersey3 and Royal Dutch Shell-companies with world-wide interests and great financial stakes in many countries 'where they constituted first-rate political factors. "The agreements bet,:"een the big oil companies, in particular, show that any law of the state becomes meaningless for them, and that all forms of jurisdiction of the national state are done away with .... Most treaties are 'gentlemen's agreements', and if one party abrogates such a contract or does not fulfil his obligations, the other party does not insist upon rights or laws accorded him by the legislation of a national state. He brings forth, instead, considerations of 'fairness' .... This refers not only to agreements between the oil trusts themselves, but to an even greater extent to agreement between these trusts and (national) states."4 The rise of the totalitarian state inevitably resulted in a decline of private world empires. -

The Secret War the War For
John Hancock Institute for International Finance" 25/06/201417:04 John Hancock Institute for Internationa· IF· tnance ™ Home World Trade Federation II Back II The Secret War The War for Oil By Frank c. Hanighen & Anton Zischka London: George Routledge & Sons 1935 Table of Contents Introduction Chapter 1--Birth of a World Power Chapter 2--A Drop of Oil Is Worth a Drop of Blood Chapter 3--The Secret War Chapter 4-- Armageddon and Oil Chapter 5--America's Pint Chapter 6--The Conversion of Calles Chapter 7--Dictator by Courtesy of Oil Chapter 8--The Struggle for the Panama Canal Chapter 9--Soldiers of the Battle of Oil Chapter 10--The Wells of Araby http://libertyparkusafd.org/lp/Hancock/CD-ROMS/GlobaIFederation ... ld%20Trade%20Federation%20-%2048%20-%20The%20Secret''Al2 OWar.htm I Page 1 of 123 John Hancock Institute for International Finance" 25/06/201417:04 Chapter 12--Russia Laughs Last Chapter 13--The Fire of Sourahkani Footnotes & Bibliography by Chapters Selected Bibliography of Books on the International Struggle for Oil Appendix A-- The Dynasties of Petroleum Appendix B--Anglo-Persian Oil Co. Ltd. Appendix C--World Production of Crude Petroleum in 1933 Introduction The publication of Frank Hanighen's study of the oil industry offers the opportunity to introduce one of the few journalists who has adapted to the world of 1934 the methods originated by S. S. McClure and Lincoln Steffens in the United States thirty years ago. At that time the period of national expansion that followed the Civil War gave rise to a system of corruption that a younger generation of journalists exposed. -
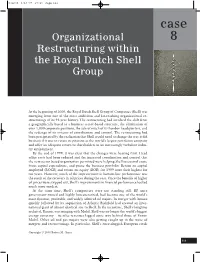
Organizational Restructuring Within the Royal Dutch Shell Group
CTAC08 4/13/07 17:23 Page 121 case Organizational 8 Restructuring within the Royal Dutch Shell Group At the beginning of 2000, the Royal Dutch Shell Group of Companies (Shell) was emerging from one of the most ambitious and far-reaching organizational re- structurings of its 93-year history. The restructuring had involved the shift from a geographically based to a business sector-based structure, the elimination of over 1,000 corporate positions, the sale of much of its London headquarters, and the redesign of its systems of coordination and control. The restructuring had been precipitated by the realization that Shell would need to change the way it did business if it was to retain its position as the world’s largest petroleum company and offer an adequate return to shareholders in an increasingly turbulent indus- try environment. By the end of 1999, it was clear that the changes were bearing fruit. Head office costs had been reduced and the increased coordination and control that the new sector-based organization permitted were helping Shell to control costs, focus capital expenditure, and prune the business portfolio. Return on capital employed (ROCE) and return on equity (ROE) for 1999 were their highest for ten years. However, much of the improvement in bottom-line performance was the result of the recovery in oil prices during the year. Once the benefits of higher oil prices were stripped out, Shell’s improvements in financial performance looked much more modest. At the same time, Shell’s competitors were not standing still. BP, once government-owned and highly bureaucratized, had become one of the world’s most dynamic, profitable, and widely admired oil majors. -

Searching for Oil in Roubaix
Searching for oil in Roubaix Joost Jonker and Jan Luiten van Zanden find a rich seam in the archives of de Rothschild frères for the history of Royal Dutch Shell and the global oil industry Baku with a forest of oil derricks in the distance, taken from the brochure Kraftübertragungsanlage der Apscheroner Elektricitäts- Gesellschaft Baku (c.1903). De Rothschild frères was the biggest shareholder in this electricity generating company in Baku; Henri de Rothschild (1872–1947) was another big investor. Archives nationales du monde du travail, 2002 132 aq 301. When we embarked on the Shell History Project in , we envisaged with some delight the exotic locations we would have to visit for the first volume alone: Indonesia, of course, Singa- ₁ pore, Egypt, Romania, Russia, Mexico, Venezuela, Los Angeles, San Francisco, St Louis … . Little did we know that we would do some of our most fruitful archival work exploring the archives of the Paris firm of de Rothschild frères deposited at the Archives nationales du monde du travail (formerly the Centre des archives du monde du travail) in the northern French town of Roubaix, a former milltown struggling to recover from industrial decline. These records provide a unique and very rich data source. The Paris firm filed the continuous flow of information which it received from its correspondents by country, economic sector, and some- times even by company, allowing business historians an insider’s view on developments in their research area. Some files are more informative than others, of course, and fortunately for us those concerning Royal Dutch Shell proved particularly rich due to the long and close associa- tion between de Rothschild frères and the oil company. -

British Foreign Policy in Azerbaijan, 1918-1920 Afgan Akhmedov A
British Foreign Policy in Azerbaijan, 1918-1920 Afgan Akhmedov A thesis Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of History University of Lancaster March 2018 Afgan Akhmedov 2018 2 Abstract This thesis examines Anglo-Russian rivalry in Transcaucasia in general - and Azerbaijan in particular - focusing on the years 1918-1920. The first part of the thesis provides a general review of the history of the Great Game - the geopolitical rivalry between the British and Russian Empires fought in the remote areas of central Asia - before going on to examine the growing investment by British firms in the oil industry of Baku. It also discusses how the Anglo-Russian Entente of 1907 changed the texture of Anglo- Russian relations without resolving the tensions altogether, which lasted until the February Revolution of 1917, despite the wartime alliance between Britain and Russia. The thesis then goes on to examine British policy towards Transcaucasia after the Bolshevik Revolution of 1917. The thesis argues that the political turmoil in Russia provided the British government with an opportunity to exert greater political control over the south of the country, securing its access to oil and control of the Caspian Sea region, thereby reducing any potential threat to India. The allied victory in the First World War, and the weakening of Turkey in particular, meant that British policy in central Asia after November 1918 increasingly focused on advancing British economic and strategic interests in the area. Although the British government did not seek to exert direct long-term political control over Azerbaijan, its policy in 1919 was designed both to support the local government in Baku against possible Bolshevik attack, whilst simultaneously exerting control over Baku oil. -

From Challenger to Joint Industry Leader, 1890-1939 a History of Royal Dutch Shell, Volume 1
From Challenger to Joint Industry Leader, 1890-1939 A History of Royal Dutch Shell, volume 1 .., Joost Jonker & Jan Luiten van Zanden Volume J covers the hIstory of Royal Dutch Shell from the foundation of the two parent corupames in the 18g05 until the outbreak of the Second WorWl \Y;w In pamcular alief lht: am.'\lgam.11101l or lhe buSInesS lOtet'ests of Royal Dutch iWld Shetl Transport III '907. Royal Dutch She. oevesoped into an industry leader. WlIh a strong presence In all main markets and production areas The company's phenomenal expansion was masterminded by Henn Deterding, arguably one of the world's most successful businessmen of his generation. During the 1920SRoyai Dutch Shell transformed Itself mtc a mature corporation, developing Innovative marketing and branding methods and branching out mto petrochemicals However, Its management structure trailed the company's evolution because Deterding res.sfed any changes that threatened his positron. When he retired in 1936, discredited Ihrough his asscctancn with Hiller's Germany Roy.IDu1Ch Shell faced the challenge of now to rebuild us top management structure while threatened by the Impending war. Joost Jonker speciakzes in financial and business hrstory. rang1flg from the 161h century unnl the present. His publications Include a history of DutCh mternational trading houses and an analysis of the emergence 01 securities trading at the Amsterdam exchange, Jan LUIlen van Zanden is Professor of Economic History at Utrecht University. and Senior Researcher at the International Institute of Social History In Amsterdam He has published widely on the economic hlSIOry of Westem Europe and Indonesia, In particular on long-term eccoormc growth and development.