MICHEL ROCARD Du Même Auteur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Primairescitoyennes Livrets I & Ii
#PRIMAIRESCITOYENNES LIVRETS I & II LES CANDIDATS ET LEURS PROPOSITIONS 1 LIVRET I - Les candidats Manuel VALLS ........................................... 4 SON PARCOURS ...................................... 4 SA CAMPAGNE ........................................ 5 Arnaud MONTEBOURG ......................... 6 SON PARCOURS ...................................... 6 SA CAMPAGNE ........................................ 7 Benoît HAMON ........................................ 7 SON PARCOURS .................................. 7 SA CAMPAGNE .................................... 8 Vincent PEILLON ..................................... 8 SON PARCOURS ...................................... 8 SA CAMPAGNE ........................................ 9 François de RUGY .................................... 12 Sylvia PINEL ............................................. 12 Jean-Luc BENNAHMIAS ......................... 13 LIVRET II - Les propositions EUROPE ..................................................... 14 ÉCONOMIE ................................................ 16 SANTÉ & SOCIAL, ENVIRONNEMENT .... 18 SOMMAIRE 2 Les « Primaires Citoyennes » DIDIER SALLÉ PRÉSIDENT Les primaires se suivent…. et semblent s’installer durablement dans le paysage politique et démocratique français, au point que certains commentaires avertis parlent d’une élection présidentielle française qui se tiendrait dorénavant à quatre tours. C’est assurément un signe de vitalité de notre vie démocratique alors que certains pensaient qu’elle s’essou ait : les citoyens y trouvent là un -

BUSINESS REVIEW 2013 Business Review (Re)Discover Caisse Des Dépôts Group’S 2013 Business Review
BUSINESS REVIEW 2013 Business Review (Re)discover Caisse des Dépôts Group’s 2013 Business Review. rapportannuel.caissedesdepots.fr A compact website (French only) offering a more in-depth look! A 2013 timeline in images, reports, by region, etc. A three-minute film summarising the Group. Déc. 2012 Janv. 2013 Déc. 2013 Janv. 2014 All of Caisse des Dépôts’ Key figures for 2013. Business Reviews… Main CSR indicators. FOLLOW US ON TWITTER, LINKEDIN, AND VIADEO! rapportannuel.caissedesdepots.fr Caisse des Dépôts Group Business Review 2013 1 Contents 2 Highlights 6 Message from Henri Emmanuelli, Chairman of the Supervisory Board 9 Message from Pierre-René Lemas, Chairman and Chief Executive Officer of Caisse des Dépôts 12 Overview of Caisse des Dépôts Group 16 Enterprise 26 Housing 36 Energy transition 46 Infrastructure, sustainable 58 Digital revolution 66 Fiduciary management mobility and tourism 76 Governance, decision-making and support functions 98 Finance 2 Highlights Centenary of Théâtre des Champs-Elysées 13 January Febuary March April May June 1Creation T of 1 F 1 F Publication1 M 1 WTra nsd ev 1Creation S of 2Bpifrance W 2 S 2 S o2 f G T r o u p’s 2 Twins new 2 S Egis Ports 2012 r e su l t s: 3 T 3 S 3 S 3 W 3 F contracts 3 M(specialising press conference in port and 4 F 4 M 4 M 4 T 4 Sto operate 4 T coastal 5 S 5 T 5 T 5 F 5networks S in 5 Wengineering) 6 S 6 W 6 W 6 S 6Melbourne M and6 T Entrepreneur Shenyang 7 M 7conference T 7 T 7Campus S d’@venir:7 T 7 F 8 T 8 F 8 F 8national M partnership8 W 8 S with Ministry for 9 W 9 S 9 S 9Higher T Education 9Launch T of 9 S 10 T 10 S 10 S 10 W 10acceleratedF technology10 MCooperation agreement 11 F 11 M 11 M 11 T 11transferS companies11 T with EIB (SAT Ts) 12 S 12 T 12 T 12 F 12 S 12 Won growth in Eastern France and 13Convention S with 13G20 W meeting13 on W 13 S 13 M 13 T employment 14 M 14 T 14 T 14 S 14 T 14 F French Ministry long-term investmentFrench Govt. -

DECISION 96-377 DC of 16 JULY 1996 Act to Strengthen Enforcement
DECISION 96-377 DC OF 16 JULY 1996 Act to strengthen enforcement measures to combat terrorism and violence against holders of public office or public service functions and to enact measures relating to the criminal investigation police On 20 June 1996 the Constitutional Council received a referral from Mr Claude ESTIER, Mr Guy ALLOUCHE, Mr François AUTAIN, Mr Germain AUTHIE, Mr Robert BADINTER, Ms Monique BEN GUIGA, Ms Maryse BERGE LAVIGNE, Mr Jean BESSON, Mr Jacques BIALSKI, Mr Pierre BIARNES, Mr Marcel BONY, Mr Jean-Louis CARRERE, Mr Robert CASTAING, Mr Francis CAVALIER BENEZET, Mr Michel CHARASSE, Mr Marcel CHARMANT, Mr Michel CHARZAT, Mr William CHERVY, Mr Raymond COURRIERE, Mr Roland COURTEAU, Mr Marcel DEBARGE, Mr Bertrand DELANOE, Mr Gérard DELFAU, Mr Jean-Pierre DEMERLIAT, Ms Marie-Madeleine DIEULANGARD, Mr Michel DREYFUS-SCHMIDT, Ms Josette DURRIEU, Mr Bernard DUSSAUT, Mr Léon FATOUS, Mr Aubert GARCIA, Mr Gérard GAUD, Mr Roland HUGUET, Mr Philippe LABEYRIE, Mr Philippe MADRELLE, Mr Jacques MAHEAS, Mr Jean-Pierre MASSERET, Mr Marc MASSION, Mr Georges MAZARS, Mr Jean-Luc MELENCHON, Mr Charles METZINGER, Mr Gérard MIQUEL, Mr Michel MOREIGNE, Mr Jean-Marc PASTOR, Mr Guy PENNE, Mr Daniel PERCHERON, Mr Jean PEYRAFITTE, Mr Jean-Claude PEYRONNET, Ms Danièle POURTAUD, Mr Paul RAOULT, Mr René REGNAULT, Mr Alain RICHARD, Mr Michel ROCARD, Mr Gérard ROUJAS, Mr René ROUQUET, Mr André ROUVIERE, Mr Claude SAUNIER, Mr Michel SERGENT, Mr Franck SERUSCLAT, Mr René-Pierre SIGNE, Mr Fernand TARDY, Mr André VEZINHET, Mr Henri WEBER, Senators, and, -

THE FRENCH SOCIALIST PARTY Membership Between Closed and Open Primaries
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Archivio istituzionale della ricerca - Università di Cagliari PA rtecipazione e CO nflitto * The Open Journal of Sociopolitical Studies http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco ISSN: 1972-7623 (print version) ISSN: 2035-6609 (electronic version) PACO, Issue 8(1) 2015: 264-283 DOI: 10.1285/i20356609v8i1p264 Published in March 15, 2015 Work licensed under a Creative Commons At- tribution-Non commercial-Share alike 3.0 Italian License RESEARCH ARTICLE THE FRENCH SOCIALIST PARTY Membership between closed and open primaries Marino De Luca University of Cagliari ABSTRACT: For some years now the clamor for democratisation of parties' internal functioning has been spreading across democracies. Among them, France has advanced impressively in the past few years. In 2006, the Socialist Party (PS) launched a closed primary to choose the socialist candidate, Ségolène Royal, for the 2007 presidential election. Approaching the 2012 presidential elections, the leftist coalition (PS and PRG) launched open primary elections to select its chief-executive candidates, with François Hollande fi- nally emerging as a nominee. In this article, we shall examine how the socialist membership changed during the past three socialist con- gresses, analysing the outcome of the two above-mentioned primary elections. In particular, we shall ob- serve the Le Mans (2005), Reims (2008) and Toulouse (2012) Congresses, and describe membership, par- ticipation, and competitiveness within the PS. The study was based on data collected from an administra- tive unit, the French départements. KEYWORDS: France, membership, party congress, primary election, Socialist Party COORESPONDING AUTHOR: Marino De Luca, email: [email protected] PACO, ISSN: 2035-6609 - Copyright © 2015 - University of Salento, SIBA: http://siba-ese.unisalento.it Partecipazione e conflitto, 8(1) 2015: 264-283, DOI: 10.1285/i20356609v8i1p264 1. -

What's Left of the Left: Democrats and Social Democrats in Challenging
What’s Left of the Left What’s Left of the Left Democrats and Social Democrats in Challenging Times Edited by James Cronin, George Ross, and James Shoch Duke University Press Durham and London 2011 © 2011 Duke University Press All rights reserved. Printed in the United States of America on acid- free paper ♾ Typeset in Charis by Tseng Information Systems, Inc. Library of Congress Cataloging- in- Publication Data appear on the last printed page of this book. Contents Acknowledgments vii Introduction: The New World of the Center-Left 1 James Cronin, George Ross, and James Shoch Part I: Ideas, Projects, and Electoral Realities Social Democracy’s Past and Potential Future 29 Sheri Berman Historical Decline or Change of Scale? 50 The Electoral Dynamics of European Social Democratic Parties, 1950–2009 Gerassimos Moschonas Part II: Varieties of Social Democracy and Liberalism Once Again a Model: 89 Nordic Social Democracy in a Globalized World Jonas Pontusson Embracing Markets, Bonding with America, Trying to Do Good: 116 The Ironies of New Labour James Cronin Reluctantly Center- Left? 141 The French Case Arthur Goldhammer and George Ross The Evolving Democratic Coalition: 162 Prospects and Problems Ruy Teixeira Party Politics and the American Welfare State 188 Christopher Howard Grappling with Globalization: 210 The Democratic Party’s Struggles over International Market Integration James Shoch Part III: New Risks, New Challenges, New Possibilities European Center- Left Parties and New Social Risks: 241 Facing Up to New Policy Challenges Jane Jenson Immigration and the European Left 265 Sofía A. Pérez The Central and Eastern European Left: 290 A Political Family under Construction Jean- Michel De Waele and Sorina Soare European Center- Lefts and the Mazes of European Integration 319 George Ross Conclusion: Progressive Politics in Tough Times 343 James Cronin, George Ross, and James Shoch Bibliography 363 About the Contributors 395 Index 399 Acknowledgments The editors of this book have a long and interconnected history, and the book itself has been long in the making. -

Valls Face À Sa Première Crise
Environnement Récifs artificiels pour la Côte sud Aquitaine Landes Récifs a fait fabriquer à Artix (64) des modules en MERCREDI béton qui seront 2 AVRIL 2014 immergés - DAX/SUD-LANDES au large. Page 11 LAISSAC LUKE PHOTO WWW.SUDOUEST.FR Valls face à sa première crise REMANIEMENT À peine installé et occupé à former son gouvernement, le Premier ministre doit gérer une situation tendue : Europe Écologie-Les Verts claque la porte ! Pages 2 à 4 Pour la première fois, les communes de plus de 1 000 habitants élisaient aussi leurs délégués communautaires. PH. PASCAL BATS/« SO » Après les communes, les communautés LANDES Les maires désormais connus, les pronostics vont bon train pour connaître les nouveaux visages des intercommunalités. P. 12-13 Où les majorités peuvent-elles changer ? LA ROCHELLE LIGUE DES CHAMPIONS 7 20 millions Le grand soir pour la mairie du PSG C’est la somme nécessaire Le club parisien reçoit à la reconstruction ce soir Chelsea en quart La passation des pouvoirs entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls fut brève. PHOTO AFP de l’édifice classé. Pages 8-9 de finale aller. Page 31 MERCREDI 2 AVRIL 2014 WWW.SUDOUEST.FR SACHEZ-LE ! Slater quitte Quiksilver Kelly Slater, onze fois champion du monde de surf, a mis fin à vingt-trois ans de partenariat avec Quiksilver pour rejoindre Kering. Annoncée hier, la nouvelle est passée pour un poisson d’avril. Landes La rumeur d’une mauvaise blague persiste mais serait infondée. PHOTO ASP / KIRSTIN SCHOLTZ / KIRSTIN ASP PHOTO SAINT-PAUL-LÈS-DAX Trois poissons au menu d’hier « Sud Ouest » n’a pas manqué l’oc- casion de faire avaler quelques poissons à ses lecteurs pour le Un éden sous l’Océan 1er avril. -

Template 6587..6623
o Année 2015. – N 87 A.N. (C.R.) ISSN 0242-6765 Jeudi 9 juillet 2015 ASSEMBLÉE NATIONALE JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE XIVe Législature SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 Séances du mercredi 8 juillet 2015 Compte rendu intégral Les articles, amendements et annexes figurent dans le fascicule bleu ci-joint 6 0 7 8 0 5 1 3 0 1 7 http://www.assemblee-nationale.fr 7 7 SOMMAIRE GÉNÉRAL re 1 séance . 6589 e 2 séance . 6625 o Année 2015. – N 87 [1] A.N. (C.R.) ISSN 0242-6765 Jeudi 9 juillet 2015 ASSEMBLÉE NATIONALE JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 10e séance Compte rendu intégral 1re séance du mercredi 8 juillet 2015 Les articles, amendements et annexes figurent dans le fascicule bleu ci-joint http://www.assemblee-nationale.fr 6590 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 8 JUILLET 2015 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BARTOLONE PAIX AU PROCHE ET AU MOYEN-ORIENT (p. 6598) M. Jean-Luc Laurent 1. Questions au Gouvernement (p. 6592) M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international SITUATION DE LA GRÈCE (p. 6592) M. Jean Leonetti GESTATION POUR AUTRUI (p. 6599) M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics M. Xavier Breton Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la SITUATION DE LA GRÈCE (p. 6593) justice M. Guillaume Bachelay M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics KME (p. 6600) M. Christophe Léonard SITUATION DE LA GRÈCE (p. 6593) M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie Mme Eva Sas et du numérique M. -

The Fears of Building Europe Les Peurs De La Construction De L'europe
European and Global Studies Journal Vol. 2, No. 1 - 2019 | ISSN 2611-853X The Fears of building Europe Les peurs de la construction de l’Europe Guest Editors Paolo Caraffini, University of Turin Filippo Maria Giordano, University of Turin CONTENTS INTRODUCTION MISCELLANEOUS Fear in international relations and in European integration • Nihil sub sole novum? Italia e Germania all’ombra Paolo Caraffini and Filippo Maria Giordano di una nuova “questione tedesca” Federico Trocini ESSAYS • Changing fears in European geopolitical discourses from BOOK REVIEWS the First till the Second World War: Halford Mackinder, • Corinne Gobin, Jean-Claude Deroubaix (a cura di) Isaiah Bowman and Arnold J. Toynbee (2018). Polémique et construction européenne, Patricia Chiantera-Stutte «Le discours et la langue», tome10.1, 232 pp. Rachele Raus • « La base de notre politique, c’est la peur ». La peur et le début du processus d’intégration européenne • Dove va l’Europa?, numero monografico della rivista Giuliana Laschi «Storia e Memoria», anno XXVIII, n. 2, 2019, ISSN 1121-9742, 174 pp. • Governing Globalisation to Overcome Nation- Fabio Sozzi Based Fears: Federalism as the Paradigm of the Contemporary Age BOOK RECOMMENDATIONS Raffaella Cinquanta • Lorenzo Bini Smaghi, 33 false verità sull’Europa, Bologna, il Mulino, 2014, • Fear and Global Risk: Failed or Rehabilitated States? ISBN 978-88-15-25153-4, 188 pp. Filippo Corigliano ABSTRACTS AND KEYWORDS • Discours sur la peur et contre l’Europe dans les tracts du Front National (2008-2017) Alida Maria Silletti • La peur d’une construction libérale de l’Union européenne et de la fin de l’État-providence : positions euro-critiques au sein du socialisme français à l’occasion des référendums sur le Traité de Maastricht et sur la Constitution européenne Paolo Caraffini De Europa Vol. -

JEAN-MARIE T IBAOU Kanaky Pandanus Online Publications, Found at the Pandanus Books Web Site, Presents Additional Material Relating to This Book
JEAN-MARIE T IBAOU Kanaky Pandanus Online Publications, found at the Pandanus Books web site, presents additional material relating to this book. www.pandanusbooks.com.au JEAN-MARIE TJIBAOU Kanaky JEAN�MARIE TJIBAOU Kanaky Writings translated by Helen Fraser and John Trotter From the original French La Presence Kanak Jean-Marie Tjibaou Edited by Alban Bensa and Eric Wittersheim First published by Editions Odile Jacob, 1996 PANDANUS BOOKS Research School of Pacificand Asian Studies THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY Cover: Jean-Marie Tjibaou salutes the Kanaky flag the first time it was flown for the provisional government, 1 December 1984. Photograph: Helen Fraser. ©Jean-Marie Tjibaou 2005 © Original publication. Editions Odile Jacob, 1996 This book is copyright in all countries subscribing ro the Berne convention. Apart from any fair dealing for the purpose of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission. Typeset in Garamond 10.75pt on 13pt and printed by Pirion, Canberra National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry Tjibaou, J.-M. (Jean-Marie), 1937-. [La presence kanak. eng] Kanaky. Includes index. ISBN 1 74076 175 8. 1. New Caledonia - History - Autonomy and independence movements. 2. New Caledonia - Politics and government. I. Fraser, Helen. II. Trotter, John. III. Title. 995.97 Editorial inquiries please contact Pandanus Books on 02 6125 3269 www.pandanusbooks.com.au Published by Pandanus Books, Research School -

Questions Pour Un Champion Partis Politiques
Le Parti Socialiste Ce dernier, Lionel Jospin, fut le candidat malheureux contre Jacques Chirac aux deux dernières présidentielles. Après sa défaite spectaculaire au premier tour de la présidentielle de On peut faire remonter ma naissance à 2002, battu par le parti d’extrême-droite, il s’est plus ou plusieurs dates, mais l’une des plus moins retiré importantes est 1905, lorsque des hommes tels Actuellement, mon premier secrétaire est François que Jean Jaurès me fondent sous un premier Hollande. Sa compagne, Ségolène Royal vient de devancer nom : la S.F.I.O. J’ai longtemps hésité à me Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn dans des lancer dans la conquête du pouvoir, car j’étais plutôt tenté élections primaires internes pour désigner mon candidat par la contestation, voire la révolution. pour la présidentielle 2007. Elle est désormais la candidate à Mais finalement, c’est Léon Blum qui, en 1936, à la tête battre pour la droite. d’une coalition dite de Front Populaire, m’a fait accéder Mon logo, qui exprime à la fois mon idéal et ma pour la première fois aux commandes de l’Etat. J’ai alors pu détermination, est « la rose au poing ». Mon siège est rue de réaliser une partie du programme de réforme sociale que Solférino à Paris. Mon sigle est P.S. Je suis … le Parti j’appelai de mes vœux, en rendant la vie plus douce aux Socialiste. ouvriers et aux plus faibles en général, en imposant par exemple les congés payés. Outre Léon Blum, des hommes tels que Guy Mollet ou Pierre Mendès-France ont marqué mon histoire, assez souvent, toutefois, vécue dans l’opposition. -
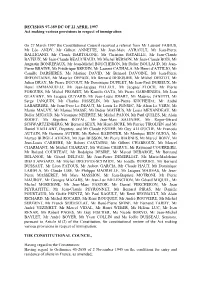
DECISION 97-389 DC of 22 APRIL 1997 Act Making Various Provisions in Respect of Immigration
DECISION 97-389 DC OF 22 APRIL 1997 Act making various provisions in respect of immigration On 27 March 1997 the Constitutional Council received a referral from Mr Laurent FABIUS, Mr Léo ANDY, Mr Gilbert ANNETTE, Mr Jean-Marc AYRAULT, Mr Jean-Pierre BALLIGAND, Mr Claude BARTOLONE, Mr Christian BATAILLE, Mr Jean-Claude BATEUX, Mr Jean-Claude BEAUCHAUD, Mr Michel BERSON, Mr Jean-Claude BOIS, Mr Augustin BONREPAUX, Mr Jean-Michel BOUCHERON, Mr Didier BOULAUD, Mr Jean- Pierre BRAINE, Ms Frédérique BREDIN, Mr Laurent CATHALA, Mr Henri d’ATTILIO, Mr Camille DARSIERES, Ms Martine DAVID, Mr Bernard DAVOINE, Mr Jean-Pierre DEFONTAINE, Mr Maurice DEPAIX, Mr Bernard DEROSIER, Mr Michel DESTOT, Mr Julien DRAY, Mr Pierre DUCOUT, Mr Dominique DUPILET, Mr Jean-Paul DURIEUX, Mr Henri EMMANUELLI, Mr Jean-Jacques FILLEUL, Mr Jacques FLOCH, Mr Pierre FORGUES, Mr Michel FROMET, Mr Kamilo GATA, Mr Pierre GARMENDIA, Mr Jean GLAVANY, Mr Jacques GUYARD, Mr Jean-Louis IDIART, Mr Maurice JANETTI, Mr Serge JANQUIN, Mr Charles JOSSELIN, Mr Jean-Pierre KUCHEIDA, Mr André LABARRERE, Mr Jean-Yves Le DEAUT, Mr Louis Le PENSEC, Mr Alain Le VERN, Mr Martin MALVY, Mr Marius MASSE, Mr Didier MATHUS, Mr Louis MEXANDEAU, Mr Didier MIGAUD, Ms Véronique NEIERTZ, Mr Michel PAJON, Mr Paul QUILES, Mr Alain RODET, Ms Ségolène ROYAL, Mr Jean-Marc SALINIER, Mr Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Mr Bernard SEUX, Mr Henri SICRE, Mr Patrice TIROLIEN and Mr Daniel VAILLANT, Deputies, and Mr Claude ESTIER, Mr Guy ALLOUCHE, Mr François AUTAIN, Mr Germain AUTHIE, Mr Robert BADINTER, Ms Monique -

Derrière Les Tensions Entre Socialistes, La Bataille Du Congrès
Derrière les tensions entre socialistes, la bataille du congrès PAR STÉPHANE ALLIÈS Alors que les implorations à changer de cap se heurtent toujours aux mêmes fins de non-recevoir de la part de l’exécutif, et que la fronde marque le pas à l’assemblée, les socialistes critiques de la politique gouvernementale n’ont en réalité plus que le congrès pour faire entendre leurs voix. Même si celui-ci pourrait avoir lieu dans plus d’un an. Voyage au pays de l’incertitude. L’ambiance n’est pas près de se calmer, dans les rangs socialistes. Après de nouvelles invectives et appels à quitter le PS, au lendemain d’un vote du budget marquant l’élargissement de la critique interne aux ministres écartés du gouvernement Valls (lire ici), les fractures récurrentes laissent entrevoir l’enjeu caché qui occupe les têtes militantes, élues et dirigeantes du parti, et qui expliquent les tensions et les démarcations en cours : le futur congrès. « Il ne faut pas se leurrer, c’est le seul moment et le seul lieu où il sera possible de s’affranchir, confie un député qui a voté le budget malgré son opposition à la politique gouvernementale. Plus grand monde n’a envie d’un énième combat budgétaire, perdu d’avance. Mieux vaut mener le combat, même dans un cadre pourri, et avoir une chance d’inverser le cours des choses, que ne plus avoir de chances du tout. » Conscients de la fragilité de leur mobilisation parlementaire, qui se contraint à l’abstention pour ne pas faire tomber un gouvernement qu’ils critiquent pourtant sans cesse, les socialistes contestataires voient combien l’expression publique de leurs désaccords se heurtent toujours aux mêmes fins de non-recevoir de la part de l’exécutif.