Liste Rouge Mollusques (Gastéropodes Et Bivalves)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pulmonata, Helicidae) and the Systematic Position of Cylindrus Obtusus Based on Nuclear and Mitochondrial DNA Marker Sequences
© 2013 The Authors Accepted on 16 September 2013 Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research Published by Blackwell Verlag GmbH J Zoolog Syst Evol Res doi: 10.1111/jzs.12044 Short Communication 1Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), University of Oslo, Oslo, Norway; 2Central Research Laboratories, Natural History Museum, Vienna, Austria; 33rd Zoological Department, Natural History Museum, Vienna, Austria; 4Department of Integrative Zoology, University of Vienna, Vienna, Austria; 5Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary New data on the phylogeny of Ariantinae (Pulmonata, Helicidae) and the systematic position of Cylindrus obtusus based on nuclear and mitochondrial DNA marker sequences 1 2,4 2,3 3 2 5 LUIS CADAHIA ,JOSEF HARL ,MICHAEL DUDA ,HELMUT SATTMANN ,LUISE KRUCKENHAUSER ,ZOLTAN FEHER , 2,3,4 2,4 LAURA ZOPP and ELISABETH HARING Abstract The phylogenetic relationships among genera of the subfamily Ariantinae (Pulmonata, Helicidae), especially the sister-group relationship of Cylindrus obtusus, were investigated with three mitochondrial (12S rRNA, 16S rRNA, Cytochrome c oxidase subunit I) and two nuclear marker genes (Histone H4 and H3). Within Ariantinae, C. obtusus stands out because of its aberrant cylindrical shell shape. Here, we present phylogenetic trees based on these five marker sequences and discuss the position of C. obtusus and phylogeographical scenarios in comparison with previously published results. Our results provide strong support for the sister-group relationship between Cylindrus and Arianta confirming previous studies and imply that the split between the two genera is quite old. The tree reveals a phylogeographical pattern of Ariantinae with a well-supported clade comprising the Balkan taxa which is the sister group to a clade with individuals from Alpine localities. -

Malacologia Vol. 56, No. 1-2 2013 Contents Full Papers
MALACOLOGIA VOL. 56, NO. 1-2 MALACOLOGIA 2013 http://malacologia.fmnh.org CONTENTS World’s Leading Malacological Journal FULL PAPERS Journal Impact Factor 1.592 (2012) Suzete R. Gomes, David G. Robinson, Frederick J. Zimmerman, Oscar Obregón & Nor- Founded in 1961 man B. Barr Morphological and molecular analysis of the Andean slugs Colosius confusus, n. sp., a newly recognized pest of cultivated flowers and coffee from Colombia, Ecuador and EDITOR-IN-CHIEF Peru, and Colosius pulcher (Colosi, 1921) (Gastropoda, Veronicellidae) ..... 1 GEORGE M. DAVIS Eva Hettenbergerová, Michal Horsák, Rashmi Chandran, Michal Hájek, David Zelený & Editorial Office Business & Subscription Office Jana Dvořáková Malacologia Malacologia Patterns of land snail assemblages along a fine-scale moisture gradient .... 31 P.O. Box 1222 P.O. Box 385 Nicolás Bonel, Lía C. Solari & Julio Lorda West Falmouth, Massachusetts 02574, U.S.A. Haddonfield, New Jersey 08033, U.S.A. Differences in density, shell allometry and growth between two populations of Lim- [email protected] [email protected] noperna fortunei (Mytilidae) from the Río de la Plata basin, Argentina ..... 43 Mariana L. Adami, Guido Pastorino & J. M. (Lobo) Orensanz Copy Editor Associate Editor Phenotypic differentiation of ecologically significant Brachidontes species co- EUGENE COAN JOHN B.BURCH occurring in intertidal mussel beds from the southwestern Atlantic ........ 59 Santa Barbara Museum of Natural History University of Michigan Santa Barbara, California, U.S.A. Ann Arbor, Michigan, U.S.A. Moncef Rjeibi, Soufia Ezzedine-Najai, Bachra Chemmam & Hechmi Missaoui [email protected] [email protected] Reproductive biology of Eledone cirrhosa (Cephalopoda: Octopodidae) in the northern and eastern Tunisian Sea (western and central Mediterranean) .. -

The Slugs of Bulgaria (Arionidae, Milacidae, Agriolimacidae
POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT ZOOLOGII ANNALES ZOOLOGICI Tom 37 Warszawa, 20 X 1983 Nr 3 A n d rzej W ik t o r The slugs of Bulgaria (A rionidae , M ilacidae, Limacidae, Agriolimacidae — G astropoda , Stylommatophora) [With 118 text-figures and 31 maps] Abstract. All previously known Bulgarian slugs from the Arionidae, Milacidae, Limacidae and Agriolimacidae families have been discussed in this paper. It is based on many years of individual field research, examination of all accessible private and museum collections as well as on critical analysis of the published data. The taxa from families to species are sup plied with synonymy, descriptions of external morphology, anatomy, bionomics, distribution and all records from Bulgaria. It also includes the original key to all species. The illustrative material comprises 118 drawings, including 116 made by the author, and maps of localities on UTM grid. The occurrence of 37 slug species was ascertained, including 1 species (Tandonia pirinia- na) which is quite new for scientists. The occurrence of other 4 species known from publications could not bo established. Basing on the variety of slug fauna two zoogeographical limits were indicated. One separating the Stara Pianina Mountains from south-western massifs (Pirin, Rila, Rodopi, Vitosha. Mountains), the other running across the range of Stara Pianina in the^area of Shipka pass. INTRODUCTION Like other Balkan countries, Bulgaria is an area of Palearctic especially interesting in respect to malacofauna. So far little investigation has been carried out on molluscs of that country and very few papers on slugs (mostly contributions) were published. The papers by B a b o r (1898) and J u r in ić (1906) are the oldest ones. -

Malaco Le Journal Électronique De La Malacologie Continentale Française
MalaCo Le journal électronique de la malacologie continentale française www.journal-malaco.fr MalaCo (ISSN 1778-3941) est un journal électronique gratuit, annuel ou bisannuel pour la promotion et la connaissance des mollusques continentaux de la faune de France. Equipe éditoriale Jean-Michel BICHAIN / Paris / [email protected] Xavier CUCHERAT / Audinghen / [email protected] Benoît FONTAINE / Paris / [email protected] Olivier GARGOMINY / Paris / [email protected] Vincent PRIE / Montpellier / [email protected] Les manuscrits sont à envoyer à : Journal MalaCo Muséum national d’Histoire naturelle Equipe de Malacologie Case Postale 051 55, rue Buffon 75005 Paris Ou par Email à [email protected] MalaCo est téléchargeable gratuitement sur le site : http://www.journal-malaco.fr MalaCo (ISSN 1778-3941) est une publication de l’association Caracol Association Caracol Route de Lodève 34700 Saint-Etienne-de-Gourgas JO Association n° 0034 DE 2003 Déclaration en date du 17 juillet 2003 sous le n° 2569 Journal électronique de la malacologie continentale française MalaCo Septembre 2006 ▪ numéro 3 Au total, 119 espèces et sous-espèces de mollusques, dont quatre strictement endémiques, sont recensées dans les différents habitats du Parc naturel du Mercantour (photos Olivier Gargominy, se reporter aux figures 5, 10 et 17 de l’article d’O. Gargominy & Th. Ripken). Sommaire Page 100 Éditorial Page 101 Actualités Page 102 Librairie Page 103 Brèves & News ▪ Endémisme et extinctions : systématique des Endodontidae (Mollusca, Pulmonata) de Rurutu (Iles Australes, Polynésie française) Gabrielle ZIMMERMANN ▪ The first annual meeting of Task-Force-Limax, Bünder Naturmuseum, Chur, Switzerland, 8-10 September, 2006: presentation, outcomes and abstracts Isabel HYMAN ▪ Collecting and transporting living slugs (Pulmonata: Limacidae) Isabel HYMAN ▪ A List of type specimens of land and freshwater molluscs from France present in the national molluscs collection of the Hebrew University of Jerusalem Henk K. -

Molluscs of the Dürrenstein Wilderness Area
Molluscs of the Dürrenstein Wilderness Area S a b i n e F ISCHER & M i c h a e l D UDA Abstract: Research in the Dürrenstein Wilderness Area (DWA) in the southwest of Lower Austria is mainly concerned with the inventory of flora, fauna and habitats, interdisciplinary monitoring and studies on ecological disturbances and process dynamics. During a four-year qualitative study of non-marine molluscs, 96 sites within the DWA and nearby nature reserves were sampled in cooperation with the “Alpine Land Snails Working Group” located at the Natural History Museum of Vienna. Altogether, 84 taxa were recorded (72 land snails, 12 water snails and mussels) including four endemics and seven species listed in the Austrian Red List of Molluscs. A reference collection (empty shells) of molluscs, which is stored at the DWA administration, was created. This project was the first systematic survey of mollusc fauna in the DWA. Further sampling might provide additional information in the future, particularly for Hydrobiidae in springs and caves, where detailed analyses (e.g. anatomical and genetic) are needed. Key words: Wilderness Dürrenstein, Primeval forest, Benign neglect, Non-intervention management, Mollusca, Snails, Alpine endemics. Introduction manifold species living in the wilderness area – many of them “refugees”, whose natural habitats have almost In concordance with the IUCN guidelines, research is disappeared in today’s over-cultivated landscape. mandatory for category I wilderness areas. However, it may not disturb the natural habitats and communities of the nature reserve. Research in the Dürrenstein The Dürrenstein Wilderness Area Wilderness Area (DWA) focuses on providing invento- (DWA) ries of flora and fauna, on interdisciplinary monitoring The Dürrenstein Wilderness Area (DWA) was as well as on ecological disturbances and process dynamics. -

Paleoclimatic Reconstruction Using Mutual Climatic Range on Terrestrial Mollusks
Paleoclimatic reconstruction using Mutual Climatic Range on terrestrial mollusks. Olivier Moine, Denis-Didier Rousseau, Dominique Jolly, Marc Vianey-Liaud To cite this version: Olivier Moine, Denis-Didier Rousseau, Dominique Jolly, Marc Vianey-Liaud. Paleoclimatic recon- struction using Mutual Climatic Range on terrestrial mollusks.. Quaternary Research, Elsevier, 2002, 57, pp.162-172. 10.1006/qres.2001.2286. hal-01208190 HAL Id: hal-01208190 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01208190 Submitted on 2 Oct 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Olivier Moine Paléoenvironnements & Palynologie, Institut des Sciences de l’Evolution (UMR CNRS 5554), Université Montpellier II, case 61, place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France Denis-Didier Rousseau Paléoenvironnements & Palynologie, Institut des Sciences de l’Evolution (UMR CNRS 5554), Université Montpellier II, case 61, place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France and Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, Palisades, New York 10964 Dominique Jolly Paléoenvironnements & Palynologie, Institut des Sciences de l’Evolution (UMR CNRS 5554), Université Montpellier II, case 61, place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France Marc Vianey-Liaud Génétique et Environnement, Institut des Sciences de l’Evolution (UMR CNRS 5554), Université Montpellier II, case 64, place E. -

Gastropoda, Prosobranchia)
BASTERIA, 64: 151-163, 2000 The genus Alzoniella Giusti & Bodon, 1984, in France. 1 West European Hydrobiidae, 9 (Gastropoda, Prosobranchia) Hans+D. Boeters Karneidstrasse 8, D 81545 Munchen, Germany In France the genusAlzoniella Giusti & Bodon, 1984, is represented with two subgenera, viz. its nominate subgenus and Navarriella subgen. nov. The nominate subgenus comprises six three species, ofwhich are described as viz. A. haicabia A. new, (A.) spec. nov., (A.) junqua spec. A. nov. and A. (A.) provincialis spec. nov., next to (A.) navarrensis Boeters, 1999, A. (A.) perrisii and A. (Dupuy, 1851) (A.) pyrenaica (Boeters, 1983). The new subgenus is proposed for A. (Navarriella) elliptica (Paladilhe, 1874) only. A. (A.) perrisii (Dupuy, 1851) [Hydrobia], the first of this became known from is redefined and species genus that France, described here with two viz. A. and A. subspecies, (A.) p. perrisii (A.) p. irubensis subspec. nov. Key words: Gastropoda, Prosobranchia, Hydrobiidae, Alzoniella (Alzoniella) and Alzoniella (Navarriella), France. INTRODUCTION Giusti & Bodon (1984: 169) described Alzoniella for three eyeless, subterranean, hy- drobiid species from Italy, that might have evolved from small populations that locally survived the Quaternary glaciations. It turned out that Alzoniella is also represented in where mountain inhabited France, regions are that have partially been subject to gla- ciations, viz. the Pyrenees and the MediterraneanAlps. In these regions too, populations ofancestral have Alzoniella might survived locally by invading subterranean waters. This development apparently went less far than in for example Bythiospeum Bourguignat, 1882, andMoitessieria Bourguignat, 1863. Species of these two genera, which are eyeless stygobionts, occur not only in karstic waters, but also in the interstitium and in subter- ranean waters bordering river valleys such as that of the Rhone river (Boeters & Miiller be found 1992). -
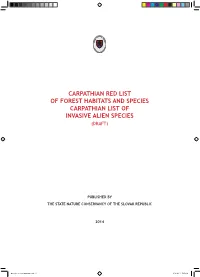
Draft Carpathian Red List of Forest Habitats
CARPATHIAN RED LIST OF FOREST HABITATS AND SPECIES CARPATHIAN LIST OF INVASIVE ALIEN SPECIES (DRAFT) PUBLISHED BY THE STATE NATURE CONSERVANCY OF THE SLOVAK REPUBLIC 2014 zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 1 227.8.20147.8.2014 222:36:052:36:05 © Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2014 Editor: Ján Kadlečík Available from: Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica Slovakia ISBN 978-80-89310-81-4 Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce Swiss-Slovak Cooperation Programme Slovenská republika This publication was elaborated within BioREGIO Carpathians project supported by South East Europe Programme and was fi nanced by a Swiss-Slovak project supported by the Swiss Contribution to the enlarged European Union and Carpathian Wetlands Initiative. zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 2 115.9.20145.9.2014 223:10:123:10:12 Table of contents Draft Red Lists of Threatened Carpathian Habitats and Species and Carpathian List of Invasive Alien Species . 5 Draft Carpathian Red List of Forest Habitats . 20 Red List of Vascular Plants of the Carpathians . 44 Draft Carpathian Red List of Molluscs (Mollusca) . 106 Red List of Spiders (Araneae) of the Carpathian Mts. 118 Draft Red List of Dragonfl ies (Odonata) of the Carpathians . 172 Red List of Grasshoppers, Bush-crickets and Crickets (Orthoptera) of the Carpathian Mountains . 186 Draft Red List of Butterfl ies (Lepidoptera: Papilionoidea) of the Carpathian Mts. 200 Draft Carpathian Red List of Fish and Lamprey Species . 203 Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia) . 209 Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia) . 214 Draft Carpathian Red List of Birds (Aves). 217 Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia) . -

Ein Beitrag Zur Anatomie Von Bythiospeum Tschapecki (CLESSIN, 1878) (Moll., Gastropoda, Prosobranchia)
©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum Heft 30 S. 79—82 Graz 1983 Ein Beitrag zur Anatomie von Bythiospeum tschapecki (CLESSIN, 1878) (Moll., Gastropoda, Prosobranchia) Von Peter L. REISCHÜTZ Mit 2 Abbildungen Eingelangt am 27. Mai 1983 Inhalt: Die Genitalmorphologie von Vitretta tschapecki CLESSIN, 1878 wurde erstmals untersucht und die Zugehörigkeit dieser Art zur Gattung Bythiospeum BOURGUIGNAT, 1882. festgestellt. Abstract: The genital morphology of Vitretta tschapecki CLESSIN, 1878 has been examined for the first time and this has proven that this species belongs to the genus Bythiospeum BOURGUIGNAT, 1882. Die Buchkogelhöhle bei St. Martin bei Graz ( = Bründlhöhle, Höhlenkat. Nr. 2793/1) ist locus typicus eines kaum bekannten stygobionten Süßwasser-Proso- branchiers: Vitrella tschapecki CLESSIN, 1878. Bei einer Exkursion mit Dr. E. KREISSL zum locus typicus konnten mehrere Exemplare dieser Art gesammelt und drei anatomisch untersucht werden. Die systematische Stellung der Art war bisher sehr unsicher, da die anatomischen Verhältnisse unbekannt waren. CLESSIN, 1878 beschrieb Vitrella tschapecki mit einem falschen Fundort (Sanriack in Kärnten). Dies wurde später korrigiert (CLESSIN, 1882 und 1887). BOURGUIGNAT, 1882 stellte diese Art zu seiner Gattung Bythiospeum, da Vitrella CLESSIN, 1877 synonym zu Vitrella SWAINSON, 1840 ist. WESTERLUND, 1886 stellte sie in die Gattung Paludinella L. PFEIFFER, 1841, GEYER, 1909 zur Gattung Lartetia BOURGUIGNAT, 1869, FUCHS, 1929 in die Gattung Paladilhiopsis PAVLOVIC, 1913. KLEMM, i960 betrachtete Paladilhiopsis als Untergattung von Paladilhia BOURGUIGNAT. Da die bisherige Gliederung nur auf konchyologischen Merkmalen beruhte (FUCHS, 1925 und 1929, MAHLER, 1949, STOJASPAL, 1978 und REISCHÜTZ, 1981 und 1983), sollte möglichst umfangreiches Material aus dem österreichischen Unter- suchungsgebiet untersucht werden. -

CLECOM-Liste Österreich (Austria)
CLECOM-Liste Österreich (Austria), mit Änderungen CLECOM-Liste Österreich (Austria) Phylum Mollusca C UVIER 1795 Classis Gastropoda C UVIER 1795 Subclassis Orthogastropoda P ONDER & L INDBERG 1995 Superordo Neritaemorphi K OKEN 1896 Ordo Neritopsina C OX & K NIGHT 1960 Superfamilia Neritoidea L AMARCK 1809 Familia Neritidae L AMARCK 1809 Subfamilia Neritinae L AMARCK 1809 Genus Theodoxus M ONTFORT 1810 Subgenus Theodoxus M ONTFORT 1810 Theodoxus ( Theodoxus ) fluviatilis fluviatilis (L INNAEUS 1758) Theodoxus ( Theodoxus ) transversalis (C. P FEIFFER 1828) Theodoxus ( Theodoxus ) danubialis danubialis (C. P FEIFFER 1828) Theodoxus ( Theodoxus ) danubialis stragulatus (C. P FEIFFER 1828) Theodoxus ( Theodoxus ) prevostianus (C. P FEIFFER 1828) Superordo Caenogastropoda C OX 1960 Ordo Architaenioglossa H ALLER 1890 Superfamilia Cyclophoroidea J. E. G RAY 1847 Familia Cochlostomatidae K OBELT 1902 Genus Cochlostoma J AN 1830 Subgenus Cochlostoma J AN 1830 Cochlostoma ( Cochlostoma ) septemspirale septemspirale (R AZOUMOWSKY 1789) Cochlostoma ( Cochlostoma ) septemspirale heydenianum (C LESSIN 1879) Cochlostoma ( Cochlostoma ) henricae henricae (S TROBEL 1851) - 1 / 36 - CLECOM-Liste Österreich (Austria), mit Änderungen Cochlostoma ( Cochlostoma ) henricae huettneri (A. J. W AGNER 1897) Subgenus Turritus W ESTERLUND 1883 Cochlostoma ( Turritus ) tergestinum (W ESTERLUND 1878) Cochlostoma ( Turritus ) waldemari (A. J. W AGNER 1897) Cochlostoma ( Turritus ) nanum (W ESTERLUND 1879) Cochlostoma ( Turritus ) anomphale B OECKEL 1939 Cochlostoma ( Turritus ) gracile stussineri (A. J. W AGNER 1897) Familia Aciculidae J. E. G RAY 1850 Genus Acicula W. H ARTMANN 1821 Acicula lineata lineata (DRAPARNAUD 1801) Acicula lineolata banki B OETERS , E. G ITTENBERGER & S UBAI 1993 Genus Platyla M OQUIN -TANDON 1856 Platyla polita polita (W. H ARTMANN 1840) Platyla gracilis (C LESSIN 1877) Genus Renea G. -

Species Distinction and Speciation in Hydrobioid Gastropoda: Truncatelloidea)
Andrzej Falniowski, Archiv Zool Stud 2018, 1: 003 DOI: 10.24966/AZS-7779/100003 HSOA Archives of Zoological Studies Review inhabit brackish water habitats, some other rivers and lakes, but vast Species Distinction and majority are stygobiont, inhabiting springs, caves and interstitial hab- itats. Nearly nothing is known about the biology and ecology of those Speciation in Hydrobioid stygobionts. Much more than 1,000 nominal species have been de- Mollusca: Caeno- scribed (Figure 1). However, the real number of species is not known, Gastropods ( in fact. Not only because of many species to be discovered in the fu- gastropoda ture, but mostly since there are no reliable criteria, how to distinguish : Truncatelloidea) a species within the group. Andrzej Falniowski* Department of Malacology, Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University, Poland Abstract Hydrobioids, known earlier as the family Hydrobiidae, represent a set of truncatelloidean families whose members are minute, world- wide distributed snails inhabiting mostly springs and interstitial wa- ters. More than 1,000 nominal species bear simple plesiomorphic shells, whose variability is high and overlapping between the taxa, and the soft part morphology and anatomy of the group is simplified because of miniaturization, and unified, as a result of necessary ad- aptations to the life in freshwater habitats (osmoregulation, internal fertilization and eggs rich in yolk and within the capsules). The ad- aptations arose parallel, thus represent homoplasies. All the above facts make it necessary to use molecular markers in species dis- crimination, although this should be done carefully, considering ge- netic distances calibrated at low taxonomic level. There is common Figure 1: Shells of some of the European representatives of Truncatelloidea: A believe in crucial place of isolation as a factor shaping speciation in - Ecrobia, B - Pyrgula, C-D - Dianella, E - Adrioinsulana, F - Pseudamnicola, G long-lasting completely isolated habitats. -

Mating Behaviour in the Terrestrial Slug Deroceras Gorgonium: Is Extreme Morphology Associated with Extreme Behaviour?
Animal Biology, Vol. 57, No. 2, pp. 197-215 (2007) Koninklijke Brill NV, Leiden, 2007. Also available online - www.brill.nl/ab Mating behaviour in the terrestrial slug Deroceras gorgonium: is extreme morphology associated with extreme behaviour? HEIKE REISE 1,∗, STEFANIE VISSER 1, JOHN M.C. HUTCHINSON 2 1 Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz, PF 300154, 02806 Görlitz, Germany 2 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Lentzeallee 94, 14195 Berlin, Germany Abstract—Mating in Deroceras consists of an investigation phase (precourtship), then a long courtship involving mutual stroking with the extruded sarcobelum, then sperm exchange (copulation). The penial gland, if present, everts over the partner’s skin during copulation: this is hypothesised to apply a secretion manipulating the partner to use received sperm. Deroceras gorgonium has a particularly large penial gland divided into many finger-like branches. We studied D. gorgonium mating behaviour in the hope of further indications of the gland’s function. Precourtship and courtship together last longer than in other Deroceras (ca. 6 h to >9 h); precourtship is highly variable, often with many bouts of different behaviours, including seemingly inactive phases. During most of the courtship partners remain apart waving their particularly long, pointed sarcobela; only at a later stage do the tips of these contact the partner. This waving alternates with circling for half a turn. For the first time in Deroceras we observed the sarcobelum transferring a secretion. The copulation is amongst the fastest: genital eversion and sperm exchange occur within 1 s, and slugs separate 18-25 s later. The penial gland is everted immediately after sperm exchange, but, surprisingly, is often spread underneath the partner rather than over its back and, if on top, is not always fully spread over the partner’s body.