Mauritanie, La Racine Par Le Colonel Sidy Ould Bilal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
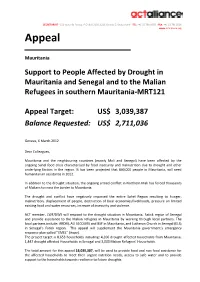
Text Begins Here
SECRETARIAT - 150 route de Ferney, P.O. Box 2100, 1211 Geneva 2, Switzerland - TEL: +41 22 791 6033 - FAX: +41 22 791 6506 www.actalliance.org Appeal Mauritania Support to People Affected by Drought in Mauritania and Senegal and to the Malian Refugees in southern Mauritania-MRT121 Appeal Target: US$ 3,039,387 Balance Requested: US$ 2,711,036 Geneva, 6 March 2012 Dear Colleagues, Mauritania and the neighbouring countries (mainly Mali and Senegal) have been affected by the ongoing Sahel food crisis characterised by food insecurity and malnutrition due to drought and other underlying factors in the region. It has been projected that 800,000 people in Mauritania, will need humanitarian assistance in 2012. In addition to the drought situation, the ongoing armed conflict in Northern Mali has forced thousands of Malians to cross the border to Mauritania. The drought and conflict have negatively impacted the entire Sahel Region resulting to hunger, malnutrition, displacement of people, destruction of local economies/livelihoods, pressure on limited existing food and water resources, increase of insecurity and violence. ACT member, LWF/DWS will respond to the drought situation in Mauritania, Fatick region of Senegal and provide assistance to the Malian refugees in Mauritania by working through local partners. The local partners include: ARDM, AU SECOURS and BSF in Mauritania, and Lutheran Church in Senegal (ELS) in Senegal’s Fatick region. This appeal will supplement the Mauritania government’s emergency response plan called ‘’EMEL’’ (hope). The project target is 8,653 households including: 4,206 drought affected households from Mauritania, 1,447 drought affected Households in Senegal and 3,000 Malian Refugees’ Households. -

2. Arrêté N°R2089/06/MIPT/DGCL/ Du 24 Août 2006 Fixant Le Nombre De Conseillers Au Niveau De Chaque Commune
2. Arrêté n°R2089/06/MIPT/DGCL/ du 24 août 2006 fixant le nombre de conseillers au niveau de chaque commune Article Premier: Le nombre de conseillers municipaux des deux cent seize (216) Communes de Mauritanie est fixé conformément aux indications du tableau en annexe. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives à l’arrêté n° 1011 du 06 Septembre 1990 fixant le nombre des conseillers des communes. Article 3 : Les Walis et les Hakems sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Annexe N° dénomination nombre de conseillers H.Chargui 101 Nema 10101 Nema 19 10102 Achemim 15 10103 Jreif 15 10104 Bangou 17 10105 Hassi Atile 17 10106 Oum Avnadech 19 10107 Mabrouk 15 10108 Beribavat 15 10109 Noual 11 10110 Agoueinit 17 102 Amourj 10201 Amourj 17 10202 Adel Bagrou 21 10203 Bougadoum 21 103 Bassiknou 10301 Bassiknou 17 10302 El Megve 17 10303 Fassala - Nere 19 10304 Dhar 17 104 Djigueni 10401 Djiguenni 19 10402 MBROUK 2 17 10403 Feireni 17 10404 Beneamane 15 10405 Aoueinat Zbel 17 10406 Ghlig Ehel Boye 15 Recueil des Textes 2017/DGCT avec l’appui de la Coopération française 81 10407 Ksar El Barka 17 105 Timbedra 10501 Timbedra 19 10502 Twil 19 10503 Koumbi Saleh 17 10504 Bousteila 19 10505 Hassi M'Hadi 19 106 Oualata 10601 Oualata 19 2 H.Gharbi 201 Aioun 20101 Aioun 19 20102 Oum Lahyadh 17 20103 Doueirare 17 20104 Ten Hemad 11 20105 N'saveni 17 20106 Beneamane 15 20107 Egjert 17 202 Tamchekett 20201 Tamchekett 11 20202 Radhi -

· ~ -~~:~ Cf '"[,...,..H'o"' ~ ~ N;: Ll"" It: Ijj ~ ,~ENTRE Franct,!~ .:\1.~F' ! a Populallun ET LE 1)T ,,
• . -· ~ -~~:~ cf '"[,...,..h'o"' ~ ~ n;: ll"" it: iJJ ~ ,~ENTRE FRANCt,!~ .:\1.~f' ! A POPULAllUN ET LE 1)t ,, ,. , __ ., · · :J:t:NT 15, rue de 1'Ec;o1t··0~-1\rlédecine 75270 PARIS CEDEX 06 Tél.: (1) 46 33 ~ifilonscrlptions administratives de Io Mauritanie Circonscription• Port· Fri ennr Pnrr • Etiennt" ""'' • F.t. "'""' Ct>rcll.' du Tiris · z,.n,·:ic>ut * ... Fort· Got:rnu.i t· ''lt - Gouraud Cercle del' Adrar •..•...•. AtM A1ar At.lr ."itAr Ct>rdl' de i'Assa!>11 ••....•. Kdfa Ki Ha \t' ; 1.ou: 'l.l'Bout Ka11Lnsso Kanko~sa Crrcll' du füakna ..•...... Ale~ Alt"1t l1<,11h t 1t •• ··' ~ .\ki;ta · Lah:ar Ka~c!i K"éd1 K >ll'c/I KaC: •. li ~laAhaina •.{ai:b.rn:a \l1>Ull,1''.1('J ... lt•!-. /\1~Ut": :aE Crrclt' Ju Ciui.!iruaka., •.. , . Ct'tclC! du l!o,!h occ id en t al , , . .\Ïnun·r I· Atrn1.s" AÏoun Aînun Tamd1al .. 1t Cl'rclt> du lfo,lh nri('ntal ....• Néma Néma Amnuzj 1\mour1 Tin1brdra T1mhéclr" l.\assikounou Cl'tclt' dl' l'Ind1iri. Akinuit Akjouit Cercle du T11~an1 . Tidjikjn Tidiikia \loudjC:ria Moudjrria lluumdei.! ' Boum,!t·id 1' Ti ch itt • Tichitt 1 Cerde du Trarza ..•.... , .. Rosso Rosso Rosso Roso;o 1'ouakcho1t Nouakd1<Ht 1 .'l.fe.ierdra l Me<ler,lra 1 [!outil imi t 1 Boutilimit ------ - _J __ _ .L.1 __ _ J N.B. Cho,ue .subdivi.rion const11ue également une commune rurole, odministree par un Conseil rural !!lu dont Io présidence esl os· 111rée par e Chef de ·,.ubdivision. Les communes•p1lotl.'S sont administrées par un Cor1Seil municipal élu t:t un moire délègue nom• mé par décret, alors que le moire des C"OPlmtmes 111/.aint>s est él•J •Lu cen:li!s de Io Baie du Ltvrier et du Tiris·Zemmour ont éte plocês sous l'o1.to1i1 . -

The World Bank
- I Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized ReportNo. 9787-MAU STAFF APPRAISAL REPORT ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA Public Disclosure Authorized HEALTHAND POPULATIONPROJECT OCTOBER 28, 1991 Public Disclosure Authorized Populationand Human Resources Operations Division Sahelian Department Africa Region Public Disclosure Authorized This documenthas a restricteddistribution and may be used by recipientsonly in the performanceof their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without WorId Bank authorization. CURRENCY EOUIVALENTS Currency Unit = ouguiya (UM) / US$1.0 = 84 UM (August 1991) MEASURES metric system ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AfDB African Development Bank BHU Village Basic Health Unit BMZ German Ministry for Economic Cooperation CEDS Centre d'Etudes Démographiques et Sociales (Center for Demographic and Social Studies) CHN Centre Hospital,er National (National Hospital Center) CPF Centre de Promotion Féminine (Center for the Promotion of Women) DAFA Directorate of Administrative and Financial Affairs DHE Directorate of Health Education DHR Directorate of Human Resources DHHP Directorate of Hygiene and Health Protection DPM Direction de la Pharmacie et de Médicaments (Directorate of Pharmacy and Drugs) DPC Directorate of Planning and Coordination DRASS Direction Régionale de l'Action Socio-Sanitaire (Regional Health Directorate) EC European Community ENSP Ecole Nationale de la Santé Publique (National School of Public Health) FPU Family Planning Unit HC Departmental Health -

Mauritanie, Pour
16°O LAS PALMAS 12° O vers TAN-TAN vers GUELMIM 8° O vers BÉCHAR vers BÉCHAR 4° O Cap Juby Gomera Tenerife Grande Canarie MAURITANIE TARFAYA MASPALOMAS M A R O C TINDOUF Hierro EL MHABAS 20° O Î l e s C a n a r i e s JDIRIYA LA'YOUN E (ESPAGNE) s S GARA DJEBILET a amr . m e qia el H a 449 ( in s) SMARA TFARITI BOUJDOUR E BOU KRA' Chenachane 'Aïn Ben Tili Z E M M O U R I g u î d i U Bîr Bel g Chegga Bîr Aïdiat Guerdâne Sebkhet ' E r A L G É R I E Dâya . Q Agmar Iguetti 'Ayoûn 'Abd el Khadra 347 GUELTAT ZEMMOUR Bîr Mogreïn el Mâlek I El Mzereb K Tourassine ÎR R E T T IS ZEMMOU N N A c h M A e 24° 24° N SAHARA Sebkhet Oumm ed Droûs A Sebkha h L Oued el Ma Zednes H OCCIDENTAL L C A ED DAKHLA 460 Cancer A El Mreïti Tropique du H g L Gleïb Dbâq G L 574 i Ti-n-Bessaïs m Tenoûmer r Agâraktem Zouérat â 370 E T ê E Fd rik a m m r Bîr 'Amrâne ' TAOUDENNI AOUSSERD ï (salines) Kediet ej Jill 915 l H e Mejaouda A E Tourîne t vers TESSA AGHOUINIT Touîjinjert q â îl BIR Tou j Aghreïjît a GANDOUZ TICHLA ZOUG M 330 e L I EL GARGARAT Châr 647 Zemlet Toffal Bir Ounâne T El Ghallâouîya n El Beyyed Cheïrîk â Nouâdhibou û â Aghoueyyît âl Ch ûm Aghouedir r N Bo Lanou r In Tmeïmîchât o Guelb er Rîchât a LAGOUIRA A 485 u Cansado Ntalfa Ahmeyim D Ouadâne O Râs Nouâdhibou â R A Azougui At r A M A L I (Cap Blanc) DAKHLET R Tiberguent 4° vers ARAOUANE NOUÂDHIBOU A z e f f â l 855 Chinguetti ADRAR É Terjît 20° 20° PARC NATIONAL Châmi DU BANC D'ARGUIN î A k c h â r Oujeft Capitale d'État Iou k Akjoujt 501 Et Tîdra Far 'aoun (plus de 750 000 hab.) C ÎR INCH I E Râs Timirist l M r e y Plus de 50 000 hab. -

HORIZONS N° 6114 DU MARDI 15 MERCREDI 16 OCTOBRE 2013 Page 3 ACTUALITE
Enrôlement: Commémoration de la journée 2 681 381 internationale citoyens de la fille enregistrés à ce jour Lire page 3 HORIZONS Lire pages 8-9 QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS - ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATION - N° 6114 DU MARDI 15 MERCREDI 16 OCTOBRE 2013 - PRIX : 100 UM Le Premier ministre reçoit Enseignement Fondamental: l'ambassadeur d'Espagne Le ministre rencontre l'Association nationale des Parents d'élèves Le ministre de l'Enseignement fondamental, M. Ba Ousmane, s'est réuni, hier, à Nouakchott, avec le bureau de l'association nationale des parents d'élèves. Au cours de la rencontre, le ministre a mis en exergue le rôle des parents d'élèves dans la redynamisation de l'action pédagogique et l'amélioration de la rentabilité des élèves. Il a souligné que ce rôle doit s’exercer dans le suivi des élèves, leur incitation à regagner leurs écoles dès les premiers jours de Le Premier ministre, Dr. Moulaye Ould ambassadeur d'Espagne dont la mission en la rentrée scolaire, le respect de la permanence officielle, et le refus des at- titudes nuisibles et contraires à la mission pédagogique. Mohamed Laghdaf, a reçu en audience, Mauritanie a pris fin. Il a également précisé que les parents d'élèves sont considérés comme hier, SEM. Alonso Dezcallar Mazarredo, l'avant-garde du département dans la gestion de l'opération pédagogique, pour hisser le niveau qualitatif de l'enseignement, ainsi que pour doter les élèves des connaissances et des informations sécurisant leur avenir péda- gogique. Assemblée Nationale : Pagee page 4 Adoption d’un contrat programme entre l'Etat et la SNFP Enfants en conflit avec la loi: Visite du ministre de la Justice au Centre d'Accueil et de Réinsertion sociale Le ministre de la Justice, M. -

ﻣراﻗﺑو اﻟﺷﻐل Controleurs De Travail ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻﻛﺗﺗﺎب 469 ﻋﻧﺻرا - 20 ﯾوﻟﯾو 2019 Concours Externe De Recrutement De 469 Unités – 20 Juillet 2019
ﻣراﻗﺑو اﻟﺷﻐل Controleurs de travail ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻﻛﺗﺗﺎب 469 ﻋﻧﺻرا - 20 ﯾوﻟﯾو 2019 Concours externe de recrutement de 469 unités – 20 Juillet 2019 رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد Nom et Prénom Lieu de Naissance °N اﻹﺳم اﻟﻛﺎﻣل ﻣﺣل اﻟﻣﯾﻼد Date de Naissance 1 ﻓﺎطﻤﺔ ﺳﯿﺪﻧﺎ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻨﻐﺪج Fatma Sidna Cheikih Maleck Tenghadej 10-déc-88 2 ﺳﻌﺪﻧﺎ اﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد آﻛﻮﯾﻨﯿﺖ Saadna Ahmed Messaoud Agoueinit 20-déc-95 3 ﺷﯿﺨﻨﺎ اﻟﺪﯾﮫ اﺣﻤﺪ ﺗﻮﺟﻨﯿﻦ Cheikhna Deh Ahmed Toujounine 05-mars-86 4 ﻋﺒﺎس ﻣﻮﻻي اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻮﻻي اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻨﻌﻤﮫ Moulaye Ismail Moulalye Ismail Néma 10-oct-85 5 اﻟﺸﯿﺦ ﺑﺎي ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺤﻤﺪ ﻣﺎل Cheikh Baye Mohamed Lemine Med Lehmed Male 12-févr-87 6 ﺳﯿﺪ ﺑﻮي ﺟﺪ اھﻠﻮ ﻏﯿﺜﻦ ﺣﺎﺳﻲ اھﻞ اﺣﻤﺪ Sidi Bouyé Jed Ehlou Ghaithne Hassi Ehl Ahmed Bechne 05-avr-99 7 ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻟﻤﻮده ﺑﻮﺗﻠﻤﯿﺖ Mariem Mohamed Salem Lemouede Boutilimit 01-déc-89 8 ﺳﻮدة اﺣﻤﺪ اﻟﺪاده دار اﻟﻨﻌﯿﻢ Saoudatou Ahmed Dadde Dar Naim 31-déc-91 9 اﻟﺤﺴﻦ اﻣﺒﻚ ﺑﻠﮫ ﺗﻮﺟﻨﯿﻦ El Hassenm'beké Boll& Toujounine 31-déc-96 10 ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺤﺴﻦ دﯾﺎھﻲ اﻟﺴﺒﺨﺔ Mariem El Hassane Dyahi Sebkha 21-mai-88 11 اﻟﻘﻄﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﺤﺮج El Ghoutoub Mohamed El Hassane Lahraj 07-déc-94 12 اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪن اﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت Ismail Hameden Etheimine Arafat 02-janv-95 13 اﻟﺸﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﻀﺮاﻣﻲ اﻟﺸﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﺒﺨﺔ Cheikh Brahim Hadrami Cheikh Brahim Sebkha 31-déc-92 14 ﯾﻌﻘﻮب اﻣﺒﺎرك اﻟﻌﯿﺪ اﻟﻤﯿﻨﺎء Yaghoub M'bareck El Id El Mina 31-déc-86 15 اﺑﻮﺑﻜﺮ اﻣﺪو ﺳﻚ ﺗﻔﺮغ زﯾﻨﮫ Aboubecrine Amadou Seck Tévragh Zeina 18-sept-93 16 ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﯾﺎض Mohamed Yahya Abdellahi Abderrahmane Ryad 31-oct-84 17 ﻟﺒﺎﻧﮫ دام ﻓﺎل ﺑﻮﻟﻨﻮار Loubana Dame Fall Boulenoire -

Prevision De La Demande
PREVISION DE LA DEMANDE Mauritanie: Plan directeur de production et transport de l'énergie électrique en Mauritanie entre 2011 et 2030 - Rapport final Table des Matières Page 3. Prévision de la demande 1 3.1 Introduction 1 3.2 Développement démographique 2 3.2.1 Période 2000 - 2010 2 3.2.2 Période 2011 - 2030 3 3.3 Développement économique 4 3.3.1 L'objectif primordial - réduction de la pauvreté 4 3.3.2 Développement du PIB dans la période 1995 - 2010 4 3.3.3 Le secteur minier et le secteur de la pêche 6 3.3.3.1 Statistique de production 6 3.3.3.2 Secteur minier 7 3.3.3.3 Secteur de la pêche 7 3.3.4 Perspectives de développement 8 3.4 Demande d'électricité dans le passé 10 3.4.1 Cadre institutionnel 10 3.4.2 Ventes BT et MT de la SOMELEC dans la période 2000 - 2012 10 3.4.3 Période 2006 - 2012 : Abonnés BT et ventes BT 11 3.4.4 Période 2006 - 2012 : Abonnés MT et ventes MT 14 3.4.5 Résumé de la situation en 2010 20 3.4.6 Le secteur minier 21 3.5 Modèle de demande des localités déjà électrifiées 22 3.5.1 Développement du taux d'électrification 24 3.5.2 Développement de la demande spécifique des abonnés domestiques 25 3.5.2.1 Nouakchott et Nouadhibou 25 3.5.2.2 Autres localités 25 3.5.3 Développement de la demande des abonnés BT non domestiques 27 3.5.4 Développement de la demande MT 28 3.5.5 Demande en puissance (pointes annuelles) 29 3.6 Demande potentielle des localités NON électrifiées 30 3.7 Demande du secteur minier 33 3.8 Résultats 34 3.8.1 Localités déjà électrifiées en 2011 34 3.8.1.1 Demande en énergie électrique 34 3.8.1.2 Demande -

Emergency Plan of Action Final Report Mauritania: Food Security Crisis
Emergency Plan of Action Final Report Mauritania: Food Security Crisis DREF operation: MDRMR008 Glide number: OT-2017-000112-MRT Date of Issue: 07 May 2018 Date of disaster: 31 July 2017 IFRC Operation Manager: Romain GUIGMA Manager, Operation timeframe: 11 August to 11 November 2017 Operations, Country Cluster Support Team Host National Society: Mauritania Red Crescent Operation budget: CHF 206,067 Number of people affected: 28,100 persons Number of people assisted: 4,0181 persons N° of National Societies involved in the operation: International Committee of the Red Cross (ICRC), French Red Cross (FRC), Spanish Red Cross, Luxembourg Red Cross, Climate Centre N° of other partner organizations involved in the operation: CILSS/AGIR, FAO, PAM, UNDP, ACMAD, AGRYMETH, GFCS, ECHO, OCHA, OFDA, State structures and community management committees A. SITUATION ANALYSIS Description of the disaster The 2016-2017 rainy season in Mauritania was characterized by a fifty-eight percent decrease compared to the previous year. Indeed, rainfall deficits exceeding 100 mm were recorded in several Wilayas in the south of the country, notably at the level of the two Hodhs (administrative regions), in Assaba, Brakna, Gorgol, Trarza and in Guidimagha. The situation greatly affected crop production, particularly rain-fed crops, which in most areas produced low or even non- existent output levels. This drop in agricultural production impacted on rural populations, particularly in rain-fed areas (along the border strip) and in the traditional areas of Aftout, where the highest rates of food insecurity were recorded during that period. The vulnerable households experienced a decline in their income from agricultural activities, either in terms of self- consumption (cereals) or in terms of income from sales or rural work. -

Receveur Domaines Recettes Minière2016
Liste des candidats définitivement acceptés pour le concours de recrutement de 20 unités pour le compte du Ministère de l’Agriculture selon les options suivantes : Ces candidats sont convoqués à l’ENI, le dimanche 10 juin à 08 heures, pour subir le concours 1. Option Agronomes Bac +4 N Date et lieu de اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ Noms et Prénoms NNI / ﺗﺎ.م . اﻟﻤﯿﻼد Officiel naissance ﷴ ﻓﺎل ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﺮاﺷﻲ Med Vall Mahfoudh Kharachi 31/12/1986 Boutilimit 3360613501 20 اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﯿﻌﻘﻮﺑﻲ Cheikh Abdelkader EL Yacoubi 31/12/1993 Teyarett 1942418890 63 ﷴ ﻣﺎدي ﻧﻔﻊ Mohamed Mady Nefaa 30/11/1980 Lybie 1513759012 66 اﻟﺴﺎﻟﻤﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اطﻮﯾﻠﺐ Salma Taleb Toueileb 04/02/1991 T. Zeina 6063300833 70 ﺷﯿﺨﻨﺎ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﺳﺤﺎق CheikhnaSid’El Moctar Ishagh 08/10/1988 ElbAderess 4488698281 156 ﷴ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺳﯿﺪي Med EL HafedHafed Sidi 21/12/1988 Teyarett 5171845516 160 ﷴ ﺳﯿﺪي ﻓﺮج Mohamed Sidi Varaj 03/04/1991 Dar Naim 3088165915 177 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎﻟﯿﺪو اﻧﻜﯿﺪ Abderrahmane Khalidou N’Gaide 28/11/1978 Sebkha 6461738518 221 ﯾﺴﻠﻢ اﻓﻜﻮ ﺣﻤﻮد YeslemIvekouHamoud 31/12/1985 Ouad Naga 3880350074 270 ﯾﺐ ﺑﺪﯾﻦ آﻣﯿﻦ YoubaBedine Amine 25/08/1984 à Tidjikja 4310763227 295 ﷴ ﺣﺴﻨﻲ ﺣﺴﻨﻲ Mohamed HacenyHaceny 31/12/1978à Aleg 9069315701 298 ﻣﺎدﯾﺎﻧﻲ آﻣﺎدو ﺳﻲ Madani amadou Sy 30/05/1980 au Ksar 7130547213 311 ام ﻛﻠﺜﻮم آﻻﺳﺎن ﺳﻲ Oumou Kelthoum AlassaneSy 27//05/1979 6380207981 365 ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﺎﺟﻲ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ Moustapha Naji Med Abderrahmane 15/12/1992 Boutilimit 3505931432 59 2. Option Ingénieurs Topographes/cartographes Bac +4 N Date et lieu de اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ Noms et Prénoms NNI / ﺗﺎ.م . -

Rapport Général Et Financier 2015
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation Direction Générale des Collectivités Territoriales Rapport général et financier 2016 sur l’utilisation des crédits d’équipement du Fonds Régional de Développement (FRD) 2015 Observatoire des Finances Locales Comité Technique National de suivi-évaluation du FRD RAPPORT GÉNÉRAL ET FINANCIER 2016 SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS D’ÉQUIPEMENT DU FONDS RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (FRD) EXERCICE 2015 SOMMAIRE Introduction Page 3 Bilan national Page 7 Constats et recommandations Page 23 Bilan communal – Tableaux de synthèse Page 27 2 INTRODUCTION Le rapport général et financier 2016 retrace principalement l’utilisation par les 218 communes mauritaniennes des crédits d’équipement du Fonds Régional de Développement (FRD) attribué au titre de l’exercice 2015, conformément au décret n°2011-059 du 14 février 2011 portant création du Fonds Régional de Développement (FRD). Institué en 1980, réorganisé en 1994, 2003 et en 2011 par le décret N° 2011-59 sus mentionné, le Fonds Régional de Développement a pour objectif de contribuer à renforcer les transferts financiers de l’État aux communes en vue d’améliorer les ressources mises à leur disposition et promouvoir l’accès de leurs populations à des services de base, en application de la Déclaration de politique de décentralisation et de développement adoptée par le Gouvernement le 22 avril 2010. Le décret du 14 février 2011 prévoit en outre la mise en place d’un Comité Technique National (CTN) de suivi-évaluation du FRD. Les arrêtés conjoints MIDEC/MF n°592 et 593 du 6 avril 2011 ont permis l’opérationnalisation de ce CTN au moyen d’un dispositif rendant compte de l’utilisation des crédits d’équipement FRD sur la base duquel est rédigé le rapport général et financier annuel présenté en Conseil des Ministres. -

Autorite De Regulation Cahier Des Charges Pour La
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur - Fraternité - Justice PREMIER MINISTERE AUTORITE DE REGULATION CAHIER DES CHARGES POUR LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU AGENCE NATIONALE D’EAU POTABLE ET DASSAINISSEMENT(ANEPA) VISA : Le Président du Conseil National de Régulation Novembre 2007 SOMMAIRE TITRE I- DÉFINITIONS ..............................................................................................................4 TITRE II- DISPOSITIONS GENERALES.................................................................................4 Article 1 : Objet..........................................................................................................................4 Article 2 : Cadre légal et réglementaire ...................................................................................5 Article 3 : Périmètre de délégation ...........................................................................................6 Article 4 : Biens mobiliers et immobiliers................................................................................6 Article 5 : Mise à disposition des terrains nécessaires ............................................................6 Article 6: Prise en charge des installations en début de délégation………………………...6 Article 7 : Prise en charge des installations en cours de délégation ......................................7 TITRE III- CONDITIONS DE FOURNITURE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU............7 Article 8 : Réglement du service public de l’eau .....................................................................7