SHAB Memoires 2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Musée De La Résistance Bretonne – Saint-Marcel
VERS UN NOUVEAU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN BRETAGNE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL Partie II – PROSPECTIVE RAPPELS – MISE EN PERSPECTIVE Situé à une vingtaine de kilomètres de Ploërmel et à 30 minutes de Vannes, Saint-Marcel est l'un des hauts-lieux de la Résistance Française. C'est aux abords de cette petite commune du Morbihan intérieur que s'est constitué, au printemps 1944, un maquis mobilisateur sans équivalent où plusieurs milliers de jeunes résistants bretons ont été armés et entraînés en vue de reprendre la lutte pour la libération de notre territoire. C'est là qu'eut lieu le 18 juin 1944 l’un des tout premiers combats livrés par des combattants Français contre l'occupant allemand après le débarquement allié en Normandie. Victoire des âmes plus encore que des armes, la « bataille de Saint-Marcel », livrée contre l’occupant à la date anniversaire de l’appel lancé quatre ans plus tôt par le général de Gaulle, a valeur de symbole. Elle a été rendue possible par la mobilisation des « enfants du pays » rassemblés au sein d’un centre mobilisateur clandestin sans équivalent. Elle n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien des parachutistes SAS de la France Libre dont les premiers furent largués en Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Eléments précurseurs de l’opération Overlord en Normandie, ils étaient chargés d’armer et d’encadrer la Résistance et de harceler l’ennemi afin de le fixer en Bretagne. Leur présence, et le constat qu’ils feront dès leur arrivée d’une Résistance structurée et prête à prendre les armes, va justifier le parachutage par les Alliés d’une quantité exceptionnelle d’armes et de matériels sur Saint-Marcel. -

105648615.23.Pdf
^J '^-♦^• (•••. m^r-m:. 3 ip-'i ••rri -^- «iP: \)Q.^k.^' a. 15/ /f //^ National Library of Scotland *B000500600* '^03S P BIBLIOTHECA LINDESIANA. HAND LIST OF THE BOUDOIR BOOKS. 1881 BIBLIOTHECA LINDESIANA, HAND LIST OF THE BOUDOIR BOOKS. 188] ^3% % 136 6 -"^ ^*i'iV. ori Abaco. Incommincia una practica molto bona ed utile . chiamata volgarmente I'arte del I'abacho. 410. Treviso. (?Michele Manzolo ?) 1478. 62 ff. Red mor. Bedford (at most 4 copies known). Acosta, Jos. de. Geographische und Historische Beschreibung der . Landschafft America ... in XX Mappen oder Landtaffeln verfasset . Folio. Colin (Johann Christoffel) 1598. Bl. mor. 52 ff. + 20 maps. De Acuna, R. P. Christoval. Nuevo descubrimiento del gran Rio de las Amazonas. 4to. Madrid 1641. 6 + 46 ff. Veil, (rigidly suppressed and very rare). Aduertisments. Aduertisements partly for due order in the publique administration of common prayers . and partly for the apparrell of all per-sons ecclesiasticall. 41°. London. (Reg. Wolfe) (1565). 8 ff. Br. elf. Advertisments. Certaine Advertisements out of Ireland concerning the losses and distresses happened to the Spanish Navie (Armada) . 4to. London (J. Vautrollier) 1588. 9 ff. Veil. Appended to (Leigh) Copie of a Letter . ^schylus. ^schyli Tragoedise Sex. (GR^CE.) 8vo. Venice (Aldus) 1518. 113 ff. + I f. Green mor. (Rt. Hon. Grenville.) Editio Princeps. ^sopus. ^2sopi vita et Fabulse, Latine, cum versione Itallica et alle- goriis Fr. Tuppi. Folio. Naples 1485. 166 ff. Brown mor. (Yemeniz.) Alcedo y Herrera. Don Dionysio de. Aviso Historico Politico Geo- graphico, con las Noticias mas particulares del Peru, Tierra-Firme, Chile, y nuevo Reyno de Granada . -

Flight of a Suspect
Turning back time by Charles Felix Ruellan (1876 –1955) Flight of a Suspect Or The Misadventures of the Jolly de Pontcadeuc family Presented by Nicole and Louis Lesbaupin Cartography: Élodie Letard Archives J.-H de la Blanchardière Translated from French to English by Gena R. Chattin Special thanks to Eva Zaghdoun for translation assistance. Final editor: Llewellyn M. Toulmin, Ph.D., F.R.S.A., F.R.G.S. Above note is from Hughes de Boiry of Vanves, France, and is inscribed in the original manuscript. Note: Items in brackets are inserted by the translator, or by the final editor, Llewellyn M. Toulmin, unless the brackets clearly indicate omissions and gaps in the original papers. There are two types of footnotes: those with Arabic numbers at the bottom of each page are from the original text. Those with Roman numerals at the end of the manuscript are notes inserted by the translator. Some of these latter notes, and other insertions in brackets, are marked as editorial insertions; these refer to my notes. Llewellyn M. Toulmin Silver Spring, Maryland, USA An American descendant of Jean Baptiste Florian Jolly de Pontcadeuc and Marguerite Marie le Det de Segray 2 FOREWORD Flight of a suspect or the misadventures of the Jolly de Pontcadeuc family recounts the story of that family from its origin to the point at which the name is lost in female lineage. The original draft of this document is a collage of typed, glued-on, and crossed- out sections of text covered in written annotations, which make it difficult to read. -

Orig. Fab. Des Du Chastel Définitif 2
Les origines fabuleuses de la famille Du Chastel Par André-Yves Bourgès* Si, à la demande expresse de Bernard Tanguy, mon maître et mon ami depuis près de vingt ans, j’ai accepté de prendre le risque de traiter des origines de la famille Du Chastel et de leur dimension fabuleuse, c’est que le sujet en question s’inscrit dans une problématique à la fois plus large et plus précise, qui touche de près à mon domaine de recherche, l’hagiographie bretonne médiévale, et à l’approche que j’ai privilégiée, qui est de mieux connaître les motivations de l’hagiographe : il s’agit notamment de vérifier que l’écrivain a pu, dans certaines occasions, travailler à la demande et au profit d’un commanditaire laïque, dans le cadre des rapports complexes entretenus au bas Moyen Âge entre la sphère religieuse et la sphère politique. Or il apparaît, et la chose était déjà évidente pour dom Lobineau 1, que les Du Chastel, ont pu susciter, vers le milieu du XV e siècle, dans un but de glorification de leur lignée, la composition d’une vita , en l’occurrence celle de saint Tanguy, texte aujourd’hui perdu, dont l’essentiel est rapporté dans l’ouvrage d’Albert Le Grand 2 ; mais cette démarche de « mythification » des origines familiales ne débouche pas sur la seule légende de saint Tanguy et dépasse même la simple dimension hagiographique : l’histoire de sainte Azénor et les différentes traditions relatives à la dynastie royale de Brest ont elles aussi à l’évidence occupé une place importante dans l’imaginaire généalogique des Du Chastel ; de plus, ces derniers ont longtemps partagé avec plusieurs autres familles * CIRDoMoC (Centre international de recherche et de documentation sur le monachisme celtique), Landévennec. -

L'adjuration À ''Saint Yves De Vérité''
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL-Rennes 1 L'adjuration `a"Saint Yves de V´erit´e" Thierry Hamon To cite this version: Thierry Hamon. L'adjuration `a"Saint Yves de V´erit´e": persistance tardive d'une ordalie populaire bretonne. M´emoiresde la Soci´et´ed'Histoire et d'Arch´eologiede Bretagne, Soci´et´e d'histoire et d'arch´eologiede Bretagne, 2008, 86, pp.41 - 88. <halshs-00853408> HAL Id: halshs-00853408 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00853408 Submitted on 16 Feb 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License Hamon Thierry, « L’adjuration à saint Yves de Vérité », Mémoires de la Société et d’Archéologie de Bretagne, Rennes, 2008, Tome 86, p. 41 – 88. « L'adjuration à saint Yves de Vérité », persistance tardive d’une ordalie populaire bretonne. A la mémoire de Mme Françoise Bodeveur, qui, la première, me révéla les mystérieuses pratiques entourant « saint Yves de Vérité ». « Te eo Zantik ar Wirione. Me a westl dit hemañ. -

Literaturdienst Frankreich
LITERATURDIENST FRANKREICH Reihe B Sozialwissenschaftliche Frankreichliteratur Neuzugänge zur Datenbasis "Internationale Beziehungen und Länderkunde" vom 1.10.2004- 30.9.2005 15. Jg. Oktober 2005 ISSN 1614-0494 Fachinformationsverbund "Internationale Beziehungen und Länderkunde" LITERATURDIENST FRANKREICH Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut, Asperger Str. 34, D-71634 Ludwigsburg, Tel.: 07141/9303-0; Fax: 07141/9303-50 E-Mail: [email protected] Bearbeitet von der Frankreich-Bibliothek1) am Deutsch-Französischen Institut, Asperger Str. 30, D-71634 Ludwigsburg, Tel.: 07141/9303-34; Fax: 07141/9303-55 E-Mail: [email protected] Redaktion: Joanna Ardizzone, Sebastian Nix Ludwigsburg, Oktober 2005 ISSN 1614-0494 Reihe A: Französische Außenbeziehungen / Deutsch-französische Beziehungen Erscheinungsweise: 1x jährlich im April Reihe B: Sozialwissenschaftliche Frankreichliteratur Erscheinungsweise: 1x jährlich im Oktober Abonnementsbedingungen: Reihe A: 11,50 Euro einschließlich Porto (9,- Euro für Institutsmitglieder) Reihe B: 12,50 Euro einschließlich Porto (10,- Euro für Institutsmitglieder) Bestellungen nimmt die Frankreich-Bibliothek am Deutsch-Französischen Institut entgegen. 1) Die Frankreich-Bibliothek wurde mit Unterstützung der Volkswagen-Stiftung und der Robert Bosch Stiftung aufgebaut. Der Aufbau der Datenbasis des Fachinformationsverbundes "Internationale Beziehungen und Länderkunde" erfolgt in Zusammenarbeit folgender Institutionen: - Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin (SWP) - Deutsches Übersee-Institut, Hamburg (DÜI) -

Combat Operations Conducted in the Finistere Region of Brittany, France
UNCLASSIFIED AD NUMBER ADB148370 NEW LIMITATION CHANGE TO Approved for public release, distribution unlimited FROM Distribution authorized to U.S. Gov't. agencies only; Proprietary Info.; 1 Jun 90. Other requests shall be referred to HQS, CAC and Ft. Leavenworth, ATTN: ATZL-GOP-SE, Ft. Leavenworth, KS 66027-5070. AUTHORITY USACGSC ltr, 2 Dec 2004 THIS PAGE IS UNCLASSIFIED ill ;.LL ~~ _ oK THE JEDBURGHS: 00 Combat Operations Conducted in the Finistere Region of 00 Brittany, France from July - September 1944 am I A thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College in partial fulfillment of the requirements for the degree MASTER OF MILITARY ART AND SCIENCE by Elliot J. Rosner, MAJ, USA B.A., United States Military Academy, 1976 DTIC ,&lELECTEf Fort Leavenworth, Kansas _ T1 9 1990 Distribution to U.S. Government agencies only; (Pro- prietary Information);(1 June 1990). Other requests for this document must be referred to: HQS, CAC and Ft. Leavanworth, ATTN: ATZL-GOP-SE, Ft. Leavenworth, Kansas 66027-5070 9004622 REORCUINTTIN D A'_-j Fr Approved REPOCU T M E D TA T ON P .(I 0MR No. 0704 0188 Public reporting burden for tirK(.1 r of mrrforraj on,%estomate to0 S rage %hu ocDrreso~e .r'udrsg tre time 101 ffClremq Instructionri. Wtchling eii,1ting data source%. p~ltsrrg arId moafitarnulngthre doaa needed. and coeoletng arnd revoti-wng threcoilftion of ,rrfrrralron Send comrretts adn litbre etmt r nete aso . i 1tO wil.i ~,t1 .0fmato.r.nct.d.ng Su.ggest,014orsi "touting thoslbu'der. -

Literaturdienst Frankreich
LITERATURDIENST FRANKREICH Reihe A Französische Außenbeziehungen Deutsch-französische Beziehungen Relations extérieures de la France Relations franco-allemandes Neuzugänge zur Datenbasis "Internationale Beziehungen und Länderkunde" vom 1.03.2007- 29.02.2008 18. Jg. April 2008 ISSN 1614-3752 Fachinformationsverbund "Internationale Beziehungen und Länderkunde" LITERATURDIENST FRANKREICH Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut, Asperger Str. 34, D-71634 Ludwigsburg, Tel.: 07141/9303-0; Fax: 07141/9303-50 E-Mail: [email protected] Bearbeitet von der Frankreich-Bibliothek 1) am Deutsch-Französischen Institut, Asperger Str. 30, D-71634 Ludwigsburg, Tel.: 07141/9303-34; Fax: 07141/9303-55 E-Mail: [email protected] Redaktion: Joanna Ardizzone, Sebastian Nix Ludwigsburg, April 2008 ISSN 1614-3752 Reihe A: Französische Außenbeziehungen / Deutsch-französische Beziehungen Erscheinungsweise: CD-ROM, 1x jährlich im April Reihe B: Sozialwissenschaftliche Frankreichliteratur Erscheinungsweise: CD-ROM, 1x jährlich im Oktober Abonnementsbedingungen : Reihe A: 11,50 Euro einschließlich Porto (9,- Euro für Institutsmitglieder) Reihe B: 12,50 Euro einschließlich Porto (10,- Euro für Institutsmitglieder) Bestellungen nimmt die Frankreich-Bibliothek am Deutsch-Französischen Institut entgegen. 1) Die Frankreich-Bibliothek wurde mit Unterstützung der Volkswagen-Stiftung und der Robert Bosch Stiftung aufgebaut. Der Aufbau der Datenbasis des Fachinformationsverbundes "Internationale Beziehungen und Länderkunde" erfolgt in Zusammenarbeit folgender Institutionen: -

September 2019
NEWSFLASH September 2019 Hello Swamp Foxes, Welcome to the September 2019 Newsletter. Hopefully we have all had some time at the benches, I look forward to seeing some of your work at the next meeting Wednesday 18th September 18.00 – 20.00 at Lexington Main Library. August's meeting saw 26 members attend, The President opened the meeting and went through the agenda and any other business(Recap on the Nats in Chattanooga and the Toy Soldier Fair) After which it was onto the show and tell of Members models and we had a nice diverse selection to enjoy as always, some really great builds and in progress work as always..... From the Front Office… Howdy, all. Here’s what’s going on… 1. A recap of the IPMS/USA Region 12 show. 2. Club Officer Nominations: We will be nominating club officers next month, and holding elections in November. Please review the Constitution and By-Laws, Sections 9 through 12, for the procedure: https://ipmsmidcarolina.files.wordpress.com/2018/07/cbl-rev-0.pdf In order to be an officer, you MUST be an IPMS/USA member—that’s an IPMS/USA requirement. It should also go without saying that an officer is required to be present for club events. While we’re on the subject of elections, if you see anything in the C&BL that needs to be revised, bring it up for discussion this month, and we’ll address it in November. 3. Show Theme: Last month, we chose “20/20 Vision” as our theme. Here is a quick list of eligible models by type: Aircraft: Photo reconnaissance, Patrol, Scout, and Observation types. -
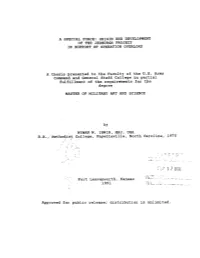
Origin and Development of the Jedburgh Project in Support of Operation Overlord
A SPECIAL FORCE: ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE JEDBURGH PROJECT IN SUPPORT OF OPERATION OVERLORD A thesis:presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College in partial fulfillment of the.requirements for the degree MASTER OF MILITARY ART AND SCIENCE .. .WYMAN W. IRWIN, MAJ, USA B.A., ~ethodistCollege, Fayetteville, North Carolina, 1975 .,. ./ , . , ... , . <. 7, : ,;; .: . , I. ! ' I,.< . .;. ., '4.. '... : . .... .. , . ! 7,. --. ... ..< 1 .a,..:.. .: : .. ,.. .... -:. - .- , ..:, . :, . Fort Leavenworth, Kansas ..,,. ..., ,. 1991 . Li L...L ..<:.“,. ..~.::...., .,- -.. ,. : Approved for public release; distribution is unlimited. A SPECIAL FORCE: ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE JEDBURGH PROJECT IN SUPPORT OF OPERATION OVERLORD A thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College in partial fulfillment of the requirements for the degree MASTER OF MILITARY ART AND SCIENCE by WYMAN W. IRWIN, MAJ, USA B.A., Methodist College, Fayetteville, North Carolina, 1975 Fort Leavenworth, Kansas 1991 Approved for public release: distribution is unlimited. MASTER OF MILITARY ART AND SCIENCE THESIS APPROVAL PAGE Name of candidate: MAJ Wyman W. Irwin, USA Title of thesis: A Special Force: Origin and Development of the Jedburgh Project in Support of Operation Overlord Approved by: , Thesis Committee Chairman Samuel/J.) Lgwi4, Ph.D. el Gordon F. Atcheson, M.A. I / ., Member C''Accepted this 7th day of June 1991 by: , Director, Graduate Degree Philip J: Brookes, Ph.D. Prog rams The opinions and conclusions expressed herein are those of the student author and do not necessarily represent the views of the U.S. Army Command and General Staff College or any other governmental agency. (References to this study should include the foregoing statement.) ii ABSTRACT A SPECIAL FORCE: ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE JEDBURGH PROJECT IN SUPPORT OF OPERATION OVERLORD by Major Wyman W. -

Des Recherches Bibliographiques Et Généalogiques De 1999
ARSSAT 2015 HISTOIRE DE LANMERIN PAR JEAN -YVES MARJOU En préambule : Des recherches bibliographiques et généalogiques de 1999 à 2003 pour Jacques Neubauer lors de la rédaction de son mémoire sur la chapelle Saint-Jérome de La Salle, une visite de cette chapelle et de l’église organisée le 25 avril 2010 par l’ARSSAT puis de nouvelles recherches avec François Bedel sur le contexte d’un manuscrit, collecté mais non transcrit par Jacques Neubauer, m’ont conduit à rédiger cette contribution à l’histoire de Lanmérin. La période analysée ici s’arrête à la Révolution sauf pour la chapelle de La Salle et l’église paroissiale. La commune de Lanmérin est située entre Lannion et Tréguier au nord de la rivière du Guindy ou sur sa rive gauche. Avant la Révolution, Lanmérin est une paroisse du Régaire de Tréguier 1, 2, fief de l’évêque, dit aussi Minihy de Tréguier dans la Réformation des fouages en 1426 3 et dans la Montre de Tréguier en 1481 4. Le nom Régaire provient du fait qu’entre le décès ou la mutation d’un évêque et l’acceptation du suivant, le duc ou le roi perçoit les dîmes, impose les tailles,… dans le fief de l’évêque (droit de régale 5). En 1437 la paroisse de Lanmérin (plus tard d’une surface de 415 ha 6) compte 15 feux ou foyers fiscaux 7. « Le Minihy du bienheureux Tugdual » s’étendait à plusieurs paroisses du Régaire de Tréguier dont Lanmérin. Dans le Minihy de saint Tugdual, la dîme ecclésiastique est à la douzième gerbe. -

Monographs Houses: Treguier
DePaul University Via Sapientiae Felix Contassot France 1962 Monographs Houses: Treguier Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/contassot Recommended Citation Monographs Houses: Treguier. https://via.library.depaul.edu/contassot/12 This Article is brought to you for free and open access by the France at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Felix Contassot by an authorized administrator of Via Sapientiae. For more information, please contact [email protected]. LES LAZARISTES DANS LE DIOCÈSE DE TRÉGUIER AVANT LE RÉVOLUTION 1648 – 1791 ÉTUDE DOCUMENTAIRE Félix CONTASSOT CM Paris — 1962 TABLE DES MATIÈRES ++++++++++++++++++++ Table des matières 1 Note liminaire 3 PREMIÈRE PARTIE : LES LAZARISTES À TRÉGUIER AVANT LA FONDATION DU SÉMINAIRE Interventions de Mgr des Landes et de Mgr Grangier 5 Première installation : • M. Jacques Tholard (1648-1653) 6 • M. Denis Pennier (1653-1654) 11 DEUXIÈME PARTIE : LES LAZARISTES AU SÉMINAIRE DE TRÉGUlER I. - FONDATION ET DOTATION DU SÉMINAIRE • Bref aperçu d'après l'abbé Dégert 14 • Contrat entre de Rumelin et N. Vincent (16-03-1654) 15 • Accord de Mgr Grangier (23-5-1654 21 • Divers dons de Mgr Grangier (28-06-1654) 23 • Lettres patentes de septembre 1654 26 II. - LE PERSONNEL DU SÉMINAIRE Louis Dupont (1654-1661) • Construction du séminaire 30 • Principaux faits et correspondance de M. Vincent 31 • Fondation de Pierre Loz (14-03-1657) 36 • Décret d'union de trois chapellenies (22-05-1660) 48 • Prise de possession des trois chapellenies 51 M. Jean Le Blanc (1661-1664) 53 • Un miracle du à M. Vincent 54 M. Louis Bréant (1664-1670) 55 • Lettres patentes de juin 1665 56 • Union de la chapelle de Pontrousault (05-12-1667) 57 • Fondation du chan.