Pratiquer Une Mobilite Alternative À Marseille
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LETTRE D'information N° 18 – Mars 2018 FORUM CULTURE
LETTRE D’INFORMATION n° 18 – mars 2018 avril-mai-juin 2018 Le groupe Vivre Ensemble Plusieurs établissements culturels marseillais ont décidé de s'associer pour mobiliser des visiteurs peu familiers des institutions culturelles. La lettre d’information Vivre Ensemble Cette lettre, trimestrielle, est destinée aux opérateurs-relais du champ social et a pour objet de mettre en avant les programmations et actions culturelles des structures membres du groupe « Vivre ensemble » pour la période d’avril à juin 2018. Les acteurs du réseau « Vivre Ensemble » à votre disposition Nous nous déplaçons volontiers dans vos structures afin de vous présenter nos activités ou de préparer au mieux vos sorties culturelles ! N’hésitez pas à contacter la personne référente (coordonnées dans la colonne contact à gauche de chaque page structure de ce document) pour toute demande de précision, d’intervention ou proposition de collaboration. A la une ce trimestre : Le Mucem Contact Manuela Joguet, Chargée des À vos agendas ! publics du champ social et du INVITATION FORUM CULTURE-NATURE / SOCIAL : 17 mai handicap Tél. : 04 84 35 13 46 Email : [email protected] Réservation Tél. : 04 84 35 13 13 Email : [email protected] Accès Ensemble en Provence (dispositif du Département des Bouches-du-Rhône), le Esplanade du J4 7 promenade Robert Laffont réseau Vivre Ensemble Marseille et l'association Cultures du cœur en partenariat 13002 Marseille avec la ville de Marseille vous invitent au Métro : station Vieux Port ou Joliette Tramway : T2 : arrêt FORUM CULTURE-NATURE / SOCIAL République/Dames ou Joliette Bus : lignes 82, 82s, 60et 49 : forum semestriel d’information et d’échanges arrêt Littoral Major ou Jeudi 17 mai 2018 de 9h30 à 16h MuCEM/Fort Saint-Jean Ligne 49 : arrêt Eglise Saint- Laurent Au MuCEM – Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Ligne de nuit 582 Promenade Robert Laffont – 13002 Marseille Centre de conservation et de ressources du Mucem (CCR) 1 rue Clovis Hugues Au programme : 13003 Marseille à partir de 9h00 Émargement et accueil café. -

World Cup France 98: Metaphors
The final definitive version of this article has been published as: 'World Cup France 98: Metaphors, meanings, and values', International Review for the Sociology of Sport , 35 (3) By SAGE publications on SAGE Journals online http://online.sagepub.com World Cup France ‘98: Metaphors, Meanings and Values Hugh Dauncey and Geoff Hare (University of Newcastle upon Tyne) The 1998 World Cup Finals focused the attention of the world on France. The cumulative television audience for the 64 matches was nearly 40 billion - the biggest ever audience for a single event. French political and economic decision makers were very aware, as will be seen, that for a month the eyes of the world were on France. On the night of July 12th, whether in Paris and other cities or in smaller communities all over France, there was an outpouring of joy and sentiment that was unprecedented - at least, most people agreed, since the Liberation of 1944. Huge numbers of people watched the final, whether at home on TV or in bars or in front of one of the giant screens erected in many large towns, and then poured onto the streets in spontaneous and good-humoured celebration. In Paris, hundreds of thousands gathered again on the Champs Elysées the next day to see the Cup paraded in an open-topped bus. For all, the victory was an unforgettable experience. An element that was commented on by many was the appropriation by the crowds of the red, white and blue national colours: manufacturers of the French national flag had never known such demand since the death of General de Gaulle. -

6Th Form Pages
08 Biass Fabiani 28/01/2011 10:15 Page 83 Nottingham French Studies, Vol. 50 No. 1, Spring 2011 83 MARSEILLE, A CITY BEYOND DISTINCTION? SOPHIE BIASS AND JEAN-LOUIS FABIANI In November 2005, when the riots that had burst out in the French ‘banlieues’, ‘quartiers’ or ‘cités’ ended, it was clear that the city of Marseille had largely remained out of the turmoil. How could Marseille, usually considered as an outpost of urban unrest, the undisputed capital of social protest and viewed as the main gate for immigrants, be immune from the contagion of violence that led the young people to set a competition among the banlieues in order to burn the greatest number of cars and fight with the police? The explanation was immediately available: it had to do with ‘l’exception marseillaise en France’ and it reactivated a very old narrative about the special place of the city within the French Nation: the second town in France is usually described as standing on the fringe of the national space, in a sort of social and cultural periphery. As opposed to Lyon, once defined as the ‘capital of the provinces’, Marseille has been depicted over and over as a foreign city within the Nation. In October 2006, a bus was burnt in a quiet area of Marseille and a young student from Senegal was very severely injured. At once, the ‘exception marseillaise’ came back to the forefront. Michel Samson, writing for Le Monde , reported on the local unanimity about the Marseillais peculiarities. ‘ Un éclair dans un ciel bleu’, a flash of lightning in a perfect blue sky, the head of the local police Bernard Squarcini, a man close to President Sarkozy, said. -

Here Weren’T Necessarily Any Rules to Stop Independence
The football Pink The Zinedine Zidane Issue 2 I I3 CONTENTS 4 La Castellane: The upbringing that fueled Zidane’s quest for greatness 10 Enzo Francescoli: Zidane’s idol 14 The foreword to a bestselling career: Zidane’s career in French football 20 Post-Platini decline: France, Euro ‘96 and Zidane’s new generation 26 Zinedine Zidane at Juventus: Becoming the King of Italy 34 Zinedine Zidane: “More entertaining than effective” 38 2003: When Zidane and Ronaldo stunned Old Trafford and Zizou’s sole La Liga title win 44 So near and yet so far: “Why do you want to sign Zidane when we have Tim Sherwood?” 48 Zidane’s swansong: The 2006 World Cup 54 Anger management: Balancing the talent with the tantrums The Zinedine Zidane Effect: Turning the Real Madrid embarrassed by Barcelona into 60 European champions I 66 Zinedine Zidane: The third lightning bolt 72 Understanding Zidanology: An inspiration to a generation 4 I I5 La Castellane: The upbringing that fueled Zidane’s quest for greatness 6 7 Today, Zinedine Zidane is footballing royalty Castellane is a concrete maze which may Zidane building’ during and after his time taught it to himself. It is typical of the street but his humble beginnings don’t paint a not necessarily make you fall in love at first living and developing his legendary skills in footballer to be a very good ball-carrier. It picture bearing any semblance of nobility. sight. this community. While that building has now is generally very much a ‘fend for yourself’ I La Castellane is just over 10km north of the been demolished, Zidane’s legacy lives on environment to develop your skills. -

Recueil Des Actes Administratifs
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE Date de Publication : 29/04/2015 N° : 2015/05 1 SOMMAIRE Bureau de la Communauté Commission "Fonctionnement et maîtrise des coûts" Page 4/18 Commission "Propreté Environnement Développement durable" Page 18/28 Commission "Voirie et Signalisation" Page 28/38 Commission "Développement économique et emploi" Page 39/51 Conseil de Communauté Commission "Fonctionnement et maîtrise des coûts" Page 56/85 Commission "Aménagement de l’espace communautaire" Page 85/92 Commission "Propreté Environnement Développement durable" Page 92/111 Commission "Développer les transports métropolitains" Page 111/116 Commission "Voirie et Signalisation" Page 116/125 Commission "Développement économique et emploi" Page 125/133 Commission "Habitat et Politique de la Ville" Page 133/155 Commission "Equipements d’intérêts communautaires, Patrimoine, Foncier, Protection et Sécurité des espaces communautaires Page 155/161 Innovation prospective et enseignement supérieur Page 161/168 2 LES DELIBERATIONS DU BUREAU DU 10 AVRIL 2015 3 des adaptations constantes pour répondre aux obligations de diffusion de ces données. COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE Le CRIGE-PACA est une association de la loi 1901 qui assure des missions de service public en ce qui Bureau de la Communauté concerne les données géographiques. Ses statuts, association à directoire avec conseil de surveillance, 10 AVRIL 2015 rapprochent son fonctionnement de celui d'une agence publique. Elle était "gouvernée" jusqu’à présent par des membres fondateurs (État et Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Région), et associés (Départements). Procès-verbal de la Séance a été affiché aux portes Comme MPM, les autres EPCI de la région sont du Siège de la Communauté Urbaine Marseille bénéficiaires de cette structure. -

Marseille, Alors MARSEILLE 2013 C a P I T a L E Européenne De La C U L T U R E E T E N P R É P a R a T I O N D U Projet De Métropole Aix-Marseille- Provence
RAPPORT DE VOYAGE DU Voyage organisé dans le cadre du master Stratégies MASTER STU t e r r i t o r i a l e s e t U r b a i n e s d e Sciences Po. en octobre 2013 à Marseille, alors MARSEILLE 2013 c a p i t a l e Européenne de la c u l t u r e e t e n p r é p a r a t i o n d u projet de métropole Aix-Marseille- Provence. 1 Préface Par Brigitte Fouilland, Responsable des masters d’Affaires Urbaines à Sciences Po de sa personnalité ; il montre également certaines logiques La nouvelle promotion du Master Stratégies à l’œuvre aussi dans d’autres villes françaises et territoriales et urbaines de Sciences Po a effectué son européennes. Même les « marseillologues » les plus affutés voyage d’études à Marseille en octobre 2013. savent que la comparaison est utile pour comprendre les Pourquoi le choix de cette ville ? Bien sûr son titre de fonctionnements et perspectives. Capitale culturelle 2013 permettait de poser avec ses Les étudiants sont revenus munis de nombreuses initiateurs, la question de la culture comme levier éventuel données et réflexions sur le développement urbain et de développement, si souvent interrogée et controversée. territorial. Nous sommes très reconnaissants envers tous La visite du MuCEM, de la Belle de Mai, de l’exposition ceux qui nous ont aidés dans la préparation de ce voyage « Le Corbusier revient à Marseille » au J1, la découverte et nous ont reçus avec disponibilité. Qu’ils soient remerciés du GR 23 constituaient autant de visites intéressantes et pour leur accueil, leurs présentations et leurs analyses. -

LA FABRIQUE Eduquer Dans La Rue Groupe Addap13
Bilan 2019 LA FABRIQUE Eduquer dans la rue Groupe addap13 Groupe association départementale pour le développement des actions de prévention 13 SOMMAIRE Cartographie des implantations .......................................................................p.3 Des éléments marquants de l’année 2019 .......................................................p.5 ELÉMENTS CHIFFRÉS DE L’ACTIVITÉ 2019 ...............................................p.8 DÉCLINAISONS DES PROJETS PAR SERVICES Service Marseille centre ...................................................................................p.14 Service Marseille sud .......................................................................................p.24 Service Marseille 13e/14e .................................................................................p.32 Service Marseille 15e/16e ..................................................................................p.41 Service pays d’Aix ............................................................................................p.50 Service pays d’Arles .........................................................................................p.60 Service Etang de Berre ....................................................................................p.67 Service Prévention sport collège ......................................................................p.72 Service Insertion par le logement .....................................................................p.78 Cellule d’écoute et d’accompagnement des familles ......................................p.83 -

État Des Subventions Versées - Exercice 2016
ÉTAT DES SUBVENTIONS VERSÉES - EXERCICE 2016 Organisme Adresse Montant Avantage en nature 321 1 RUE CONSOLAT 13001 MARSEILLE 1 000,00 100 POUR CENT GLISSE 9 RUE JOBIN 13003 MARSEILLE 2 500,00 118 BIS ASTRONEF 118 CHEMIN DE MIMET 13015 MARSEILLE 10 000,00 13 A TIPIK 18 RUE TRANSVAAL 13004 MARSEILLE 6 500,00 13 HABITAT 80 RUE ALBE 13234 MARSEILLE 20 362,94 23 AVENUE E VAILLANT 65 AVENUE ALEXANDRE 13014 MARSEILLE 74 862,05 ANSALDI A PETITS SONS 119 BOULEVARD LONGCHAMP 13001 MARSEILLE 1 000,00 A SUIVRE 13 RUE DE LA LOUBIERE 13006 MARSEILLE 3 000,00 AAA Z APPEL AR ZENITH 50 BD DE LA CORDERIE 13007 MARSEILLE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ABDELKADER YAMINA 19 QUAI DE LA JOLIETTE 13002 MARSEILLE 840,42 ABERGEL YVONNE 3 BD DU POLYGONE 13008 MARSEILLE 6 080,80 ABLE 1 ROUTE DE LA GAVOTTE 13015 MARSEILLE 3 000,00 ACADEMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE 40 RUE ADOLPHE TIERS 13001 MARSEILLE 12 311,40 ACCES AU DROIT DES ENFANTS ET DES JEUNES 142 LA CANEBIERE 13001 MARSEILLE 40 000,00 ACCES CITOYEN A LA CULTURE A L EDUCATION ET AU SPORT 12 TRAVERSE LA 13014 MARSEILLE 50 000,00 PASSERELLE ACCES CULTURE 16 RUE BEAUTREILLIS 75004 PARIS 6 000,00 ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT INSERTION SERVICE ALISE 7 RUE FRANCIS DAVSO 13001 MARSEILLE 3 000,00 ACCORDS EN SCENE 51 RUE SAINTE 13001 MARSEILLE 13 000,00 ACCUEIL DE JOUR 5 A PLACE MARCEAU 13002 MARSEILLE 60 000,00 ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES MARSEILLE CITE DES ASSOCIATIONS 13001 MARSEILLE 1 000,00 ACCUEIL ET RENCONTRES 68 CH DES BAUMILLONS 13015 MARSEILLE 7 000,00 ACELEM 12 RUE EDOUARD VAILLANT 13003 MARSEILLE -
DP Ronaldo Zidane.Pdf
Sommaire 4ème édition du « Match contre la pauvreté »......................p.1 Le programme de l’ONU et l’utilisation des fonds.................p.2 ATTITUDE Des ambassadeurs de marque ............................................p.3 Deux sélections de joueurs internationaux...........................p.4 Les partenaires...................................................................p.5-11 Infos billetterie...................................................................p.12 Infos pratiques...................................................................p.13 LundiLundi 1919 MarsMars 20072007 20h3020h30 stadestade VélodromeVélodrome 4ème édition du « Match contre la pauvreté » Après Bâle, Madrid et Dusseldorf, la 4ème édition du « Match contre la pauvreté » se déroule cette année à Marseille le lundi 19 Mars 2007 à 20h30 au stade Vélodrome. Ce match de gala, placé sous le signe de la générosité, oppose deux équipes composées de joueurs prestigieux avec pour capitaines les deux ambassadeurs itinérants du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) : Ronaldo et Zidane. ATTITUDE Organisé au profit du PNUD, ce match caritatif vise à sensibiliser le public et récolter des fonds afin de financer des projets de lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement. Cette 4ème édition est également l’occasion d’accueillir un tout nouveau ambassadeur du PNUD : l’ancien olympien Didier Drogba. Rappel des précédentes éditions • 2003 : Bâle (Suisse) - Parc Saint-Jacques de Bâle - 30 000 spectateurs • 2004 : Madrid (Espagne) - stade Santiago Bernabeu de Madrid - 65 000 spectateurs • 2005 : Dusseldorf (Allemagne) - LTU Arena à Düsseldorf - 49 000 spectateurs LundiLundi 1919 MarsMars 20072007 20h3020h30 stadestade VélodromeVélodrome 1 Le programme de l’ONU et l’utilisation des fonds Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) est le réseau mondial de développement mis en place par le système des Nations Unies. -

Rapport De La Commission D'enquête Jean-Claude REBOULIN Président Catherine PUECH Jean-Marc IENNY
E20000019/1 PREFECTURE des BOUCHES DU RHONE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE Extension Nord et Sud du réseau de tramway et création d'un site de maintenance et remisage Première Phase Enquête publique unique DDAU et DUP du 7 septembre 2020 au 9 octobre 2020 inclus Rapport de la commission d'enquête Jean-Claude REBOULIN Président Catherine PUECH Jean-Marc IENNY Novembre 2020 Rapport de la commission d'enquête sur le projet extension du TRAM Marseille 7 novembre 1/ 75 E20000019/1 SOMMAIRE 1/ OBJET DE L'ENQUETE 11 – PRESENTATION PROJET p5 12 – CONTEXTE REGLEMENTAIRE p8 13 – CONCERTATION PREALABLE p11 131 - Cadre réglementaire 132 - Les modalités générales 133 – Bilan de la concertation 133 - Avis du garant sur le déroulé de la concertation 14 – MISE EN PLACE DE L'ENQUETE p15 121 - Désignation de la commission d'enquête 122 – Arrêté fixant les modalités d'enquête 123 - Actions préparatoires 2/ COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE 21 – LISTE DES PIECES DU DOSSIER p19 211 - Dossier d’Autorisation Environnementale 212 - Dossier de Déclaration d'Utilité Publique du projet (DUP) 22 – PRESENTATION DU PROJET p21 221 – Situation, phasage 222 – Les aménagements 223 – Contexte de l'opération 224 – Impacts et mesures sur l'environnement 225 – Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 23 – AVIS DES SERVICES ET PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES p31 3/ DEROULEMENT DE L'ENQUETE 31 – MODALITES D'INFORMATION DU PUBLIC p35 311 - Mesures de publicité 312 - Affichage Rapport de la commission d'enquête sur le projet extension du TRAM Marseille 7 novembre 2/ 75 E20000019/1 -
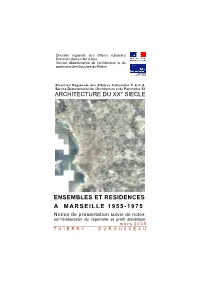
Architecture Du Xx° Siecle Ensembles Et Residences A
Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur Service départemental de l’architecture et du patrimoine des Bouches-du-Rhône Direction Régionale des Affaires Culturelles P.A.C.A Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 13 ARCHITECTURE DU XX° SIECLE ENSEMBLES ET RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975 Notice de présentation suivie de notes sur l’élaboration du répertoire et profil statistique m a r s 2 0 0 5 T H I E R R Y D U R O U S S E A U Direction Régionale des Affaires Culturelles P.A.C.A Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 13 ARCHITECTURE DU XX° SIECLE ENSEMBLES ET RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975 Notice de présentation suivie de notes sur l’élaboration du répertoire et profil statistique m a r s 2 0 0 5 T H I E R R Y D U R O U S S E A U DRAC PACA-SDAP13 ENSEMBLES & RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975 ENSEMBLES & RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975 est une étude réalisée durant l’année 2004, par Thierry Durousseau sous la maîtrise d’ouvrage de la DRAC- PACA, avec l’assistance technique du SDAP 13, y ont participé Agnes Souville et Nicolas Mémain. Remerciements particuliers à Ville de Marseille : Georges Lacroix Atelier du Patrimoine : Daniel Drocourt. Musée d’histoire : Myriam Morel. DGUHC : Laurent Méric. AGAM : Helene Balu, Patricia Antalovski. Ordre des architectes PACA : Micheline Sanchez Ministère de la culture : DAPA : Bernard Toullier. Ecole Nationale des Beaux Arts : Annie Jacques. INA : Marie Christine Helias. Ministère de l’Equipement Comité d’Histoire du Ministère: Françoise Porcher. -
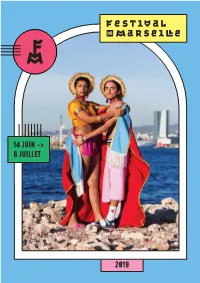
14 JUIN -> 6 JUILLET 2019
14 JUIN -> 6 JUILLET 2019 1 2 Toujours plus de créations, des spectacles Ainsi, avec Cion : le requiem du Boléro de totalement exclusifs, un lien sans cesse Ravel, Gregory Maqoma, figure de proue renforcé avec Marseille, telles sont les de la danse sud-africaine, est de retour au promesses de la 24e édition du Festival de Festival avec une pièce chorale qui réussit Marseille. la symbiose de la voix et du corps. Le [mac] vibrera sous l’électro sensorielle du duo de Du 14 juin au 6 juillet 2019, la danse Yes Sœur! aux platines ! investira à nouveau la ville, de la Friche la Belle de Mai au Théâtre de La Criée, du Il y aura aussi du théâtre, du cinéma, de la Théâtre de La Sucrière en passant par le musique. Et on reviendra à la danse, essence Parc Borély ou encore la Canebière, de même de cet événement, avec notamment La Gare Franche au Mucem et au Théâtre Faustin Linyekula, Dorothée Munyaneza, Joliette, du Théâtre Silvain à l’Alhambra via kabinet k, Selma et Sofiane Ouissi et bien le Klap, la Vieille Charité, le [mac]… De quoi d’autres artistes… sillonner Marseille sur un pas de danse ! Bravo à Jan Goossens et à son équipe pour Cette année, le Festival retourne à ses avoir conservé cette approche humaniste anciennes amours en retrouvant pour et universaliste si chère aux racines du deux soirées la cour de la Vieille Charité Festival. Ils ont su respecter Marseille, ville avec un spectacle de musique et de danse cosmopolite ouverte sur la Méditerranée Luminescence donné par le trompettiste et l’Europe.