Observatoire De L'aviation Civile 2009
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
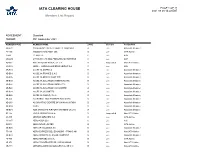
IATA CLEARING HOUSE PAGE 1 of 21 2021-09-08 14:22 EST Member List Report
IATA CLEARING HOUSE PAGE 1 OF 21 2021-09-08 14:22 EST Member List Report AGREEMENT : Standard PERIOD: P01 September 2021 MEMBER CODE MEMBER NAME ZONE STATUS CATEGORY XB-B72 "INTERAVIA" LIMITED LIABILITY COMPANY B Live Associate Member FV-195 "ROSSIYA AIRLINES" JSC D Live IATA Airline 2I-681 21 AIR LLC C Live ACH XD-A39 617436 BC LTD DBA FREIGHTLINK EXPRESS C Live ACH 4O-837 ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V. B Suspended Non-IATA Airline M3-549 ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. C Live ACH XB-B11 ACCELYA AMERICA B Live Associate Member XB-B81 ACCELYA FRANCE S.A.S D Live Associate Member XB-B05 ACCELYA MIDDLE EAST FZE B Live Associate Member XB-B40 ACCELYA SOLUTIONS AMERICAS INC B Live Associate Member XB-B52 ACCELYA SOLUTIONS INDIA LTD. D Live Associate Member XB-B28 ACCELYA SOLUTIONS UK LIMITED A Live Associate Member XB-B70 ACCELYA UK LIMITED A Live Associate Member XB-B86 ACCELYA WORLD, S.L.U D Live Associate Member 9B-450 ACCESRAIL AND PARTNER RAILWAYS D Live Associate Member XB-280 ACCOUNTING CENTRE OF CHINA AVIATION B Live Associate Member XB-M30 ACNA D Live Associate Member XB-B31 ADB SAFEGATE AIRPORT SYSTEMS UK LTD. A Live Associate Member JP-165 ADRIA AIRWAYS D.O.O. D Suspended Non-IATA Airline A3-390 AEGEAN AIRLINES S.A. D Live IATA Airline KH-687 AEKO KULA LLC C Live ACH EI-053 AER LINGUS LIMITED B Live IATA Airline XB-B74 AERCAP HOLDINGS NV B Live Associate Member 7T-144 AERO EXPRESS DEL ECUADOR - TRANS AM B Live Non-IATA Airline XB-B13 AERO INDUSTRIAL SALES COMPANY B Live Associate Member P5-845 AERO REPUBLICA S.A. -

Gateway 2020 Strategy and H1 2015 Results
TITLE SIZES Gateway 2020 strategy COVER TITLE and H1 2015 results Arial Headings Bold 28 point / Dark Blue / Accent 1 SUBTITLE Investors Day presentation Arial Headings Bold 18point / 80% Grey September 3, 2015 DATE Arial Headings Regular © Copyright gategroup 2015 14point / 80% Grey gategroup Investor Day Table of Contents 1 Gateway 2020 strategy 2 1H 2015 Financial review 3 Conclusions 2 PHOTO(1) SLIDE INSERT PICTURE gategroup Investor Day 3 1 Schedule Right-click on existing picture and choose Fill/ 12.30 - 14.00 Lunch gategroup team Picture or Texture Fill. 14.00 - 16.00 Presentation and Q&A Xavier Rossinyol / 2 Christoph Schmitz Choose Insert from File, find the image and click 16.00 - 17.00 Apèro & Kitchen Tour gategroup team ´Insert´ Insert 3 If needed, select picture and ‘Send to Back’ gategroup H1 Results and Strategy Review – September 2015 gategroup Investor Day Table of contents 1 Gateway 2020 strategy • gategroup Today • Key Industry Trends • 2020 Gateway Strategy 2 1H2015 Financial Review 3 Conclusions PHOTO(1) SLIDE INSERT PICTURE What is gategroup? 5 1 gategroup is the leading global, independent airline caterer and on board passenger experience Right-click on existing picture and choose Fill/ gategroup is the leading… Picture or Texture Fill. …global … specialized in: …independent ▶ catering and hospitality ▶ provisioning and logistics …airline caterer ▶ on board products and services …and on board passenger experience 2 Market Share Customer Segmentation Product and Segmentation Choose Insert from File, find the image and click ´Insert´ gategroup, 21% Retail on Non-Aviation, Board, 8% Other, 2% 2% Equipment, Insert 9% Other, 37% 3 If needed, select picture Flying Food, 1% and ‘Send to Back’ SATS, 2% LSG, 20% Catering and Do & Co, 2% Handling, Dnata, 6% Hospitality, Newrest, 5% Servair, 6% 26% Aviation, 98% 56% Source: gategroup gategroup H1 Results and Strategy Review – September 2015 PHOTO(1) SLIDE INSERT PICTURE What is gategroup? 6 1 Key Figures Right-click on existing picture and choose Fill/ Picture or Texture Fill. -
Social Rights and Ethics Charter Editorial by Alexandre De Juniac
Social Rights and Ethics Charter Editorial By Alexandre De Juniac The epitome of the values and rights underpinning the AIR FRANCE KLM Group’s identity and cohesion, the Social Rights and Ethics Charter applies to all employees of the two companies and their subsidiaries. An ambitious action plan spanning the Group as a whole, this Charter tackles various issues such as labour relations, ethics requirements and the respect for the environment and sustainable development principles. It highlights our vision of an open, united world, based on both economic responsibility and social and environmental progress. Negotiated with and signed by the staff representatives within the AIR FRANCE KLM European Works Council, this Charter is a prime example of how successful our contractual policy proves to be when it comes to achieving fair, balanced development. Every employee is now encouraged to become acquainted with this Charter and proactively endorse it. 1 Preamble The AIR FRANCE KLM Group and the AIR FRANCE KLM European Works Council (AFKL EWC) have jointly set out in this document the values and fundamental rights which underpin the identity of these two companies, and guide their social and ethics policy. These values and rights are the foundation for social, economic and cultural cohesion within each company and within the Group, which is essential to be able to share in the benefi ts of growth. The purpose of this Charter is to foster a climate of enhanced mutual trust and respect in a work environment in which no form of discrimination or harassment may be tolerated. The development of a work environment favorable to the good economic and commercial performance of the Group and each of its companies, to progress in labour relations and personnel advancement requires continuous and extensive cooperation on the part of all. -

JULY–SEPTEMBER 2009 Meet the 2009 'Kapustin' Scholars
JULY–SEPTEMBER 2009 Meet The 2009 ‘Kapustin’ Scholars (Page 3) Why Do Emergency Evacuation Slides Fail? (Page 8) Accident Investigation—A Complete Service? (Page 13) Cockpit ‘Conversations’: Pilot Error or Communications Failure (Page 18) Council Meets in Spring Session (Page 22) CONTENTS Volume 42, Number 3 FEATURES Publisher Frank Del Gandio Editorial Advisor Richard B. Stone 3 Meet The 2009 ‘Kapustin’ Scholars Editor Esperison Martinez Incorporated into “President’s View” are the three 1000-word essays selected Design Editor William A. Ford as the best of the 12 submitted in the competition to win the 2009 ISASI Rudolph Associate Editor Susan Fager Kapustin Memorial Scholarship award, which memorializes all ISASI members Annual Report Editor Ron Schleede who have “flown west.” ISASI Forum (ISSN 1088-8128) is pub- lished quarterly by International Society of Air Safety Investigators. Opinions ex- 8 Why Do Emergency Evacuation Slides Fail? pressed by authors do not necessarily rep- By Gerard van Es, Senior Consultant, NLR-Air Transport Safety Institute, resent official ISASI position or policy. Amsterdam, the Netherlands—The author presents an analysis of historical Editorial Offices: Park Center, 107 East emergency evacuations in which slides were used. The factors that have hampered Holly Avenue, Suite 11, Sterling, VA 20164- the use of emergency evacuation slides are identified from these data and are 5405. Telephone (703) 430-9668. Fax (703) analyzed in-depth. 430-4970. E-mail address isasi@erols. com; for editor, [email protected]. Internet website: www.isasi.org. ISASI Forum is not responsible for unsolicited 13 Accident Investigation—A Complete Service? manuscripts, photographs, or other ma- By Phil Taylor, Senior Inspector of Air Accidents, UK AAIB—Using examples from terials. -
Planting 2.0 Time Friday Afternoon
Search for The Westfield News Westfield350.comTheThe Westfield WestfieldNews News Serving Westfield, Southwick, and surrounding Hilltowns “TIME IS THE ONLY WEATHER CRITIC WITHOUT TONIGHT AMBITION.” Partly Cloudy. JOHN STEINBECK Low of 55. www.thewestfieldnews.com VOL. 86 NO. 151 TUESDAY, JUNE 27, 2017 75 cents $1.00 SATURDAY, JULY 25, 2020 VOL. 89 NO. 178 High-speed New Westfield internet could be coming COVID to Southwick By HOPE E. TREMBLAY cases drop Editor By PETER CURRIER SOUTHWICK – The High- Staff Writer Speed Internet Subcommittee WESTFIELD- The rate of coronavirus spread in reported its findings July 21 to the Westfield continues to slow down after a couple of weeks Southwick Select Board. of slightly elevated growth. The group formed in 2019 to The city recorded just five new cases of COVID-19 in research the town’s options regard- the past week, bringing the total number of confirmed ing internet service after being cases to 482 as of Friday afternoon. This is the lowest approached by Whip City Fiber, weekly number of new cases in more than a month in part of Westfield Gas & Electric, Westfield. Health Director Joseph Rouse said that there are on bringing the service to a new eight active cases in the city. development on College Highway. Fifty-five Westfield residents have died due to COVID- Select Board Chairman Douglas 19 since the beginning of the pandemic. Moglin, who served on the sub- The Town of Southwick had not released its weekly committee, said right now the only report on the number of new COVID-19 cases as of press real choice is Comcast/Xfinity. -
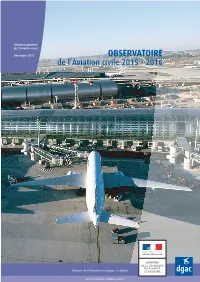
Observatoire
Direction générale de l’Aviation civile Décembre 2017 OBSERVATOIRE de l’Aviation civile 2015 - 2016 de l’Aviation civile 2015 - 2016 de l’Aviation OBSERVATOIRE OBSERVATOIRE Ministère de la Transition écologique et solidaire www.ecologique-solidaire.gouv.fr Observatoire de l’Aviation civile - Édition 2016 Observatoire de l’Aviation civile 2015 - 2016 1 Observatoire de l’Aviation civile - Édition 2016 Sommaire I. Environnement économique et réglementaire ................................................... 7 I.1 Cadre et réglementation de l’aviation civile .............................................................. 9 I.1.1 Cadre français et international ..................................................................................... 9 I.1.2 Réglementation nationale .......................................................................................... 15 I.1.3 Réglementation européenne ...................................................................................... 18 I.2 Environnement économique ................................................................................... 21 I.2.1 Environnement économique international .................................................................. 21 I.2.2 Economie française .................................................................................................... 23 I.3 Événements et faits marquants 2015 - 2016 .......................................................... 24 I.3.1 Événements marquants de l’année 2015 ................................................................. -

356 Partners Found. Check If Available in Your Market
367 partners found. Check if available in your market. Please always use Quick Check on www.hahnair.com/quickcheck prior to ticketing P4 Air Peace BG Biman Bangladesh Airl… T3 Eastern Airways 7C Jeju Air HR-169 HC Air Senegal NT Binter Canarias MS Egypt Air JQ Jetstar Airways A3 Aegean Airlines JU Air Serbia 0B Blue Air LY EL AL Israel Airlines 3K Jetstar Asia EI Aer Lingus HM Air Seychelles BV Blue Panorama Airlines EK Emirates GK Jetstar Japan AR Aerolineas Argentinas VT Air Tahiti OB Boliviana de Aviación E7 Equaflight BL Jetstar Pacific Airlines VW Aeromar TN Air Tahiti Nui TF Braathens Regional Av… ET Ethiopian Airlines 3J Jubba Airways AM Aeromexico NF Air Vanuatu 1X Branson AirExpress EY Etihad Airways HO Juneyao Airlines AW Africa World Airlines UM Air Zimbabwe SN Brussels Airlines 9F Eurostar RQ Kam Air 8U Afriqiyah Airways SB Aircalin FB Bulgaria Air BR EVA Air KQ Kenya Airways AH Air Algerie TL Airnorth VR Cabo Verde Airlines FN fastjet KE Korean Air 3S Air Antilles AS Alaska Airlines MO Calm Air FJ Fiji Airways KU Kuwait Airways KC Air Astana AZ Alitalia QC Camair-Co AY Finnair B0 La Compagnie UU Air Austral NH All Nippon Airways KR Cambodia Airways FZ flydubai LQ Lanmei Airlines BT Air Baltic Corporation Z8 Amaszonas K6 Cambodia Angkor Air XY flynas QV Lao Airlines KF Air Belgium Z7 Amaszonas Uruguay 9K Cape Air 5F FlyOne LA LATAM Airlines BP Air Botswana IZ Arkia Israel Airlines BW Caribbean Airlines FA FlySafair JJ LATAM Airlines Brasil 2J Air Burkina OZ Asiana Airlines KA Cathay Dragon GA Garuda Indonesia XL LATAM Airlines -

(EU) 2019/226 Оd 6
L 41/100 HR Službeni list Europske unije 12.2.2019. UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/226 оd 6. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 748/2009 o popisu operatora zrakoplova koji su 1. siječnja 2006. ili kasnije obavljali zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, kojim se određuje država članica nadležna za svakog operatora zrakoplova (Tekst značajan za EGP) EUROPSKA KOMISIJA, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 18.a stavak 3. točku (b), budući da: (1) Direktivom 2003/87/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), zrakoplovne aktivnosti uključuju se u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije. (2) Uredbom Komisije (EZ) br. 748/2009 (3) utvrđuje se popis operatora zrakoplova koji su 1. siječnja 2006. ili kasnije obavljali zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ. (3) Svrha je popisa smanjiti administrativno opterećenje operatora zrakoplova dostavom obavijesti o državi članici koja je nadležna za određenog operatora zrakoplova. (4) Uključivanje operatora zrakoplova u sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama ovisi o obavljanju zrakoplovne aktivnosti iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, a ne o uvrštavanju na popis operatora zrakoplova koji je Komisija sastavila na temelju članka 18.a stavka 3. te direktive. (5) Promjene popisa operatora zrakoplova temelje se na najnovijim informacijama koje je dostavio Eurocontrol. (6) Uredbu (EZ) br. -

OBSERVATOIRE Avril 2013 De L’Aviation Civile 2011 - 2012 Tome 1 - Analyses
Direction générale de l’Aviation civile OBSERVATOIRE Avril 2013 de l’Aviation civile 2011 - 2012 Tome 1 - Analyses Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Observatoire de l’Aviation civile 2011-2012 2 Observatoire de l’Aviation civile 2011-2012 Tome 1 Analyses 3 Observatoire de l’Aviation civile 2011-2012 Sommaire Sommaire ..........................................................................................................................................................4 Avant-propos ....................................................................................................................................................7 I. Environnement économique et réglementaire ...........................................................................................9 I.1 Cadre et réglementation de l’aviation civile............................................................................................11 I.1.1 Cadre ...............................................................................................................................................11 I.1.2 Réglementation nationale................................................................................................................17 I.1.3 Réglementation internationale.........................................................................................................22 I.2.Environnement économique...................................................................................................................25 I.2.1 Environnement -

Avianca Holdings S.A. (Translation of Registrant’S Name Into English)
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the month of February, 2019. Commission File Number 001-36142 Avianca Holdings S.A. (Translation of registrant’s name into English) Aquilino de la Guardia Calle No. 8, Panama City, Republic of Panama (+507) 205-600 (Address of principal executive offices) Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F. Form 20-F ☒ Form 40-F ☐ Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1): ☐ Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7): ☐ Bogotá D.C., February 22, 2019 MATERIAL INFORMATION Avianca Holdings S.A. informs that it has published on its website www.aviancaholdings.com its earnings release for the fourth quarter of 2018 and its consolidated financial statements as of December 31, 2018 and 2017 and for each of the years ended December 31, 2018 and 2017. Enclosures: Exhibit 99.1 – Consolidated financial statements as of December 31, 2018 and 2017 and for each of the years ended December 31, 2018 and 2017. For further information please contact: Avianca Investor Relations + 571-5877700 ext. 2474, 1349 [email protected] ABOUT AVIANCA HOLDINGS S.A. The terms “Avianca Holdings” or “the Company” refer to the consolidated entity. -

Global Volatility Steadies the Climb
WORLD AIRLINER CENSUS Global volatility steadies the climb Cirium Fleet Forecast’s latest outlook sees heady growth settling down to trend levels, with economic slowdown, rising oil prices and production rate challenges as factors Narrowbodies including A321neo will dominate deliveries over 2019-2038 Airbus DAN THISDELL & CHRIS SEYMOUR LONDON commercial jets and turboprops across most spiking above $100/barrel in mid-2014, the sectors has come down from a run of heady Brent Crude benchmark declined rapidly to a nybody who has been watching growth years, slowdown in this context should January 2016 low in the mid-$30s; the subse- the news for the past year cannot be read as a return to longer-term averages. In quent upturn peaked in the $80s a year ago. have missed some recurring head- other words, in commercial aviation, slow- Following a long dip during the second half Alines. In no particular order: US- down is still a long way from downturn. of 2018, oil has this year recovered to the China trade war, potential US-Iran hot war, And, Cirium observes, “a slowdown in high-$60s prevailing in July. US-Mexico trade tension, US-Europe trade growth rates should not be a surprise”. Eco- tension, interest rates rising, Chinese growth nomic indicators are showing “consistent de- RECESSION WORRIES stumbling, Europe facing populist backlash, cline” in all major regions, and the World What comes next is anybody’s guess, but it is longest economic recovery in history, US- Trade Organization’s global trade outlook is at worth noting that the sharp drop in prices that Canada commerce friction, bond and equity its weakest since 2010. -

→ Valorisation Économique Et Sociale Du Transport Aérien
Améliorer la compétitivité du secteur aérien français Cahier technique n°1 Î Valorisation économique et sociale du transport aérien Améliorer la compétitivité du secteur aérien français - Cahier 1 - Date : 21/06/05 Valorisation économique et sociale du transport aérien Quelle définition pour le transport aérien ? Selon la nomenclature d’activités françaises, le transport aérien regroupe les activités régulières (code NAF 62.1Z) et le transport aérien non régulier (code NAF 62.2Z). Le transport aérien régulier regroupe le transport de personnes, de marchandises et de courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés. L’ensemble des vols charters, même réguliers, est exclu de cette classe. Le transport aérien non régulier regroupe les transports aériens de personnes et de marchandises réalisés par les charters, les avions-taxis, les locations d’avions avec pilote, ou encore les excursions aériennes. Les autres activités aériennes telles que les baptêmes de l’air, le parachutisme, les promenades en montgolfière, etc. ne sont pas assimilées à du transport aérien mais à des services récréatifs et services liés au sport. Le transport aérien, un outil indispensable de nos sociétés d’échanges Le trafic aérien mondial est en constante augmentation depuis 10 ans, indépendamment des événements géopolitiques récents. En 2001, l’activité « transport de passagers » est estimée à 364 milliards de dollars, en augmentation de 77% par rapport à 1991. La croissance du transport aérien de fret est de 9% par an, soit en moyenne 3 points de plus que celle du trafic passagers. La demande de transport aérien est principalement induite par la croissance économique, qui s’appuie dans un contexte mondialisé sur un besoin important d’échange et de mobilité des biens et des personnes.