Driemaandelijks Tijdschrift Nr 49 / 1995
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schindler's Learning Guide
RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS "The universe exists on the merit of the righteous among the nations of the world, and they are privileged to see the Divine Presence." -- The Talmud THE GOOD SAMARITAN And who is my neighbor? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him. And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these three, thinking thou, was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, He that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise. --St. Luke 10: 30 “He [Schindler] was fortunate to have people in that short fierce era who summoned forth his deeper talents.” --Emilie Schindler Introduction There have been many attempts to tell the story of the Holocaust to the general public in a comprehensible, yet historically accurate manner. -

Jewish Behavior During the Holocaust
VICTIMS’ POLITICS: JEWISH BEHAVIOR DURING THE HOLOCAUST by Evgeny Finkel A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Political Science) at the UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON 2012 Date of final oral examination: 07/12/12 The dissertation is approved by the following members of the Final Oral Committee: Yoshiko M. Herrera, Associate Professor, Political Science Scott G. Gehlbach, Professor, Political Science Andrew Kydd, Associate Professor, Political Science Nadav G. Shelef, Assistant Professor, Political Science Scott Straus, Professor, International Studies © Copyright by Evgeny Finkel 2012 All Rights Reserved i ACKNOWLEDGMENTS This dissertation could not have been written without the encouragement, support and help of many people to whom I am grateful and feel intellectually, personally, and emotionally indebted. Throughout the whole period of my graduate studies Yoshiko Herrera has been the advisor most comparativists can only dream of. Her endless enthusiasm for this project, razor- sharp comments, constant encouragement to think broadly, theoretically, and not to fear uncharted grounds were exactly what I needed. Nadav Shelef has been extremely generous with his time, support, advice, and encouragement since my first day in graduate school. I always knew that a couple of hours after I sent him a chapter, there would be a detailed, careful, thoughtful, constructive, and critical (when needed) reaction to it waiting in my inbox. This awareness has made the process of writing a dissertation much less frustrating then it could have been. In the future, if I am able to do for my students even a half of what Nadav has done for me, I will consider myself an excellent teacher and mentor. -

Holocaust Awareness Week"
2017 HOUSE JOINT RESOLUTION 17-1027 BY REPRESENTATIVE(S) Michaelson Jenet and Sias, Arndt, Becker J., Becker K., Beckman, Benavidez, Bridges, Buck, Buckner, Carver, Catlin, Coleman, Covarrubias, Danielson, Esgar, Everett, Exum, Foote, Garnett, Ginal, Gray, Hamner, Hansen, Herod, Hooton, Humphrey, Jackson, Kennedy, Kraft-Tharp, Landgraf, Lawrence, Lebsock, Lee, Leonard, Liston, Lontine, Lundeen, McKean, McLachlan, Melton, Mitsch Bush, Navarro, Neville P., Nordberg, Pabon, Pettersen, Rankin, Ransom, Rosenthal, Saine, Salazar, Singer, Thurlow, Valdez, Van Winkle, Weissman, Willett, Williams D., Wilson, Winter, Wist, Young, Duran; also SENATOR(S) Crowder and Fenberg, Aguilar, Baumgardner, Cooke, Coram, Court, Donovan, Fields, Garcia, Gardner, Guzman, Hill, Holbert, Jahn, Jones, Kagan, Kefalas, Kerr, Lambert, Lundberg, Marble, Martinez Humenik, Merrifield, Moreno, Neville T., Priola, Scott, Smallwood, Sonnenberg, Tate, Todd, Williams A., Zenzinger, Grantham. CONCERNING THE DECLARATION OF APRIL 23, 2017, THROUGH APRIL 29, 2017, AS "HOLOCAUST AWARENESS WEEK". WHEREAS, Prejudice, bigotry, and racism have been the cause of conflict, war, and mass atrocities throughout human history; and WHEREAS, The Holocaust was the systematic, bureaucratic, state-sponsored persecution and murder of 6 million Jews by the Nazi regime and its collaborators; the Nazis, who came to power in Germany in January 1933, believed that Germans were "racially superior" and that the Jews, deemed "inferior", were an alien threat to the so-called German racial community; and -

Past, Present, and Future
I s s u e 9 F a l l 2 0 2 0 History of Pharmacy SIG Newsletter Pharmacy Chronicles: Past, Present, and Future Welcome Message from the Chair, History of Pharmacy Special Interest Group Welcome Readers! It has been quite a year since I’d like to take a brief mo- tice of pharmacy provides a wealth our last History of Pharmacy SIG ment to introduce myself. I’m Me- of exploration and application! newsletter, one which we will all re- gan R. Undeberg, PharmD, BCACP flect upon with historical implica- and Clinical Associate Professor at In my year with you as your tions in the future. As your time Washington State University College AACP History of Pharmacy SIG permits, take a journey over to of Pharmacy and Pharmaceutical chair, I encourage each of you to A I H P ’ s https://aihp.org/ Sciences in Spokane, WA. While my explore your area of interest in phar- collections/aihp-covid19-project. main role is educating future phar- macy history. We invite all of you to There, you can reflect and record macists through the didactic curricu- submit articles, briefs, book reviews, your experiences with COVID-19 lum as well as their clinical APPE pictures, or ways you incorporate the for our future historical reference. experiences in acute care, as with history of pharmacy in your teaching Just as many have looked back to the many of you, I hold dear to my heart and practice. As we look forward to 1918-19 influenza pandemic, some- a love of history—particularly that of our future in 2021, we all will be join- day clinicians and laypeople alike will the pharmacist during WWII Re- ing the Philadelphia College of Phar- wonder what perspectives we had sistance activities and the role of the macy in their bicentennial celebration with COVID-19. -

Security Dimensions No.10 (2013) 159-163
SECURITY DIMENSIONS NO.10 (2013) 159-163 SECURITY DIMENSIONS INTERNATIONAL & NATIONAL STUDIES REFLECTIONS ON THE MECHANISM OF THE AUTHORITARIAN SYSTEM OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC BASED ON ACTIONS OF THE SECURITY SERVICE TOWARDS TADEUSZ PANKIEWICZ – THE RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS OF THE WORLD Michał Zajda mgr, Instytut Pami ęci Narodowej ARTICLE INFO ABSTRACT The purpose of this article is to identify mechanisms of influence exerted by security Key words: agents on citizens in authoritarian People's Republic of Poland. The author uses the Security, life of Tadeusz Pankiewicz, honoured with the medal "Righteous Among the service, Nations", as an example to show the procedures ran by the security apparatus just, against citizen. The case of T. Pankiewicz was unique due to circumstances of his Pankiewicz, wartime merit for the Jewish community of Krakow, his resulting social position, Kraków, prestige and great respect he was bestowed with. It is therefore understandable Jews that his case was considered special in an attempt to analyse. The text highlights operational methods, along with critical commentary, aimed at acquiring T. Pankiewicz for cooperation, and the actual failure of these efforts. The article has rich academic value and is based on archival material. The figure and deeds of Tadeusz Pankiewicz are widely known and admired throughout Poland, as well as abroad. During the war he used all means at his disposal to save many people, putting himself at the highest risk. He played a game of chance against German occupation forces, a game with lives being at stake. After the war, when the seal uniforms of the SS were substituted with Soviet apparatchiks for whom the occupational trauma became a pretext for acquiring power, Tadeusz Pankiewicz naturally found himself in the spectrum of their interests. -

The Holocaust to the General Public in a Comprehensible, Yet Historically Accurate Manner
A Study Guide By Plater Robinson Published by The Southern Institute for Education and Research at Tulane University RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS "The universe exists on the merit of the righteous among the nations of the world, and they are privileged to see the Divine Presence." -- The Talmud THE GOOD SAMARITAN And who is my neighbor? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him. And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these three, thinking thou, was neighbour unto him that fell among the thieves? And he said, He that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise. -

Jews, Poles, and Slovaks: a Story of Encounters, 1944-48
JEWS, POLES, AND SLOVAKS: A STORY OF ENCOUNTERS, 1944-48 by Anna Cichopek-Gajraj A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History) in The University of Michigan 2008 Doctoral Committee: Professor Todd M. Endelman, Co-Chair Associate Professor Brian A. Porter-Sz űcs, Co-Chair Professor Zvi Y. Gitelman Professor Piotr J. Wróbel, University of Toronto This dissertation is dedicated to my parents and Ari ii ACKNOWLEDGMENTS I am greatly appreciative of the help and encouragement I have received during the last seven years at the University of Michigan. I have been fortunate to learn from the best scholars in the field. Particular gratitude goes to my supervisors Todd M. Endelman and Brian A. Porter-Sz űcs without whom this dissertation could not have been written. I am also thankful to my advisor Zvi Y. Gitelman who encouraged me to apply to the University of Michigan graduate program in the first place and who supported me in my scholarly endeavors ever since. I am also grateful to Piotr J. Wróbel from the University of Toronto for his invaluable revisions and suggestions. Special thanks go to the Department of History, the Frankel Center for Judaic Studies, and the Center of Russian and East European Studies at the University of Michigan. Without their financial support, I would not have been able to complete the program. I also want to thank the Memorial Foundation for Jewish Culture in New York, the Ronald and Eileen Weiser Foundation in Ann Arbor, the YIVO Institute for Jewish Research in New York, and the Center for Advanced Holocaust Studies at the United States Holocaust Memorial Museum in Washington DC for their grants. -
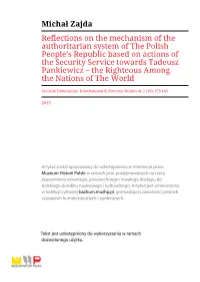
Michał Zajda Reflections on the Mechanism of the Authoritarian
Michał Zajda Reflections on the mechanism of the authoritarian system of The Polish People’s Republic based on actions of the Security Service towards Tadeusz Pankiewicz – the Righteous Among the Nations of The World Security Dimensions. International & National Studies nr 2 (10), 159-163 2013 SECURITY DIMENSIONS 10 REFLECTIONS ON THE MECHANISM OF THE AUTHORITARIAN SYSTEM OF THE POLISH PEOPLE 'S REPUBLIC BASED ON ACTIONS OF THE SECURITY SERVICE TOWARDS TADEUSZ PANKIEWICZ – THE RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS OF THE WORLD Michał Zajda ABSTRACT The purpose of this article is to identify his wartime merit for the Jewish community of mechanisms of influence exerted by security Krakow, his resulting agents on citizens in authoritarian People's social position, prestige and great respect he was Republic of Poland. The author uses the life of bestowed with. It is therefore understandable that Tadeusz Pankiewicz, honoured with the medal his case was considered special in an attempt to "Righteous Among the Nations", as an example to analyse. The text highlights operational methods, show the procedures ran by the security along with critical commentary, aimed at acquiring apparatus against citizen. The case of T. T. Pankiewicz for cooperation, and the actual Pankiewicz was unique due to circumstances of failure of these efforts. The article has rich academic value and is based on archival material. KEYWORDS Security, service, just, Pankiewicz, Kraków, Jews The figure and deeds of Tadeusz itself into Kraków's history in golden letters. 1 In Pankiewicz are widely known and admired 1930 T. Pankiewicz graduates pharmacy at the throughout Poland, as well as abroad. -

The Story of Jewish Resistance in the Warsaw, Łódź, and Kraków Ghettos, 1940-1944
From Milk Cans to Toilet Paper: The Story of Jewish Resistance in the Warsaw, Łódź, and Kraków Ghettos, 1940-1944 By Jason Michael Hadley A THESIS APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF HISTORY 14 June 2017 Table of Contents Abstract iii Dedication v Acknowledgements vi Note on Translation vii Introduction 1 Chapter 1: Warsaw 23 Chapter 2: Łódź 45 Chapter 3: Kraków 71 Conclusion 92 Bibliography 96 ii Abstract The fate of European Jewry was still unwritten when Adolph Hitler and his Nazi party came into power in January 1933; however, over the course of twelve years he and his followers attempted to eradicate the continent’s 9.5 million Jews. Despite the high levels of death and destruction, the Jews did not submit to their oppressors like Hilberg and other scholars had claimed. To resist the Nazis, the Jews often used a pen rather than a gun. By examining the attempts to preserve Jewish history and culture in Poland’s Warsaw, Łódź, and Kraków ghettos, I will prove these actions constitute a form of resistance because they were an effort to save Jewish history, values, ideas, concepts, and rules of behavior and circumvent the Nazis efforts to eradicate any trace of Jewish existence. In Warsaw, Emanuel Ringelblum established Oneg Shabbath, the largest underground ghetto archive. He and the highly trained O.S. staff compiled and preserved over 35,000 pages of Jewish history and culture. The members meticulously reviewed everything to ensure accuracy. The collection holds studies, monographs, and testimonies pertaining to every aspect of Jewish life from pre-war to the ghetto experience across Poland. -

Teofila Silberring and Janusz Korczak. Living in the Cracow and Warsaw Ghetto
Anna Janina Kloza, Bialystok (Poland) - [email protected] SUBJECT: Teofila Silberring and Janusz Korczak. Living in the Cracow and Warsaw Ghetto. Before the lesson: Tell your students about CENTROPA's website and ask them to read the biography of Teofila Silberring from Cracow as homework. Level of education: Post-gymnasium school Subject: Polish, history General objective: The class participants learn about the situation of people in the Warsaw and Cracow Ghetto with a particular emphasis on the figures of Janusz Korczak and Teofila Silberring. Detailed objectives: Workshop participants: - analyse the source texts and the photographic material, - reconstruct the everyday life in the Warsaw and Cracow Ghetto (hunger, diseases, smuggling, work, etc.), - analyse the human relations and dependence on the historical situation, - learn about important people connected with the ghetto and of their biographies: I. Kancenelson, J. Korczak, J. Bauman née Lewinson, A. Blady-Szwajgier, W. Szpilman, M. Edelman, J. Sendler, - describe the fate of Jewish children during the extermination, - analyse the cultural and spiritual life and the aspect of education, i.e. the attempt to lead a normal life in extreme situations, - define the ambiguity of the word “ghetto”, taking into account different aspects. Methods: Lecture; working with source material, literary texts and photographs; discussion; mind map (spidergram). Forms of work: individual, collective, in groups Auxiliary materials: Passages from the following books (see below): Bauman Janina, Winter in the Morning: A Young Girl’s Life in the Warsaw Ghetto, Cracow, 2009. Blady-Szwajgier Adina, And that is all I remember, Warsaw 2009. Czerniaków Adam, Adam Czerniaków's Diary of the Warsaw Ghetto, ed. -

Apteka Tadeusza Pankiewicza W Getcie Krakowskim – 35 Lat Działalności Muzeum
360 2018 Recenzenci zeszytu nr 36 / Reviewers of Volume No. 36 MHK: Wojciech Baliński, Monika Bednarek, Elżbieta Firlet, Ewa Gaczoł, dr Piotr Hapanowicz, Klaudia Kaczmarczyk, dr Iwona Kawalla-Lulewicz, Marta Marek, Janusz T. Nowak, Piotr Opaliński, Jacek Salwiński, Magdalena Smaga, Joanna Strzyżewska, dr Andrzej Szoka, Maria Zientara, dr Jacek Zinkiewicz oraz / and prof. Michał Baczkowski (UJ), prof. Wojciech Bałus (UJ), prof. Czesław Brzoza (UJ), prof. Jacek Chrobaczyński (UP w Krakowie), dr Janusz Firlet (Zamek Królewski na Wawelu), dr hab. Łukasz Gaweł (UJ), prof. Dariusz Kosiński (UJ), dr Marta Wardas-Lasoń (AGH), dr Konrad Meus (UP w Krakowie), dr hab. Janusz Mierzwa (UJ), prof. Piotr Mikietyński (UJ), dr Michał Pręgowski (Politechnika Warszawska), dr hab. Paweł Rodak (Uniwersytet Paris-Sorbonne), prof. Mariusz Wołos (UP w Krakowie), dr hab. Marek Zgórniak (UJ) Redaktor / Editor: Anna Biedrzycka Projekt graficzny / Graphic Design: Monika Wojtaszek-Dziadusz Tłumaczenie na język angielski / Translation into English: Michał Szymonik Ilustracje / Illustrations: Archiwum Narodowe w Krakowie (ANK), Archiwum Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska (BJ), Biblioteka Narodowa (BN), Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie (BN PAN i PAU), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHK), Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK), Muzuem Narodowe w Warszawie (MNW), Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Österreichischen Staatsarchiv, oddział Kriegsarchiv; archiwa rodzinne Elżbiety i Krzysztofa Malinowskich, rodziny Wolnych, -

J Anusz K Orczak
Number 6 - September 2009 Our Goals Membership fee Condolences Membership fee of the The objectives of the Janusz Korczak We express our condolences and deepest Janusz Korczak Association of Canada Association of Canada are as sympathy to Hanna Skowronska-Niwinska is $10 per year, payable in cheque form. follows: for the loss of Zbigniew Niwinski, to Jerry Please mail to: To foster the recognition of Janusz and Sofia Nussbaum for the loss of Mrs. Gina Dimant Korczak's life and work Alexander Weksler, to Jozef and Magda #203 – 5455 West Boulevard, Vancouver, To familiarize Canadians with his Zalewski for the loss of Jadwiga BC heroism during World War II, and his Wagnerowska. V6M 3W5 Canada staunch defense of children's rights New members are very welcome. To disseminate Korczak's pedagogical Thank-you ideas and their effect on children's Our contacts Our sincere gratitude to our supporters: education. Mr. Jerry Nussbaum The Consulate General of the Our Tasks #203 – 5455 West Boulevard, Republic of Poland in Vancouver and Projects developed in 2008-2009 Vancouver, BC V6M 3W5 Canada in particular, Consul General Mr. tel. 604.733.6386 Mrs. Gina Dimant Maciej Krych, A talk “My Life and My Books in fax. 604. 264. 8675 Mr. Jerry Nussbaum The Vancouver Holocaust Education the Shadow of the Holocaust” by E-mail: [email protected] Center and especially Executive Miriam Akavia (Israel) Director Mrs. Frieda Miller, An event “Honoring Irena Sendler in Announcement St. George‘s School of Vancouver, cooperation with “The Episode Please join our friends‘ and supporters‘ Gazeta Informacyjna and its Group” organization POLCA-BC Polish- editor Elzbieta Kozar.