«La Victoire Qui Vainc Le Monde, C'est Notre Foi»
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

POPE Benedict XVI's Resignation Has Sparked Calls For
[POPE Benedict XVI's resignation has sparked calls for his successor to come from Africa, home to the world's fastest-growing population and the front line of key issues facing the Roman Catholic Church. Around 15 per cent of the world's 1. 2 billion Catholics live in Africa and the per centage has expanded significantly in recent years in comparison to other parts of the world. Much of the Catholic Church's recent growth has come in the developing world, with the most rapid expansions in Africa and Southeast Asia. Names such as Ghana's Peter Turkson and Nigerian John Onaiyekan have been mentioned as potential papal material, as has Francis Arinze, also from Nigeria and considered a possibility when Benedict was elected, but who is now 80. ] BURUNDI : RWANDA : Protests in Rwanda Over Genocide Acquittals February 11, 2013 /(AP)/abcnews. go. com KIGALI, Rwanda Hundreds of Rwandans on Monday marched to the offices of the United Nations tribunal set up to try key cases related to Rwanda's 1994 genocide to protest the court's decision to acquit two former cabinet ministers accused of masterminding killings. The protesters, bearing placards denouncing the Arusha, Tanzania-based International Criminal Tribunal of Rwanda (ICTR), mainly constituted of survivors of the genocide, youths and students who accused the tribunal of denying justice to genocide victims. "The international community failed in their response to protect the Tutsi from being killed and now it is failing to provide justice to survivors," one of the banners read. More than 500,000 ethnic Tutsis and moderate Hutus were killed during Rwanda's 1994 genocide. -

A Special Place in History
Inside Building a culture of life See our annual Respect Life Supplement, Criterion pages 13-16. Serving the Church in Central and Southern Indiana Since 1960 CriterionOnline.com October 3, 2008 Vol. XLIX, No. 1 75¢ ‘Spiritual A special place in history nourishment’ of Freshmen at Bible to be a Saint Mary-of-the- synod focus, Woods College Hughes Lynn by Submitted photo says cardinal have ties to SAN FRANCISCO (CNS)—A renewed appreciation for the “spiritual nourishment” available in sacred St. Theodora Scripture, a shot in the arm for ecumenical Guérin dialogue and enhanced preaching on “the word By John Shaughnessy of God in Scripture” are among hopeful SAINT MARY-OF-THE-WOODS—For outcomes of the world cousins Jena Thralls and Ashley Vermillion, Synod of Bishops on the it’s just a short walk from their college dorm Bible, a U.S. cardinal room to the site of their family’s special place Cardinal said. in American Catholic history. William J. Levada Cardinal William J. At night on the campus of Saint Mary-of- Levada, prefect of the the-Woods College west of Terre Haute, Jena Vatican’s Congregation for the Doctrine of and Ashley sometimes walk to the rock that the Faith, made the comments in an memorializes a historic October moment from interview in San Francisco with the 168 years ago—the moment in 1840 when newspaper of the archdiocese, St. Theodora Guérin ended a three-month Catholic San Francisco. journey from France and arrived in the Indiana The cardinal, who is the former wilderness with a dream. -
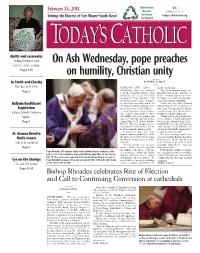
On Ash Wednesday, Pope Preaches on Humility, Christian Unity
February 24, 2013 Think Green 50¢ Recycle Volume 87, No. 8 Go Green todayscatholicnews.org Serving the Diocese of Fort Wayne-South Bend Go Digital TTODAYODAY’’SS CCATHOLICATHOLIC Quilts and casseroles Finding fulfillment with On Ash Wednesday, pope preaches interests, service to others Pages 8-10 on humility, Christian unity In Truth and Charity BY FRANCIS X. ROCCA The Chair of St. Peter VATICAN CITY (CNS) — ing the vast basilica. Page 2 Celebrating what was expected The Ash Wednesday liturgy, tra- to be the last public liturgy of his ditionally held in two churches on pontificate two weeks before his Rome’s Aventine Hill, was moved to resignation, Pope Benedict XVI St. Peter’s to accommodate the great- preached on the virtues of humil- est possible number of faithful. Indiana healthcare ity and Christian unity and heard At the end of the Mass, Cardinal his highest-ranking aide pay trib- Tarcisio Bertone, who as secretary of legislation ute to his service to the Church. state is the Vatican’s highest official, Jesus “denounces religious hypoc- voiced gratitude for Pope Benedict’s Indiana Catholic Conference risy, behavior that wants to show pontificate of nearly eight years. update off, attitudes that seek applause and “Thank you for giving us the lumi- approval,” the pope said in his homily nous example of a simple and humble Page 5 during Mass in St. Peter’s Basilica laborer in the vineyard of the Lord,” Feb. 13. “The true disciple does not Cardinal Bertone said, invoking the serve himself or the ‘public,’ but his same metaphor Pope Benedict had Lord, in simplicity and generosity.” used in his first public statement fol- Coming two days after Pope lowing his election in 2005. -

Infographie. Les Dix Papables (PDF)
Parmi eux, peut-être le successeur de Benoît XVI Marc Ouellet Timothy Dolan Sean Patrick O’Malley Odilo Scherer Oscar Andres Rodriguez Maradiaga 68 ans, ex-arche- 63 ans, archevêque 68 ans, archevêque 63 ans, archevêque 70 ans, archevêque vêque de Québec de New York de Boston de São Paulo de Tegucigalpa Ce cardinal canadien, Le plus médiatique Ce capucin barbu, Ce conservateur Peut-être est-il traditionaliste, vu au des cardinaux qui porte la bure de attaché à l’ortho- davantage la Québec comme un américains, moine franciscain, doxie de la doctrine, «papabile» des cardinal de fer, préfet débonnaire et est reconnu pour bon gestionnaire et médias que celui des de l’influente congrégation des convivial, est toutefois un prélat avoir lutté avec détermination contre bon communicateur, dirige le plus cardinaux électeurs, mais le nom de évêques, figure depuis plusieurs mois intransigeant sur les principes. Il le fléau des prêtres pédophiles dans grand archidiocèse du Brésil, pays ce farouche défenseur des droits de parmi les «papabile». Cet homme de défend une lecture traditionaliste du son diocèse. Il inspire respect et sera qui compte le plus de catholiques. Il l’homme revient régulièrement. conviction connaît très bien les catholicisme, opposé à Obama et sa très écouté dans le conclave. Mais vu connaît les rouages de Rome, où il a Classique sur le plan de la doctrine rouages de l’Eglise et est proche de la loi sur la santé quant à la prise en la surpuissance des Etats-Unis, le travaillé de 1994 à 2001 au sein de la romaine, il est à même d’engager des puissante Eglise nord-américaine. -

Named Person Scheme Website Under Fire
Salesians POPE FRANCIS GERALD WARNER celebrate the calls for an reflects on the bicentenary of end to the recent synod ST JOHN BOSCO. death penalty. on the family. Page 2 Pages 6-7 Page 10 No 5593 VISIT YOUR NATIONAL CATHOLIC NEWSPAPER ONLINE AT WWW.SCONEWS.CO.UK Friday October 31 2014 | £1 PRO-LIFERS LIGHT UP GLASGOW PROCESSION Glasgow’s George Square was illuminated by candlelight last week as hundreds of pro-life supporters gathered to pray for the repeal of the 1967 Abortion Act. The annual pro-life torchlight procession brought Faithful campaigners and supporters into the rain and darkness of Glasgow to pray the Rosary and process through the city’s streets to St Andrew’s Cathedral. For more on the torchlight procession and pro-life gathering, turn to pages 4 and 5 PIC: ROBERT WILSON Named Person scheme website under fire I Government’s online educational portal described as ‘blatant propaganda’ by critics of the legislation By Ian Dunn these apparently superhuman Named limited money is being poured into this is quite frightening,” he said threshold set for triggering the sharing of Persons can remedy almost any problem programme which is fundamentally information about children among state A WEBSITE that has been put in the way of ordinary people,” he designed to undermine and destabilise Archbishop’s concerns agencies,” he said. “While recognising designed to educate children about continued. “They can save families families.” Earlier this year Archbishop Leo Cushley the good intentions behind such efforts, Scotland’s controversial Named from desolation after divorce and even On one part of the site, a named person of St Andrews and Edinburgh said that we hope that the government will act in Person scheme has been described help get dads to kick alcohol—according is described as a ‘kind, elderly lady with the ‘Bishops’ Conference of Scotland is a proportionate and focused manner as ‘blatant propaganda’ by critics. -

THE POPE: Resignation and Election 2013
News in Review – April 2013 – Teacher Resource Guide THE POPE: Resignation and Election 2013 MINDS‐ON ACTIVITY When it is time to elect a new pope, the cardinals of the Roman Catholic Church come from all over the world to take part in a papal conclave in Rome. Behind the sealed doors of the Sistine Chapel, the cardinals pick the man who will follow in footsteps of St. Peter. Going into the conclave of 2013, many believed that Cardinal Marc Ouellet of Quebec had a realistic chance of earning the papacy. As head of the Vatican’s office of bishops, Ouellet was a well-known and respected Catholic cleric who garnered strong support in the early voting. However, Ouellet, much to his relief, did not become pope. 1. What would it be like to have a Canadian as Roman Catholic pope? 2. Do you think church attendance would improve among Catholic Canadians if Ouelett were pope? 3. Would it be a source of national pride if a Canadian held such a prestigious office? SETTING THE STAGE Benedict Resigns The resignation of Pope Benedict was the event No one predicted the outcome of the conclave of that set this whole process in motion. Citing 2013. A little over a month after Pope declining health and the rigours of the job, Benedict’s resignation, 115 Cardinals gathered Benedict announced he was stepping down in in the Sistine Chapel to pick a new pope. The mid-February 2013. Pope Benedict’s seven-year outcome of the secret vote surprised almost term had its highs and lows. -

Page 02 March 10.Indd
ISO 9001:2008 CERTIFIED NEWSPAPER Sunday 10 March 2013 28 Rabial II 1434 - Volume 18 Number 5634 Price: QR2 WEF’s Executive Cook, Compton Opinion Survey hit tons, lead in Qatar England’s recovery Business | 17 Sport | 28 www.thepeninsulaqatar.com [email protected] | [email protected] Editorial: 4455 7741 | Advertising: 4455 7837 / 4455 7780 Sheikha Moza at CILE conference Released UN Single motor peacekeepers reach Jordan insurance plan AMMAN: The United Nations welcomed the release yesterday of 21 Filipino peacekeepers, who had been seized by Syrian rebels on the Golan Heights, as they for GCC likely crossed to freedom in Jordan after a three-day ordeal. Philippine authorities also expressed relief at the release Draft may get nod at Doha meet of the members of the UN Disengagement Observer Force. DOHA: Plans to have a uni- from one GCC state to another A Jordanian military offi- fied insurance policy for auto- need to buy third-party insur- cial said the peacekeepers were mobiles in the GCC region are ance cover. This is most common greeted by border guards as they in the pipeline and if things in the case of Saudi Arabia which crossed from Syria in the after- go as planned, regional motor attracts a large number of reli- noon and “underwent medical insurance schemes might be gious visitors from the region who examinations.” launched before the year-end. prefer to travel by road. They then boarded an army bus A preliminary draft of the pro- People travelling to Saudi and were given a military escort posed policy has been framed, and Arabia from Qatar by road for pil- to the east Amman headquarters approved by the Gulf Insurance grimage like Umrah, for example, of the armed forces where they Federation at its meeting in must pay up QR100 as third-party were “handed over to the UN rep- Dubai last month. -

Medjugorje Traceptive/Sterilization Mandate
March 17, 2013 Think Green 50¢ Recycle Volume 87, No. 11 Go Green todayscatholicnews.org Serving the Diocese of Fort Wayne-South Bend Go Digital TTODAYODAY’’SS CCATHOLICATHOLIC Call to Prayer Whole Church called to enter Pages 3, 10 Priests’ curriculum conclave in prayer, archbishop says Good Leaders, Good Shepherds introduced BY CINDY WOODEN Page 4 VATICAN CITY (CNS) — Although there will only be 115 cardinals in the Sistine Chapel voting for a pope, the whole Laetare Medal Church joins them in prayer and Notre Dame announces winners expectation, said the archbishop who spearheaded the design of the Page 5 conclave rites and prayers. Archbishop Piero Marini, cur- rently president of the Pontifical Committee for International Eucharistic Congresses, was master Commencement of ceremonies for Blessed John Paul II and coordinated the development speaker announced of the prayers and Masses to guide Cardinal Dolan to deliver the cardinals entering the conclave March 12. address at Notre Dame “The spirit of expectation is part of this period” in the life of the Page 8 Church, Archbishop Marini told reporters March 9 during a media briefing organized by the U.S. Conference of Catholic Bishops at the Pontifical North American Dwenger CNS PHOTO/PAUL HARING College. cheerleaders Members of the media preview the Sistine Chapel as preparations continued for the conclave March 9 at the Vatican. Cardinal electors entered the chapel March 12 to begin the conclave to elect the new pope. Crowned National CONCLAVE, PAGE 16 Grand Champions Page 13 Priests say Light Is On For You was ‘time of grace’ For You was very well received as five priests pastor of St. -

Papa Francisco Completó La Lista De Los Padres Sinodales Catholic.Net
Papa Francisco completó la lista de los padres sinodales Catholic.net Papa Francisco completó la composición del Sínodo ordinario sobre la familia, que se llevará cabo en el Vaticano del 4 al 25 de octubre, y nombró personalmente, además de a los participantes previstos por los estatutos (representantes de los episcopados, encargados de dicasterios curiales, miembros de las Iglesias orientales, colaboradores del secretario especial, oidores y oidoras, delegados fraternos), a 45 padres sinodales (fueron 26 en el Sínodo extraordinario del año pasado). Son muchos los cardenales y obispos italianos de diferentes posturas, entre los cuales están presentes los nuevos purpurado creados por Francisco (Bassetti, Montenegro y Menichelli, que también participó en el Sínodo del año pasado), dos párrocos italianos y obispos que han sido nombrados recientemente, como el arzobispo estadounidense de Chicago, Blase J. Cupich. El Sínodo ordinario se reunirá para reflexionar sobre el tema «La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo» por segunda ocasión, después del Sínodo extraordinario de octubre del año pasado («Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización»). Si, según los estatutos, un Sínodo extraordinario (ha habido tres desde que se creó esta institución después del Concilio) está compuesto por los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, el ordinario, más amplio, cuenta con la participación de delegaciones elegidas en cada uno de los episcopados. Algunos ejemplos. Italia, en los últimos meses, eligió a los cardenales Scola y Bagnasco y a los monseñores Brambilla y Solmi; Alemania, al cardenal Marx y a los monseñores Koch y Bode; Francia al cardenal Vingt-Trois y a los monseñores Pontier, Brunin y James, Bélgica a mons. -

The Parthenon, March 13, 2013
Marshall University Marshall Digital Scholar The aP rthenon University Archives 3-13-2013 The aP rthenon, March 13, 2013 John Gibb [email protected] Tyler Kes [email protected] Follow this and additional works at: http://mds.marshall.edu/parthenon Recommended Citation Gibb, John and Kes, Tyler, "The aP rthenon, March 13, 2013" (2013). The Parthenon. Paper 199. http://mds.marshall.edu/parthenon/199 This Newspaper is brought to you for free and open access by the University Archives at Marshall Digital Scholar. It has been accepted for inclusion in The aP rthenon by an authorized administrator of Marshall Digital Scholar. For more information, please contact [email protected]. C M Y K 50 INCH Conference USA tournament bracket > More on Sports Wednesday, March 13, 2013 | VOL. 116 NO. 102 | MARSHALL UNIVERSITY’S STUDENT NEWSPAPER | marshallparthenon.com Town Hall meeting discusses Affordable Care Act By SHANE BIAS and families. associate professor of pedi- preventive services like con- was well run and informative. on the Affordable Care Act and THE PARTHENON “We are trying to educate atrics at the Joan C. Edwards traception are free,” Pore said. “I thought they did a great job will even train student affairs A town hall meeting hosted West Virginians about what’s School of Medicine, Allan Cham- “Students can now remain on at going into detail about how people to help enroll students,” by Marshall University Student coming up in the affordable berlin, president of United their parent’s health insur- the affordable care act affects Pore said. “If students are look- Health and the Women’s Center care act,” Pore said. -

Libro 50 Años
253 SEXTA PARTE LA CAL A PARTIR DEL MOTU PROPRIO DECESSORES NOSTRI DESDE 1988 254 255 El año 1988 es importante en la historia de la Pontificia Comisión para América Latina. En ese año el Santo Padre Juan Pablo II, con el Motu Proprio Decessores Nostri del 18 de junio y con la Constitución Apostólica Pastor Bonus del 28 de junio, reorganizó y potenció la CAL, dándole una ubicación en el orgánico de la Curia Romana y precisando más su naturaleza y finalidad. Estos dos actos pontificios son el punto de partida de una nueva etapa en la vida de este Organismo de la Curia Romana, cuya importancia era cada vez más evidente para la renovación y fortalecimiento del catolicismo latinoamericano. Después de 30 años de existencia, Su Santidad Juan Pablo II, consideró que había llegado el momento de reestructurar y potenciar la Comisión para América Latina de modo que fuera siempre en grado de responder a las expectativas que la Santa Sede había depositado en ella desde su constitución en 1958. El Santo Padre renovando y potenciando la CAL quiso dar un nuevo impulso a la obra evangelizadora de la Iglesia en América Latina y renovar el organismo de la Curia Romana especialmente llamado a animar la Nueva Evangelización del “Continente de la Esperanza”. En estos últimos 20 años la CAL ha tenido como Presidente los Eminentísimos Cardenales Bernardín Gantin (1984-1998), Lucas Moreira Neves (1998-2000), Giovanni Battista Re (desde el año 2000). El Motu Proprio Decessores Nostri dispuso que el Presidente fuese ayudado por un Obispo Vice-Presidente, este cargo lo han ejercido: S.E. -

Hawaii Catholic Herald • March 1, 2013
Hawaii Catholic HawaiiVOLUME 76, NUMBER 4 Herald CatholicFRIDAY, FEBRUARY 15, 2013 Herald$1 VOLUME 76, NUMBER 5 FRIDAY, MARCH 1, 2013 $1 Aloha In a nearly unprecedented move, Pope Benedict XVI retires. The church anxiously awaits the election of a new successor to Peter Special section: pages 5-13 Pope Benedict XVI waves as he leaves his general audience in Paul VI hall at the Vatican Dec. 5. CNS photo/Paul Haring 2 HAWAII HAWAII CATHOLIC HERALD • MARCH 1, 2013 Receiving two newspapers? Hawaii The Hawaii Catholic Catholic Herald is now being sent to participants in the Herald diocesan With Grateful Newspaper of the Diocese of Honolulu Hearts campaign who Founded in 1936 were not receiving it Published every other Friday PUBLISHER before. Bishop Larry Silva However, because (808) 585-3356 of the ways names of [email protected] subscribers and their EDITOR addresses are listed, you Patrick Downes may be receiving a du- (808) 585-3317 [email protected] plicate copy. REPORTER/PHOTOGRAPHER If you are now getting Darlene J.M. Dela Cruz two copies and want (808) 585-3320 to cancel one, please [email protected] contact our circulation ADVERTISING manager Donna Aquino Shaina Caporoz at 585-3321 or (808) 585-3328 [email protected] [email protected], CIRCULATION or me at 585-3317 or Donna Aquino pdownes@rcchawaii. (808) 585-3321 org. [email protected] HAWAII CATHOLIC HERALD Patrick Downes (ISSN-10453636) Periodical postage editor paid at Honolulu, Hawaii. Published ev- ery other week, 26 issues a year, by the Roman Catholic Church in the State of Hawaii, 1184 Bishop Street, Honolulu, HI 96813.