Clinosperma Macrocarpa… Du Mythe À La Réalité
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Doc De Projet PCNC V4
Document de projet Programme de Conservation des Palmiers et des Conifères en Nouvelle-Calédonie © M. Rossi Noé conservation Sommaire A propos de Noé Conservation ......................................................................................................................... 1 Contexte ............................................................................................................................................................ 1 La biodiversité : érosion à l’échelle planétaire .............................................................................................. 1 La Nouvelle-Calédonie : un haut lieu mondial de biodiversité ..................................................................... 1 Pourquoi cibler les Palmiers et Conifères ? ....................................................................................................... 2 Objectifs de conservation .................................................................................................................................. 2 Historique du programme ................................................................................................................................. 3 Une stratégie en cinq composantes .................................................................................................................. 3 Améliorer les connaissances ......................................................................................................................... 3 Conserver les espèces menacées ................................................................................................................. -

Seed Geometry in the Arecaceae
horticulturae Review Seed Geometry in the Arecaceae Diego Gutiérrez del Pozo 1, José Javier Martín-Gómez 2 , Ángel Tocino 3 and Emilio Cervantes 2,* 1 Departamento de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (CYMVIS), Universidad Estatal Amazónica (UEA), Carretera Tena a Puyo Km. 44, Napo EC-150950, Ecuador; [email protected] 2 IRNASA-CSIC, Cordel de Merinas 40, E-37008 Salamanca, Spain; [email protected] 3 Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced 1–4, 37008 Salamanca, Spain; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +34-923219606 Received: 31 August 2020; Accepted: 2 October 2020; Published: 7 October 2020 Abstract: Fruit and seed shape are important characteristics in taxonomy providing information on ecological, nutritional, and developmental aspects, but their application requires quantification. We propose a method for seed shape quantification based on the comparison of the bi-dimensional images of the seeds with geometric figures. J index is the percent of similarity of a seed image with a figure taken as a model. Models in shape quantification include geometrical figures (circle, ellipse, oval ::: ) and their derivatives, as well as other figures obtained as geometric representations of algebraic equations. The analysis is based on three sources: Published work, images available on the Internet, and seeds collected or stored in our collections. Some of the models here described are applied for the first time in seed morphology, like the superellipses, a group of bidimensional figures that represent well seed shape in species of the Calamoideae and Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud. -

(Arecaceae): Évolution Du Système Sexuel Et Du Nombre D'étamines
Etude de l’appareil reproducteur des palmiers (Arecaceae) : évolution du système sexuel et du nombre d’étamines Elodie Alapetite To cite this version: Elodie Alapetite. Etude de l’appareil reproducteur des palmiers (Arecaceae) : évolution du système sexuel et du nombre d’étamines. Sciences agricoles. Université Paris Sud - Paris XI, 2013. Français. NNT : 2013PA112063. tel-01017166 HAL Id: tel-01017166 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01017166 Submitted on 2 Jul 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE PARIS-SUD ÉCOLE DOCTORALE : Sciences du Végétal (ED 45) Laboratoire d'Ecologie, Systématique et E,olution (ESE) DISCIPLINE : -iologie THÈSE DE DOCTORAT SUR TRAVAUX soutenue le ./05/10 2 par Elodie ALAPETITE ETUDE DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR DES PAL4IERS (ARECACEAE) : EVOLUTION DU S5STE4E SE6UEL ET DU NO4-RE D'ETA4INES Directeur de thèse : Sophie NADOT Professeur (Uni,ersité Paris-Sud Orsay) Com osition du jury : Rapporteurs : 9ean-5,es DU-UISSON Professeur (Uni,ersité Pierre et 4arie Curie : Paris VI) Porter P. LOWR5 Professeur (4issouri -otanical Garden USA et 4uséum National d'Histoire Naturelle Paris) Examinateurs : Anders S. -ARFOD Professeur (Aarhus Uni,ersity Danemark) Isabelle DA9OA Professeur (Uni,ersité Paris Diderot : Paris VII) 4ichel DRON Professeur (Uni,ersité Paris-Sud Orsay) 3 4 Résumé Les palmiers constituent une famille emblématique de monocotylédones, comprenant 183 genres et environ 2500 espèces distribuées sur tous les continents dans les zones tropicales et subtropicales. -

Arecaceae 1 Arecaceae
Arecaceae 1 Arecaceae Arécacées Cocos nucifera Classification de Cronquist Règne Plantae Sous-règne Tracheobionta Division Magnoliophyta Classe Liliopsida Sous-classe Arecidae Ordre Arecales Famille Arecaceae Bercht. & J.Presl, 1820 Synonymes Palmae Juss., 1789 Classification APG III Arecaceae 2 Classification APG III Clade Angiospermes Clade Monocotylédones Clade Commelinidées Ordre Arecales Famille Arecaceae Les palmiers, palmacées (Palmae) ou arécacées (Arecaceae) - les deux noms sont reconnus - forment une famille de plantes monocotylédones. Facilement reconnaissables à leur tige non ramifiée, le stipe, surmonté d'un bouquet de feuilles pennées ou palmées, les palmiers symbolisent les déserts chauds et les côtes et paysages tropicaux. Botanique La famille des arécacées comprend (selon Watson & Dallwitz) plus de 2 500 espèces réparties en plus de 200 genres, dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, de l'Afrique aux Amériques et à l'Asie : • Liste alphabétique des genres de la famille des Arecacées Conformément aux règles de la nomenclature scientifique, le nom de la famille découle de celui du genre le plus représentatif (dans le cas d'espèce, il s'agit du genre Areca, qui comprend notamment Areca catechu L., l'aréquier ou palmier à bétel). D'un point de vue botanique, les palmiers sont des monocotylédones et ne sont donc pas des arbres, mais des « herbes géantes » : ils ne possèdent pas de vrai bois au sens botanique, l'épaississement du stipe résultant de l'addition répétée de faisceaux appelée « croissance secondaire diffuse », processus différent de celui à l'origine de la formation du bois des dicotylédones et des gymnospermes. Cela n'empêche pas les Ceroxylon des Andes de posséder les plus hauts stipes du monde (40 à 60 m). -
Supplement to Global Patterns and Drivers of Phylogenetic Structure In
Supplementary information Weigelt, P., Kissling, W.D., Kisel, Y., Fritz, S.A., Karger, D.N., Kessler, M., Lehtonen, S., Svenning, J.-C. and Kreft, H. Global patterns and drivers of phylogenetic structure in island floras. Scientific Reports. Content Supplementary Text S1. Ecological and biogeographical characteristics of angiosperms, palms and ferns relevant to the hypothesized relationships between environmental factors and phylogenetic diversity and structure. Supplementary Methods S1. Floras and phylogenies. Supplementary Methods S2. Statistical models and spatial autocorrelation. Supplementary Table S1. Pearson correlations of phylogenetic community metrics within angiosperms, palms and ferns on islands worldwide. Supplementary Table S2. Pearson correlations of phylogenetic community metrics among angiosperms, palms and ferns on islands worldwide. Supplementary Table S3. Best Generalized Additive Models based on Akaike's Information Criterion corrected for small sampling sizes of the relationships of the standardized effect size of phylogenetic diversity of angiosperms, palms and ferns with environmental factors on islands. Supplementary Table S4. Variable importance estimated from all possible multi-predictor Generalized Additive Models for the standardized effect size of mean pairwise phylogenetic distance of angiosperms, palms and ferns on islands in dependence on environmental predictors. Supplementary Table S5. Best Generalized Additive Models based on Akaike's Information Criterion corrected for small sampling sizes of the relationships of the standardized effect size of mean pairwise phylogenetic distance of angiosperms, palms and ferns with environmental factors on islands. Supplementary Table S6. Pearson correlations among predictor variables used to explain phylogenetic structure of island floras. Supplementary Table S7. Pearson correlations among phylogenetic community metrics calculated with a global island species pool and three different regional species pool delineations. -
Homoplasious Character Combinations and Generic Delimitation: a Case Study from the Indo-Pacific Arecoid Palms (Arecaceae:Areceae)1
American Journal of Botany 93(7): 1065–1080. 2006. HOMOPLASIOUS CHARACTER COMBINATIONS AND GENERIC DELIMITATION: A CASE STUDY FROM THE INDO-PACIFIC ARECOID PALMS (ARECACEAE:ARECEAE)1 MARIA VIBE NORUP,2,3,5 JOHN DRANSFIELD,3 MARK W. CHASE,3 ANDERS S. BARFOD,2 EDWINO S. FERNANDO,4 AND WILLIAM J. BAKER3 2Department of Systematic Botany, University of Aarhus, Ny Munkegade, Building 540, 8000 Aarhus, Denmark; 3Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AB, UK; and 4Department of Forest Biological Sciences, The University of the Philippines, Los Ban˜os, College, 4031 Laguna, Philippines The complex distributions of morphological character states in the Indo-Pacific palm tribe Areceae (Arecaceae; Arecoideae) are potentially challenging for the delimitation of its genera. In the first exhaustive sampling of all 65 genera of the Areceae, we examined relationships of two of the tribe’s most problematic genera, Heterospathe and Rhopaloblaste, using portions of the low- copy nuclear genes phosphoribulokinase (PRK) and RNA-polymerase II subunit B (RPB2). Both genera fell within a highly supported clade comprising all Areceae genera, but are clearly unrelated. Rhopaloblaste was strongly supported as monophyletic and is most closely related to Indian Ocean genera. Heterospathe was resolved with strong support within a clade of western Pacific genera, but with the monotypic Alsmithia nested within it. Ptychosperma micranthum, which has previously been included in both Heterospathe and Rhopaloblaste, is excluded from these and from Ptychosperma, supporting its recent placement in a new genus Dransfieldia. Morphological comparisons indicate that the crownshaft is putatively synapomorphic for the Areceae with numerous reversals within the clade and some independent origins elsewhere. -

Challenges in Ex Situ Conservation
SPECIAL ISSUE CSIRO PUBLISHING Australian Journal of Botany, 2017, 65, 609–624 Review https://doi.org/10.1071/BT17096 Saving rainforests in the South Pacific: challenges in ex situ conservation Karen D. Sommerville A,H, Bronwyn Clarke B, Gunnar Keppel C,D, Craig McGill E, Zoe-Joy Newby A, Sarah V. WyseF, Shelley A. JamesG and Catherine A. Offord A AThe Australian PlantBank, The Royal Botanic Gardens and Domain Trust, Mount Annan, NSW 2567, Australia. BThe Australian Tree Seed Centre, CSIRO, Canberra, ACT 2601, Australia. CSchool of Natural and Built Environments, University of South Australia, Adelaide, SA 5001, Australia. DBiodiversity, Macroecology and Conservation Biogeography Group, Faculty of Forest Sciences, University of Göttingen, Büsgenweg 1, 37077 Göttingen, Germany. EInstitute of Agriculture and Environment, Massey University, Private Bag 11 222 Palmerston North 4442, New Zealand. FRoyal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place, RH17 6TN, United Kingdom. GNational Herbarium of New South Wales, The Royal Botanic Gardens and Domain Trust, Sydney, NSW 2000, Australia. HCorresponding author. Email: [email protected] Abstract. Rainforests in the South Pacific hold a considerable amount of plant diversity, with rates of species endemism >80% in some countries. This diversity is rapidly disappearing under pressure from logging, clearing for agriculture or mining, introduced pests and diseases and other anthropogenic sources. Ex situ conservation techniques offer a means to limit the loss of plant diversity. Seed banking is considered the most efficient and cost effective of these techniques but is applicable only to seed capable of tolerating desiccation and cold storage. Data on the degree of tolerance of these conditions was lacking for more than half of the 1503 South Pacific rainforest genera examined for this review. -

Revoceania.Pdf
REVIEW OF THE PROTECTED AREAS SYSTEM IN OCEANIA Prepared by the iNTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES COMMISSION ON NATIONAL PARKS AND PROTECTED AREAS in collaboration with the UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME Based on the work of ARTHUR LYON DAHL Consulting Ecologist September 1986 Published by: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Gland, Switzerland and Cambridge, UK Prepared in collaboration with the United Nations Environment Programme (UNEP). A contribution to GEMS - the Global Environment Monitoring System. 91986 United Nations Environment Programme! International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ISBN: 2-88032-509-9 Cover design: James Butler Cover photo: 70 Islands Marine Reserve, Republic of Belau, Caroline Islands, North Pacific Ocean: WWF/IUCN Douglas Faulkner Printed by: IPH Litho, Ryton-on-Dunsmore, Coventry, UK Available from: IUCN Conservation Monitoring Centre, 219c Huntingdon Road, Cambridge, CB3 ODL, UK or IUCN Publications Services, Avenue du Mont Blanc, CH- 1196 Gland, Switzerland The designations of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Review of the Protected Areas System of Oceania TAt3LE OF CONfENTS Page Forward iii Summary iv Introduction 1-5 Definition of the region 1 Special characteristics of Oceania 2 Reviewing the protected areas system 2 Vethods 3 Factors not considered in this regional synthesis Results 6-20 Species dispersal in Oceania 6 Ecosystem conservation strategies 7 Conservation significance of individual islands LU Present protected areas in Oceania I Strategies for development of the protected areas system 14 Conclusions 19 Acknowledgements 2 1. -

Le Référentiel Taxonomique Florical Et Les Caractéristiques De La Flore Vasculaire Indigène De La Nouvelle-Calédonie
Le référentiel taxonomique Florical et les caractéristiques de la flore vasculaire indigène de la Nouvelle-Calédonie Author(s): Philippe Morat , Tanguy jaffré , Frédéric Tronchet , Jérôme Munzinger , Yohan Pillon , Jean-Marie Veillon , Monique Chalopin , Philippe Birnbaum , Frédéric Rigault , Gilles dagostini , Jacqueline Tinel , Porter P. Lowry II Source: Adansonia, 34(2):179-221. 2011. Published By: Muséum national d'Histoire naturelle, Paris DOI: http://dx.doi.org/10.5252/a2012n2a1 URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.5252/a2012n2a1 BioOne (www.bioone.org) is a nonprofit, online aggregation of core research in the biological, ecological, and environmental sciences. BioOne provides a sustainable online platform for over 170 journals and books published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Web site, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s Terms of Use, available at www.bioone.org/page/ terms_of_use. Usage of BioOne content is strictly limited to personal, educational, and non-commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder. BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research. Le référentiel taxonomique Florical et les caractéristiques de la -

Palme Della Nuova Caledonia
Odoardo Beccari LE PALME DELLA NUOVA CALEDONIA www.liberliber.it 1 Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di: E-text Editoria, Web design, Multimedia http://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: Le palme della Nuova Caledonia AUTORE: Beccari, Odoardo TRADUTTORE: CURATORE: NOTE: Il testo è presente in formato immagine sul sito Gallica (http://gallica.bnf.fr) DIRITTI D'AUTORE: no. LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/ TRATTO DA: "Le palme della Nuova Caledonia" di Odoardo Beccari Firenze : Tipografia M. Ricci, 1920 CODICE ISBN: non disponibile 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 22 luglio 2008 INDICE DI AFFIDABILITA': 1 0: affidabilità bassa 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO: Daniele Cicuzza, [email protected] REVISIONE: Claudio Paganelli, [email protected] PUBBLICATO DA: Claudio Paganelli, [email protected] Informazioni sul "progetto Manuzio" Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: http://www.liberliber.it/ Aiuta anche tu il "progetto Manuzio" Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. Qui le istruzioni: http://www.liberliber.it/sostieni/ 2 ODOARDO BECCARI LE PALME DELLA NUOVA CALEDONIA FIRENZE TIP0GRAFIA DI M. RICCI Via San Gallo, 31 1920 3 Le Palme della Nuova Caledonia per ODOARDO BECCARI Le Palme indigena nella Nuova Caledonia non sono molte ma in compenso sono assai caratteristiche e tutte sono endemiche. -
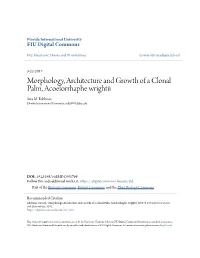
Morphology, Architecture and Growth of a Clonal Palm, Acoelorrhaphe Wrightii Sara M
Florida International University FIU Digital Commons FIU Electronic Theses and Dissertations University Graduate School 3-22-2017 Morphology, Architecture and Growth of a Clonal Palm, Acoelorrhaphe wrightii Sara M. Edelman Florida International University, [email protected] DOI: 10.25148/etd.FIDC001769 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/etd Part of the Biology Commons, Botany Commons, and the Plant Biology Commons Recommended Citation Edelman, Sara M., "Morphology, Architecture and Growth of a Clonal Palm, Acoelorrhaphe wrightii" (2017). FIU Electronic Theses and Dissertations. 3201. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/3201 This work is brought to you for free and open access by the University Graduate School at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Miami, Florida MORPHOLOGY, ARCHITECTURE AND GROWTH OF A CLONAL PALM, ACOELORRHAPHE WRIGHTII A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in BIOLOGY by Sara Melissa Edelman 2017 To: Dean Michael R. Heithaus College of Arts, Sciences and Education This dissertation, written by Sara Melissa Edelman, and entitled Morphology, Architecture and Growth of a Clonal Palm, Acoelorrhaphe wrightii, having been approved in respect to style and intellectual content, is referred to you for judgment. We have read this dissertation and recommend that it be approved. _______________________________________ Kenneth Feeley _______________________________________ Javier Francisco-Ortega _______________________________________ Michael Ross _______________________________________ Scott Zona _______________________________________ Jennifer H. Richards, Major Professor Date of Defense: March 22, 2017 The dissertation of Sara Melissa Edelman is approved. -

A Genus-Level Phylogenetic Linear Sequence of Monocots
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/277301125 A genus-level phylogenetic linear sequence of monocots Article in Taxon · June 2015 DOI: 10.12705/643.9 CITATIONS READS 5 1,098 6 authors, including: William John Baker David Alan Simpson Royal Botanic Gardens, Kew Royal Botanic Gardens, Kew 155 PUBLICATIONS 3,287 CITATIONS 194 PUBLICATIONS 1,523 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Odile Weber Paul Wilkin Musée national d'histoire naturelle de Luxemb… Royal Botanic Gardens, Kew 16 PUBLICATIONS 34 CITATIONS 113 PUBLICATIONS 1,665 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Palm hydraulics linking biodiversity and functioning of tropical forests under climate change View project Flora of Mount Jaya, Papua, Indonesia View project All content following this page was uploaded by Anna Trias Blasi on 27 May 2015. The user has requested enhancement of the downloaded file. TAXON — 27 May 2015: 30 pp. Trias-Blasi & al. • Linear sequence of monocots CLASSIFICATION A genus-level phylogenetic linear sequence of monocots Anna Trias-Blasi, William J. Baker, Anna L. Haigh, David A. Simpson, Odile Weber & Paul Wilkin Herbarium, Library, Art and Archives, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AB, U.K. Author for correspondence: Anna Trias-Blasi, [email protected] ORCID: AT-B, http://orcid.org/0000-0001-9745-3222; WJB, http://orcid.org/0000-0001-6727-1831 DOI http://dx.doi.org/10.12705/643.9 Abstract This paper provides an up-to-date linear sequence of monocot families and genera (excluding Orchidaceae and Poaceae) based on current phylogenetic evidence.