Forbach Et Son Arrondissement
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
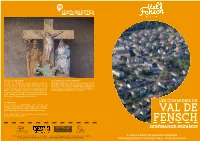
Historiettes
HISTORIETTES LA CROIX D’ERZANGE LES RUINES DU VIEUX CHÂTEAU La croix fut erigée par les erzangeois guéris de Charles de Wendel fit construire son château à la fin la peste (ou du cholera) après avoir bu l’eau de du XIXème siècle. Il devait ressembler à celui de son la fontaine (ou « bonne source »). Elle occupe frère Guy (à Hayange) achevé en 1906. Cependant, l’emplacement de l’ancienne place communale. On il abandonna son projet suite au décès de sa fiancée, peut y voir l’agneau pascal, la vierge à l’enfant, Mlle de Villefranche, dans un incendie. St Martin, patron de l’église de Hayange et Graoully de St Clément en souvenir de l’ancien appartenance d’Erzange à l’abbaye de Ste Glossinde. LE CHANVRE LES COMMUNES DU On trouvait à Serémange une culture de chanvre relativement importante qui remonte vraisemblablement au Moyen-Âge. Ce fut, au XIXème siècle l’une des plus florissantes industries locales. VAL DE NB : début XIXème, on trouvait à Serémange 6 chanvriers et 7 tisserands. FENSCH SERÉMANGE-ERZANGE Rédaction : Val de Fensch Tourisme / Conception : Communauté d’Agglomération du Val de Fensch - 2020 2, RUE DE L’HÔTEL DE VILLE 57700 HAYANGE Crédits photos : Val de Fensch Tourisme, ville de Serémange-Erzange, Raoul Gilibert, 4vents WWW.VALDEFENSCH-TOURISME.COM // + 33 (0)3 82 86 65 30 IL ÉTAIT UNE VILLE LA FENDERIE L’ARCHE DE UNE FOIS SIDÉRURGIQUE La fenderie a été l’une des plus importantes usines LA VIEILLE FORGE de Wendel. Le nom ne se rapporte pas à l’activité du Le hameau de Serémange placé en bordure de la Le destin de la cité s’est vu lié depuis le XVIIème site mais rapppelle une ancienne fabrique où l’on voie romaine Daspich-Fontoy est nommément siècle à celui de la sidérurgie avec l’arrivée de la coupait et fendait le fer. -

LES DÉBUTS DU PUITS WENDEL Au Cours De L'histoire De La Compagnie
LES DÉBUTS DU PUITS WENDEL Au cours de l'histoire de la Compagnie Anonyme des Mines de Houille de Stiring, le fonçage du puits Wendel l, entre 1866 et 1868, marqua une étape importante. Après dix ans d'exploitation à Petite-Rosselle, la compagnie se trouvait confrontée à des difficultés techniques, financières et humaines. La production des puits Saint Charles et Saint Joseph ne répondait pas aux besoins de la Maison de Wendel, principal actionnaire. Pour faire son appoint, elle devait se fournir auprès du Bergamt de Sarrebruck. Les échecs successifs à Stiring-Wendel, les sondages arrêtés dans le val de l'Ursel, les travaux improductifs au puits Sainte Stéphanie, l'irrégularité des couches exploitées et le tracé de la frontière limitant les recherches, ajoutées aux difficultés de recrutement de la main-d'œuvre laissaient apparaître l'avenir de la houillère comme incertain. Pour Charles de Wendel, administrateur délégué de la compa gnie, la solution des différents problèmes passait par une augmen tation de la production. Ce fut Emile Vuillemin, ingénieur-conseil de la société qui orienta, une nouvelle fois, les recherches vers le val de l'Ursel. Le puits de reconnaissance d'Urselsbrunn, commencé le 23 janvier 1862, à une centaine de mètres de l'ancien sondage de Geisenhoff, livra son premier charbon, environ dix tonnes par jour, dès février 1863. En décembre de la même année, Charles Wohlwerth chargé de la direction des travaux proposa d'arrêter la reconnaissance au puits d'Urselsbrunn arrivé à 120 mètres de pro fondeur. A partir de 45 mètres de profondeur, dans un sondage mené jusqu'à 300 mètres, plus aucune couche exploitable n'a été trouvée. -

WENDEL Page 1 Sur 4
Généalogies de WENDEL Page 1 sur 4 WENDEL Le patronyme Wendel est d'origine germanique, il faut alors le rapprocher du verbe wenden, tourner. Wendel signifie alors tourneur. Une ville d'Allemagne, sur la Blies, s'appelle Saint-Wendel. J.N. JEANNEREY fait dériver le nom de Van DAELE. Jean WENDEL vit à Bruges (B) à la fin du XVIème Siècle. Il épouse Marie de WANDERVE[1]. Ils quittent Bruges pour Coblence (D). I - Jean-Georges WENDEL est né le 08.10.1605 à Coblence (D). Il épouse Marguerite de HAMMERSTEIN . Il devient Colonel d'un Régiment de Cravattes[2] sous l'Empereur FERDINAND III. I.1 - Christian WENDEL est né le 23.04.1636 à Coblence (D). Il est Lieutenant dans l'armée de Charles IV de Lorraine. En 1656, il épouse en premières noces Dorothée Agnès JACOB. En 1660, il épouse en secondes noces Claire SAURFELD . Ils ont 9 enfants : 6 filles et 3 fils. I.1.1 - François WENDEL décède le 23.02.1742, sans alliance. I.1.2 - Jean-Martin WENDEL est né le 22.02.1665 à Longlaville (54), domaine amené dans la dot de sa mère. Vers 1700, il épouse Anne-Marie MEYER. Le 26.03.1704, il achète pour 9.621 livres les usines Le Comte à Hayange (57). C'est le début de l'essor industriel de cette famille qui reste toutefois très liée à l'Armée. Jean-Martin achète au Roi de France la seigneurie foncière d'Hayange avec droit de moyenne et basse justices. Le 17.11.1711, il achète la charge de Conseiller Secrétaire du Roi en la Chancellerie du Parlement de Metz. -

La Main-D'œuvre Aux Forges De Stiring-Wendel En 1869
LA MAIN-D'ŒUVRE AUX FORGES DE STIRING-WENDEL EN 1869 Dans l'esprit d'un large public, l'histoire de Stiring-Wendel s'inscrit dans l'aventure charbonnière du bassin houiller. Sa surprise est souvent grande lorsqu'il apprend que la fondation de Stiring Wendel est avant tout liée à la sidérurgie. On ne saurait retracer le passé de la commune sans évoquer ses forges dont les voyageurs apercevaient du train, avant d'arriver à Sarrebruck, les hautes cheminées et les lueurs rougeoyantes. Stiring devint Stiring-Wendel en 1857 par la volonté de Napoléon III, qui considéra la réalisation de la famille de Wendel comme exemplaire. L'importance de l'activité de l'usine et le nécessaire hébergement de son personnel assurèrent à la nouvelle cité son autonomie de commune de plein exercice(1). Aujourd'hui tout ce passé, voué au travail du fer, est oublié. La rapidité de son essor industriel, dont l'expansion se réalisa en moins d'une décennie, peut étonner. Son déclin ensuite constitue un précédent aux reconversions actuelles en mettant déjà en relief, pour l'époque, les inconvénients d'une industrie peu diversifiée. De cette épopée, qui dura un demi-siècle(2), seule demeure à Stiring-Wendel l'appellation « Stade de la vieille usine », nom donné à un terrain de football couvrant une partie de l'emprise au sol des forges(3). L'ancien crassier, attenant à l'usine, a laissé place, depuis quelques années, à l'aménagement d'une zone de verdure et à des installations de loisirs. Espace de travail et de labeur autrefois, le site est devenu de nos jours endroit de détente et de repos. -

Fonds Wendel (1205-1984)
Fonds Wendel (1205-1984) Répertoire numérique (189AQ/1-189AQ/624) Par B. Joly Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1994 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_005740 Cet instrument de recherche a été encodé en 2011 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) Préface Liste des abréviations Liens : Liens annexes : • Liste des abréviations 3 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 189AQ/1-189AQ/624 Niveau de description fonds Intitulé Fonds Wendel Date(s) extrême(s) 1205-1984 Localisation physique Pierrefitte DESCRIPTION Présentation du contenu AVANT-PROPOS Tous les historiens de la sidérurgie française connaissent les archives de la famille Wendel. L'extraordinaire réussite des maîtres de forges lorrains atteint presque au mythe par son ampleur et son ancienneté. Fondée au début du XVIII e siècle et vite remarquée par le pouvoir royal, ruinée par la Révolution et reconstruite avec une ténacité étonnante sous le Premier Empire, à nouveau victime de la guerre en 1870 et partagée entre deux pays par l'annexion d'une partie de la Lorraine, confisquée par l'Allemagne en 1914 et en 1940, l'entreprise Wendel a plus souffert qu'aucune autre firme française des aléas de l'histoire. C'est dire la richesse et l'intérêt de ses archives pour l'histoire économique. On aurait tort, cependant, de penser que ces documents ne doivent solliciter la curiosité que des seuls historiens économistes. -
Paternalisme Et Habitat Dans La Vallée De La Fensch
paternalisme et habitat dans la vallée de la fensch 26 michel printz Le rapport habitat et paternalisme est lié à l’essor de l’industrie sidé- (1) – Frédéric Le Play, la réforme sociale rurgique qui a pris son essor au XIXe siècle. Le grand tournant, en ce en France, Tours, Alfred Mame, 1872, 484 p. qui concerne le développement des cités ouvrières en Moselle par (2) – Adrien Printz, la vallée usinière, exemple, se situe au milieu du siècle. Dans la vallée de la Fensch, ce Florange, Marchal, 1985, 175 p. paternalisme a pendant longtemps été associé à la famille de Wendel. Mais, quand on parcourt cette même vallée, on s’aperçoit que partout où il y a eu créations d’usines ou exploitations de mines, on trouve la présence de logements construits en rapport avec ces exploitations par d’autres maîtres de forge. À Nilvange, des constructions ont été mises en place par des industriels allemands dans le cadre du site de la Paix, puis de la SMK (importantes casernes qui alternent avec de coquettes villas : utilisation du bois, pignons, frontons, décrochements, utilisation du grès rouge). Citons aussi la cité du Haut-Pont à Fontoy, construite par Carl Luege, la cité d’Italie à Uckange, construite par les frères Stumm. À Algrange, une cité ouvrière, rue de Londres, fut également construite par Röchling, à partir de 1914, pour les mineurs de la mine d’Angevillers. La construction de logements ouvriers est au centre de la politique sociale mise en chantier par le paternalisme ; ces théories ont été déve- loppées par Le Play (1) dans son livre La réforme sociale en France, paru en 1872. -

6217 FRENCH HISTORICAL STUDIES 23:4 / Sheet97 of 210 the Original Lorraine Came Into Existence at the Treaty of Verdun in 843, Which Divided the Carolingian Empire
Identity in a Divided Province: The Folklorists of Lorraine, 1860–1960 David Hopkin 6217 FRENCH HISTORICAL STUDIES 23:4 / sheet97 of 210 The original Lorraine came into existence at the Treaty of Verdun in 843, which divided the Carolingian Empire. Its boundaries have been frequently redrawn since then, as the original Middle Kingdom of the Franks was fought over, occupied, and divided by its neighbors, but Lorraine survived, in the reduced form of an independent duchy, al- most until the Revolution.1 However, from the Constituent Assembly’s partition of France into departments in 1790 until after the Second World War, the term Lorraine was only a geographical expression: the four departments of the Moselle, Meuse, Meurthe, and the Vosges had no significant institutions in common.2 Throughout the nineteenth and twentieth centuries some of its inhabitants felt that Lorraine deserved more unity and control over its own actions. Mostly associated with the political right, they ranged from moderate decentralizers to outright autonomists. But they were all agreed that Lorraine was a real entity, and its political claims were merely the recognition of this ‘‘fact.’’ But of what did this Lorraine consist? Even its boundaries were uncertain; historically, the area covered by the four departments was more one of divisions than of unity. The dukes were, from the fifteenth David Hopkin is lecturer in social history at the University of Glasgow. A short version of this article was delivered to the conference of the Association for French Historical Studies in Ottawa, 1998. The author is grateful for the comments from participants at the conference (particularly those of Tony Nuspl and the commentator Robert Schneider), as well as those of the German Historical Studies Group in Cambridge (particularly Chris Clark, Ulinka Rublack, and Brendan Simms) and the anonymous readers for French Historical Studies. -

2 0 0 3 a N N U a L R E P O
2003 ANNUAL REPORT CONTENTS 1 Investing and entrepreneurial spirit 42 HEALTHCARE 2 Message from the Chairman 42 Stallergènes 3 History of the Group 44 bioMérieux 6 Interview with the Chief Executive Officer 46 Silliker 8 Stages in development 10 Board of Directors 47 CORPORATE ORGANIZATION 12 Corporate governance 48 RECENT DEVELOPMENTS 15 Internal control 18 Sustainable development FINANCIAL STATEMENTS 2003 22 Shareholders' review 49 Consolidated financial statements 24 Financial highlights 93 Parent company financial statements 26 Business sectors as of December 31, 2003 ANNUAL SHAREHOLDERS’ 28 INDUSTRY MEETING 28 Legrand 120 Independent auditors’ reports 30 Wheelabrator Allevard 127 Explanation of resolutions 32 Oranje-Nassau 130 Resolutions 34 Valeo 141 SUPPLEMENTAL INFORMATION 35 SERVICES 35 Capgemini 36 Bureau Veritas 38 Trader Classified Media 40 Neuf Telecom 41 Other corporate holdings 2003 Annual Report • WENDEL Investissement 1 INVESTING AND ENTREPRENEURIAL SPIRIT WENDEL Investissement was created to invest in companies active in the industrial and service sectors, and to help them become international leaders by fostering their development. WENDEL Investissement is a full-fledged industrial and financial partner – it supports entrepreneurial teams by monitoring operations on a regular basis, helps define ambitious strategies, and provides the financing needed to ensure the success of the companies in which it has invested. WENDEL Investissement invests in a relatively limited number of significant equity holdings in industry (products and systems for electrical installations, automotive components and systems, industrial abrasives, oil exploration and real estate), services (conformity assessment and certification, classified advertising and multimedia services, IT services and consulting, telecommunications), and healthcare (medical diagnostics, food quality testing, allergy laboratory). -

Albert De L'espée
Christophe Luraschi ALBERT DE L’ESPÉE (1852-1918) DU MÊME AUTEUR Le Château d’Ilbarritz, éditions Pyrénéennes, 1982. Le Biarritz des Goélands, Biographie de P.-B. Gheusi, éditions Atlantica, 2002. Conrad-Alexandre Gérard (1729-1790). Artisan de l’Indépendance américaine, éditions Séguier, 2008. Couverture : Élodie Boisse Mise en page : Caroline Viollier ISBN : 978-2-7588-0482-6 © atlantica, Biarritz, 2013 Atlantica : 18, allée Marie-Politzer – 64200 Biarritz 05 59 52 84 00 – [email protected] Paris : 3, rue Séguier – 75006 Paris Catalogue en ligne : www.atlantica.fr 5 Avant-propos Quinze années se sont écoulées depuis la première édition de cette biographie du baron Albert de L’Espée. Je pensais alors que la publi cation de cet ouvrage mettrait un terme à de longues années de recherches consacrées à celui qui avait hanté ma jeunesse. L’environ- nement qui était alors le mien, le château d’Ilbarritz, avait tout natu- rellement poussé ma curiosité à mettre au jour l’existence de celui qui avait commandé les plans de la maison que j’habitais. Hélas, le fameux baron n’avait rien laissé de lui et son nom me semblait échappé d’un vieux conte ou d’un roman oublié. J’avais 14 ans lorsque j’entrepris mes premières recherches. Partant pour ainsi dire de rien, mis sur ses traces par quelques rares écrits de P.-B. Gheusi, j’allais désormais consacrer mes temps libres, mes lectures, mes déplacements à la poursuite de témoignages, à la chasse aux documents, à la découverte d’autres lieux qui me permettraient peut-être de mieux pénétrer la personnalité de celui qui avait décidé de l’étrange demeure qui me servait de toit. -

Thionville Sous L'annexion (1870-1914)
Thionville sous l'annexion (1870-1914) Comme toutes les villes de la Lorraine mosellane, Thionville conserve l'empreinte de l'annexion à l'Empire allemand(1). Les arbres des places, des avenues et des promenades de la Moselle ont grandi, les immeubles flambants neufs de style germanique qui surprirent tant les Français se sont depuis longtemps fondus dans un ensemble et sont deve nus si familiers aux Thionvillois qu'il faut le regard du visiteur pour rele ver ce qu'un état et une culture ont apporté au patrimoine urbain. Au demeurant cette annexion longue d'un demi-siècle, a laissé dans le corps social des traces qui, aujourd'hui encore, ne sont pas cicatrisées en pro fondeur ; il faut un temps d'écoute et d'observation pour les repérer, un temps plus long encore à l'historien pour les analyser dans leur contexte. A deux reprises le tissu social de cette ville a été désagrégé par le départ de nombreux habitants. En 1870-1871, beaucoup ont émigré pour rester des Français ; en 1918-1919, d'autres ont été expulsés parce qu'ils étaient des Allemands. Nous nous proposons d'éclairer ce problème majeur de l'histoire sociale afin d'ouvrir la voie à des recherches plus fondamenta les. 1-Le coût d'une défaite Le 24 novembre 1870, après trois jours de bombardement et plus de trois mois de siège, la garnison française de Thionville doit hisser le dra peau blanc ; les troupes prussiennes entrent dans une ville partiellement incendiée et dans les mois qui suivent, se prépare l'annexion à l'Empire allemand que consacre légalement la signature du traité de Francfort (10 mai 1871). -
Dossier De Presse Sommaire 4 Historique
PATRIMOINE RESTAURATION DU COLOMBIER DES GRILLES D’ENCEINTE ET DU PORTAIL DU DOMAINE DE WENDEL 10 RUE DE WENDEL - HAYANGE DOSSIER DE PRESSE SOMMAIRE 4 HISTORIQUE 6 LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE MECENAT 14 EVENEMENTIEL 18 GESTION DES SOUSCRIPTIONS 22 LES SOUTIENS FINANCIERS 24 L’ECHO DES MEDIAS 30 LES PHOTOS DU CHANTIER 59 LES ENTREPRISES 2 - RESTAURATION DU COLOMBIER - RESTAURATION DU COLOMBIER. - 3 LE COLOMBIER HISTORIQUE Classé aujourd’hui monument historique, ce colombier a la particularité d’être surmonté d’une toiture d’ardoise très élaborée. Bien que portant la date de 1767, cet édifice LE DOMAINE DE WENDEL serait bien plus ancien que les chiffres en fer forgé qui y sont apposés. L’histoire de la famille de Wendel s’est conjuguée, des siècles durant, avec celle de la L’histoire du colombier regorge de mystère et Lorraine et tout particulièrement de la vallée de la Fensch. d’interrogations : est-ce un vrai ou faux colom- Situé sur le banc communal de la ville de Hayange, l’ancien domaine de la famille de Wendel, bier ? Date t -il du XVIIIème ou XXème siècle ? devenu en 2002 propriété de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF), se compose du “Bureau Central”, des deux ailes du château de famille, restaurées aujourd’hui et devenues le siège de la CAVF, de la chapelle, du parc du château et de son colombier. LA RESTAURATION L’aile est du château Au vu de l’état des différents éléments En 1704 Jean-Martin Wendel, officier de patrimoniaux, leur rénovation s’avèrait ur- Louis XV et régisseur des forges d’Ottange, gente. -

A Propos Des De Wendel
A PROPOS DES DE WENDEL ... A l'heure où la sidérurgie lorraine traverse une crise consi dérable et où disparaît «des portails des usines � le nom même de la famille qui fut,· deux siècles durant, synonyme de cette même sidérurgie, paraissent deux ouvrages consacrés aux de Wendel, qui analysent ce que fut leur rôle politique, économique, social et financier. JEANNENEY (Jean-Noël), François de Wendel en République. L'argent et le pouvoir (1 914-1 940), Paris, le Seuil, 1976, 6070 p. La thèse de J.-N. Jeanneney doit ses sources principales à une documentation d'une grande richesse : les papiers de François de Wendel, et, en particulier, son «Journal » (19.06-1949) qui a servi de fil directeur de «valeur inappréciable ». L'auteur a pu également utiliser les archives de Louis Marin, ce député lorrain, président de la «Fédération républicaine de France », le grand parti modéré d'alors, les archives de cette même fédération, et de nombreux autres papiers privés. Ce travail sur le grand sidérurgiste lorrain est en fait axé sur le rôle politique du personnage, et ce, au niveau national. On n'y trouvera donc ni une biographie complète, ni une étude de l'action du gérant de l'entreprise sidérurgique. J.-N. Jeanneney n'a pas étudié l'histoire de la «Maison de Wendel », ni, à travers elle, cene de la sidérurgie lorraine de 1914 à 1940. Seules quelques indications fixent ici les idées essentielles. On trouvera néanmoins de très utiles développements en particulier sur la «Maison » et la sidérurgie française de 1914 à 1918. C'est donc le rôle politique, au sens le plus large, du député, puis sénateur de Meurthe-et-Moselle qu'envisage l'ouvrage, et surtout, comme l'indique le sous-titre, les interférences de ce rôle politique avec ceux, non seulement de sidérurgiste et de président du Comité des Forges, mais encore de régent de la Banque de France et de maître du «Journal des Débats ».